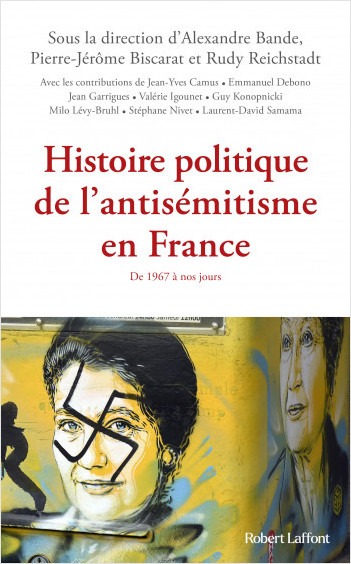Le pacifisme et l’Allemagne coupable…
Appel des mutilés et des combattants du Loiret, 29 octobre 1922
« Fête nationale du 11 novembre
Appel au Peuple
Citoyens !
Les Hommes de la Guerre veulent célébrer le 11 novembre.
Le 11 novembre 1918 marque la fin de la plus épouvantable tuerie qui ait désolé la monde moderne. Pendant cinquante-deux mois, des peuples entiers se sont affrontés sur d’immenses champs de bataille. Quarante millions d’hommes se sont battus. Six millions ont été tués. Quinze millions ont été blessés. Des régions populeuses et riches ont été ravagées ; il faudra un quart de siècle pour les ramener à la vie.
C’est l’Allemagne qui portera devant l’histoire la responsabilité du sang versé et des ruines accumulées. C’est l’Allemagne impérialiste, pangermaniste et militariste qui a voulu cette guerre, qui l’a déclarée et qui l’a poursuivie par les moyens les plus criminels.
La France républicaine et pacifique s’est battue pour la justice, pour la liberté, pour le droit. Les Hommes de la Guerre se sont battus contre l’impérialisme, contre le militarisme : ils ont fait la guerre à la guerre. Sept millions et demi de Français ont porté leur vie sur les champs de bataille ! un million cinq cent mille sont morts ! Un million sont incurablement mutilés ! Huit cent mille enfants n’ont plus de père ! Sept cent mille femmes n’ont plus de mari
Citoyens !
Les Hommes de la Guerre veulent que leur victoire consacre l’écrasement de la guerre !
Ils veulent que l’Allemagne coupable paye la guerre qu’elle a déchaînée ! Ils veulent que la France victorieuse demeure la Patrie du Droit et le Soldat de la Paix. Ils veulent qu’à l’anarchie entre les peuples soit substitué le règne du droit entre les nations.
Hommes de la Guerre, en mémoire des luttes géantes que nous avons soutenues ; au nom de nos frères morts, nous sommes les serviteurs pacifiques de la Société des Nations.
Citoyens !
Avec les Hommes de la Guerre, soyez les Hommes de la Paix.
Le 11 novembre, jour de la Victoire, jour de nos souvenirs, jour de nos deuils, jour de nos espoirs, avec nous sachez vouloir d’un seul cœur :
Liberté, Justice, Paix entre les citoyens ! Justice pour la France ! Paix dans le monde ! »
Souvenirs traumatiques et Récits. Pacifisme des années 1930
« Il y avait toujours une trêve du petit matin, à l’heure où la terre sue sa fumée naturelle. La rosée brillait sur la capote des morts. Le vent de l’aube, léger et vert, s’en allait droit devant lui. Des bêtes d’eau pataugeaient au fond des trous d’obus. Des rats, aux yeux rouges, marchaient doucement le long de la tranchée. On avait enlevé de là-dessus toute la vie, sauf celle des rats et des vers. Il n’y avait plus d’arbres et plus d’herbe, plus de grands sillons, et les coteaux n’étaient que des os de craie, tout décharnés. Ça fumait doucement quand même du brouillard dans le matin.
On entendait passer le silence avec son petit crépitement électrique. Les morts avaient la figure dans la boue, ou bien ils émergeaient des trous, paisibles, les mains posées sur le rebord, la tête couchée sur le bras. Les rats venaient les renifler. Ils sautaient d’un mort à l’autre. Ils choisissaient d’abord les jeunes sans barbe sur les joues. Ils reniflaient la joue puis ils se mettaient en boule et ils commençaient à manger cette chair d’entre le nez et la bouche, puis le bord des lèvres, puis la pomme verte de la joue. De temps en temps ils se passaient la patte dans les moustaches pour se faire propres. Pour les yeux, ils les sortaient à petits coups de griffes, et ils léchaient le trou des paupières, puis ils mordaient dans l’oeil, comme dans un petit œuf, et ils le mâchaient doucement, la bouche de côté en humant le jus.
Quand l’aube n’était pas encore bien débarrassée, les corbeaux arrivaient à larges coups d’ailes tranquilles. Ils cherchaient le long des pistes et des chemins les gros chevaux renversés. A côté de ces chevaux, aux ventres éclatés comme des fleurs de câprier, des voitures et des canons culbutés mêlaient la ferraille et le pain, la viande de ravitaillement encore entortillée dans son pansement de gaze et les baguettes jaunes de la poudre à canon.
Ils s’en allaient aussi sur leurs ailes noires jusqu’au carrefour des petits boyaux, à l’endroit où il fallait sortir pour traverser la route. Là, toutes les corvées de la nuit laissaient des hommes. Ils étaient étendus, le seau de la soupe renversé dans leurs jambes, dans un mortier de sang et de vin. Le pain même qu’ils portaient était crevé des déchirures du fer et des balles, et on voyait sa mie humide et rouge gonflée du jus de l’homme comme des bouts de miche qu’on trempe dans le vin pour se faire bon estomac au temps des moissons. Les corbeaux mangeaient au pain et en même temps ils le vendangeaient de leurs griffes en sautant d’une patte sur l’autre. De là ils s’en venaient jusqu’à pousser de la tête le casque du mort. C’étaient des morts frais, des fois tièdes et juste un peu blêmes. Le corbeau poussait le casque; parfois, quand le mort était mal placé et qu’il mordait la terre à pleine bouche, le corbeau tirait sur les cheveux et sur la barbe tant qu’il n’avait pas mis à l’air cette partie du cou où est le partage de la barbe et du poil de poitrine. C’était là tendre et tout frais, le sang rouge y faisait encore la petite boule. Ils se mettaient à becqueter là, tout de suite, à arracher cette peau, puis ils mangeaient gravement en criant de temps en temps pour appeler les femelles.
Les morts bougeaient. Les nerfs se tendaient dans la raideur des chairs pourries et un bras se levait lentement dans l’aube. Il restait là, dressant vers le ciel sa main noire toute épanouie; les ventres trop gonflés éclataient et l’homme se tordait dans la terre, tremblant de toutes ses ficelles relâchées. Il reprenait une parcelle de vie. Il ondulait des épaules comme dans sa marche d’avant. Il ondulait des épaules, comme à son habitude d’avant quand sa femme le reconnaissait au milieu des autres, à sa façon de marcher. Et les rats s’en allaient de lui. Mais, ça n’était plus son esprit de vie qui faisait onduler ses épaules, seulement la mécanique de la mort, et au bout d’un peu, il retombait immobile dans la boue. Alors les rats revenaient.
La terre même s’essayait à des gestes moins lents avec sa grande pâture de fumier. Elle palpitait comme un lait qui va bouillir. Le monde, trop engraissé de chair et de sang, haletait dans sa grande force. Au milieu des grosses vagues du bouleversement, une vague vivante se gonflait; puis, l’apostume se fendait comme une croûte de pain. Cela venait de ces poches où tant d’hommes étaient enfouis. La pâte de chair, de drap, de cuir, de sang et d’os levait. La force de la pourriture faisait éclater l’écorce. Et les mères corbeaux claquaient du bec avec inquiétude dans les nids de draps verts et bleus, et les rats dressaient les oreilles dans leurs trous achaudis de cheveux et de barbes d’hommes. De grosses boules de vers gras et blancs roulaient dans l’éboulement des talus.
En même temps que le jour, montait des au-delà du désert le roulement sourd d’un grand charroi. C’étaient ces fleuves d’hommes, de chars, de canons, de camions, de charrettes qui clapotaient là-bas dans le creux des coteaux : les grands chargements de viande, la nourriture de la terre.
Mais le jour traînait longtemps avant de monter. D’abord, de l’horizon déchiré, un liséré de lumière dépassait, puis un feu pâle glissait entre les nuages, coulait comme de l’eau, dans les détours des tranchées, C’était tout. Ça se diluait dans le vaste espace du ciel et de la terre, et ça restait, comme ça, couleur de vieille paille grise. C’était le jour. »
Jean Giono, Le Grand troupeau, chap. 9, Gallimard, 1931