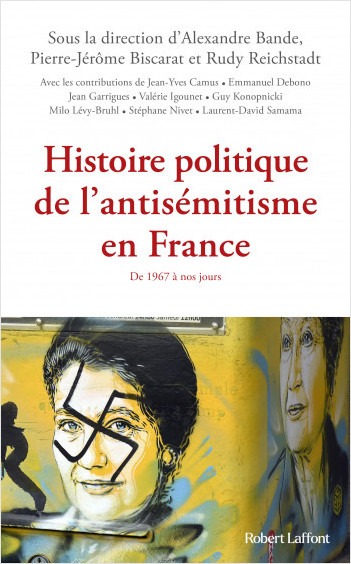Daniel DEFOE, Robinson Crusoé,
Folio classique, 1996, pp.7-42
Préface
de Michel BARIDON (extraits)

Robinson Crusoé est un livre comme il y en a peu. C’est un classique, traduit dans presque toutes les langues y compris le copte et l’esquimau, et tout classique qu’il est, il se lit par plaisir. Les enfants le découvrent très vite en version abrégée et les adultes, sans doute en raison du souvenir qu’ils en ont gardé, l’associent aux joies du plein air. Paris a son « Robinson », jadis rendez-vous de canotiers dans la vallée de Chevreuse. Dans un style moins bucolique, les universitaires glosent sur cette histoire d’homme seul et lui font une place parmi les grandes oeuvres. Mais Robinson Crusoé ne se laisse pas enfoncer dans le passé. Un siècle et demi après sa première publication, Offenbach en a tiré un opéra et Marx le substantif robinsonnade, passé depuis longtemps dans le vocabulaire des littéraires et des économistes. Et voici que de notre temps le Sud africain Coetzee en fait une lecture tiers-mondiste, et que Michel Tournier promeut au rang de personnage principal Vendredi, le brillant second qui méritait mieux. Vraiment, il n’est pas facile de trouver succès plus total et réputation plus vivante.
Pourtant, on ne trouve dans ce livre ni grandes passions, ni crimes, ni larmes, ni éclats de rire. Nous sommes ici très loin de Tolstoï, de Balzac ou de Dickens. Defoe nous conte l’histoire d’un homme modeste, besogneux, seul par nécessité, vertueux par inclination, volontiers prêcheur, et qui aurait toutes les chances d’être ennuyeux s’il n’avait eu des aventures, de bien curieuses aventures. Du moins, c’est ce que dit le titre : La Vie et les Aventures étranges et surprenantes de Robinson Crusoé, marin natif de York, qui vécut vingt-huit ans tout seul sur une île déserte de la côte de l’Amérique près de l’embouchure du fleuve Orénoque, après avoir été jeté à la côte au cours d’un naufrage dont il fut le seul survivant et ce qui lui advint quand il fut mystérieusement délivré par des pirates. Plus bas, barrant la page entre deux traits horizontaux, on peut lire la mention Écrit par lui-même.
Il faut prêter attention à ce titre – programme car il explique beaucoup de choses. Il annonce à son de trompe une histoire vraie, celle d’un marin qui raconte tout : son naufrage, sa vie sur une île déserte, et qui l’en a tiré. Cet homme simple semble ne pas pouvoir mentir puisqu’il dit où il est né, où c’est arrivé, pendant combien de temps, et puisque son aventure le surprend lui-même. Tout est forcément vrai. Pourtant rien n’est véridique. Robinson Crusoé n’a jamais existé. Le vrai auteur c’est Defoe, né à Londres. Il n’a rien du loup de mer et tout de l’homme de plume. Son héros part pour les tropiques et reste seul devant l’océan pendant vingt-huit ans. Lui part d’un fait divers et reste seul devant son encrier mais juste le temps de jeter sur le papier une histoire qu’il veut vendre. Ce titre est donc une bande publicitaire qui cherche à attirer la curiosité du passant pour forcer sa poche. Profitant de cette percée initiale, Defoe va faire du client un lecteur. Il n’a pas plus tôt pris son argent, qu’il parasite son imagination.
Pour y parvenir, il utilise un épisode du vécu collectif une histoire dont on avait parlé dans la presse, et il en fait l’aventure de chacun par un petit tour de sa façon: il se fabrique un masque de marin, il lui donne sa voix, qu’il déguise, et d’entrée de jeu, il raconte en direct l’histoire d’un naufragé qui a réinventé la civilisation à lui seul. Étrange et surprenante aventure, en vérité. On pourrait même crier à la galéjade pour peu qu’on ait une once de sens critique. Mais sens critique ou pas, le lecteur est pris. Il écoute cette voix qui triomphe de tout, qui s’infiltre dans tous les milieux et dans toutes les langues au fil des générations. Ce prodige, le critique doit l’expliquer, et la seule voie qu’il puisse emprunter est celle du succès que ce livre a connu dès sa sortie des presses de William Taylor « à l’enseigne du Navire dans Paternoster Row ». C’est ensuite de s’élever au-dessus des circonstances historiques de sa composition pour suivre son ascension, son étrange et surprenante ascension, vers le zénith où il a rejoint les classiques du patrimoine mondial. Robinson Crusoé est à la fois un livre-témoin et un livre-mythe.
UN LIVRE – TÉMOIN
Né de la rencontre d’un homme et d’une époque, d’un créateur et d’un public, Robinson Crusoé exprime les idées, les aspirations et les craintes des lecteurs qui l’ont découvert. Pour comprendre les raisons de son succès, il faut reconstituer son écologie, rendre vie aux problèmes et aux rêves de la foule anonyme qui s’y est reconnue. Il faut montrer en même temps comment Defoe a grandi, vécu, dans cette masse en mouvement, captant la rumeur d’idées et de mots qui marchait avec elle, et lui donnant forme par le récit d’un homme à la fois proche de ses semblables et loin d’eux. S’il a déguisé sa voix, c’est pour l’ajuster à l’écoute d’un public dont il pressentait les réactions. Sa propre histoire explique pourquoi il y est si bien parvenu.
Daniel Foe, car tel est son vrai nom, est né dans une famille de boutiquiers de la Cité de Londres, en 1660. Il semblait destiné à se retrouver lui aussi derrière un comptoir ou à devenir pasteur, mais quand les événements politiques vont vite, les traditions familiales ne pèsent pas lourd pour des hommes de son genre. Il vient au monde l’année même où Charles II rentre dans sa capitale après un exil de neuf ans. Le parti puritain est vaincu et les Foe ne s’en réjouissent guère. Leurs sympathies vont aux presbytériens qui ont longtemps constitué l’aile modérée du puritanisme. Être presbytérien, cela signifiait que l’on était contre le pouvoir de l’Église établie, l’Église anglicane, à qui l’on reprochait ses cérémonies, sa hiérarchie proche de l’Église catholique et sa compromission avec le pouvoir royal considéré comme corrompu. Cela signifiait aussi que l’on scrutait le texte des Écritures et que l’on s’administrait soi-même sous la conduite des « aînés » ou « anciens » en formant de petites communautés où on s’édifiait les uns les autres (Vendredi en saura quelque chose). Cela signifiait enfin que l’on était résolument hostile à l’Espagne et la France, championnes d’un catholicisme monolithique et rivales de toujours sur l’Atlantique.
Ces problèmes religieux avaient un retentissement politique direct. S’en prendre à l’Église anglicane, c’était mettre en question toute la structure de la vieille Angleterre terrienne. Cette Angleterre-là, le négoce ne parvenait à y entrer qu’en achetant des domaines pour se donner de la respectabilité. Sa force venait d’ailleurs, par voie de mer surtout, depuis que la Réforme, en affirmant l’indépendance de l’Angleterre vis-à-vis de la Papauté et du monde méditerranéen, en avait fait la citadelle avancée du bloc protestant qui s’était formé autour de la Baltique et de la mer du Nord. Londres occupait une place stratégique, au débouché du Pas de Calais où passaient tous les navires allemands, suédois ou hollandais qui partaient chercher fortune sur l’Atlantique. Defoe fait peut-être naître son héros à York, mais ses rêves à lui, le Londonien, sont ceux d’un enfant qui a suivi le va-et-vient des navires et entendu des histoires de galions et d’îles perdues.
Pendant la période de la Restauration (1660-1688) qui fut celle de sa jeunesse, la flotte marchande se développe et le pouvoir du négoce s’accroît, créant de nouvelles tensions entre le roi et le Parlement. Ces tensions, il les vit intensément. Très vite, il connaît le poids d’un pouvoir hostile à ses idées. Pas question pour lui d’entrer dans l’une des deux universités ; elles sont réservées aux anglicans. Il fréquentera donc – et il n’y perdra rien – l’académie Morton, où enseignent des dissidents puisque tel est le nouveau nom des ex-puritains. Morton, qui deviendra l’un des fondateurs de Harvard, axe l’enseignement sur la navigation, la comptabilité, la géographie et les sciences de la nature. Defoe est bien armé pour la carrière de marchand qu’il commence alors. Il se marie en 1684.
Pourtant, en 1685, il abandonne une voie toute tracée et se jette dans la lutte armée pour empêcher l’arrivée du catholique Jacques II sur le trône. Il échappe à la terrible répression qui suit la défaite de Sedgemoor mais il a tremblé pour sa vie et restera marqué par la peur. Trois ans plus tard, il a sa revanche. Jacques II doit fuir en France et Guillaume d’Orange, hollandais et calviniste, fait son entrée à Londres. Defoe fait partie de son cortège.
Cette « glorieuse révolution » opère de grandes transformations. Le nouveau roi, Guillaume III, accepte le contrôle du Parlement. La couronne renonce à certains de ses monopoles, les compagnies coloniales se démocratisent, les dissidents reçoivent la liberté du culte. Avec la levée de la censure, le commerce des livres devient aussi florissant qu’en Hollande, et la presse se développe en se faisant directement l’écho de la lutte entre les deux partis qui divisent la classe politique : les tories, isolationnistes en politique, liés au conservatisme anglican, et les whigs, partisans de l’expansion outre-mer et favorables au compromis avec les dissidents.
Defoe exploite toutes les possibilités qui s’offrent. Il tente sa chance dans les affaires et, pour défendre le roi en lutte contre Louis XIV il fait du journalisme. Il y réussit bien et on le lit dans les milieux du négoce favorables aux whigs. Cela lui vaut de se faufiler dans les allées du pouvoir, mais en passant par la petite porte, car il ne fait pas partie des élites traditionnelles. Cette petite porte va se refermer sur lui dans des circonstances assez mystérieuses. Ruiné par des spéculations malheureuses dans les assurances maritimes, il est menacé de la prison pour dettes et le voici condamné à écrire, écrire sans relâche et à mettre sa plume au service des gens en place. De plus, il perd son grand homme quand Guillaume III meurt d’une chute de cheval en 1702.
La reine Anne qui lui succède est favorable aux tories. Une crise survient quand ces derniers s’en prennent de nouveau aux dissidents. Defoe lance une provocation: dans un pamphlet, Comment en finir avec les dissidents, il propose la solution finale, le massacre général. Il espère créer un choc dans l’opinion mais il a mal calculé son coup et se retrouve au pilori, puni comme un voleur, exposé aux trognons de choux et même aux pierres du premier passant. Heureusement, et c’est un triomphe personnel, il en sort sans mal, mais c’est pour entrer à Newgate, la prison dont il parle dans Moll Flanders. Libéré, il se retrouve dans une semi-clandestinité, acceptant de servir Harley, un ex-whig passé aux tories mais dont il se sent proche parce qu’ils ont en commun une éducation puritaine. Nous le retrouvons à Glasgow, en agent secret qui guette les réactions locales au traité d’union avec l’Écosse. Il vit sous un faux nom, écoute les conversations et mystifie les gens pour mieux les épier. Cela lui servira dans ses romans où il manie avec brio la caméra indiscrète. En attendant, il essaie de se remettre à flot après son naufrage financier; il se bat seul, rembourse une partie de ses dettes et lance un journal, The Review, qu’il orchestre pendant neuf ans, apprenant l’art de mettre sous influence un public important.
Bientôt, c’est de nouveau la peur. La reine, malade, n’a pas d’héritier et le choix de son successeur fait monter la tension. Defoe est remis en prison mais Anne morte, c’est à nouveau un prince protestant, allemand cette fois et venu du Hanovre, qui s’installe sur le trône (1714) sous le nom de George Ier. Commence alors la dernière période de la vie de Defoe. Son rôle politique est plus clair, la pression politique désormais moins sensible. Il n’a plus que ses créanciers pour ennemis et il les tient en respect par la plume.
C’est en effet un phénomène nouveau en Angleterre que celui d’un homme de lettres qui vit de ce qu’il vend. Jusque-là, quand il n ëavait pas de moyens personnels, l’écrivain cherchait un mécène. Il pouvait aussi écrire pour le théâtre ou entrer dans l’Église anglicane et vivre en intellectuel fonctionnarisé. Aucune de ces voies n’était ouverte à Defoe : il était trop indépendant, trop hostile au théâtre par tradition familiale, et quant à l’Église anglicane… Il va donc tenter sa chance sur le grand marché du livre et du journal qui s’est créé depuis que le pouvoir a libéralisé la circulation des idées. On le voit serrer l’actualité dans des pamphlets comme Considérations de l’état présent de la Grande-Bretagne (1717) ou Miserere Clerici ou les Factions de l’Église (1718), etc.; il écrit aussi sur des questions économiques (Une mine d’or ouverte au profit des Hollandais, 1718) ou fait de la compilation en écrivant une Histoire des guerres de Charles XII (1715). Tout d’un coup, il ajoute à cette production très diverse sa première longue oeuvre de fiction, Robinson Crusoé (1719), qui marque un tournant dans sa carrière.
Il a frappé un grand coup. Son livre se vend vite et bien: quatre éditions dès la première année, et bientôt des traductions en français, allemand, hollandais. Mais la propriété littéraire n’est pas encore vraiment protégée et il faut s’accommoder d’éditions courtées ou piratées. Defoe proteste mais il n’a pas le choix. Il continue donc à exploiter les filons du moment : l’actualité politico-économique, le mirage de l’horizon colonial, les traités de morale pratique : La Grande Loi de la subordination ou l’Insolence des domestiques (1724), Le Parfait Commerçant anglais (1725), Le Nouveau Conseiller de la famille (1727), Projets pour le commerce anglais (1728). Et voici que de nouveau, il ajoute à cette littérature qui l’a toujours nourri, une série d’oeuvres de fiction qui font de lui le fondateur du roman moderne. Paraissent successivement : Fortunes et Infortunes de la célèbre Moll Flanders d’après ses propres mémoires et L’Histoire et la Vie remarquable du vraiment honorable Col. Jacque, connu sous le nom de Col. Jack (1722), La Maîtresse fortunée ou l’Histoire de la vie mouvementée de Mademoiselle de Beleau, devenue comtesse de Wintelsheim, en Allemagne, connue par ailleurs sous le nom de lady Roxana, au temps de Charles II (1724). Defoe achève cette brillante série alors qu’il a soixante-quatre ans, un grand âge pour l’époque. Il va vivre encore sept ans, toujours occupé à écrire, écrire encore, jusqu’a ce que la mort le surprenne dans un logis d’emprunt où il fuyait ses créanciers. S’est-il jamais douté qu’il serait un jour célèbre grâce à ces histoires étranges et surprenantes d’hommes et de femmes du commun ? Nul ne le sait. Une chose paraît certaine : avec le succès de Robinson Crusoé, il a senti qu’il tenait une formule appréciée du public : il avait tant écrit pour conseiller les autres qu’il se sentait capable en vieillissant de leur donner aussi le rêve qu’ils attendaient.
En 1719, en Angleterre, ce rêve avait souvent les couleurs des mers chaudes. Pour une nation relativement petite (cinq millions et demi d’habitants contre plus de vingt en France), c’était une grande victoire que le traité d’Utrecht imposé à Louis XIV. Elle y gagnait le droit de faire le commerce des esclaves entre l’Afrique et l’Amérique du Sud, enfonçant un coin dans les anciens empires coloniaux. Defoe en était très conscient. Même si des lézardes se dessinaient dans l’édifice hâtivement construit de la Compagnie des Mers du Sud, l’idée d’empire était dans l’air. On en parlait dans les coffee-houses et dans les clubs. On en discutait en lisant les journaux et plus d’un se sentait partagé entre la peur de l’inconnu et l’appel de l’aventure.
C’est dans ce contexte que Defoe apparaît comme l’homme de la situation. Il sent que la fiction a besoin d’un décor et il sait que le public apprécie par-dessus tout un beau conflit moral. Le décor, il le tient; le conflit, il l’a vécu dans sa jeunesse à l’époque où son père voulait le maintenir dans le petit commerce ou en faire un pasteur. Il rêvait, lui, d’autre chose: de grosses affaires, de l’industrie naissante et, plus tard, de fortunes faites sur les mers. Ce conflit était mal vécu dans les milieux où il avait grandi. On y était très critique du luxe de la monarchie et des riches (voir Roxana) mais en même temps on espérait accéder au monde des armateurs, ces traders at sea que Gregory King situe très haut dans l’échelle sociale. C’est ce qu’a très bien vu Bayle quand il dit que la Hollande calviniste était déchirée entre la religion et le commerce et que l’argent l’emportait toujours parce que « la marchandise attire tout à elle ». La religion des dissidents ne leur interdisait pas de gagner de l’argent, elle leur permettait même le prêt à intérêt, mais elle craignait pour la morale de ceux qui allaient trop vite en besogne : ils risquaient de se laisser aller aux tentations que la fortune fait naître. Defoe a dit dans The Review (11 juin 1713) que le commerce était « une garce » qui lui avait fait perdre la tête. C’est dire combien a pu peser sur lui le jugement de ses aînés car dans toute communauté qui discute ouvertement de ses valeurs morales, les plus aventureux se font toujours chapitrer.
Tout cela, il se le rappelait d’autant mieux qu’il arrivait à l’âge où les souvenirs de jeunesse prennent une intensité lancinante. On n’a peut-être pas assez souligné que Robinson Crusoé est de la génération du père de Defoe: il quitte sa famille en 1651 et rentre en Angleterre définitivement en 1705. Moll Flanders, elle, écrit sa confession en 1683 tandis que Roxana dit avoir vécu « à l’époque de Charles II » (1660-1685). En outre, le Journal de l’année de la peste, écrit en 1722, est présenté comme un témoignage vécu de la grande épidémie de 1665. Dans sa vieillesse, une fois de plus, Defoe menait donc une double vie : très attentif à l’actualité politique dont il nourrissait ses pamphlets, ses traités de morale pratique et ses vies de pirates célèbres, il retournait à sa jeunesse pour construire le monde de sa fiction.
Ne nous étonnons donc pas que la figure du père apparaisse au seuil de Robinson Crusoé. Defoe a dû la voir plus d’une fois se dresser devant lui, muette et impérieuse comme les Tables de la Loi, surtout lors de sa retentissante faillite, de ses emprisonnements ou quand il flattait les goûts du public pour le scandale ou pour ces histoires de hors-la-loi ou de femmes qu’on dit de mauvaise vie mais qui l’ont finalement assez bonne. Tout cela c’est l’attrait du fruit défendu, toujours puissant chez un puritain doué d’une imagination vive et même violente. Defoe le caresse juste assez pour susciter ce sentiment trouble que nous éprouvons quand nous voyons quelqu’un d’autre y céder sans rien risquer nous-mêmes. C’est en cela qu’il est le grand ancêtre de la fiction moderne. Il a découvert que le romancier est le constructeur d’un monde plausible où son lecteur le suit pour devenir un autre, mais pour un temps seulement. Donnant, donnant. Contre de l’argent, il vend au lecteur quelques heures de voyeurisme licite et la douceur de s’offrir une aventure sans risque par le malheur d’autrui.