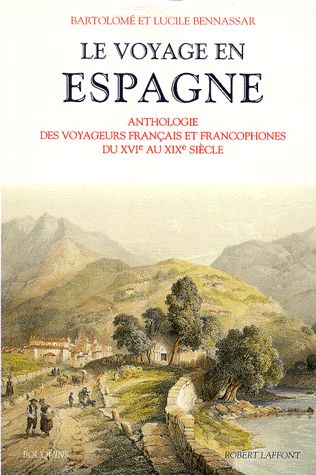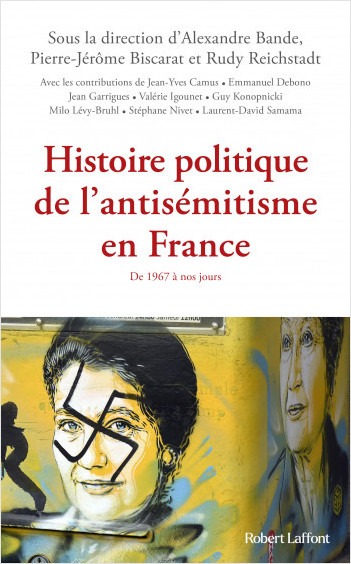Le soutien ottoman à la révolte des morisques de Grenade (1570)
Firman adressé à la population d’Andalousie par le grand vizir Mehmed Sokolli de la part du sultan Sélim II :
« Vous nous avez adressé une pétition dans laquelle vous relater comment les infidèles, aux rites trompeurs, égarés hors du bon chemin, se liguent contre les musulmans, les empêchant de parler l’arabe, imposant à leurs épouses des charges contraires à la loi coranique, se rendant coupables envers eux d’injustice et d’oppression. En ce moment 20’000 [de ces musulmans] se trouvent [au combat] ; mais 100’000 de ces hommes n’ont pas encore d’armes et ceci est confirmé et établi. Dans le cas où cette quantité d’armes arriverait d’Alger il en résulterait un affermissement de la volonté et du moral de la population pour combattre.
Vous nous dites que vous avez infligé de nombreuses défaites aux maudits infidèles, que Dieu soit remercié d’avoir apporté des victoires pour la population musulmane contre les infidèles égarés. Tout ce qui est arrivé et que vous avez détaillé dans votre pétition est parvenu à la connaissance de notre Sultan qui ne cesse de vous manifester, toujours, son intérêt et son affection.
Ceci dit, à cette époque-ci, à proximité de nos provinces se trouve l’île de Chypre avec qui, grâce à mes majestueux ancêtres, depuis fort longtemps, est conclu un traité de paix ; mais les infidèles de l’île ont violé le traité par leurs attaques et leurs agressions contre les populations musulmans et l’ensemble des commerçants qui désirent se rendre aux Lieux Saints pour faire le pèlerinage ; les infidèles, en cela, confirment leur dessein d’agressivité.
Ainsi nous nous sommes confiés à Dieu et avons imploré son aide, celle de notre Prophète et de ses compagnons fidèles, que la miséricorde soit sur eux tous et, à la suite de ces agressions notre Sultan a décidé au printemps, d’occuper ladite île, car son droit est évident à ce sujet. Si Dieu nous apporte la victoire et la conquête de ladite île qui sera en ma possession et sous mon administration, les musulmans comme par le passé parviendront à remplir leur devoir religieux, la paix gagnera l’ensemble des voyageurs et des commerçants ; la population formule des souhaits pour notre règne et notre gloire.
Nous allons donc préparer une flotte et de nombreux soldats pour les envoyer sans retard vers l’île. Avec la volonté de Dieu, nous projetons l’envoi de ma glorieuse flotte sur votre côte, cela est d’un importance fondamentale et, dès à présent nous nous préparons. Nous avons aussi adressé un ordre impérial ferme au Berlebey d’Alger, celui-ci pour procurera toute l’aide possible car vous avez fait preuve d’un zèle et d’un soin constant à défendre l’Islam, et vous n’avez pas abandonné votre religion malgré les combats contre les infidèles – que Dieu les maudisse – . Vous avez fait preuve de toute votre persévérance et de votre bravoure ; et jusqu’à ce que la victoire nous soit accordée dans ces lieux nous demandons aux savants, aux personnes pieuses et à l’ensemble de la population de formuler des vœux pour notre victoire et vous ne devez rien négliger pour toujours nous informer de votre situation chez vous. »
Remis à Khalili Shaush, le 10 Dhilki-da 977 (16 avril 1570).
Traduit et publié par TEMIMI, Abdeljelil, « Le gouvernement ottoman face au problème morisque », in Les morisques et leur temps, Paris, CNRS, 1983, p. 310 – 311.
Les Morisques de Valence (1604)
Barthélemy Joly, « conseiller et aumônier du Roi », accompagne en 1604 l’abbé général de Cîteaux, qui se rendait en Espagne visiter les couvents de son ordre. Connaissant bien la langue espagnole, observateur intelligent et sans complaisance, il a laissé l’une des meilleures relations de voyage du XVIIe siècle. Entré en Espagne par la Catalogne, il passe par le royaume de Valence ; son témoignage sur les Morisques demeure un document exceptionnel.
Expression d’époque
« (…) Les Mores d’Espagne ont tenu huit cents ans, excepté aucunes montagnes secrètes en Navarre et Biscaye, Asturias, León et Galice, où les chrétiens retirés en bien petit nombre, secourus et exhortés des Français firent enfin quelques corps d’armée et élevèrent des rois en Asturias et Navarre, avec lesquels prenant leur avantage pied à pied s’élargirent jusqu’à rechasser les Mores aux extrémités de l’Espagne. Don Ferdinand et Isabelle, aïeux de Charles V, achevèrent de les jeter dehors par la prise de Grenade, l’an 1492. Or, comme un royaume se reconquérait, les Mores nés et naturels ne repassaient tous en Afrique, mais ne sachant où se retirer demeuraient en cette extrémité de la terre, souffrant la condition des vaincus, les charges, servitudes et tributs que les vainqueurs leur voulaient imposer, qui de leur part ayant affaires de leurs hommes pour la guerre, souffraient ces Mores afin de cultiver la terre et tenir le pays fourni de vivres d’ailleurs déshabité de chrétiens, se contentant de tirer d’eux un serment de fidélité. (…) De sorte que redimant leur vie et la soustenant par l’extrême labeur d’icelle, demeurèrent ainsi jusque au temps de Ferdinand, après la prise de Grenade, que l’Espagne fut repurgée de Mores armés qui avaient repassé le détroit de Gibraltar. Alors le Roi, pour ôter entièrement l’appréhension des maux passés à l’occasion des Mores et se conformer au nom de catholique qu’il avait pris, commença aussi à vouloir entendre à ces pauvres diables demeurés, qui multipliant en peuples et continuant au mahométisme en fait d’état et de conscience, étaient trouvés dangereux à être tolérés, de façon qu’il leur ordonna de vider ou recevoir le christianisme. Que firent-ils ? La douceur de leur patrie, l’amour de leurs femmes et enfants, l’appréhension des misères, l’incertitude du lieu où ils se pourraient retirer, la certitude de l’état présent, l’excuse de la contrainte qu’on leur faisait et la liberté de volonté en leur religion qu’ils se promettaient en secret, fit simuler à plusieurs d’accepter la condition, auxquels pour le commencement on se contenta de donner le baptême de régénération, afin de les faire capables de la vie éternelle. Tous ceux qui demeurèrent le reçurent ; les sacrements de mariage et de pénitence leur furent aussi enjoints. Les autres sacrements, comme pain des enfants, l’on ne trouva pas bon avec considération grand et avis des théologiens de les donner à ces Morisques : n’étant à la vérité chose raisonnable, ains du tout indigne, à ces coeurs rebelles, méprisant obstinément la religion, leur en révéler et comme déposer inconsidérément les mystères sacrés pour en faire moquerie entre eux, opprobre du nom chrétien ; si bien que réduit à ces trois points, l’on les appelle nouveaux chrétiens, hesterni christiani, et eux se le disent de nom, mais en effet au-dedans sont tous mahométans, gardant en secret leurs sabbats et néoménies, l’alcala (1) et le jeûne du Romadan (2), ne discourant ensemble que des fables de leur Alcoran en langue arabe, qu’ils parlent tous, femmes et enfants, bien qu’il leur ait été défendu. Vous les connaissez en ce que les feriez plus tôt mourir que manger chair de porc ou boire du vin sinon à quelques débauchés d’entre eux. Comme ils sont obligés de venir à confesse, à tout le moins à Pâques, ils s’y présentent bien, ne pouvant faire de moins, devant le prêtre, mais leurs curés disent qu’ils ne s’accusent d’avoir fait aucun péché. Quant à la messe, ils n’y assistent que forcément de peur de l’Inquisition et de payer l’amende et ne recourent jamais aux prêtres pour assister leurs malades, voire, afin qu’ils ne viennent d’office, cèlent la maladie en sorte que tous meurent de mort soudaine ou la feignent telle par leur malice. Que si par quelque crime autre que d’infidélité, quelqu’un est condamné à mourir publiquement par justice, alors jugeant ne pouvoir avoir pis que la mort, ils professent Mahomet haut et clair, lapidés d’ordinaire par les assistants chrétiens. J’en ai vu mourir un en Valladolid sans avoir jamais pu être réduit par les confortateurs.
Ils sont ordinairement plus teints que les Espagnols, pareils à ces Egyptiens qui courent le monde ; mais néanmoins le mot de More en Espagne n’a rien de commun avec la couleur ; ceux que nous appelons Mores de la Mauritanie, ils les appellent nègres ou negros simplement, ce qui s’observe en Levant. Ceux-ci sont désarmés de toutes armes, for de couteaux épointés, et ne possèdent rien en propre, tenus comme serfs par les seigneurs auxquels ils sont serviables cruellement, doivent le travail de leur journée, la poule, l’oeuf et autres vivres pour le quart du prix ordinaire, payent des terres que l’on leur loue quasi tout le revenu, pratiquant le soustènement de leurs vies sur la misère et escharté d’icelle et sur le travail continuel auquel ils sont contraints de vaquer ; par ce moyen, les seigneurs les supportent pour le grand profit qu’ils en retirent et l’Inquisition dissimule et relâche de son ordinaire rigueur.
S’ils étaient chrétiens, ils feraient pitié à les voir travailler après le riz, en l’eau jusqu’à mi-jambe, depuis avril qu’ils le sèment, lui conduisant et entretenant l’eau entre sillons, le sarclant et le repurgeant des herbes qui y croissent, jusque en septembre qu’ils le recueillent et portent en un village tout de Morisques, l’hôte seulement étant chrétien, à cause des méchants tours qu’ils font aux chrétiens, les tuant quand ils le peuvent secrètement, sans qu’on puisse jamais tirer d’eux aucune confession. Quelques autres Morisques sont par les villes gens de métier et d’autres encore trafiquants de blés et huiles, qu’ils nomment trajineros, un peu plus à leurs aises ; mais je ne sais si c’est la malédiction de la secte ou qu’ils cèlent leurs moyens, comme l’on croit, ayant des deniers cachés qu’ils gardent en extrême secret pour lever un jour leurs armes et se remettre en la domination que leurs aïeux ont eu en Espagne. On m’assura qu’au royaume de Valence y avait soixante dix mil maisons de Mores. »
Barthélemy JOLY, Voyage en Espagne (1603 – 1604), dans BENNASSAR, Bartolomé et Lucile, Le voyage en Espagne. Anthologie des voyageurs français et francophones du XVIe au XIXe siècle, Paris, Robert Laffont, « Bouquins », 1998, p. 1082 – 1084.
1) Zalat : les cinq prières quotidiennes, un des cinq piliers de l’islam.
2) Ramadan, 9e mois du calendrier musulman marqué par le jeûne, dont l’observation est l’un des cinq piliers de l’islam.
Danses morisques et culture de la canne à sucre dans le royaume de Valence (1604)
Barthélemy Joly, « conseiller et aumônier du Roi », accompagne en 1604 l’abbé général de Cîteaux, qui se rendait en Espagne visiter les couvents de son ordre. Connaissant bien la langue espagnole, observateur intelligent et sans complaisance, il a laissé l’une des meilleures relations de voyage du XVIIe siècle. Entré en Espagne par la Catalogne, il passe par le royaume de Valence ; son témoignage sur les Morisques demeure une document exceptionnel.
« Le sucre, comme j’ai dit, croît au royaume de Valence, principalement au dedans du pays plus méridional en sa longueur. Pour aller voir les cannes sur le pied et l’artifice de l’extraire, [nous] allâmes vers Gandia où il s’en fait en grande quantité, passant par un village de Morisques, où les plus maîtres Mores apportèrent chacun un plat ou deux de dragées et confitures de leur cru, qu’ils posèrent eux-mêmes sur la table qui était toute couverte, dont nos valets garnirent à plein fond leurs pochettes.
Après le dîner, M. de Cîteaux voulut bien que ces gens vinssent danser à la morisque, au son d’une grosse guitare comme un luth, qu’un d’entre eux touchait sans distinction de sons ; puis parurent trois ou quatre baladins morisques et six femmes, plus modestes que belles, vêtues de robes de toiles ouvrées de soie, à grandes et larges manches ouvertes des côtés, de soie de couleur, un petit chapeau sur la tête, des escarpins riolés (1) aux pieds, et comme il n’y a rien de si misérable qui n’aie son petit je ne sais quoi de réserve pour cette occasion, avaient aussi des bagues d’or et d’argent, des bracelets et colliers aux doigts et bras, au col et oreille de monstrueusement gros pendants. Les tours de salle se faisaient à la cadence de la guitare, laquelle en outre les femmes avec les hommes marquaient le son du pouce et du doigt du milieu frottés ensemble, auxquels étaient attachés certains petits engins, castañetas, faits de bois solide ou ivoire, comme coquilles de Saint-Michel : cela dura assez longuement, s’entre-relayant l’un l’autre.

Cela fini, nous allâmes voir les cannes de sucre appelées cañas de azucar ; elles aiment le pays chaud et humide, croissent cinq ou six pieds de haut pareilles aux cannes communes, sinon qu’elles sont plus tendres et les noeuds plus près après le dessus ; aussi ne portent graine ; mais pour en continuer l’engeance, l’on coupe un pied au-dessus la racine de celles qu’on arrache au mois de décembre et le plante-t-on en mars suivant ou lorsque les chaleurs commencent, éloignées d’un pied l’une de l’autre, parfois deux ou trois en un seul trou. Cette canne est pleine d’un suc ou eau douce contenue dans sa moelle. Pour en faire sucre, l’on les broie sous une meule, les mettant ainsi concassées à la presse, afin d’en exprimer le jus, de couleur d’eau trouble, qui se coule après par de gros passoires, d’où il est reçu dans de grandes chaudières, et là cuit et purifié avec blanc et coquille d’oeuf et passé par des draps, après lesquels et une dernière cuisson l’on le met dans des formes de terre faites comme cloches médiocres, percées d’un trou à la pointe ; la bouche, on la tourne en haut et chaque forme a son pot de terre sur lequel elle est posée pour l’égoutter par le trou et distiller la matière glueuse, noire et douce qu’ils nomment miel de azucar [« miel de sucre »]. Après que ces formes sont bien racises et égouttées à demeurer, le sucre n’est pas encore bien dur ni blanc, ains de couleur de cire neuf, comme nous vîmes deux ou trois qu’on vida exprès devant nous. Pour le blanchir et affiner, ils ont de la terre à potier, grosse et grise, la détrempent d’eau et en font mortier dont ils enduisent lesdites formes jusqu’au tiers d’icelles, en emplissent le vide de dessus qui s’est affaissé et coule en miel. Cette terre ou boue se change chaque jour six jours durant, au bout duquel ce sucre jusque au tiers est blanc extrêmement et achevé, hormis la dureté qu’il prend aux formes non percées, où il est mis pour la dernière façon. Le dessous qui reste en ces moules troués, l’on le recuit aux chaudières pour être refait et affiné comme dessus, et tant plus cuit-il plus acquiert-il de perfection. Voilà comme se fait le sucre, qui est en la perfection comme celui de Madère. Quant au miel, on le mange en forme de résine ou miel blanc ; il ne laisse pourtant l’officine de ce sucre d’être pénible, sale, crasseuse comme une huilerie ou pressoir à vin. »
Barthélemy JOLY, Voyage en Espagne (1603 – 1604), dans BENNASSAR, Bartolomé et Lucile, Le voyage en Espagne. Anthologie des voyageurs français et francophones du XVIe au XIXe siècle, Paris, Robert Laffont, « Bouquins », 1998, p. 653 – 654.
1) Riolés : bariolés.