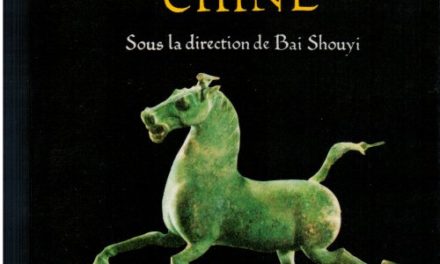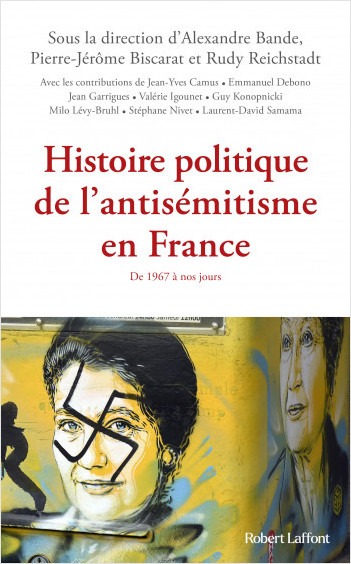Le Siam décrit par le comte de Forbin

« Sa Majesté me fit l’honneur de me questionner beaucoup sur le royaume de Siam ; elle me demanda d’abord si le pays était riche. « Sire, lui répondis-je, le royaume de Siam ne produit rien, et ne consomme rien. – C’est beaucoup dire en peu de mots, répliqua le roi. » Et continuant à m’interroger, il me demanda quel était le gouvernement, comment le peuple vivait, et d’où le roi tirait tous les présents qu’il lui avait envoyés. Je lui répondis que le peuple était fort pauvre ; qu’il n’y avait parmi eux ni noblesse ni condition, naissant tous esclaves du roi, pour lequel ils sont obligés de travailler une partie de l’année, à moins qu’il ne lui plaise de les en dispenser en les élevant à la dignité de mandarin ; que cette dignité, qui les tire de la poussière, ne les met pas à couvert de la disgrâce du prince, dans laquelle ils tombent fort facilement, et qui est toujours suivie de châtiments rigoureux ; que la barcalon lui-même, qui est le premier ministre, et qui remplit la première dignité de l’Etat, y est aussi exposé que les autres ; qu’il ne se soutient dans un poste si périlleux qu’en rempant devant son maître, comme le dernier du peuple ; que s’il lui arrive de tomber en disgrâce, le traitement le plus doux qu’il puisse attendre c’est d’être renvoyé à la charrue après avoir été très sévèrement châtié ; que le peuple ne se nourrit que de quelques fruits et de riz, qui est très abondant chez eux ; que, croyant tous à la métempsychose, personne n’oserait manger rien de ce qui a eu vie de crainte de manger son père, ou quelqu’un de ses parents ; que pour ce qui regardait les présents que le roi de Siam avait envoyé à Sa Majesté, M. Constance avait épuisé l’Epargne, et avait fait des dépenses qu’il ne lui serait pas aisé de réparer ; que le royaume de Siam, qui forme presque une péninsule, pouvait être un entrepôt fort commode pour faciliter le commerce des Indes, étant frontière de deux mers, l’une du côté de l’est, qui regarde la Chine, le Japon, le Tonkin, la Cochinchine, le pays de Lahore1 et Camboye ; et l’autre côté de l’ouest, faisant face au royaume d’Arasant2, au Gange, aux côtes de Coromandel, de Malabar, et à la ville de Surate3 ; que les marchandises de ces différentes nations étaient transportées toutes les années à Siam, qui est le rendez-vous et comme une espèce de foire où les Siamois font quelque profit en débitant leurs denrées ; que le principal revenu du roi consistait dans le commerce qu’il fait presque tout entier dans ce royaume, où l’on ne trouve que du riz, de l’arec dont on compose le bétel, un peu d’étain, quelques éléphants qu’on vend, et quelques peaux de bêtes fauves dont le pays est rempli ; quqe les Siamois allant presque nus, à la réserve d’une toile de coton qu’ils portent depuis la ceinture jusqu’à mi-cuisse, ils n’ont chez eux aucune sorte de manufacture, si ce n’est de quelques mousselines, dont les mandarins seulement ont droit de se faire comme une espèce de chemisette, qu’ils mettent dans les jours de cérémonies ; que lorsqu’un mandarin a eu l’adresse de ramasser quelque petite somme d’argent, il n’a rien de mieux à faire que de la tenir cachée, sans quoi le prince la lui ferait enlever ; que personne ne possède dans tout le royaume aucuns biens-fonds, qui de droit appartiennent tous au roi, ce qui fait que la plus grande partie du pays demeure en friche, personne ne voulant se donner la peine de cultiver des terres qu’on leur enlèverait dès qu’elles seraient en bon état, qu’enfin le peuple y est si sobre, qu’un particulier qui peut gagner quinze ou vingt francs par an a au-delà de tout ce qui lui est nécessaire pour son entretien. (…)
Leur monnaie (…) est un morceau d’argent rond comme une balle de fusil, marqué de deux lettres siamoises, qui sont le coin du prince : cette balle, qui s’appelle tical, vaut quarante sous de France. Outre le tical, il y a encore le demi-tical, et une autre sorte de monnaie d’argent qu’on appelle faon, de la valeur de cinq sous. Pour la petite monnaie, ils se servent de coquilles de mer qui viennent des îles Maldives4, et dont les six-vingts5 font cinq sous. (…)
(A la question du roi si le roi de Siam songe à se faire chrétien, Forbin répond.) Sire (…), ce prince n’y a jamais pensé, et nul mortel ne serait assez hardi pour lui en faire la proposition. »
Mémoires du comte de Forbin. Paris, Mercure de France, 1993, pp. 176 – 179.
1. Le Laos.
2. La Birmanie.
3. Aujourd’hui Goudjerate.
4. Archipel situé au sud-ouest de Malabar.
5. Six-vingts : cent vingt.
—-
Un Français au Cap de Bonne Espérance en 1685
Le comte de Forbin participe à l’expédition de la marine française qui conduit une mission diplomatique auprès du roi du Siam, en réponse à une mission siamoise à Versailles. Après trois mois de navigation sans heurts, l’expédition fait relâche au Cap de Bonne Espérance, en juin 1685. Les notes sont de l’éditrice, Micheline Cuénin.
« Voici tout ce que j’en pus découvrir pendant le peu de séjour que nous y fîmes.
Les Hollandais en sont les maîtres : ils l’achetèrent des principaux chefs des peuples qui l’habitaient, et qui, pour une assez médiocre quantité de tabac et d’eau-de-vie, consentirent de se retirer plus avant dans les terres. On y trouve une fort belle aiguade1. Le pays est en lui-même sec et aride : malgré cela, les Hollandais y cultivent un jardin qui est sans contredit l’un des plus grands et des plus beaux qu’il y ait au monde. Il est entouré de murailles : outre une grande quantité d’herbes2 de toute espèce, on y trouve abondamment les plus beaux fruits de l’Europe et de l’Inde.
Comme ce cap est une espèce d’entrepôt où tous les vaisseaux qui font le commerce d’Europe aux Indes, et des Indes en Europe, viennent se radouber et prendre les rafraîchissements dont ils ont besoin, il est pourvu abondamment de tout ce qu’on peut souhaiter. Les Hollandais ont établi, à douze lieues du cap, une colonie de religionnaires français3, à qui ils ont donné des terres à cultiver. Ceux-ci ont planté des vignes : ils y sèment du blé, et y recueillent en abondance toutes les denrées nécessaires à la vie.
Le climat y est fort tempéré : sa latitude est au trente-cinquième degré. Les naturels du pays sont Caffres, un peu moins noirs que ceux de Guinée, bien faits de corps et très dispos4, mais d’ailleurs le peuple le plus grossier et le plus abruti5 qu’il y ait dans le monde. Ils parlent sans articuler, ce qui fait que personne n’a jamais pu apprendre leur langue. Ils ne seraient pourtant pas incapables d’éducation : les Hollandais en prennent plusieurs dans l’enfance ; ils s’en servent d’abord pour interprètes, et en font ensuite des hommes raisonnables.
Ces peuples vivent sans religion : ils se nourrissent indifféremment de toutes sortes d’insectes qu’ils trouvent dans les campagnes ; ils vont nus, hommes et femmes, à la réserve d’une peau de mouton qu’ils portent sur les épaules, et dans laquelle il s’engendre de la vermine qu’ils n’ont pas horreur de manger.
Les femmes portent, pour tout ornement, des boyaux de moutons fraichement tués dont elles entourent leurs bras et leurs jambes. Ils sont très légers à la course ; ils se frottent le corps avec de la graisse, ce qui les rend dégoûtants, mais très souples, et propres à toutes sortes de sauts : enfin ils couchent tous ensemble, pêle-mêle, sans distinction de sexe, dans de misérables cabanes, et s’accouplent indifféremment comme des bêtes, sans aucun égard à la parenté. »
Mémoires du comte de Forbin. (1656 – 1733). Paris, Mercure de France, 1993, pp. 81 – 82.
1. « Sources côtières où un navire peut se ravitailler en eau douce. »
2. « Légumes frais, indispensables pour un équipage toujours menacé du scorbut. »
3. « Un refuge de protestants français chassés par la Révocation de l’Edit de Nantes s’organisait au Cap sur des terres vendues à prix doux par les coreligionnaires hollandais. Mêlés, à eux, ces Français constitueront les ancêtres des Boers. »
4. « Agile, alerte. »
5. « Grossier : aux manières frustes. Abruti : dépourvu de rudiments de connaissances. »