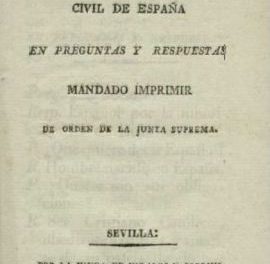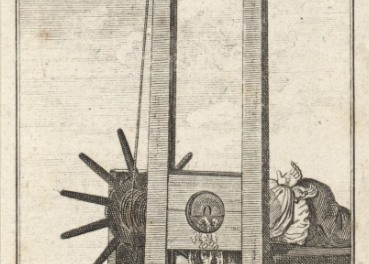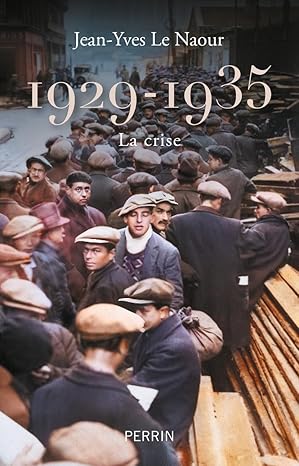Voici le discours que prononca le ministre Jean-Marie Roland de la Platière (né à Thizy en 1734 – mort à Bourg-Baudouin en 1793), par devant la Convention Nationale, le Samedi soir 22 septembre 1792, deux jours après la victoire de Valmy.
Voici le discours que prononca le ministre Jean-Marie Roland de la Platière (né à Thizy en 1734 – mort à Bourg-Baudouin en 1793), par devant la Convention Nationale, le Samedi soir 22 septembre 1792, deux jours après la victoire de Valmy.
Nommé ministre de l’Intérieur en mars 1792, Roland avait été renvoyé par le roi au mois de juin, pour revenir à ce poste après la journée du 10 août. Mais alors, sous l’influence de sa femme devenue girondine dans l’âme (Jeanne-Manon Phlipon alias « Madame Roland »), il perdra progressivement sa popularité.
Ses attaques contre Robespierre et les Montagnards et surtout son attitude dans le procès de Louis XVI achèveront de le perdre.
La volonté des Français (dit-il) est prononcée. La liberté et l’égalité sont leurs biens suprêmes; ils sacrifieront tout pour les conserver. Ils ont en horreur les crimes des nobles, l’hypocrisie des prêtres, la tyrannie des rois. Des rois ! Ils n’en veulent plus. Ils savent que hors de la République, il n’est point de liberté. La seule idée d’un fonctionnaire public héréditaire leur rappelle le danger de son influence corruptrice. Un être aussi différent des autres ne peut exister parmi des hommes dont les devoirs sont égaux. Toute la France court aux armes; il s’agit de combattre des rois conspirateurs. L’énergie du peuple est extrême; avec elle, on peut tout faire. La patrie est sauvée, si cette énergie se dirige au même but, si les forces se réunissent; cette réunion semble difficile à l’instant. Une multitude de traîtres cachés et soudoyés soufflent la discorde en semant les défiances; ils trompent les citoyens, et les déterminent à des actes qui nuisent à la chose publique, lorsque ceux qui les font croient la servir.
J’ai employé de grands moyens pour déjouer ces manoeuvres; j’ai multiplié les lettres circulaires, j’ai favorisé la distribution des écrits qui m’ont paru les plus propres à éclairer mes concitoyens sur la situation des choses, sur leurs vrais intérêts. J’ai peut-être eu quelques succès, mais le grand moyen pour réunir tous les esprits, celui qui va produire le plus grand effet, parce que les intentions du peuples sont pures, la Convention nationale l’a saisi en proclamant la République. Ce mot sera le signal d’alliance des amis de la patrie, la terreur de tous les traîtres. Lassé d’une suite de trahisons, le peuple répugne à donner sa confiance. Cependant, s’il continue à méconnaître les autorités qu’il a érigées lui-même, j’ose lui dire la vérité toute entière; il se perd, et l’Etat périt. Un ennemi puissant est sur notre territoire; ses efforts sont concertés, ses vues profondes, ses plans désastreux. Les Français ne doivent voir que lui, ne songer qu’à lui pour le vaincre et le repousser loin de la terre des hommes libres. Paris a donné le signal de l’action au reste de l’empire, dans toutes les grandes circonstances: ses habitants ont abattu le despotisme, prévenu ses fureurs, déjoué tous ses plans; leur agitation a brisé ses forces; mais elle doit finir avec lui. Si l’agitation survit à cet ennemi intérieur, elle prend sa place pour produire des effets non moins funestes: la France se déchire, tout se désorganise: ce danger est extrême. Paris qui a tout fait pour le bien de l’empire, pourrait-il devenir la cause de ses malheurs ? Non, la Convention nationale va faire prendre à l’état des choses une face toute nouvelle. Les membres qui y siègent connaissent, comme moi, les dangers que je viens d’exposer. Il me serait inutile de m’étendre davantage sur un sujet qui répugne mon coeur; mais j’ai cru devoir dire de grandes vérités; elles intéressent le salut de mon pays, et jamais la crainte ne m’a arrêté, quand j’ai cru mes discours ou mes actions capables de le servir.
La loi actuelle est bien la loi du peuple: il doit au moins provisoirement reconnaître son propre ouvrage. Dans les décrets qui émaneront de la Convention nationale, nulle crainte ne peut plus éloigner son obéissance à la loi. Le pouvoir exécutif doit donc être revêtu d’une grande force. Les ministres ne peuvent plus être suspects. Leur cause est commune avec celle de leurs concitoyens.
Quiconque refusera son obéissance à la loi, sera un homme perfide ou égaré. Dans les deux cas, sa résistance peut perdre l’Etat. Il faudra donc le réprimer et le punir. La raison dirigera certainement la grande majorité des Français; et c’est à sa force que devra céder la minorité. Ce n’est qu’avec un gouvernement vigoureux que les états libres se soutiennent. Cette vérité est surtout applicable à un peuple de 25 millions d’hommes, à un temps de dangers publics, et à une époque où toutes les ressources nationales doivent se déployer pour terrasser à la fois la fureur de l’anarchie et la coalition des despotes.
Cette idée me conduit à une autre, et dont je crois devoir l’expression à l’Assemblée nationale. Investie de la confiance publique, elle peut tout sans doute. Il n’est rien qu’elle ne doive attendre de ce ressort, le plus puissant de tous les ressorts politiques, le seul qui doive agir sur un peuple libre dans les temps ordinaires; mais celui où nous sommes n’est pas de cette classe. La Convention nationale pourrait être entourée de mouvements contre lesquels ce ressort serait impuissant. Il faut donc qu’elle puisse s’environner d’une force armée imposante. Cette force, pour être plus utile, doit être composée d’hommes qui n’aient d’autre destination que le service militaire. Une troupe soldée me paraît le plus propre à remplir ce but.
Au moment où j’ai été renommé au ministère, la France éprouvait une commotion générale. Il n’y a plus de doute que les projets des ennemis intérieurs ne fussent concertés avec ceux de nos ennemis du dehors. Si les premiers ont échoué, c’est que l’éveil des patriotes a été plus prompt qu’ils ne l’avaient cru. Cette correspondance est prouvée par les troubles des départements de l’Ardèche, des Deux-Sèvres, par la conspiration de Dussaillant, et elle aurait eu les effets les plus funestes et les plus terribles. Il a fallu réunir des forces considérables pour poursuivre les rebelles rassemblés dans le district de Châtillon. Dans le département de la Drôme, il a fallu faire le siège d’un château; dans d’autres départements, des perturbateurs cachés y ont excité des insurrections plus ou moins fatales. Ces troubles ont été excités, tantôt par le fanatisme religieux, et tantôt par la crainte qu’on avait l’art d’inspirer au peuple, sous le prétexte d’une prochaine disette de subsistances. Ils avaient encore pour cause l’interprétation arbitraire des lois ou leur silence à certains égards. L’insurrection presque générale du peuple français, nécessaire dans son principe, a cependant bientôt porté dans l’esprit du peuple une propension désorganisatrice. Les autorités publiques se heurtaient; et dès mon entrée dans le ministère, j’ai fait prononcer par le conseil exécutif la suspension de plusieurs administrations. Cependant toutes celles contre lesquelles il s’était élevé des réclamations n’ont pas encore été suspendues; les reproches dont elles étaient l’objet n’étaient pas assez graves pour motiver à leur égard des actes de sévérité.
Je leur ai écrit avec force et mesure pour leur rappeler leurs devoirs; mais les plaintes s’étant reproduites dans les assemblées électorales, plusieurs ont arrêté de procéder à leur renouvellement; et je me suis trouvé entre la nécessité de rappeler à ces assemblées qu’elles s’écartaient des lois, et la considération de l’utilité de cette mesure, lorsque l’Assemblée a rendu dans sa sagesse un décret d’autant plus nécessaire qu’il n’y a pas d’administration où il ne manque la plus grande partie des membres, par mort, démission, suspension, destitution, ou nomination au corps législatif. Le peuple attendait avec impatience ce renouvellement. Dans plusieurs villes, les insurrections n’ont eu pour prétexte que le peu de confiance qu’on avait dans les administrations. Je ne vous entretiendrai point des détails de ces insurrections; le soin de la régénération publique exige que vos regards planent à la fois sur tous les départements et que leur aspect ne soit défiguré par aucune irrégularité particulière.
Les hommes qui ont fait appeler à la Convention nationale les Payne et les Priestley feront sans doute de bons choix, et l’on doit s’attendre que leur patriotisme et leur discernement porteront dans les administrations des hommes qui sauront faire respecter les lois, et retenir tous les individus dans cette heureuse tranquillité nécessaire au salut de la République. Mais je dois faire part à la Convention de quelques inconvénients sur lesquels l’expérience m’a éclairé. Une lutte alarmante s’est élevée entre les différentes administrations. La plupart des municipalités sont amies de la liberté; c’est à elle que l’on doit la propagation de l’esprit public, le triomphe de l’égalité. Les corps administratifs, au contraire, pensaient qu’ils ne devaient point fraterniser avec elles. Ils commençaient à s’ériger en autorité suprême; et beaucoup de citoyens, qui briguaient les places d’administrateurs, auraient dédaigné celles de municipaux. Pour détruire cet abus et établir des relations plus fraternelles entre les municipalités et les administrations chargées de les surveiller, peut-être la Convention jugera-t-elle utile que pour être élu par les corps électoraux dans les administrations supérieures, il faudra d’abord avoir été nommé par le peuple dans les administrations municipales.
Depuis ma rentrée dans le ministère, ma correspondance a été très étendue non seulement avec les corps administratifs, mais avec les municipalités, et même avec un très grand nombre de particuliers. Le nombre des lettres que j’ai reçues est prodigieux. J’ai répondu à toutes; j’ai donné des solutions et contribué de toutes mes facultés à assurer partout le triomphe de l’égalité et l’exécution des lois (On applaudit).
En outre (dit encore le ministre), le mouvement que la révolution a imprimé aux esprits doit se communiquer aux choses. L’agriculture et le commerce prendront une activité nouvelle, et l’énergie de la liberté animera les arts; mais ces progrès ne peuvent se faire que dans des temps de paix. En attendant, on ne peut se dissimuler que ces parties sont en souffrance; si nous ne voulons pas qu’elles dépérissent entièrement, rétablissons l’ordre intérieur, l’obéissance aux lois, le respect des propriétés. Il faut la paix au dedans pour faire la guerre au dehors. Si nous ne réprimions l’anarchie, les citoyens paisibles resteraient tremblants dans leurs foyers, l’industrie serait suspendue. La culture des champs, la circulation des subsistances seraient interrompues. La Convention nationale, par les résolutions fermes et énergiques qu’elle vient de prendre, a saisi un des plus heureux moyens de rétablir l’ordre. J’ai envoyé hier dans tous les départements, par des courriers extraordinaires, son décret qui abolit la royauté, et celui qui est relatif au respect des personnes et des propriétés. Je les ai accompagnés d’une lettre circulaire que je vais soumettre à l’Assemblée.
Nous avons aussi pensé dans le conseil qu’il convenait de rappeler en ce moment les commissaires que le pouvoir exécutif avait envoyés dans les départements. Les motifs en sont énoncés dans le préambule de l’arrêté.(Roland fait alors lecture de sa lettre circulaire).
Le ministre de l’Intérieur aux corps administratifs. Le 21 septembre, l’an 4e de la liberté et le 1er de l’égalité.
La Convention nationale est formée; elle prend séance, elle vient de s’ouvrir. Français ! Ce moment solennel doit être l’époque de votre régénération. Jusqu’à présent, vous avez été, pour la plupart, simples témoins d’événements qui se préparaient sans que vous cherchassiez à les prévoir; qui survenaient sans que vous en calculassiez les suites, et dans le jugement desquels les passions des individus ont souvent mêlé des erreurs. La masse entière d’une nation, longtemps opprimée, se soulevait de lassitude et d’indignation. L’énergie de la capitale frappa la première ce colosse du despotisme; il s’abaissa devant une constitution nouvelle; mais il respirait encore, et cherchait les moyens de se rétablir. Ses efforts multiples l’ont trahi, et ses propres manoeuvres pour anéantir les effets de la révolution nous ont amené une révolution dernière et terrible. Dans ces années d’agitations et de troubles, si de grandes vérités ont été répandues, si des vertus méconnues des peuples esclaves ont honoré notre patrie, de honteuses passions l’ont déchirée.
L’orgueil cruel et forcené, nourri par la féodalité, lui a survécu et s’est irrité de ses pertes; d’autre part, la résistance à l’oppression a été suivie de vengeances dont les siècles avaient accumulé les matériaux. L’égoïsme hideux qui se promenait tranquillement au milieu des ruines, pour y chercher ce qu’il peut s’approprier; l’ambition jalouse et hardie, toujours prête à germer dans les têtes ardentes et peu mesurées, l’habitude nonchalante et immorale de tant d’hommes viciés par la tyrannie, soit qu’elle en fit ses agents ou qu’elles les avilit sous son joug, entretenaient un foyer de corruption dont les effets ont paru ternir quelques époques de la Révolution. Ce serait une égale injustice que de les applaudir ou de s’en étonner.
L’instant où les éléments confondus dans le chaos se rapprochèrent et s’unirent pour former l’univers dut être celui d’une agitation dans laquelle tout autre que le Créateur n’eût aperçu que des mouvements incalculables et désordonnés. Le moment où le génie de la liberté souffle sur un empire doit offrir quelque chose de comparable, que la philosophie peut seule calculer. Mais la lumière est faite, les rayons éclatants animent et colorent les objets; la royauté est proscrite, et le règne de l’égalité commence.
La France ne sera plus la propriété d’un individu, la proie des courtisans; la classe nombreuse de ses habitants industrieux ne baissera plus un front humilié devant l’idole de ses mains. En guerre avec les rois qui fondent sur elle et veulent la déchirer pour le bon plaisir de l’un d’entre eux, elle déclare qu’elle ne veut plus de roi; ainsi, chaque homme, dans son empire, ne reconnaît de maître et de puissance que la loi. C’est elle dont le joug sacré est en même temps honorable et doux; c’est elle que les hommes n’altèrent jamais, et dont l’autorité est toujours plus aimable et plus salutaire, à mesure qu’on la respecte davantage.
Il ne faut pas nous le dissimuler, autant ce glorieux régime nous promet de biens, si nous sommes dignes de l’observer, autant il peut nous causer de déchirements, si nous ne voulons approprier nos moeurs à ce nouveau gouvernement. Il ne s’agit plus de discours ou de maximes, il faut du caractère, des vertus. L’esprit de tolérance, d’humanité de bienveillance universelle, ne doit plus être seulement dans les livres de nos philosophes; il ne doit plus se manifester uniquement par ces manières douces ou ces actes passagers, plus propres à satisfaire l’amour propres de ceux qui les montrent qu’à concourir au bien général; il faut qu’il devienne l’esprit national par excellence; il doit respirer sans cesse dans l’action du gouvernement, dans la conduite des administrés; il tient à la juste estime de notre espèce, à la noble fierté de l’homme libre, dont le courage et la bonté doivent être les caractères distinctifs.
Vous allez, messieurs, proclamer la République, proclamez donc la fraternité, ce n’est qu’une même chose. Hâtez-vous de publier le décret qui l’établit, faites-le parvenir dans toutes les municipalités de votre département; accusez moi sa réception. Annoncez le règne équitable mais sévère de la loi. Nous étions accoutumés à admirer la vertu comme belle, il faut que nous la pratiquions comme nécessaire; notre condition devenant plus élevée, nos obligations sont aussi plus rigoureuses. Nous obtenons le bonheur si nous sommes sages; nous ne parviendrons à le goûter qu’à force d’épreuves et d’adversités, si nous ne savons pas le mériter. Il n’est plus possible de le fixer parmi nous, je le répète, que par l’héroïsme du courage, de la justice et de la bonté; c’est à ce prix que le met la République.
Signé : Roland, ministre de l’Intérieur.
(L’Assemblée ordonne l’impression de ce rapport. Le ministre sort de la salle au milieu des plus vifs applaudissements de l’Assemblée entière).
Source : « Journal officiel de la Convention Nationale – La Convention Nationale (1792-1793), Procès-verbaux officiels des séances depuis le 21 septembre 1792, Constitution de la grande assemblée révolutionnaire, jusqu’au 21 janvier 1793, exécution du roi Louis XVI, seule édition authentique et inaltérée contenant les portraits des principaux conventionnels et des autres personnages connus de cette sublime époque », auteur non mentionné, Librairie B. Simon & Cie, Paris, sans date, pages 18 à 20.