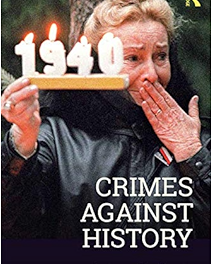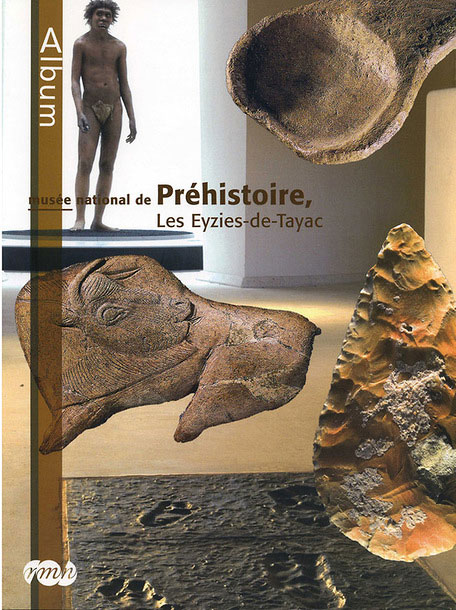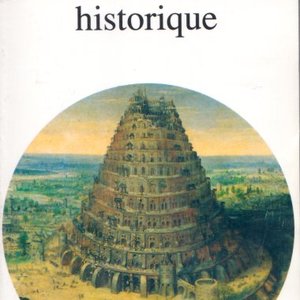
L’histoire est inséparable de l’historien
«Feuilletons le parfait manuel de l’érudit positiviste, notre vieux compagnon le Langlois et Seignobos : à leurs yeux, l’histoire apparaît comme l’ensemble des « faits ›› qu’on dégage des documents; elle existe, latente, mais déjà réelle, dans les documents, dès avant qu’intervienne le labeur de l’historien. Suivons la description des opérations techniques de celui-ci : l’historien trouve les documents puis procède à leur « toilette », c’est l’œuvre de la critique externe, « technique de nettoyage et de raccommodage » : on dépouille le bon grain de la balle et de la paille : la critique d’interprétation dégage le témoignage dont une sévère « critique interne négative de sincérité et d’exactitude » détermine la valeur (le témoin a-t-il pu se tromper ? A-t-il voulu nous tromper ?…); peu à peu s’accumulent dans nos fiches le pur froment des « faits ›› : l’historien n’a plus qu’à les rapporter avec exactitude […], s’effaçant derrière les témoignages reconnus valides. En un mot, il ne construit pas l’histoire, il la retrouve : Collingwood, qui ne ménage pas ses sarcasmes à une telle conception de la « connaissance historique préfabriquée, qu »il n’y aurait qu’à ingurgiter et recracher », appelle cela « l’histoire faite avec des ciseaux et un pot de colle » […] Ironie méritée, car rien n’est moins exact qu’une […] analyse, qui ne rend pas compte des démarches réelles de l’esprit de l’historien.
Une telle méthodologie n’aboutissait à rien de moins qu’à dégrader l’histoire en érudition, et de fait c’est bien à cela qu’elle a conduit celui de ses théoriciens qui l’a pratiquement prise au sérieux, Ch.-V. Langlois qui, à la fin de sa carrière, n’osait plus composer de l’histoire, se contentant d’offrir à ses lecteurs un montage de textes ( […] comme si le choix des témoignages retenus n’était pas déjà une redoutable intervention de la personnalité de l’auteur, avec ses orientations, ses préjugés, ses limites !) […]
Mais non, « il n’existe pas une réalité historique, toute faite avant la science qu’il conviendrait simplement de reproduire avec fidélité » […] : l’histoire est le résultat de l’effort, en un sens créateur, par lequel l’historien, le sujet connaissant, établit ce rapport entre le passé qu’il évoque et le présent qui est le sien. On sera tenté ici de recourir de nouveau à une comparaison avec l’idéalisme, pour qui la connaissance reçoit sa forme, sinon même sa réalité tout entière, de l’activité de la pensée. J’hésite cette fois à le faire, étant bien conscient des dangers que comporte l’abus de telles références, car à trop insister sur l’apport créateur de l’historien, on en viendrait à décrire l’élaboration de l’histoire comme un jeu gratuit, le libre exercice d’une imagination fabulatrice se jouant parmi un matériel hétéroclite de textes, dates, gestes et paroles avec la liberté du poète […] Or une telle conception, qui ruine le sérieux de notre discipline et la validité de sa vérité, ne saurait passer pour une description adéquate de l’activité réelle de l’historien […] Il vaut mieux donc renoncer à toute comparaison par trop boiteuse […] Je me rallierai volontiers à la formule, sans prétention ni paradoxe, qu’a proposée un de nos confrères britanniques, le professeur V. H. Galbraith de Cambridge : […] « l’histoire, c’est le passé, dans la mesure où nous pouvons le connaître ».
Oui, beaucoup mieux que l’orgueil du philosophe idéaliste assuré de construire […] le réel avec les seules ressources de la pensée, beaucoup mieux que la myopie consciencieuse de l’érudit positiviste, content d’accumuler des « faits » dans sa boîte à fiches, la modestie et la précision logique, de cette formule me paraît apte à résumer l’essentiel de notre expérience d’historiens : elle ne saurait être décrite comme le paisible labeur de l’un ni comme l’expansion triomphante de l’autre; elle est quelque chose de beaucoup plus risqué, en un sens de tragique, d’où nous sortons haletants, humiliés, toujours plus qu’à demi-vaincus […]
L’histoire est un combat de l’esprit, une aventure et […] ne connaît jamais que des succès partiels, tout relatifs, hors de proportion avec l’ambition initiale […] L’homme en revient avec un sentiment aigu de ses limites, de sa faiblesse, de son humilité.
Car nous sentons bien quelle est la tâche qu’il faudrait pouvoir assumer ; à force de nous colleter avec ce réel déroutant […]
Si limitée que soit notre expérience, elle suffit à nous révéler l’existence de ce réseau serré de relations où les causes prolongent leurs effets, où les conséquences se recoupent, se nouent, se combattent, où le moindre « fait » […] est le point d’aboutissement d’une série convergente de réactions en chaîne ; tout problème d’histoire, si limité soit-il, postule […] la connaissance de toute l’histoire universelle.»