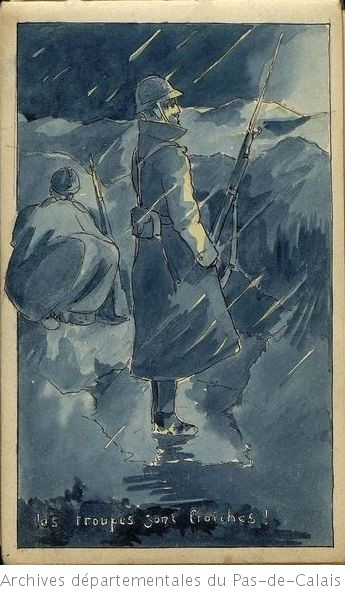
Témoignages sur la violence de guerre (1914-1915)
« Beziak est formé de trois villages. Les Autrichiens y tuèrent 54 personnes par divers procédés. La plupart furent éventrés avec le gros sabre des prisonniers. A.J., 32 ans, yeux cre- vés, nez et oreilles coupés. S.J., 14 ans, nez et oreilles coupés. K.K., 56 ans, yeux crevés, nez et oreilles coupés (…), M.V., 21 ans, violée par environ 40 soldats, organes génitaux coupés, ses cheveux introduits dans le vagin. Elle fut finalement éventrée. Elle est morte immédiatement après. L.P., 46 ans, main coupée et yeux crevés. Une famille : M.P., 45 ans, seins coupés, D.P., 18 ans, yeux crevés, S.P., 14 ans, yeux crevés, nez coupé, A.P., 7 ans, oreilles coupées. Ils furent trouvés dans un fossé, ligotés ensemble, ainsi qu’avec leur chien (…).
La façon dont les soldats ennemis s’y sont pris pour tuer et massacrer correspond à un système. Ce système est celui de l’extermination. Il est impossible de voir dans les atrocités commises les actes de quelques apaches comme il s’en trouve sûrement dans toute armée. On aurait pu le croire si le nombre des victimes se fût chiffré par quelques douzaines, mais quand il faut les compter par milliers, l’excuse de la mauvaise conduite de quelques éléments galeux n’est plus admissible. Les soldats austro-hongrois, arrivant en territoire serbe et se voyant en présence de ces gens qu’on leur avait toujours présentés comme barbares, ont eu peur. Et c’est par peur, pour ne pas être massacrés eux-mêmes, qu’ils ont probablement commis leurs premières cruautés. Mais à la vue du sang, il s’est produit le fait que maintes fois j’ai eu l’occasion d’observer : l’homme s’est changé en brute sanguinaire. Un véritable accès de sadisme collectif s’est emparé de ces troupes. L’œuvre de dévastation a été poursuivie par des hommes qui sont des pères de famille et qui, probablement, sont doux dans la vie privée. »
Source : Docteur A. REISS (médecin suisse), Rapport sur les atrocités commises par les troupes austro-hongroises pendant la première invasion de la Serbie, Paris, Grasset, 1919, pp.68-69, p.162.
Le 4 février 1915, à Monsieur et Madame T., instituteurs.
« Durant quelques jours, le froid a été très vif, le thermomètre était descendu à moins 14 degrés. Il ne fait pas très chaud pour coucher dans les tranchées qu’en beaucoup d’endroits 50 mètres à peine séparent de celles des Boches (…). La nuit, des fusées éclairantes, des grenades à main qu’ils lancent, la garde (…) rendent le sommeil impossible (…) il pleut souvent; tout ce qui tombe s’amasse en nappes boueuses (…) nous sommes obligés de nous coucher là-dedans (…), nous avons les pieds dans l’eau.
Quoique cela, il n’y a parmi nous aucune trace de découragement, une volonté inflexible tendue vers le but final. C’est-à-dire la victoire. (…) J’ai le ferme espoir que cela finira bientôt et que nous chasserons ces Huns de la France que vous m’avez appris à connaître et à aimer. »
Vichy, le 14 janvier 1917 (aux mêmes correspondants).
« Depuis quelques jours les journaux causent fort de ces notes échangées entre pays neutres au sujet de la paix. Je doute que c’est encore une vaste blague combinée pour nous faire prendre patience. On nous a tant conté de balivernes (…).
Je ne pense pas, malgré tout, qu’ils arrivent à trouver le terrain d’entente sans l’avoir défoncé par les obus et arrosé abondamment par le sang (…). Je pense que lors de cette formidable offensive qui, j’espère, éclaircira la situation, la mitraille ne sera pas ménagée… il paraît que Verdun ne serait qu’une rosée en comparaison de cette épouvantable averse (…). Si ce grand coup était réservé pour nos bons embusqués Soldats qui occupent un poste à l’abri, loin des combats. certes il y aurait pas de mal et je ne serais pas jaloux (…) mais il n’y a pas danger, ils préfèrent tout ignorer de la guerre, même l’honneur d’avoir défendu son pays brutalement attaqué Ce sera nous, les pauvres, les travailleurs, qui serons obligés d’aller défendre leur vie et leur fortune et leur forger, au prix de notre sang, la victoire dont ils jouiront (…).
La petite cure à Vichy touche à sa fin, je ne suis pas complètement guéri et je crois même que je ne guérirai jamais. »
Dans les tranchées allemandes (17 oct. 1915)
» À ma lettre je joins une carte postale aux armées d’un soldat français… Elle vient du portefeuille d’un Français tué. Il est des plus intéressants d’étudier la correspondance des Français tués ou prisonniers. Exactement comme chez nous revient aussi là-bas très souvent la question : Quand cela finira-t-il ?
À mon étonnement jamais je n’ai lu à vrai dire de remarques haineuses ou défavorables envers l’Allemagne ou les soldats allemands. Par contre dans beaucoup de lettres de leurs parents on parle de la ferme croyance en la justice de leur cause, comme en l’assurance de la victoire. Dans chaque lettre, mère, femme, fiancée, enfants, amis, dont les photographies étaient souvent jointes, espéraient un retour joyeux et prochain, et maintenant ils gisent tous là, morts et à peine enfouis entre les tranchées et au-dessus d’eux les balles sifflent et les obus chantent leur horrible chant de mort. Tant mieux pour ceux que nous, ou ceux d’en face, avons pu au moins enterrer à peu près décemment mais encore aujourd’hui il y a des lambeaux de corps humains dans les barbelés. Devant notre tranchée, il y a peu de temps, il y avait encore une main avec une alliance, à quelques mètres de là il y avait un avant-bras dont il ne restera finalement que les os. Que la chair humaine semble bonne pour les rats ! C’est affreux.
Qui ne connaît pas la terreur l’apprend ici… Si la nuit je vais seul par les tranchées et les sapes, ici et là on entend des bruits et à tout moment un soldat noir peut vous sauter à la gorge. Par une nuit d’encre c’est parfois réellement terrifiant; mais avec le temps je me suis habitué et je suis devenu aussi indifférent que nos » Landser » Terme populaire analogue à celui de » poilu « en France . La guerre abrutit le cœur et les sentiments; elle rend l’homme indifférent face à tout ce qui, autrefois, le troublait et l’émouvait : cependant cet endurcissement, cette dureté et cette cruauté devant le destin et la mort sont nécessaires dans la rage des combats auxquels conduit la guerre de tranchées. Celui qui laisserait influencer son cœur par toute la tragédie des multiples événements qu’apporte ici un jour normal, celui-là perdrait la raison ou bien devrait courir vers l’ennemi avec les bras levés. »
Lettre de Hugo Müller (1892-1916).
boue et poux
Deux extraits de journaux des tranchées.
« On meurt de la boue comme des balles, et plus horriblement. La boue où s’enlise l’homme et ce qui est pire l’âme. Mais où sont-ils tous ces »chieurs » d’articles héroïques quand il y a de la boue haut comme ça ! La boue recouvre les galons. Il n’y a plus que de pauvres êtres qui souffrent.Tiens, regarde, il y a des veines rouges sur cette flaque de boue. C’est le sang d’un blessé. L’enfer n’est pas du feu. Ce ne serait pas le comble de la souffrance. L’enfer, c’est la boue ! »
«Le bochofage», 26 mars 1917,in Les combattants des tranchées, S. Audouin-Rouzeau, A. Colin, 1986,
cité dans FRANK, Robert (s.d.), « Histoire 1e : L, ES, S », Paris, Belin, 1994
La peste du Poilu: les poux
« Je sais que, pendant un certain temps, cela a paru très drôle, surtout à ceux de l’arrière. Les poux, le rat faisaient partie du décor, avec la boue, la barbe hirsute et la tenue débraillée. C’était le genre « poilu » la plus sinistre blague des temps modernes, la plus inconvenante facétie, qui donnait l’air à chaque combattant de se plaire dans la crasse et la malpropreté. Permettez-moi, Messieurs, de vous le dire bien timidement, bien respectueusement : nous serions absolument charmés de ne plus nous gratter. Quand il est question pour nous,d’un nouveau secteur, si l’on nous dit : « les Boches sont à vingt mètres », cela nous laisse froids ; mais si l’on nous dit : « les Boches sont pleins de poux », cela nous dégoûte ! »
«Le pépère», 21 avril 1916, cité dans FRANK, Robert (s.d.), « Histoire 1e : L, ES, S », Paris, Belin, 1994
bouffe, hygiène
Christian Bordeching, lieutenant dans l’armée allemande, était le fils d’horticulteurs allemand domiciliés à Brème. il était étudiant en architecture et écrivait très souvent à sa soeur Hanna. Il fut tué sur le front le 20 avril 1917, à 24 ans.
« Le 24, 25 février 1916
Ma chère Hanna,
(…) Tu me demandes ce que nous mangeons. Dans la semaine en moyenne deux fois de la soupe aux pois à la couenne de lard, deux fois du bouillon de riz sucré, une fois des haricots verts et une fois de la soupe de riz avec de la viande de boeuf. On mange à même le couvercle de notre casserole de fer, et j’ai toujours dans ma poche ma cuillère, juste essuyée à l’aide de papier.Tous les huit jours, je dors une fois sans mes bottes, tous les dix jours je change de chaussettes et je reçois ma solde de cinq marks trente. Je dors toujours habillé, les pieds enfoncés dans un sac, le manteau par-dessus,puis recouvert d’une couverture de laine où je m’enfouis entièrement dessous. Pour nous asseoir, nous avons au mieux une caisse, mais le plus souvent rien du tout. Nous nous asseyons par terre, sur la paille. Dans notre groupe, nous allons chercher notre café dans une batterie de cuisine française, c’est très grand et chacun se sert lui-même avec sa tasse souillée. Personne n’a peur de la crasse : on s’y est habitués ; on rince, on boit et l’on se lave dans l’eau des tranchées. Mon bonnet à l’intérieur a l’air d’une caisse de charbon et des nuages de poussière sortent de mon uniforme. Je ne peux me laver que tous les deux jours. Tu devrais voir nos latrines, elles sont à mourir de rire : un simple tronc de bouleau où l’on est aligné derrière contre derrière et qui offre, du chemin principal, une belle vue. Nous avons eu si peu de pain cette semaine que la plupart ont déjà mangé leurs biscuits de secours. Si tu veux en savoir davantage, tu n’as qu’à me demander des détails.
Tu peux sûrement t’expliquer ma mauvaise écriture, assieds-toi donc par terre, mets un livre sur lequel tu peux écrire sur tes cuisses, et pose entre tes genoux une bouteille avec une faible lumière. (…) »
in GUÉNO, J-P, (s. d.), Paroles de poilus : lettres et carnets du front 1914-1918, Paris, Librio, 2001, p. 69-70
boue
« Octobre 1915
Je crois n’avoir jamais été aussi sale. Ce n’est pas ici une boue liquide, comme dans l’Argonne. C’est une boue de glaise épaisse et collante dont il est presque impossible de se débarrasser, les hommes se brossent avec des étrilles. (…) Par ces temps de pluie, les terres des tranchées, bouleversées par les obus, s’écroulent un peu partout, et mettent au jour des cadavres, dont rien, hélas, si ce n’est l’odeur, n’indiquait la présence. Partout des ossements et des crânes. Pardonnez-moi de vous donner ces détails macabres ; ils sont encore loin de la réalité.
Jules Grosjean »
in GUÉNO, J-P, (s. d.), Paroles de poilus : lettres et carnets du front 1914-1918, Paris, Librio, 2001, p. 61
cafard, froid, boches comme nous
Etienne Tanty était le fils d’un professeur d’espagnol qui était également bibliothécaire au lycée Hoche, à Versailles. En 1914, Etienne, philosophe de formation, avait vingt-quatre ans. Il était déjà sous les drapeaux lorsque son service militaire déboucha sur la guerre. Il fut blessé le 25 septembre 1915 à Neuville-Saint-Vaast. Soigné pendant près de six mois, il fut renvoyé au front et fait prisonnier à Tabure le 21 mars 1918. Il fut libéré de son camp de prisonniers et rapatrié le 15 décembre 1918, puis démobilisé le 8 août 1919. Il devint ensuite professeur de lettres et de latin.
« Jeudi 28 janvier 1915
J’erre, toujours aussi incapable d’écrire. J’ai eu hier matin votre lettre du 23 et j’ai mis une enveloppe hier soir.
Il gèle épouvantablement ce matin, sans que j’arrive à me réchauffer les doigts. S’il n’y avait encore que les doigts de gelés ; mais le bonhomme ne vaut guère mieux, et le cafard est pire que la gelée.
Car n’est-ce pas, j’ai le cafard, vous vous en doutez, et je désespère de le chasser. Il y a de quoi, et ce n’est pas aujourd’hui qu’il passera ; la perspective de retourner ce soir dans le vieux secteur du bois carré, et de reprendre la vie souterraine, nocturne et marécageuse n’étant pas pour le dissiper.
Voilà six mois bientôt que ça dure, six mois, une demi-année qu’on traîne entre vie et mort, jour et nuit, cette misérable existence qui n’a plus rien d’humain ; six mois, et il n’y a encore rien de fait, aucun espoir ; six mois qu’on a quitté le fort, et l’on est un peu moins avancé qu’au lendemain du Châtelet. (…)
Hier, ou avant-hier, au rapport, on a lu des lettres de prisonniers boches.Pourquoi ? je n’en sais rien, car elles sont les mêmes que les nôtres. La misère, le désespoir de la paix, la monstrueuse stupidité de toutes ces choses, ces malheureux sont comme nous, les Boches ! Ils sont comme nous et le malheur est pareil pour tous. (…) »
in GUÉNO, J-P, (s. d.), Paroles de poilus : lettres et carnets du front 1914-1918, Paris, Librio, 2001, p. 94
froid
« Dimanche 22 novembre 1914
Voilà quelques jours qu’il fait très froid, il gèle très fort chaque nuit, hier matin le thermomètre était à 9 degrés au-dessous de zéro ; le canal del a Marne au Rhin qui passe par ici est tout gelé, aussi je t’avoue franchement que la nuit c’est bien le moment de s’enfoncer le nez sous la paille, sans crainte des rats qui peuvent très bien nous grignoter le bout du nez sans qu’on le sorte dehors car la bise souffle rudement et passe à travers les tuiles, je viens de faire faire des feuillées « cabinets » ; la terre est gelée sur une profondeur d’au moins 12 centimètres, c’est te dire qu’il ne fait pas chaud.
Voilà une dizaine de jours que nous n’avons pas été au combat, le canon tonne dans le lointain ; je ne sais pas si un de ces jours il ne nous appellera pas mais, que veux-tu ? puisque nous sommes là pour ça….
Joseph Gilles »
in GUÉNO, J-P, (s. d.), Paroles de poilus : lettres et carnets du front 1914-1918, Paris, Librio, 2001, p. 93-94
pas de repos, discipline
Emile Sautour était originaire de Juillac en Corrèze. Il appartenait au 131e RI et il a été tué sur le front le 10 octobre 1916.
« 31 mars 1916
Mes bons chers parents, ma bonne petite sœur,
Il me devient de plus en plus difficile de vous écrire. Il ne me reste pas un moment de libre. Nuit et jour il faut être au travail ou au créneau. De repos jamais. Le temps de manger aux heures de la soupe et le repos terminé il faut reprendre son ouvrage ou sa garde. Songez que sur vingt-quatre heures je dors trois heures, et encore elles ne se suivent pas toujours. Au lieu d’être trois heures consécutives, il arrive souvent qu’elles sont coupées de sorte que je dors une heure puis une deuxième fois deux heures.Tous mes camarades éprouvent les mêmes souffrances. Le sommeil pèse sur nos paupières lorsqu’il faut rester six heures debout au créneau avant d’être relevé. Il n’y a pas assez d’hommes mais ceux des dépôts peuvent être appelés et venir remplacer les évacués ou les disparus. Un renfort de vingt hommes par bataillon arrive, trente sont évacués.
Il n’y a pas de discipline militaire, c’est le bagne, c’est l’esclavage… Les officiers ne sont point familiers, ce ne sont point ceux du début. Jeunes, ils veulent un grade toujours de plus en plus élevé. Il faut qu’ils se fassent remarquer par un acte de courage ou de la façon d’organiser défensivement un secteur, qui paie cela le soldat. La plupart n’ont aucune initiative. Ils commandent sans se rendre compte des difficultés de la tâche, ou de la corvée à remplir. En ce moment nous faisons un effort surhumain. Il nous sera impossible de tenir longtemps ; le souffle se perd. Je ne veux pas m’étendre trop sur des faits que vous ne voudriez pas croire tout en étant bien véridiques, mais je vous dirai que c’est honteux de mener des hommes de la sorte, de les considérer comme des bêtes. (…)
J’ai voulu vous montrer que ceux qui vous diront que le soldat n’est pas malheureux au front, qu’un tel a de la chance d’être valide encore, mériteraient qu’on ne les fréquente plus. Qu’ils viennent donc entendre seulement le canon au-dessus de leurs têtes, je suis persuadé qu’ils regagnent leur chez-soi au plus vite. Nos misères empirent chaque jour, je les vaincrai jusqu’au bout. A bientôt la victoire, à bientôt le baiser du retour. »
in GUÉNO, J-P, (s. d.), Paroles de poilus : lettres et carnets du front 1914-1918, Paris, Librio, 2001, p. 75-76
monotonie, obus
Maurice Maréchal avait vingt-deux ans en 1914. Après la guerre, il deviendrait l’un des plus grands violoncellistes du monde. En mai 1915, un autre poilu lui fabriqua un violoncelle avec les morceaux d’une porte et d’une caisse de munitions. Ce violoncelle signé par les généraux Foch, Pétain, Mangin et Gouraud est aujourd’hui conservé à Paris, à la Cité de la Musique.
« Dimanche 27 septembre 1914
Ah, que c’est long et monotone et déprimant. Voilà quinze jours que nous restons sur place. En 1870, autant que je me rappelle, il y eut de formidables batailles où les armées se cognèrent vraiment avec acharnement ! (…) Je pense à ces régiments de cavaliers balayant la plaine, ces combats corps à corps, ou presque, dans les rues de village : eux les voyaient… les Prussiens ! Nous, nous ne les voyons pas ! Pour la malheureuse infanterie, la tâche est bien facile à résumer : « Se faire tuer le moins possible par l’artillerie. » Pour cela on marche la nuit, les mouvements se font au petit jour et au crépuscule on a toujours l’air de se cacher. Une fois arrivé au poste de combat, chacun prend ses positions, ici telle compagnie, là telle autre, là le commandement ; puis on se terre dans les tranchées et on attend. On ne voit rien, mais on entend : c’est tout de même quelque chose ! L’artillerie se met à cracher, on compte les coups, on risque un oeil pour mesurer la distance à laquelle éclatent les projectiles ; on se baisse vivement lorsqu’on perçoit, ironique et railleur, le dss, dss d’une nouvelle marmite ! Et voilà l’héroïsme de nos jours : se cacher le mieux possible. Évidemment, à force de s’amuser d’un côté et de l’autre à s’envoyer, les uns de la picrite, les autres de la mélinite plein les obus, il arrive quelque bobo ! Boum ! Oh, celui-là arrive bien près ! Reboum ! Bon, tout le monde est par terre, roulé de sable et de poussière, on ne voit plus rien à cause de la fumée noire qui vous aveugle. Mais on entend des râles et c’est le spectacle hideux, indigne d’être raconté, de sept ou huit bons hommes au milieu desquels est venu éclater avec un gros bruit bête, l’obus contenant des kilos de mélinite. Alors, les moins blessés s’en vont, suffoquant encore un peu, sous le coup de l’émotion nerveuse. On les sent tout petits, tout petits, en face de cette épouvantable chose, les uns le bras sanglant, d’autres le soulier déchiqueté avec un trou rouge, et ils passent devant les autres tranchées, boitillant mais pas pleurards. Pour la plupart, ils sont courageux, peut-être aussi songent-ils avec effroi que les voilà encore bien partagés et que d’autres sont restés dans le trou et qu’on les enterrera demain …
Puis le soir arrive, (…) alors, on se lève sans bruit, on ramasse les sacs, le fusil, et on reprend la route du cantonnement, tandis que des régiments reposés viennent nous remplacer sur les positions. Il fait froid, les mains gèlent sur le guidon, et on ne sait pas bien, oh non vraiment ! si on a fait quoi que ce soit d’utile pour la Patrie ! On n’a pas agi ! »
in GUÉNO, J-P, (s. d.), Paroles de poilus : lettres et carnets du front 1914-1918, Paris, Librio, 2001, p. 45
L’attaque
« Le talus, de sous côtés, s’est couvert d’hommes qui se mettent à dévaler en même temps que nous. A droite se dessine la silhouette d’une compagnie qui gagne le ravin par le boyau 97, un ancien ouvrage allemand en ruines.
Nous traversons nos fils de fer par les passages. On ne tire encore pas sur nous. Des maladroits font des faux pas et se relèvent. On se reforme de l’autre côté du réseau, puis on se met à dégringoler la pente un peu plus vite : une accélération instinctive s’est produite dans le mouvement Quelques balles arrivent alors contre nous. Bertrand nous crie d’économiser nos grenades, d’attendre au dernier moment. Mais le son de sa voix est emporté : brusquement devant nous, sur toute la largeur de la descente, de sombres flammes s’élancent en frappant l’air de détonations épouvantables. En ligne, de gauche à droite, des fusants sortent du ciel, des explosifs sortent de la terre. C’est un effroyable rideau qui nous sépare du monde, nous sépare du passée et de l’avenir. On s’arrête, plantés au sol, stupéfiés par la nuée soudaine qui tonne de toutes parts ; puis un effort simultané soulève notre masse et la rejette en avant, très vite.
On trébuche, on se retient les uns aux autres, dans de grands flots de fumée. On voit, avec de stridents fracas et des cyclones de terre pulvérisée vers le fond où nous nous précipitons pêle-mêle, s’ouvrir des cratères, ça et là, à côté les uns des autres. Puis on ne sait plus où tombent les décharges. Des rafales se déchaînent si monstrueusement retentissantes qu’on se sent annihilé par le seul bruit de ces averses de tonnerre, de ces grandes étoiles de débris qui se forment en l’air. On voit, on sent passer près de sa tête des éclats avec leur cri de fer rouge dans l’eau. A un coup, je lâche mon fusil, tellement le souffle d’une explosion m’a brûlé la main. Je le ramasse en chancelant et je repars tête baissée dans la tempête à lueurs fauves, dans la pluie écrasante des laves, cinglé par les jets de poussière de suie. Les stridences des éclats qui passent vous font mal aux oreilles, vous frappent sur la nuque, vous traversent les tempes, et on ne peut retenir un cri lorsqu’on les subit. On a le cœur soulevé, tordu par l’odeur soufrée. Les souffles de la mort nous poussent, nous soulèvent, nous balancent. On bondit, on ne sait pas où on marche. Les yeux clignent, s’aveuglent et pleurent. Devant nous, la vue est obstruée par une avalanche fulgurante, qui tient toute la place.
C’est le barrage. Il faut passer dans ce tourbillon de flammes et ces horribles nuées verticales. On passe. On est passé, au hasard ; j’ai vu, çà et là, des formes tournoyer, s’enlever et se coucher, éclairées d’un brusque reflet d’au-delà. J’ai entrevu des faces étranges qui poussaient des espèces de cris, qu’on apercevait sans les entendre dans l’anéantissement du vacarme. Un brasier avec d’immenses et furieuses masses rouges et noires tombait autour de moi, creusant la terre, l’ôtant de dessous mes pieds, et me jetant de côté comme un jouet rebondissant. Je me rappelle avoir enjambé un cadavre qui brûlait, tout noir, avec une nappe de sang vermeil qui grésillait sur lui, et je me souviens aussi que les pans de la capote qui se déplaçait près de moi avaient pris feu et laissaient un sillon de fumée. A notre droite, tout au long du boyau 97, on avait le regard attiré et ébloui par une file d’illuminations affreuses, serrées l’une contre l’autre comme des hommes.
– En avant !
Maintenant, on court presque. On en voit qui tombent tout d’une pièce, la face en avant, d’autres qui échouent, humblement, comme s’ils s’asseyaient par terre. On fait de brusques écarts pour éviter les morts allongés, sages et raides, ou bien cabrés, et aussi pièges plus dangereux, les blessés qui se débattent et qui s’accrochent. »
extrait de Henri Barbusse, Le Feu, 1916.
boucherie, explosifs
« Le 31 juillet [sans année]
Les tranchées de première ligne sont en face de nous. (…) ici, en plus des balles, des bombes et des obus, on a la perspective de sauter à 100 mètres en l’air d’un instant à l’autre ; c’est la guerre des mines. (…) la dernière explosion a fait un trou de 25 mètres de profondeur sur 50 mètres de diamètre. Inutile de te dire ce que sont devenus ceux qui se trouvaient dans le rayon.
Pierre Rullier »
in GUÉNO, J-P, (s. d.), Paroles de poilus : lettres et carnets du front 1914-1918, Paris, Librio, 2001, p. 61
« 24 juin 1915
Dans la tranchée, le pis, ce sont les torpilles. Le déchirement produit par ces 50 kg de mélinite en éclatant est effroyable. Quand une d’elles tombe en pleine tranchée, et ces accidents-là arrivent, elle tue carrément 15 à 20 types. L’une des nôtres étant tombée chez les Boches, des pieds de Boches ont été rejetés jusque sur nos deuxièmes lignes.
Michel Lanson »
in GUÉNO, J-P, (s. d.), Paroles de poilus : lettres et carnets du front 1914-1918, Paris, Librio, 2001, p. 62
L’attente
» La journée est longue, très longue. Ennui… Courbaturé d’être toujours assis ou couché par terre… on cherche à se distraire… lecture… jeux de cartes… Volonté courte! … Essais de positions moins fatigantes … Puis on se lève… On regarde les aéros et l’on voit leurs évolutions à la jumelle… Faible distraction! … On réintègre l’abri … L’ennui, toujours … On écrit… On dort … »
» On progresse « , ler septembre 1917
L’attaque
» A l’heure prescrite, les officiers nous font le petit laïus habituel, les dernières recommandations, puis nous demandent si nous sommes prêts. Sur notre réponse affirmative suit un instant de silence, de recueillement, puis soudain retentit le cri : « En avant ! » Nous étions dans le deuxième parallèle de départ. Sans hésitation officiers et hommes, nous sautons sur le parapet et courons vers la première tranchée pour y remplacer les camarades qui déjà s’approchent des lignes boches. On s’arrête à peine, que déjà retentit de nouveau le cri : « En avant ! » Nous escaladons le nouveau parapet et en criant de toutes nos forces n’importe quoi : Vive la France! Sus aux Boches! Allons les gars ! nous partons pour rejoindre la première vague. La fusillade crépite là-bas devant nous. Les mitrailleuses dévident leurs rubans de mort. Tac, tac, tac, tac. Nous rejoignons les camarades, mais. horreur, nous nous heurtons à une barrière de fils de fer barbelés intacte et profonde de plus de trente mètres. Pendant ce temps, les mitrailleuses ennemies continuent : tac, tac, tac, tandis que nous voyons à droite, à gauche, les camarades tomber et joncher la terre de taches bleues de capotes, rougies de sang aux endroits où le coup a frappé. Voici à présent les 3e et 4e vagues qui arrivent à leur tour. En avant, quelques poilus qui ont réussi à se couler sous les fils de fer atteignent la tranchée des empoisonneuses. Ils sautent dedans mais hélas on ne les a pas revus… Ils étaient trop peu nombreux ! D’autre part, franchir le réseau en masse est impossible et la situation devient de plus en plus critique. Le cri » aux outils ! » retentit. On creuse alors fébrilement le sol et bientôt nous sommes terrés tout contre le réseau boche. Les balles sifflent au-dessus de nous et nous nous cramponnons au terrain acquis. Voici le résultat de la journée mais… si les fils de fer avaient été coupés… comme nous enlevions la position ! ( … ) Bon dieu ! si seulement notre artillerie avait réussi à établir une brèche ! ( … ) Si encore nous n’avions pas le chagrin d’avoir perdu notre commandant. notre capitaine, mon lieutenant et combien de copains tués ou blessés. »
» L’Écho de tranchées-ville « , 28 octobre 1915.
La mort en face
» Personne ne croirait que dans ce désert tout déchiqueté il puisse y avoir encore des êtres humains ; mais, maintenant, les casques d’acier surgissent partout dans la tranchée et à cinquante mètres de nous il y a déjà en position une mitrailleuse, qui, aussitôt, se met à crépiter.
Nous reconnaissons les visages crispés et les casques ; ce sont les Français. Ils atteignent les débris des barbelés et ont déjà des pertes visibles. Toute une file est fauchée par la mitrailleuse qui est à côté de nous : puis nous avons une série d’ enrayages et les assaillants se rapprochent. Au moment où nous reculons, trois visages émergent du sol. Sous l’un des casques apparaît une barbe pointue, noire et deux yeux qui sont fixés droit sur moi. Je lève la main, mais il m’est impossible de lancer ma grenade dans la direction de ces étranges yeux. Pendant un instant de folie, toute la bataille tourbillonne autour de moi et de ces yeux qui, seuls, sont immobiles ; puis en face de moi. La tête se dresse, je vois une main, un mouvement, et aussitôt ma grenade vole, vole là-dessus.
Nous sommes devenus des animaux dangereux, nous ne combattons pas, nous nous défendons contre la destruction. Ce n’est pas contre les humains que nous lançons nos grenades, car à ce moment-là nous ne sentons qu’une chose : c’est que la mort est là qui nous traque, sous ces mains et ces casques. La fureur qui nous anime est insensée ; nous ne pouvons que détruire et tuer, pour nous sauver… pour nous sauver et nous venger. »
E.-M. Remarque, A l’Ouest rien de nouveau , 1928
Contre la mort, la dérision
» A quoi bon vous creuser la tête. Un obus le fera bien. »
» Le cri de guerre « , 20 octobre 1916
» Pourquoi les vaguemestres portent-ils sur les lettres non délivrées : « Le destinataire n’a pu être atteint » alors que, en général, c’est au contraire parce qu’il a été atteint par un projectile que le destinataire n’est plus là ? »
» L’Écho des guitounes » 10 novembre 1917
blessés achevés
Jacques Ambrosini était originaire de Speloncato en Haute-Corse. Fils d’agriculteur, engagé dans les Dardanelles contre les Turcs, à l’âge de dix-neuf ans, il finira la guerre comme lieutenant, écrivant de temps en temps à son frère.
« Les balles avaient bien sifflé, mais personne n’avait été touché. La rage de tuer et poussés par l’odeur de la poudre aussi bien que par les cris des bêtes féroces, car à ce moment-là on devient des bêtes féroces, [ne] pensant qu’à tuer et massacrer, nous nous élançons tous comme un seul homme. (…) Les camarades tombent. Presque tous blessés. Ce sont alors des cris de douleur. D’un côté, on entend « ma femme », « mes enfants » de l’autre, « ma mère », « achevez-moi », « ne me faites plus souffrir ». Tout ceci te déchire le cour, le sang coule à flots, mais nous avançons quand même, marchant sur les morts. Les Turcs sont couchés par centaines. Notre 75 aussi bien que les pièces de marine ont fait du bon travail. Ils sont déjà tout gonflés. (…) Les Sénégalais qui passent sur les tranchées ennemies achèvent les blessés. On nous l’avait bien recommandé à nous aussi, mais je n’ai pas le courage. Tout à coup, à la troisième tranchée turque, un de ces vieux mahométans, blessé et pouvant encore bouger ses bras hisse un drapeau blanc au bout d’un morceau de bois. Je m’approche pour le voir de près. Que fait-il ? Il me regarde puis saisit son fusil et veut me mettre en joue. Le malheureux. Plus leste que lui, je lui flanque ma baïonnette dans la tempe gauche et, instinctivement, je fais partir un coup. Les cervelles sautent en l’air et viennent jusqu’à ma figure. Il me crie pardon et meurt. Je repars me disant : « Tous les blessés, tu les achèveras. » C est ce que je fis. »
in GUÉNO, J-P, (s. d.), Paroles de poilus : lettres et carnets du front 1914-1918, Paris, Librio, 2001, p. 48-49
colis, hôpital
« Décembre 1914, Lézignan
Je viens de recevoir le colis avec le tricot, les chaussettes, le pâté, les biscuits et la saucisse, tout cela est bien bon. Je te remercie beaucoup. Le tricot me convient aussi, il vaut mieux qu’il soit blanc pour mettre en dessous et puis il est très chaud, ainsi que les chaussettes. Pour le caleçon, ne te dérange pas, si j’y vais nous l’achèterons tous les deux, pour le moment je n’ai pas froid. Je ne sais pas si je resterai longtemps à l’hôpital mais j’ai l’espoir de rester quelque temps, car j’ai besoin d’engraisser un peu. Je te dirai que mes parents m’ont écrit, ils m’ont envoyé 10 francs. Je ne suis pas à plaindre pour un certain temps, ne te fais pas du mauvais sang. Embrasse bien les enfants pour moi. (…)
François Sutra »
in GUÉNO, J-P, (s. d.), Paroles de poilus : lettres et carnets du front 1914-1918, Paris, Librio, 2001, p. 92-93
Bourrage de crâne
Horreur et dévastation. (titre du texte d’origine)… janvier 1915.
« Il n’y a rien qui ressemble à un point du front gigantesque sur lequel deux ou trois millions d’hommes s’étreignent comme un autre point de ce même front. Nous en avons parcouru quelque trois cents kilomètres: partout le même ciel gris, triste et bas; partout, sur les routes défoncées, les mêmes troupeaux qui chassent les territoriaux armés du front, les mêmes convois, les mêmes autobus, les mêmes batteries attendant en un lieu propice l’instant d’entrer dans la ligne de feu, les mêmes soldats crottés par la boue des tranchées ou massés un peu à l’arrière dans l’attente du grand coup; partout aussi les mêmes maisons trouées d’obus, les mêmes pans de murailles dressés dans la grisaille de décembre. Et partout aussi, il faut l’ajouter, malgré la pluie, malgré le vent, malgré les champs délavés où l’on enfonce jusqu’à la chevi11e, le même entrain, la même bonne humeur, la même volonté de vaincre. Tant de cercueils hâtivement confiés à la terre ! Pourtant, on a bon espoir, mieux que cela, on est sûr de la victoire.
– Mot de passe : le sourire !… nous dit une sentinelle transpercée jusqu’aux os par la pluie glaciale .
Et l’on est confondu de tant de courage ,paisible, d’une si belle vaillance devant la tâche monstre ; car enfin, depuis des semaines, on quitte la boue des chemins pour la boue des champs, la boue des champs pour la boue des tranchées, où il faut demeurer accroupi des heures et souvent des jours sans voir l’ennemi, tapi lui-même dans ses trous humides. Comme on est loin de l’image classique de la guerre, des clairons sonnant la charge, des bataillons courant derrière les drapeaux déployés, de la belle batai11e sous le gros soleil du mois d’août avec ses cavaliers qui galopent sabre au clair ! … Maintenant, tout est ruse, prudence sournoise, patience surtout. Il faut vaincre l’ennui, il faut vaincre la boue qui colle, qui Se referme sur les souliers des fantassins comme sur les roues des canons. Et quand on est à portée de fusil, il faut s’enterrer dans cette boue pour tenir tête à l’invisible ennemi enterré lui-même vers ce bois, dans cette plaine jaune plantée de betteraves. Oui, guerre de patience, d’héroïsme souterrain, le nez dans la ,boue et les pieds dans l’eau !
– Savez-vous ce qui nous donne tout ce courage? disait un caporal. Ils nous en ont trop fait, tout simplement. Il suffit d’avoir logé deux jours chez l’habitant, dans un village précédemment occupé par les Boches, pour y aller de plein cœur… C’est dégoûtant!
Il n’exagérait pas, le petit caporal. Cela dépasse l’imagination. Pour s’en rendre compte, il faut, en effet, loger chez l’habitant, gagner sa confiance, passer un soir ou deux à causer au coin du feu. Peu à peu, les langues se délient. On va chercher des voisins, des voisines, des témoins. Ce que l’on apprend est simplement effroyable. Ne nous attardons pas aux attentats répugnants. II faut avoir entendu – et quelle voix et quels yeux! – une femme dont le mari est mobilisé dire : «Si je pensais que je dusse donner le jour à un de ces monstres, je me suiciderais !… » pour réaliser dans quel enfer étaient tombés les malheureux villages livrés à une soldatesque en déroute. Les démentis peuvent pleuvoir. Ils sont sans valeur aucune pour ceux qui ont été sur les lieux : il y a des accents qui ne trompent pas. Il ne faut pas être injuste, sans faute, et nous voulons aller jusqu’à croire que les vertueux camarades, c’est-à-dire l’immense majorité, n’ont pas entendu les cris poussés par les victimes, pas plus que les officiers. Nous savons d’autre part qu’il y a des apaches dans toutes les armées, que l’homme à l’état normal est une lassez triste bête et qu’en temps de guerre, il doit tomber encore au-dessous de lui-même, ce qui est beaucoup dire. Mais pourtant, quand on apporte au monde perverti l’Évangile et la Kultur on devrait, semble-t-il, non pas respecter les traités que l’on a signés, puisque ce ne sont que des chiffons de papier, mais châtier les apaches coupables. L’a-t-on fait ?
Hélas! ce n’est pas tout. Qui donc a vidé les maisons par douzaines, de la cave au grenier ? … brisé les armoires à glace, criblé les plafonds de coups de baïonnette, ignoblement, sali les tapisseries, écrasé des tomates contre les murs, cassé des milliers de bouteilles dont les débris gisent encore sur le sol des caves, éventré des tonneaux vides, détruit tout ce qui peut être détruit, pour le seul plaisir ? »
in B. Vallotton, A travers la France en guerre, souvenirs d’Alsace, Lettres d’un sergent suisse extraites de la Gazette de Lausanne, Lausanne, Libraire F. Rouge & Cie, 1915, p. 78-81
Aveux français. (titre du texte d’origine)
« Ce n’est que rarement que les carnets de guerre français renferment un jugement impartial, une appréciation équitable de nos mesures militaires. Le passage suivant trouvé dans le carnet du commandant français D. en est une exception heureuse: »
« De France, on propage la nouvelle que les cathédrales de Reims et de Senlis sont en flammes. Quoique cette nouvelle manque encore de confirmation, on l’exploite pour protester contre les barbares allemands. Le gouvernement français encourage ce mouvement. Les comptes rendus français racontent que les Allemands ont dirigé leur feu sans raison sur la cathédrale, mais ils taisent le fait que Reims est un poste de concentration français et que les Allemands ne pouvaient pas en ménager la cathédrale… »
in Les brutalités envers les prisonniers – notes du gouvernement allemand aux puissances neutres – publié avec l’agrément du ministère allemand des affaires étrangères, Berlin, Carl Heymanns Verlag, 1918, p. 68
Le bombardement de la cathédrale d’Ostende par les Anglais (titre du texte d’origine)
« Les Anglais nient officiellement le bombardement de la cathédrale d’Ostende, bien que les 29’000 habitants que n’ont pas encore frappés les obus de leurs libérateurs et alliés attestent devant le monde entier l’attentat commis par les Anglais, le 22 septembre, et que l’on vende partout à Ostende des cartes postales illustrées, immortalisant par l’image la destruction de la cathédrale. La trace des coups comparée au démenti officiel anglais ultérieur rend vraisemblable l’hypothèse d’un bombardement parfaitement prémédité de la cathédrale par les obus de 38 centimètres des navires anglais.
Comme l’a fait savoir le rapport officiel allemand, le feu des monitors arrêtés en mer hors de la portée de la vue était dirigé au moyen de la radiotélégraphie par des aviateurs anglais qui croisaient à une grande hauteur au-dessus de la ville. Ceux-ci auront sans doute pris pour des soldats allemands se rendant en masse à la cathédrale ce qui était en réalité des habitants allant assister à la messe du matin. Le premier obus arriva un peu après le commencement de l’office. On l’entendit siffler dans l’église. Au dire des habitants, son sifflement dans l’air rappelait le bruit, de la vapeur s’échappant d’une locomotive. L’objet frappa un pâté de maisons situé juste en face de l’église et démolit de fond en comble des bâtiments à plusieurs étages. Des éclats de projectiles et des débris pénétrèrent par les fenêtres de l’église. Une panique se produisit parmi les fidèles. Beaucoup se précipitèrent vers la sortie, lorsque le tir ayant été rectifié télégraphiquement par les aviateurs anglais, le second obus éclata devant le portail principal de la cathédrale. Il fit dans le gazon des parterres et dans le pavé des marches qui donnent accès à l’église un entonnoir d’environ 6 mètres de largeur et 3 mètres de profondeur. Les éclats tuèrent et blessèrent un certain nombre de femmes et de jeunes filles qui se pressaient hors de l’église. Les gens affolés refluèrent alors vers l’intérieur dans l’espoir de trouver un abri plus sûr sous les voûtes. Pendant que sur le parvis les mourants et les blessés mutilés se roulaient dans leur sang avec des cris affreux, un troisième obus, tiré après une nouvelle rectification tomba dans la cathédrale même, où il détruisit la nef transversale sud. Le portail latéral sud fut complètement enlevé et lancé dans la rue, une partie des piliers extérieurs fut brisée, et les lourdes pierres de taille en quartz et en calcaire de Givet furent détachées de la maçonnerie, de sorte que le côté sud de la cathédrale a dû être appuyé par un mur provisoire de soutènement en briques, pour éviter l’écroulement. Pendant ce temps, les batteries côtières allemandes empêchaient par leur feu la continuation du bombardement. Un quatrième obus, également destiné à la cathédrale selon toute apparence, tomba encore dans le voisinage de l’édifice.
Il est absolument impossible que ces coups dirigés contre la cathédrale, après les rectifications. indiquées par les aviateurs, aient été des coups de hasard. Les pièces de marine anglaises ne tirent pas si mal. Il est de même inadmissible que les destructions ne soient pas reconnaissables sur les clichés des aviateurs anglais, comme le prétend le télégramme officiel de démenti. Ces subterfuges sont l’effet d’une mauvaise conscience et sont réduits à néant devant tout le monde civilisé par les photographies publiées du côté allemand. Le mensonge officiel anglais est aussi lâche et méprisable que le criminel attentat des Anglais contre l’église d’une station de bains de mer encore toute pleine aujourd’hui des souvenirs de l’hospitalité dont les Anglais ont été les hôtes assidus autrefois.»
in Les brutalités envers les prisonniers – notes du gouvernement allemand aux puissances neutres – publié avec l’agrément du ministère allemand des affaires étrangères, Berlin, Carl Heymanns Verlag, 1918, p. 65-66
bourreurs de crâne
Auxence Guizart était agriculteur et fils d’agriculteurs. Il était originaire de Crépy dans le Pas-de-Calais ; il avait dix-neuf ans en 1914 et fut mobilisé tout comme ses deux frères. Auxence est mort pendant le mois d’avril 1918, dans la Somme près de Montdidier.
« Le 13 novembre 1916
Chers parents,
(…) Il y a beaucoup de poilus qui se iront encore évacuer aujourd’hui pour pieds gelés. Quant aux miens, ils ne veulent pas geler malheureusement car je voudrais bien une évacuation aussi. Il n’y fait pas bon ici en arrière : ce sont les avions qui font des ravages terribles et en avant c’est loin de marcher comme les journaux vous annoncent. Ceux-ci sont des bourreurs de crâne pour encourager le civil, n’y croyez rien, comme je vous ai déjà dit c’est la guerre d’usure en bonshommes, en tout. Je termine pour aujourd’hui en vous embrassant de grand cour. »
in GUÉNO, J-P, (s. d.), Paroles de poilus : lettres et carnets du front 1914-1918, Paris, Librio, 2001, p. 73
poste
« Virginy, le 28 novembre 1914
Tu ne peux croire le plaisir que cela fait quand on reçoit un colis, on est comme de grands enfants ici. Un rien te contente comme un rien t’attriste.Tu vois tous ces pères de famille, au courrier, l’oeil et l’oreille aux aguets, épier et attendre s’il y a une lettre ou un colis pour eux. Quand ils n’en ont pas, quelle déception ! Quand ils ont une lettre ils ont le sourire, vivement ils la décachettent, avidement la parcourent pendant que d’un revers de main, ils écrasent la larme qui était au coin de l’œil.
Ton ami [anonyme] »
in GUÉNO, J-P, (s. d.), Paroles de poilus : lettres et carnets du front 1914-1918, Paris, Librio, 2001, p. 93
censure
« 3 décembre 1917
La censure, tu le sais, est impitoyable ici et certains pauvres poilus ont appris à leurs dépens qu’ils ne devaient pas avoir la langue trop longue, ni même recevoir des lettres (qui sont d’ailleurs supprimées) sur lesquelles les parents ont souvent aussi la langue un peu longue. C’est révoltant mais c’est ainsi. Il semblerait qu’une lettre est une chose sacrée, il n’en est rien. Sois donc prudente, ma chérie, et si tu veux que je reçoive toutes tes lettres, ne me parle pas de la guerre. Contente-toi de me parler de notre grand amour, cela vaut beaucoup plus que tout.
Gros bécot,
Henri Bouvard »
in GUÉNO, J-P, (s. d.), Paroles de poilus : lettres et carnets du front 1914-1918, Paris, Librio, 2001, p. 92
chant
« Le 11 juillet 1917
L’exercice ne s’arrête pas comme tu pourrais le croire à l’exercice de la baïonnette et à la gymnastique. Non, il y a encore une troisième pause et celle-là est consacrée au chant. Parfaitement, mon vieux, on nous fait chanter maintenant, comme autrefois à l’école : La Marseillaise, Le Chant du départ et La Madelon (chanson de marche). Donc à la troisième pause, le moniteur de gymnastique se transforme en chef d’orphéon et tout le monde chante, naturellement.
Pierre Rullier »
in GUÉNO, J-P, (s. d.), Paroles de poilus : lettres et carnets du front 1914-1918, Paris, Librio, 2001, p. 64
Pauvre Radjpoute
« Dans la prairie, des appels et des cris de douleur à l’accent exotique s’élevaient. Ces voix nous rappelèrent les coassements des grenouilles qu’on entend dans les prés après un orage. Nous découvrîmes dans l’herbe haute une file de morts et trois blessés qui, soulevés sur leurs coudes, nous suppliaient de les épargner. Ils semblaient convaincus que nous allions les égorger.
A ma question : » Quelle nation ? « , l’un répondit : » Pauvre Radjoute ! « .
Nous avions donc devant nous des Hindous venus d’au-delà des mers pour se fracasser la tête dans ce coin perdu contre des fusiliers hanovriens. Pauvres types ! »
in Ernst Jünger, Orages d’acier , Christian Bourgois (coll. » Folio » No 539).
bombardement
Raoul Pinat est né en 1896 à Valence. Sa famille était originaire du Dauphiné, et don père était polytechnicien et militaire de carrière. Après avoir commencé la guerre comme simple soldat, Raoul finira lieutenant et deviendra exploitant agricole après l’armistice, puis, au fil des ans, assureur et papetier.
» 22 avril 1917
La cagna s’est effondrée. Il y a encore des vivants dessous. Ma foi, tant pis pour le bombardement : je cours chercher ma pioche au fond de la sape et, entre deux salves, je cours vers la cagna.
Lepeule prend une pelle : en hâte nous déblayons un peu. Il y a quatre hommes dessous : c’est affreux !…
Une voix nous appelle : « Dépêchez-vous, je meurs, j’étouffe ! – Où es-tu ? – Là, là… » C’est profond… c’est profond ! Il va étouffer sûrement. L’obus est tombé juste sur la cagna ; tout a cédé : les poutres, les étais, les rondins sont en poudre. La terre a comblé tout ça. Les malheureux ont un mètre de débris au-dessus d’eux ! Lepeule appelle : « Qui êtes-vous ? – Revenaz. – Et les autres ? – Je ne sais pas. » Il appelle encore : personne d’autre ne répond.
Cependant le bombardement s’est arrêté depuis un instant. Plusieurs servants de la 7e batt. accourent avec des outils. On se hâte : cette voix suppliante qui monte de terre nous électrise. Lepeule, voyant du monde au travail en nombre suffisant, lâche sa pelle, et, calme, comme toujours, prend une photo de l’ensemble. « Attention ! !… en voilà un !… » Tous se sauvent, affolés, nerveux…. L’obus hurle, siffle : il est sur nous ! – non. Il nous inonde de terre, de pierres, d’éclats de bois.
Fontaine, deux poilus de la 7, et moi sommes seuls restés. Vite, nous continuons. Enfin, voilà sa main. On voit d’abord la terre bouger, puis sa main crispée apparaît. Je la lui serre ; il hurle de joie : « Vite, vite, dépêchez-vous, j’étouffe. »
Le bombardement reprend : c’est affreux ; l’avion doit nous voir… [il faut comprendre que l’aviateur sert d’observateur à l’artillerie] Un obus un 150 tombe à quelques mètres de nous : il nous jette pêle-mêle à terre… L’un dit : « Foutons le camp ; on va se faire tuer ! – Non, restons, ça ne se commande pas, il faut sortir cet homme ! » On reste. La sueur nous inonde tant nous peinons pour enlever vite la terre, les morceaux de poutres, les pierres…
« Cette main ? Est-ce ta main droite ? – Oui ! – Où est ta tête ? »
« Dessous, dessous ! J’ai la main levée, en l’air ! »… Oh ! ce qu’il y en a de terre !… et ces obus qui nous radinent toujours dessus !…
Ah ! la terre est chaude ici : en suivant son bras qui est levé en effet, voilà sa tête ici ; elle a chauffé la terre ; son baleine suinte à travers une mince couche de terre ; sa voix est plus distincte. Avec précaution je gratte avec les mains : voilà ses cheveux, son front… Vite, vite : sa bouche. Enfin il respire plus à l’aise. C’est bien Revenaz. « Pauvre vieux, tu en vois une dure ; t’en fais pas, on t’en tirera… t’as fini la guerre, te bile pas ! » Ces paroles le remontent un peu : il cesse cette espèce de râle d’angoisse qu’il faisait tout le temps. »
Raoul Pinat, Carnet de guerre, in GUÉNO, J-P, (s. d.), Paroles de poilus : lettres et carnets du front 1914-1918, Paris, Librio, 2001, p. 53
porte-manteau boche, cadavres partout
Michel Taupiac dit « François » avait vingt-neuf ans en 1914. Il était le fils d’ouvriers agricoles du Tarn-et-Garonne. Il avait l’habitude d’écrire souvent à son ami Justin Cayrou. Il survécut à la guerre.
« Dimanche 14 février 1916
Cher ami,
Quand nous sommes arrivés par ici au mois de novembre, cette plaine était alors magnifique avec ses champs à perte de vue, pleins de betteraves, parsemés de riches fermes et jalonnés de meules de blé. Maintenant c’est le pays de la mort, tous ces champs sont bouleversés, piétinés, les termes sont brûlées ou en ruine et une autre végétation est née : ce sont les petits monticules surmontés d’une croix ou simplement d’une bouteille renversée dans laquelle on a placé tes papiers de celui qui dort là. (…) J’étais l’autre jour dans les tranchées [des Joyeux]. Je n’ai jamais rien vu de si horrible. Ils avaient étayé leurs tranchées avec des morts recouverts de terre, mais, avec la pluie, la terre s’éboule et tu vois sortir une main ou un pied, noirs et gonflés. Il y avait même deux grandes bottes qui sortaient dans la tranchée, la pointe en l’air, juste à hauteur, comme des porte-manteaux. Et les « joyeux » y suspendaient leurs musettes, et on rigole de se servir d’un cadavre boche comme porte-manteau. Je ne te raconte que des choses que je vois, autrement je ne le croirais pas moi-même. (…) »
in GUÉNO, J-P, (s. d.), Paroles de poilus : lettres et carnets du front 1914-1918, Paris, Librio, 2001, p. 90
Maurice Drans avait vingt-trois ans en 1914. Fils de commerçants, il avait fait ses études au Mans. Blessé trois fois durant la guerre, il y survécut.
« (…) Avant-hier soir, dans l’encre bleue de la nuit, je parcourais sur la terre les signes de croix de l’au-delà… C’était l’éparpillement macabre du cimetière sans couverture, sans croix, abandonné des hommes, les gisements épars des cadavres innombrables, sans sépultures, le charnier à nu dans le grouillement des vers et dans les pluies d’obus qui continuaient. Plus d’un millier de cadavres se tordaient là déchiquetés, charries les uns sur les autres… Je traînais de la nuit vers les lignes, mon fardeau de pièces sur le dos ; je défaillais ; dans ma bouche, dans mes narines ce goût, cette odeur ; l’ennemi et le Français sympathisant dans le rictus suprême, dans l’accolade des nudités violées, confondus, mêlés, sur cette plaine de folie hantée, dans ce gouffre traversé de rafales vociférantes. L’Allemand et le Français pourrissant l’un dans l’autre, sans espoir d’être ensevelis jamais par des mains fraternelles ou pieuses. Aller les recueillir, c’est ajouter son cadavre dans cette fosse toujours béante, car insatiable est la guerre… Chaque nuit, nous plongeons cette géhenne pétrifiée où s’agitent les spectres, le cour chaviré, nous bouchant le nez, les lèvres crispées. »
in GUÉNO, J-P, (s. d.), Paroles de poilus : lettres et carnets du front 1914-1918, Paris, Librio, 2001, p. 81
FRATERNISATION
Gervais Morillon était le fils d’un contremaître poitevin qui travaillait dans une pépinière à Breuil-Mingot, tout près de Poitiers. Gervais fut tué à vingt-et-un ans en mai 1915.
« Tranchées-Palace, le 14 décembre 1914,
Chers parents,
Il se passe des faits à la guerre que vous ne croiriez pas ; moi-même, je ne l’aurais pas cru si je ne l’avais pas vu ; la guerre semble autre chose, eh bien, elle est sabotée. Avant-hier – et cela a duré deux jours dans les tranchées que le 90e occupe en ce moment – Français et Allemands se sont serré la main ; incroyable, je vous dis ! Pas moi, j’en aurais eu regret.Voilà comment cela est arrivé : le 12 au matin, les Boches arborent un drapeau blanc et gueulent : « Kamarades, Kamarades, rendez-vous. » Ils nous demandent de nous rendre « pour la frime ». Nous, de notre côté, on leur en dit autant ; personne n’accepte. Ils sortent alors de leurs tranchées, sans armes, rien du tout, officier en tête ; nous en faisons autant et cela a été une visite d’une tranchée à l’autre, échange de cigares, cigarettes, et à cent mètres d’autres se tiraient dessus ; je vous assure, si nous ne sommes pas propres, eux sont rudement sales, dégoûtants ils sont, et je crois qu’ils en ont marre eux aussi.
Mais depuis, cela a changé ; on ne communique plus ; je vous relate ce petit fait, mais n’en dites rien à personne, nous ne devons même pas en parler à d’autres soldats.
Je vous embrasse bien fort tous les trois. »
in GUÉNO, J-P, (s. d.), Paroles de poilus : lettres et carnets du front 1914-1918, Paris, Librio, 2001, p. 78-79
Gustave Berthler était un instituteur de la région de Chalon-sur-Saône. Il habitait Sousse, en Tunisie. Mobilisé en août 1914, Gustave a été tué Le 7 juin 1915 à Bully-les-Mines. Il avait vingt-huit ans.
« Le 28 décembre 1914
Ma bien chère petite Alice,
Nous sommes de nouveau en réserve pour quatre jours, au village des Brebis. Le service tel qu’il est organisé maintenant est moins fatigant. Quatre jours aux tranchées, quatre jours en réserve. Nos quatre jours de tranchées ont été pénibles à cause du froid et il a gelé dur, mais les Boches nous ont bien laissés tranquilles. Le jour de Noël, ils nous ont fait signe et nous ont fait savoir qu’ils voulaient nous parler. C’est moi qui me suis rendu à 3 ou 4 mètres de leur tranchée d’où ils étaient sortis au nombre de trois pour leur parler.
Je résume la conversation que j’ai dû répéter peut-être deux cents fois depuis à tous les curieux. C était le jour de Noël, jour de fête, et ils demandaient qu’on ne tire aucun coup de fusil pendant le jour et la nuit,eux-mêmes affirmant qu’ils ne tireraient pas un seul coup. Ils étaient fatigués de faire la guerre, disaient-ils, étaient mariés comme moi (ils avaient vu ma bague), n’en voulaient pas aux Français mais aux Anglais. Ils me passèrent un paquet de cigares, une boîte de cigarettes bouts dorés, je leur glissai Le Petit Parisien en échange d’un journal allemand et je rentrai dans la tranchée française où je fus vite dévalisé de mon tabac boche.
Nos voisins d’en face tinrent mieux leur parole que nous. Pas un coup de fusil. On put travailler aux tranchées, aménager les abris comme si on avait été dans la prairie Sainte-Marie. Le lendemain, ils purent s’apercevoir que ce n’était plus Noël, l’artillerie leur envoya quelques obus bien sentis en plein dans leur tranchée.(…) »
in GUÉNO, J-P, (s. d.), Paroles de poilus : lettres et carnets du front 1914-1918, Paris, Librio, 2001, p. 79-80
Les soldats face aux officiers
» Lorette ! nom sinistre évoquant des lieux d’horreur et d’épouvante, lugubres bois, chemins creux, plateaux et ravins pris et repris vingt fois et où pendant des mois, nuit et jour, on s’égorgea, se massacra sans arrêt, faisant de ce coin de terre un vrai charnier humain, et cela par l’obstination criminelle de notre état-major qui savait bien qu’une décision ne pouvait sortir de cette guerre de détail, de ces attaques par petits paquets; mais ils avaient imaginé cette guerre d’usure, croyant bêtement que les Allemands seraient, à ce jeu, usés les premiers.
» je les grignote « , dit cette vieille bedaine de Joffre, mot que la presse servile recueillit comme une perle rare, et cette offensive stérile et sanglante dura plusieurs mois. »
in les Cahiers de guerre de Louis Barthas, tonnelier, Maspero, 1978.
Va-y mon gars !
« Vas-y, mon gars, dans la fournaise, Vas-y, mon gars, sous les obus, Ecras’le Boch’comme un’ punaise, Et puis jett’-le aux détritus ! Hohenzollern, sal’ rac’ maudite, Qu’y n’en rest’ plus un seul debout, Ca s’ fourr’ partout, c’est comm’ les mites, Pour les avoir va jusqu’au bout !
Ça renver’ tout’s nos théories, Tu vas me traiter d’assassin, Parc’ que j’ t’envoie à la bouch’rie, Pour te fair’ tuer comme un vieux chien, Tu vas m’dir’qu’y z’ont ci’ la famille, Qu’ce sont des homms comm’nous enfin, Qu’on Il se fâch’ pas pour des vétilles, Et qu’avant tout faut être humain.
Tu vas m’ dir’ que l’seul responsable, C’est leur Kaiser, ce chenapan, Et que ce s’rait épouvantable, De les traiter tous su’ l’ mêm’ plan, Mais, mon p’tit gars, pense à tes frères, Qui ont déjà versé leur sang, A Lill’, Roubaix et Armentières, A ceux qui sont sous l’joug allemand. »
in Raymond Davy, poème d’un militant socialiste , décembre 1917. Archives de la Somme.
Les villages détruits
» Combles A 10 km au nord-ouest de Péronne (Somme) ne présentait plus, pour autant qu’on pût s’en rendre compte dans l’obscurité, que le squelette d’une agglomération.
Des maisons entières avaient été aplaties ou fendues en deux par un coup de plein fouet, si bien que les chambres avec leur mobilier pendaient comme des coulisses de théâtre au-dessus du chaos. Une odeur de cadavres sortait de ces décombres, car le premier bombardement avait complètement surpris par sa soudaineté les habitants, et en avait enterré un grand nombre sous les ruines, avant qu’ils n’eussent pu sortir de chez eux.
Le village de Guillemont semblait avoir complètement disparu,- seule, une tache blanchâtre parmi les entonnoirs signalait encore l’endroit où le calcaire de ses maisons avait été pilé. Devant nous, nous avions la gare, fracassée comme un jouet d’enfant, et plus loin, derrière, le bois de Delville, haché en copeaux. »
Ernst Jünger, Orages d’acier , Christian Bourgois (coll. » Folio » No 539)








