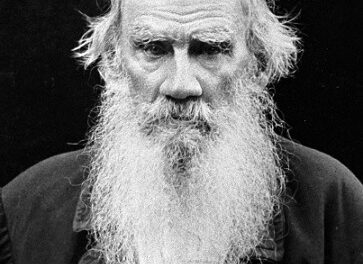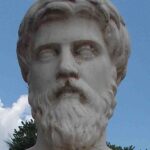La rencontre diplomatique entre Donald Trump et Vladimir Poutine, le 15 août 2025 en Alaska, fait ressurgir la question de cette dernière et ce, même si le sujet principal de la rencontre est consacré à l’Ukraine. En effet, depuis le milieu des années 2000, s’il est notoirement connu que le nationalisme russe milite pour une récupération de gré ou de force de tout ou partie de l’Ukraine, des Pays baltes et d’un certain nombre d’autres territoires, la question de l’Alaska n’est jamais évoquée ; pourtant, les revendications russes à son sujet sont réelles.
Territoire situé au nord du continent américain, séparé de la Russie par la mer de Béring et le détroit du même nom, l’Alaska est découverte en 1741, officiellement par un marin danois au service de la Russie, Vitus Jonassen Béring que l’Empereur Pierre le Grand avait chargé de cartographier les territoires situés entre la frontière orientale de la Russie et le continent nord-américain : dans les faits, l’Alaska. Cela marque le début de l’implantation de la Russie sur le continent américain. La Compagnie russe d’Amérique est créée en 1799 par Grigori Chelikhov et Nikolaï Rezanov et elle est financée par l’Empereur de Russie Paul Ier qui lui accorde par une charte le monopole du commerce des fourrures sur toutes les possessions russes en Amérique du Nord. Un tiers des bénéfices revenait à l’Empereur.
Mais, à partir des années 1820, l’Alaska n’est plus un territoire attractif économiquement, tandis que l’évolution géopolitique en Europe rend ce territoire difficile à conserver, et que la guerre de Crimée (1853-1856) achève de vider les caisses de la Russie.

L’idée de se séparer et de vendre l’Alaska aux États-Unis émerge en Russie dès 1857. Si, dans un premier temps, les États-Unis ne prêtent pas attention à cette idée, elle finit par aboutir 10 ans plus tard. Cette vente est surtout le produit de la volonté de deux hommes : Edouard de Stoeckl pour la Russie et Henry Seward pour les États-Unis. Le baron Edouard Andreïevitch de Stoeckl (1804-1892), fils d’un diplomate, est promu envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de Russie à Washington, le 21 février 1857. Il a 53 ans et très vite les soirées de l’ambassadeur deviennent le lieu mondain par excellence de Washington. Dans les années 1858 et 1859, Stoeckel participe à des entretiens secrets avec le sénateur démocrate de Californie William Gwin concernant la cession de l’Alaska, rencontres qu’il résume régulièrement par courriers au prince Alexandre Mikhaïlovitch Gortchakov, ministre des affaires étrangères de Russie. L’affaire est finalement conclue le 30 mars 1867 pour la modique somme de 7,2 millions de dollars (l’équivalent de 4,5 dollars le mètre carré).
L’extrait que nous vous proposons provient d’un article publié en avril 1920 dans The American historical review, revue d’histoire scientifique créée en 1895 sur le modèle de l’English Historical Review et de la Revue historique française. Si les extraits choisis ne mentionnent pas l’action de Seward pour lequel l’achat de l’Alaska répond à sa vision continentale de l’Amérique, il met par contre en avant les motivations russes et l’action de Stoeckl en faveur de la vente de l’Alaska, qui, selon lui, ne valait finalement plus un kopec.
Version française :
[…] Le véritable promoteur de la vente de l’Alaska n’était autre que le grand-duc Constantin, frère du tsar Alexandre II. Entre le 23 mars et le 4 avril 1857, il écrivit une lettre à Gorchakov pour l’inciter à transférer les possessions russes en Amérique [l’Alaska] aux États-Unis. Il donna trois raisons pour lesquelles cela devait être fait : la faible valeur des colonies pour la Russie, le grand besoin d’argent et la nécessité pour les États-Unis de compléter leurs possessions dans le Pacifique. Il suggéra que, pour déterminer la valeur des terres, les officiers à la retraite de la compagnie, le baron Wrangell et d’autres personnes qu’il nomma, soient consultés, mais il mit en garde contre le fait de prendre leurs chiffres trop au sérieux, car ils étaient actionnaires de la compagnie. La question fut soumise à Wrangell, qui fixa le prix de vente des colonies à 7 442 800 roubles d’argent, dont la moitié devait aller à la compagnie en paiement de ses 7 484 actions et l’autre moitié au gouvernement.
Au cours du mois, Gorchakov fit un rapport au grand-duc sur la base de l’avis et des estimations de Wrangell. Il expliqua la nécessité de faire preuve de prudence et de discrétion afin de ne pas nuire aux intérêts de la Compagnie russe d’Amérique. À cette époque, la compagnie connaissaient des différends avec la Compagnie commerciale russe américaine de San Francisco au sujet d’un contrat conclu en 1853, et Gorchakov proposa de laisser l’affaire en suspens jusqu’à ce que ces différends soient réglés.
À Washington, Stoeckl avait du mal à protéger les intérêts de la Compagnie russe d’Amérique. Chaque année, de plus en plus d’Américains s’installaient dans le territoire de l’Oregon, et cette colonisation le mettait mal à l’aise. « L’établissement des Américains », écrivait-il à Nesselrode en janvier 1856, «à proximité de nos possessions du Nord-Ouest les mettra en danger réel et deviendra une source d’embarras et de harcèlement entre les deux gouvernements». En novembre 1857, il rapportait à Gorchakov que la situation devenait très embarrassante. Selon le traité du 5/17 avril 1824 entre la Russie et les États-Unis, il était convenu «que les citoyens des États-Unis ne se rendraient en aucun lieu où se trouvait un établissement russe sans l’autorisation du gouverneur ou du commandant ; et que, réciproquement, les sujets russes ne se rendraient dans aucun établissement des États-Unis sur la côte nord-ouest sans autorisation». La Russie appliqua cet article du traité ; les États-Unis ne le firent pas. […]
À cette époque, une pression indirecte pour vendre l’Alaska vint d’une source inattendue. Dans une lettre adressée à Gorchakov, datée du 20 novembre/2 décembre 1857 rédigée depuis Washington, Stoeckl rapporta une conversation qu’il avait eue récemment avec Buchanan au sujet de Brigham Young et des Mormons, et de l’information selon laquelle ils prévoyaient de s’installer soit sur le territoire de la Compagnie de la Baie d’Hudson, soit sur celui de la Compagnie russo-américaine. Stoeckl demanda au président si les mormons partaient en conquérants ou en colons. À cela, le président répondit en riant que cela lui importait peu, à condition de s’en débarrasser. À cela s’ajoutait une lettre de l’agent de la compagnie à San Francisco demandant des informations sur la migration des mormons en Alaska. Stoeckl était quelque peu inquiet de ces rumeurs et ne savait pas quelle importance leur accorder. Il ne manqua pas cependant d’attirer l’attention de son gouvernement sur eux et de faire remarquer que si les Mormons venaient, la Russie serait obligée soit de les combattre, soit de leur céder du territoire.
[…]
À un moment donné, entre 1858 et 1859, Stoeckl se rendit à Petrograd pendant ses vacances et discuta de l’Alaska avec Gorchakov. Ils convinrent que si les États-Unis faisaient une nouvelle offre d’achat du territoire, celle-ci devrait être sérieusement étudiée. Vers la fin de l’année 1859, cette initiative fut prise. Le 4 janvier 1860 (N. S.), Stoeckl rapporta que Gwin l’avait récemment approché au sujet de la vente de l’Alaska et lui avait assuré que le président était prêt à l’acheter. Quelques jours plus tard, Gwin aborda à nouveau le sujet et dit à Stoeckl que Buchanan souhaitait que le gouvernement russe soit consulté sur la question et que, pour l’instant, les discussions à ce sujet devaient se faire avec le secrétaire d’État adjoint, Appleton, et non avec Cass, le secrétaire, qui était délibérément tenu à l’écart. Au cours de la conversation, Gwin mentionna incidemment que les États-Unis seraient prêts à payer jusqu’à cinq millions de dollars. Pour Stoeckl, cela semblait une somme importante, supérieure à la valeur actuelle ou future des colonies du point de vue des revenus, et probablement autant que les États-Unis seraient prêts à donner. Sans recommander directement la vente, Stoeckl réussit néanmoins à glisser indirectement quelques arguments convaincants en sa faveur. Il a souligné que la situation dans le Pacifique avait complètement changé au cours du siècle.
Le commerce des fourrures, qui occupait autrefois une position dominante, était en train de disparaître, remplacé par l’agriculture, le commerce et l’industrie, qui se développaient rapidement. Mais les possessions russes en Amérique, en raison de leur situation géographique, ne pouvaient espérer se développer dans ce sens et allaient donc prendre du retard par rapport aux autres régions de la côte. Si la compagnie devait à l’avenir, comme par le passé, dominer les colonies, la situation ne ferait sans doute qu’empirer ; et si le gouvernement devait les reprendre, personne ne pouvait être certain que cela améliorerait la situation. D’autre part, les colonies n’avaient aucune importance pour la Russie et ne pouvaient être protégées ; toute puissance navale en guerre avec la Russie pouvait s’en emparer en les attaquant. Enfin, et c’était là le coup de grâce, en cédant l’Alaska aux États-Unis, l’Angleterre serait grandement déconcertée. La conquête de la Californie par les Yankees avait été le premier coup dur porté aux ambitions de la Grande-Bretagne dans le Pacifique, et l’acquisition de l’Alaska y mettrait définitivement fin. Coincée entre l’Oregon et l’Alaska, la Colombie-Britannique n’aurait pas de grand avenir.
Parmi les documents du ministère russe des Affaires étrangères, il existe un rapport sur les colonies russes, daté du 7 février 1860, rédigé par un anonyme qui s’était rendue en Californie et en Alaska. Il y a lieu de croire que l’auteur était le contre-amiral Popov, qui avait navigué dans le Pacifique Nord à cette époque. Il écrivait fréquemment au grand-duc Constantin, qui jouait un rôle de premier plan dans la direction des affaires navales de la Russie et qui a probablement transmis des copies à Gorchakov. Le rapport brosse un tableau sombre de la grande misère que la Compagnie russe d’Amérique avait infligée aux autochtones d’Alaska, des dommages qu’elle avait causés à ce territoire et du préjudice qu’elle avait causé au commerce russe. Selon le rapport, la compagnie ne pense qu’aux dividendes, et les seuls à profiter de son existence sont les actionnaires. Elle détient le monopole du commerce dans le Pacifique Nord, ce qui suscite une profonde rancœur chez les Américains qui y vivent ; sans Stoeckl, le sénateur Gwin aurait déjà porté l’affaire devant le Congrès. Non seulement la compagnie ne sert pas les intérêts de la Russie, mais elle aliénait la bonne volonté d’un peuple ami. Il est facile, poursuit l’auteur, pour les Européens de se moquer de la doctrine Monroe et de la « Destinée manifeste », mais s’ils connaissaient mieux les Américains, ils sauraient que ces idées sont dans leur sang et dans l’air qu’ils respirent. Il y a vingt millions d’Américains, tous libres et convaincus que l’Amérique appartient aux Américains. Ils ont pris la Californie, l’Oregon, et tôt ou tard, ils prendront l’Alaska. C’est inévitable. […]
Source : Franck B. Golder « The purchase of Alaska« , The American Historical Review, n°3, avril 1920, p. 411-423, extraits
Version américaine d’origine :
[…] The real promoter of the sale of Alaska was no other than the Grand-duke Constantine, brother of the Tsar Alexander II. On March 23/April 4, 1857, he wrote a letter to Gorchakov urging the transfer of the Russian American possessions to the United States. He gave three reasons why this should be done: the small value of the colonies to Russia, the great want of money, and the need of the territory by the United States to round out its holdings in the Pacific. He suggested that in order to determine the worth of the property the retired officers of the company, Baron Wrangell and others whom he named, should be consulted, but he cautioned against taking their figures too seriously, since they were stockholders of the company. The matter was referred to Wrangell, and he put the selling price of the colonies at 7,442,800 rubles silver, one-half of it to go to the company in payment for its 7484 shares and the other half to the government.
In the course of a month Gorchakov made a report to the grand-duke based on the opinion and estimates given by Wrangell. He explained the necessity of caution and secrecy in order not to injure the interest of the Russian American Company. At that time the company was having some misunderstandings with the American Russian Commercial Company of San Francisco about a contract made in 1853, and Gorchakov proposed to let the matter rest until these differences were adjusted.
Stoeckl in Washington was having trouble in protecting the interests of the Russian American Company. Each year more and more Americans were settling in the Oregon Territory, and this colonization made him uneasy. « The establishment of the Americans, » he wrote to Nesselrode in January, 1856, « in the vicinity of our Northwest possessions will put them in real danger and will become a source of embarrassment and harassment between the two governments. » In November, 1857, he reported to Gorchakov that the situation was becoming very embarrassing. According to the treaty of April 5/17, 1824, between Russia and the United States, it was agreed « that the citizens of the United States shall not resort to any point where there is a Russian establishment, without the permission of the governor or commander ; and that, reciprocally, the subjects of Russia shall not resort, without permission, to any establishment of the United States upon the Northwest coast. » Russia enforced this article of the treaty ; the United States did not. […]
About this time indirect pressure to sell Alaska came from an unexpected quarter. In a letter to Gorchakov, dated Washington, November 20/December 2, 1857, Stoeckl related a conversation he had had recently with Buchanan about Brigham Young, the Mormons, and the report then current that they planned to settle either in the territory of the Hudson’s Bay Company or in that of the Russian American Company. Stoeckl asked the President whether the Mormons were going as conquerors or as colonists.To this the President laughingly replied that it mattered little to him which, pro- vided he got rid of them. On the top of this came a letter from the company’s agent in San Francisco asking for information on the subject of the Mormon migration to Alaska. Stoeckl was somewhat worried by these rumors and did not know just how much impor- tance to attach to them. He did not fail, however, to call the attention of his government to them and to remark that if the Mormons should come, Russia would be obliged either to fight them or to give up territory to them.
[…]
At some time during 1858-1859, Stoeckl went to Petrograd on his vacation and while there discussed Alaskan affairs with Gorchakov. It was agreed between them that if America should make another move to purchase the territory, it should be considered seriously. Towards the end of 1859, the move came. On January 4, 1860 (N. S.), Stoeckl reported that Gwin had approached him recently on the matter of the sale of Alaska and had assured him that the President was ready to buy. A few days later, Gwin brought up the subject again and told Stoeckl it was Buchanan’s wish that the Russian government should be sounded on the question and that, for the present, discussion on the subject should be with the assistant secretary of state, Appleton, and not with Cass, the secretary, who was purposely left in the dark. In the course of the conversation, Gwin incidentally mentioned that the United States would be willing to pay as high as five million dollars. To Stoeckl, this seemed a large sum, more than the colonies were then worth or would ever be worth from the point of view of revenue, and probably as much as the United States would ever be willing to give. Without directly recommending the sale, Stoeckl nevertheless managed to slip in indirectly a few telling arguments in its favor. He pointed out that the situation on the Pacific had completely changed in the course of the century.
The fur trade, which at one time held a commanding position, was becoming a thing of the past, and in its place agriculture, commerce, and industry were rapidly developing. But the Russian American possessions, because of their geographic position, could not hope to grow along these lines and would therefore drop behind the other parts of the coast. If the company should in the future, as in the past, dominate the colonies, the situation would undoubtedly grow worse; and if the government should take them over no one could be certain that it would improve. Then again, the colonies were of no importance to Russia and could not be protected ; any naval power at war with Russia could get them by going after them. Finally, and this was the shot intended to reach home, by the handing of Alaska to the United States England would be greatly discomfited. The conquest of California by the Yankees was the first effective blow to Great Britain’s ambitions in the Pacific, and the acquisition of Alaska would put an end to them altogether. Sandwiched in between Oregon and Alaska, British Columbia could have no great future.
Among the documents in the Russian Ministry of Foreign Affairs, there is a paper on the Russian colonies, dated February 7, 1860, written by someone who had been in California and Alaska. There is reason to believe that the author was Rear-Admiral Popov, who had cruised in the North Pacific around that time. He frequently wrote to Grand Duke Constantine, who played a leading role in guiding Russia’s naval affairs and who probably transmitted copies to Gorchakov. The report paints a grim picture of the great misery the Russian American Company had brought upon the natives of Alaska, the harm it had done to that territory, and the injury it had caused to Russian commerce. All the company thinks about, says the report, is dividends, and the only people who profit by its existence from are the shareholders. It has a monopoly of the trade in the North Pacific, and this is deeply resented by the Americans who live there ; and were it not for Stoeckl, Senator Gwin would have brought the matter to the attention of Congress before now. Not only is the company not advancing the interest of Russia, but it is actually alienating the good-will of a friendly people. It is easy enough, the writer goes on to say, for Europeans to sneer at the Monroe Doctrine and « Manifest Destiny, » but if they were better acquainted with Americans, they would know that these ideas are in their very blood and in the air they breathe. There are twenty million Americans, every one of them a free man filled with the idea that America is for Americans. They have taken California, Oregon, and sooner or later, they will get Alaska. It is inevitable. […]
Source : Franck B. Golder « The purchase of Alaska« , The American Historical Review, n°3, avril 1920, p. 411-423, extraits