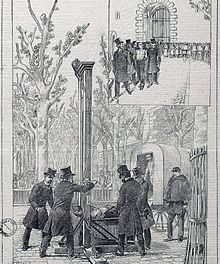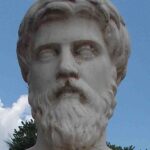Dès la Libération en 1944, la France engage une vaste épuration pour sanctionner les collaborateurs du régime de Vichy. Si, dans un premier temps, celle-ci est marquée par des violences extra-judiciaires, assez vite, le Gouvernement provisoire de la République française présidé par le général de Gaulle établit un cadre légal avec la création des cours de justice, des chambres civiques et la reconstitution de la Haute Cour, le 18 novembre 1944, chargée de juger les responsables politiques. En parallèle, après avoir été contraint de suivre les Allemands à Sigmaringen situé au sud-ouest de l’Allemagne, Pétain obtient finalement l’autorisation de partir pour la Suisse, où il refuse l’asile politique, préférant se remettre aux autorités françaises afin de défendre son honneur. Il est remis aux autorités françaises, le 26 avril 1945.

C’est dans ce climat d’attente et de tension que s’ouvre, le 23 juillet 1945, le procès du maréchal Pétain, présidé par Paul Mongibeaux. Le ministère public est représenté par le procureur général André Mornet, président honoraire de la Cour de cassation, tandis que l’instruction est assurée par Pierre Bouchardon, président de la commission de la Haute Cour. Le jury est constitué de vingt-quatre personnes : douze parlementaires et quatre suppléants, et de douze non-parlementaires issus de la Résistance auxquels sont adjoints également quatre suppléants.
Interné au fort de Montrouge, Pétain est défendu par Fernand Payen, Jacques Isorni et Jean Lemaire. Si l’opinion publique est divisée, le Parti Communiste Français n’hésite pas à réclamer la condamnation à mort. Lors de l’ouverture du procès, il refuse de reconnaître la légitimité de la Haute Cour et annonce qu’il ne répondra à aucune question, laissant ses avocats parler pour lui. C’est dans ce contexte et après la clôture des témoignages (dont celui de Pierre Laval), que le 11 août après-midi, le procureur général Mornet prononce un réquisitoire sévère dénonçant la « France déshonorée », et s’attachant à démontrer la trahison du Maréchal.
Messieurs,
Pendant quatre années – que dis-je pendant quatre années ! – À l’heure actuelle encore, la France est victime d’une équivoque, la plus redoutable qui puisse jeter le trouble dans les esprits, celle qui à la faveur d’un nom illustre sert de paravent à la trahison.
Oh ! Messieurs, je sais quel mot je viens de prononcer, un mot dont le rapprochement avec l’homme qui est ici sonne péniblement, je vous assure, aux oreilles de ceux qui savent et dont les illusions se sont dissipées, qui par contre provoque la crédulité, l’étonnement, l’indignation même chez ceux qui ne savent pas et dont les illusions persistent.
Ce sont ceux-là qu’il importe de convaincre, ceux qui de bonne foi doutent encore. Aussi bien, après la satisfaction donnée à la conscience nationale, est-ce là le but principal de ce procès, celui que pour ma part je m’efforcerai d’atteindre. Et par cela même si vous dire que c’est sans passion, m’imposant à moi-même un frein toutes les fois que les mots risqueraient de traduire trop exactement les sentiments que j’éprouve, si vous dire que c’est sans passion, objectivement, que j’envisage ici la tâche que je me suis assignée.
Cette tâche, je la conçois comme une démonstration, mais une démonstration découlant tout naturellement de faits après l’exposé objectif desquels j’espère que la vérité apparaîtra aux yeux de tous, de tout ceux du moins qui veulent bien l’apercevoir.
Et d’abord, messieurs, définissons de quel genre de trahison il s’agit ici. Loin de moi la pensée d’assimiler les faits reprochés au Maréchal à ces marchés brutalement cyniques où délibérément l’on vend sa patrie pour satisfaire une rancune ou un intérêt inavouable. Mais, comme dit La Rochefoucauld, la trahison joue toutes sortes de personnages, même celui de serviteur loyal et désintéressé du pays.
Or, parmi les formes qu’elle peut revêtir, la plus grave est celle que je définirai, une atteinte portée aux intérêts sacrés de la patrie dans des circonstances et dans des conditions telles que les mobiles auxquels obéit l’auteur paralysent en lui le réflexe national et lui font perdre la notion de certaines choses qu’aucune nation ne peut pardonner à ceux qui lui en infligent la honte.
Or, ce qu’une nation ne peut pardonner à ceux qui la représentent, c’est de la condamner à accepter définitivement sa défaite, de lui dire : « tu es définitivement vaincue, ne songe pas à te relever dans les rapports avec ton vainqueur ; résigne-toi à prendre place derrière lui dans l’ordre d’une Europe germanisée ».
En second lieu, ce qu’une nation ne peut pas pardonner à un homme, c’est de l’humilier à la face du monde, c’est de l’asservir à son vainqueur et l’asservir à ce vainqueur au point de le prendre pour modèle, d’adopter ses lois, ses préjugés et jusqu’à ses haines.
Enfin, une troisième chose qu’une nation ne peut pas pardonner à ceux qui prétendent la représenter, c’est, sous le couvert d’une neutralité hypocrite, au mépris des engagements pris envers ses compagnons d’armes de la veille, de leur faire une guerre sournoise, d’apporter à l’ennemi commun une aide à peine camouflée. Une nation, en effet, ne peut pas pardonner ce qui la déshonorent.
Eh bien, ce sont ces trois ordres de griefs que l’accusation reproche aujourd’hui au maréchal Pétain. Trois ordres de griefs reposant sur des faits dont je puis vous dire que l’information avait à peine à vous apporter la preuve, car c’est de l’histoire contemporaine encore présente à l’esprit de tous. Ce sont des faits qu’il suffit d’exposer, non pas seulement dans leur ordre chronologique, mais dans leur ordre logique, car ils revêtent un enchaînement inéluctable.
Ce que par contre l’accusation vous doit, c’est d’expliquer comment, à son âge, avec son passé l’homme qui est ici a pu se laisser aller jusqu’à jouer dans le drame dont la France était l’enjeu le rôle qu’il a amené jusqu’à cette audience. Ce qu’il faut vous exposer, ce sont les mobiles auxquels obéit cet homme.
Ces mobiles, ils sont de deux sortes. Et d’abord, une ambition ? Non, le mot est impropre, une vanité du pouvoir pour le pouvoir, vanité jointe à un instinct autoritaire qui semble se développer avec l’âge, et, à côté, la haine du régime qui a précédé, cette haine assortie d’une joie toute maurassienne qui faisait dire à quelques-uns de l’entourage du Maréchal : la République est morte ; cela vaut bien une défaite.
Attentat contre la République, c’est ainsi qu’a commencé l’affaire Pétain. Telle est à l’origine et telle elle demeure, mais suivie nécessairement d’une série d’attentats contre la nation, parce que le maintien des résultats de l’attentat contre le régime ne pouvait être obtenu qu’à l’aide d’une entente avec l’envahisseur au préjudice même de la nation.
Et c’est là, messieurs, ce qui différencie l’affaire Pétain de ces marchés brutalement cyniques, où l’objet principal du marché, c’est la livraison de la patrie. Ici, l’objet principal c’est la destruction du régime, la destruction du régime et son remplacement par un régime nouveau qui ne peuvent être obtenus qu’à l’aide d’une entente avec l’envahisseur.
Et c’est ce qui fait que pendant ces quatre années qu’on voudrait pouvoir rayer de notre Histoire, crimes contre le régime et crimes contre la sûreté extérieure de l’État, se confondent à tel point qu’il est parfois malaisé de les distinguer les uns des autres, tant il est vrai qu’au cours de ces quatre années jamais la France et la République n’ont été aussi indissolublement liées l’une à l’autre.
Deux mobiles, vous disais-je, ayant déterminé Pétain : d’abord la vanité du pouvoir pour le pouvoir, assortie d’un instinct autoritaire, et, pour vous en apporter la preuve, je n’ai que l’embarras du choix dans les multiples déclarations du Maréchal, les documents mêmes qui émanent de lui.
Je vous demande pardon des nombreuses lectures que j’aurais à faire, et je commence.
« Cette politique est la mienne » dit-il aux Français dans son message du 30 octobre [1940], au lendemain de Montoire. Et pour bien montrer qu’il l’a fait sienne, sous son autorité personnelle, « Les ministres, dit-il, ne sont responsables que devant moi ; c’est moi seule que l’Histoire jugera ». Et il termine par ces mots : « je vous ai tenu jusqu’ici le langage d’un père, je vous tiens aujourd’hui le langage d’un chef ».
« Seule responsable devant l’Histoire », avez-vous mesuré, Messieurs, tout l’orgueil qui vient dans une pareille phrase ? Orgueil assorti de l’obéissance qu’il exige de tous les Français, une obéissance qu’il symbolise en quelque sorte dans le serment qu’il impose à tous les fonctionnaires, serment sans aucune valeur, je l‘ai dit déjà, serment dont le refus eût été aussi dépourvu de portée qu’il était au lieu de l’imposer sous l’œil de l’envahisseur, serment prêté à la personne du chef de l’Etat, de sorte que s’il avait trouvé quelques valeurs aujourd’hui, il se trouverait prêté au général de Gaulle. Mais le Maréchal a tenu à lui donner la portée qu’il entendait être la véritable, c’est-à-dire d’un serment à sa personne, et je n’en veux d’autres preuves que son allocution devant le conseil d’État lorsqu’il est venu recueillir le serment de cette assemblée le 21 août 1941.
« Il faut se prononcer, a t-il dit. On est avec moi ou contre moi. C’est la portée du serment que je suis venu entendre ». […]
Procès du maréchal Pétain – présidence de Monsieur le premier président Mongibeaux – 18e audience – audience du samedi 11 août 1945, réquisitoire du procureur général Mornet, extrait de : Le procès du maréchal Pétain : compte rendu sténographique, Paris, 1945, Albin Michel, collection Grands procès contemporains dirigée par Maurice Garçon, de l’Académie française, extrait du tome 2 pages 893-896.
Pour aller plus loin :
- Podcast en 3 épisodes sur le site de Radio France : Pétain, général, maréchal, traître disponible : ICI
- Laurent Joly (dir) Vichy. Histoire d’une dictature. 1940-1944, Tallandier, 2025, 558 pages.