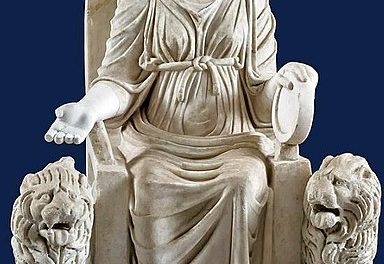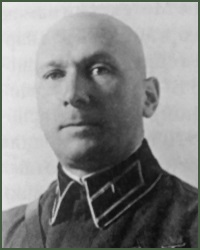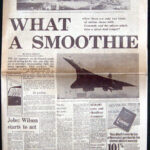Le 18 novembre 2025, le général d’armée Fabien Mandon, chef d’état-major des armées françaises, provoquait une onde de choc en déclarant devant le 107e Congrès des maires de France qu’il fallait « accepter de perdre nos enfants » et « souffrir économiquement » pour préparer la nation à un conflit de haute intensité dans « trois à quatre ans ». Au-delà de la violence des termes employés, cette intervention marquait explicitement le basculement vers une posture de réarmement moral et matériel face à la menace russe, le général affirmant que « ce qu’il nous manque, c’est la force d’âme pour accepter de nous faire mal pour défendre la nation ». Le chef d’État-major des armées demande aux maires de préparer la population aux futurs conflits. L’allocution, qui appelait les édiles locaux à devenir des relais de cette préparation psychologique collective, ravivait – consciemment ou non – une maxime latine vieille de seize siècles : Igitur qui desiderat pacem, praeparet bellum (« Donc, que celui qui désire la paix prépare la guerre »), extraite du prologue du Livre III de l’Epitoma rei militaris de Flavius Vegetius Renatus, haut fonctionnaire impérial de la fin du IVe siècle ap. J.-C.
Une citation tronquée qui a traversé les siècles …
Cette citation, généralement abrégée en Si vis pacem, para bellum, constitue l’un des adages stratégiques les plus galvaudés de la culture occidentale. Popularisée sous cette forme condensée dès le Moyen Âge, elle a connu une fortune politique et rhétorique considérable, du maréchal de Saxe à Frédéric II de Prusse, en passant par son inscription dans les débats sur le réarmement européen des années 1930 et, désormais, dans la rhétorique sécuritaire du XXIe siècle. Or, cette instrumentalisation contemporaine repose sur un double malentendu historique : d’une part, la formule abrégée ne figure pas textuellement chez Végèce ; d’autre part, elle réduit drastiquement une pensée stratégique autrement plus nuancée, ancrée dans un contexte de déclin impérial et de nostalgie républicaine. Comme l’a souligné Philippe Richardot dans ses travaux sur la culture militaire médiévale, la postérité de Végèce tient moins à la pertinence tactique de ses prescriptions qu’à sa capacité à produire des « formules-chocs » détachables de leur substrat historique.
L’historiographie contemporaine, notamment depuis l’édition critique d’Étienne Famerie et Jacques-Henri Michel (2015), s’est attachée à réhabiliter l’Epitoma comme « compendium ordonné de la tradition militaire romaine » plutôt que comme simple « compilation nostalgique ». Les recherches récentes insistent sur la dimension prescriptive du traité : Végèce ne décrit pas l’armée romaine tardive telle qu’elle existe, mais formule un projet de réforme adressé à l’empereur (probablement Théodose Ier ou Valentinien III) dans un contexte de pression barbare accrue. Le prologue du Livre III, d’où provient la célèbre maxime, s’insère dans une argumentation plus large sur la nécessité d’une discipline préventive : « Quantum autem in proeliis Lacedaemoniorum disciplina profuerit » (« Combien la discipline des Lacédémoniens profita dans les batailles »), rappelle Végèce en citant les exemples de Xanthippe et d’Hannibal, avant de conclure sur la trilogie stratégique : préparation militaire (praeparet bellum), formation rigoureuse des soldats (milites imbuat diligenter), et art tactique contre le hasard (dimicet arte, non casu). La sentence finale – « Nemo provocare, nemo audet offendere quem intellegit superiorem esse, si pugnet » (« Personne n’ose provoquer, personne n’offense celui qu’il sait supérieur au combat ») – révèle le véritable enjeu : non pas la glorification de la course aux armements, mais l’éloge de la dissuasion par la préparation.
… alors que l’auteur reste largement inconnu
Pourtant, entre le texte de Végèce et sa réception contemporaine, s’ouvre un abîme de sens. L’intervention du général Mandon, en convoquant l’imaginaire du sacrifice collectif et de l’effort de guerre, actualise une lecture belliciste de Végèce que le Bas-Empire romain ne connaissait pas sous cette forme. Là où l’auteur antique théorisait une pédagogie militaire comme rempart contre la virtus imprévisible et la fortuna capricieuse, le discours contemporain mobilise la maxime pour légitimer une montée en puissance capacitaire face à une menace étatique identifiée (la Russie).
Nous vous proposons donc de (re)découvrir le texte originel de Végèce. De ce dernier, on sait peu de choses. Mort en 450 après J.-C., Végèce est un haut fonctionnaire de l’ouest de l’Empire et un écrivain romain, très certainement chrétien, auteur de trois œuvres dont le succès n’a jamais faibli jusqu’à l’époque moderne. Le premier, intitulé Epitoma rei Militari (celui qui nous intéresse ici) porte sur l’armée et la tactique militaire romaine, les deux autres portant sur la médecine vétérinaire, et le soin des bovidés. Epitoma rei Militari se présente comme un manuel pratique d’environ 120 pages réparties en cinq livres où Végèce, qui a lu les auteurs latins qui l’ont précédé, compile des connaissances du passé. Ce livre est avant tout un ensemble de propositions, adressées à l’Empereur, sur les mesures à prendre pour sauver l’Empire romain de la catastrophe.
Version française (traduction personnelle)
Les annales anciennes rapportent que les Athéniens et les Lacédémoniens exercèrent l’hégémonie avant les Macédoniens. Mais les Athéniens brillèrent non seulement dans l’art militaire mais aussi dans diverses disciplines, tandis que les Lacédémoniens firent de l’art de la guerre leur priorité absolue. La tradition atteste qu’ils furent les premiers à théoriser l’art du combat, en tirant les leçons de l’expérience des batailles, au point qu’ils transformèrent l’art militaire – qu’on attribue généralement au seul courage ou, du moins, à la fortune – en une discipline relevant d’un savoir technique, et confièrent à des instructeurs militaires – qu’ils nommèrent tacticiens – le soin d’enseigner à leur jeunesse les techniques et tactiques de combat. Ô hommes qui méritent la plus haute admiration, eux qui voulurent apprendre avant tout cet art sans lequel les autres arts ne peuvent exister ! Héritiers de ces principes, les Romains ont conservé les préceptes de l’art militaire dans la pratique comme dans la théorie. Ces préceptes, dispersés dans de nombreux ouvrages, tu m’as ordonné, invincible empereur, de les synthétiser, pour éviter que l’abondance ne lasse le lecteur ou que la brièveté ne nuise à la crédibilité. L’efficacité de la discipline lacédémonienne dans les batailles est démontrée, entre autres, par l’exemple de Xanthippe qui, intervenant seul au secours des Carthaginois contre Atilius Regulus et l’armée romaine souvent victorieuse, non par le courage mais par l’art stratégique, ayant écrasé les légions, le captura et le vainquit, mettant fin à toute la guerre en une seule bataille. De même Hannibal, avant de marcher vers l’Italie, s’attacha les services d’un instructeur spartiate, sur les conseils duquel, bien qu’inférieur en nombre et en forces, il anéantit de nombreux consuls et de puissantes légions. Donc, que celui qui désire la paix prépare la guerre ; que celui qui désire la victoire forme soigneusement ses soldats ; que celui qui souhaite des résultats favorables combatte par l’art, non par le hasard. Personne ne provoque, personne n’offense celui qu’il sait supérieur au combat.
Version latine :
Athenienses et Lacedaemonios ante Macedonas rerum potitos prisci locuntur annales. Verum apud Athenienses non solum rei bellicae sed etiam diuersarum artium uiguit industria, Lacedaemoniis autem praecipua fuit cura bellorum. Primi denique experimenta pugnarum de euentibus colligentes artem proeliorum scripsisse firmantur usque eo, ut rem militarem, quae uirtute sola uel certe felicitate creditur contineri, ad disciplinam peritiaeque studia reuocarent ac magistros armorum, quos tacticos appellauerunt, iuuentutem suam usum uarietatemque pugnandi praeciperent edocere. O uiros summa admiratione laudandos, qui eam praecipue artem ediscere uoluerunt, sine qua aliae artes esse non possunt ! Horum sequentes instituta Romani Martii operis praecepta et usu retinuerunt et litteris prodiderunt. Quae per diuersos auctores librosque dispersa, imperator inuicte, mediocritatem meam abbreuiare iussisti, ne uel fastidium nasceretur ex plurimis uel plenitudo fidei deesset in paruis. Quantum autem in proeliis Lacedaemoniorum disciplina profuerit, ut omittam cetera, Xanthippi decleratur exemplo, qui Atilium Regulum Romanumque exercitum saepe uictorem, cum Karthaginiensibus non uirtute sed arte solus ferret auxilium, prostratis exercitibus cepit ac domuit unoque congressu triumphans bellum omne confecit. Nec minus Hannibal petiturus Italiam Lacedaemonium doctorem quaesiuit armorum, cuius monitis tot consules tantasque legiones inferior numero ac uiribus interemit. Igitur qui desiderat pacem, praeparet bellum; qui uictoriam cupit, milites inbuat diligenter ; qui secundos optat euentus, dimicet arte, non casu. Nemo prouocare, nemo audet offendere quem intellegit superiorem esse, si pugnet.
Source : Végèce Épitomé de l’art militaire, Livre III, prologue
Le texte, peu acccessible en français, est disponible dans sa version latine ICI. L’ une des rares versions françaises dont la traduction a été assurée par Etienne Famerie a été publiée aux Presses universitaires de Liège et est disponible ICI
Choix du texte et commentaires : Ludovic Chevassus
Mise en forme et présentation de la vie de Végèce : Cécile Dunouhaud