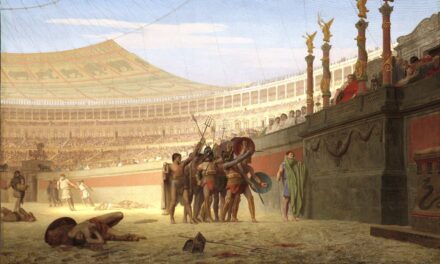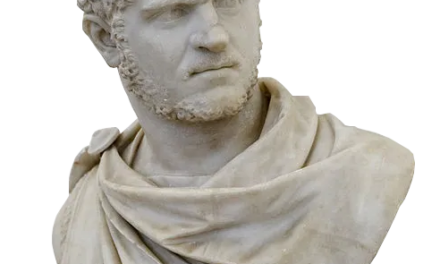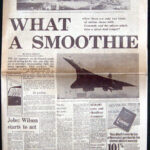Cicéron (106-43 av. J.-C.) est né dans une famille de rang équestre. Il fréquente les plus grands rhéteurs et, en tant qu’avocat, obtient de notables succès. Intellectuel prolifique, il est l’auteur d’une œuvre philosophique majeure et d’une abondante correspondance. Sa carrière politique le mène jusqu’au consulat et finit de manière sinistre: Antoine exigera qu’on l’égorge.
Dans l’extrait de La République1 présenté ci-dessous (la traduction est celle figurant dans le petit ouvrage Rome par les textes de Sylvie Laigneau-Fontaine, pp.53-55), Cicéron insiste sur l’excellence du choix du site de Rome par Romulus.
Celui-ci repose sur un « triptyque gagnant »: éloignement de la mer afin de préserver la Ville des dangers; prémunition contre toutes les « nouveautés »; lutte contre le luxe et les prodigalités.
Dans ce texte au relent des plus conservateurs, Cicéron exalte les valeurs « ancestrales » de Rome garantit par sa localisation par opposition à la « décadence » des cités ouvertes sur le monde. On relèvera le morceau de bravoure constitué par les songeries des habitants qui « s’exilent et vagabondent en pensée »…
1 : la traduction est celle figurant dans le petit ouvrage Rome par les textes de Sylvie Laigneau-Fontaine, pp.53-55.
« Quant à l’emplacement à choisir pour la ville, celui qui vise à jeter les fondements d’un État durable doit s’en préoccuper avec un soin tout particulier ; Romulus choisit un site d’une convenance merveilleuse. En effet, il ne s’établit pas près de la mer (…) ; en homme d’une exceptionnelle clairvoyance, il se rendit compte avec netteté que les régions côtières ne convenaient pas du tout aux ville fondées avec l’espoir d’un empire qui durerait longtemps. La première raison est que les villes situées au bord de la mer sont exposées à des dangers non seulement multiples, mais aussi dissimulées. A l’intérieur des terres, l’arrivée des ennemis, qu’elle soit attendue ou même inopinée, se révèle par bien des signes: par un brusque fracas et aussi par le bruit sourd de leur approche. (…) Au contraire, l’ennemi dont la flotte traverse la mer peut être là avant que personne ne soupçonne qu’il viendra et, en approchant, il ne relève ni qui il est, ni d’où il vient, ni même ce qu’il veut ; bref, il n’y a pas le moindre indice qui permette de discerner avec certitude si ses intentions sont pacifiques ou hostiles.
En second lieu, les villes du littoral sont exposés aussi à des éléments corrupteurs, qui amènent une transformation des mœurs ; elles sont contaminées par des innovations dans les paroles et la conduite ; on n’y importe pas seulement des marchandises mais des mœurs exotiques, si bien qu’aucune institution ancestrale ne peut demeurer intacte. Bientôt, les habitants de ces cités ne tiennent plus en place, mais leurs songeries les emportent, sur les ailes de l’espérance, toujours plus loin de leurs demeures, et même quand leurs corps restent là, ils s’exilent et vagabondent en pensée. Rien ne contribua davantage à rendre longtemps chancelantes et enfin à renverser Carthage et Corinthe que ces voyages sans fin, qui dispersaient les citoyens ; en effet, poussés par l’amour du commerce et de la navigation, ils avaient délaissé l’agriculture et l’entraînement militaire. D’autre part, la mer procure soit du butin, soit des importations, qui encouragent dangereusement ces cités au luxe ; enfin, le charme même des lieux fait naître bien des tentations de se livrer à la prodigalité et à la fainéantise ; et ce que j’ai dit de Corinthe, peut-être pourrait-on le dire en toute vérité de toute la Grèce ».
Cicéron, La République, II, 3-6.