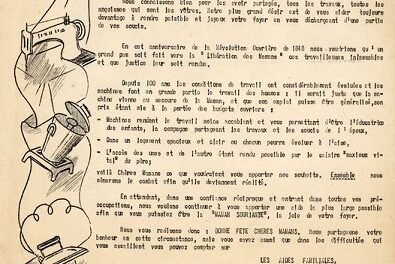Les femmes espagnoles furent actrices à part entière de la guerre civile qui ravagea leur pays pendant près de trois ans. Elles subirent des violences propres à leur genre et furent également victimes, comme les hommes, d’emprisonnements, d’assassinats ou d’exécutions ordonnées par une justice expéditive. Même si les hommes constituent l’immense majorité des victimes éliminées pendant la guerre d’Espagne, le sort réservé aux femmes ne doit pas être considéré comme un détail de l’histoire.
Les textes présentés sont issus des mémoires de Gumersindo de Estella (1880-1974) publiés en 2003, près de 30 ans après sa mort, sous le titre « Fusilados en Zaragoza 1936-1939 Tres años de asistencia espiritual a los reos » (Fusillés à Saragosse 1936-1939 trois ans d’assistance spirituelle aux prisonniers).
Gumersindo de Estella est un religieux franciscain de l’ordre des Capucins depuis 1900. Doté d’une solide culture religieuse et h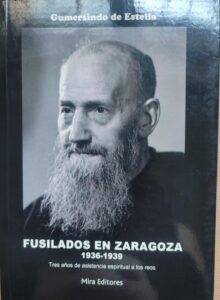
Selon ses mémoires, c’est lui qui demande à assister volontairement les prisonniers et les prisonnières condamnés à mort, détenus dans la prison de Torrero, à Saragosse. Homme animé par une foi chrétienne profonde, il sait qu’il ne peut rien contre la justice (ou plus exactement l’injustice) des hommes, mais croit de tout son être que si celui ou celle qui va mourir se réconcilie avec Dieu, son âme sera sauvée et accédera à la vie éternelle ; mais toujours dans le respect de la conscience et des convictions de chacun.
Le texte des mémoires de Gumersindo de Estella a été élaboré à partir des carnets personnels que le religieux rédigeait au jour le jour. C’est la raison pour laquelle il peut parfois indiquer l’identité des victimes et donner des détails précis. Ces carnets ont servi de matière première à la rédaction des mémoires, dont la première version a été rédigée vers 1945 et la deuxième, celle qui a été publiée en 2003, vers 1950.
Les extraits choisis concernent le cas de trois femmes qui vont être fusillées au petit matin. C’est la première fois (mais pas la dernière) que le religieux est appelé pour des femmes et assiste à leur exécution, comme il le fait à chaque fois pour tous les condamnés. Dans son récit, Gumersindo de Estella traduit sa profonde émotion du fait que ce sont des femmes qui sont victimes ; émotion partagée, semble t-il, par de nombreux soldats chargés de la basse besogne.
On remarquera que le motif de la condamnation à mort est assez futile : les trois femmes ont cherché à passer en zone républicaine et n’ont pas de sang sur les mains. Le récit aborde aussi le drame des enfants en bas âge de ces femmes et qui leur sont enlevés. Cette question des enfants des femmes républicaines arrachées à leur mère est en soi un vrai sujet d’histoire, non seulement pendant la guerre civile, mais aussi pendant la dictature franquiste. Le récit du drame fait par Gumersindo de Estella peut être lu comme une critique de l’inhumanité de la répression franquiste, le mot de « caudillo » employé par l’auteur n’étant pas choisi au hasard.
22 septembre 1937. Trois femmes
Je pensais avoir au moins un jour de répit. Mais il n’y en pas eu. Le 21, alors que je me préparais à me coucher, je reçois le message suivant : « De la part du directeur de la prison, vous devez vous rendre à la prison demain à l’aube ; vous en connaissez déjà l’objet… »
Avant cinq heures du matin le 22 [septembre 1937], le père Victor et moi sommes allés à la prison dans la voiture du médecin.
« Combien d’exécutions sont prévues aujourd’hui ? » ai-je demandé en entrant.
—Trois femmes et un homme— fut la réponse.
Je ne pus réprimer un mélange de surprise et de dégoût. Je pensais en mon for intérieur que pour tuer une femme, il fallait un crime plus grave que pour tuer un homme. Une femme pouvait-elle vraiment être si dangereuse pour un régime ou un État ? Un gardien de prison m’expliqua que ces femmes et un homme (qui allait lui aussi être fusillé avec elles) avaient tenté de passer en zone républicaine dans le même camionnette que les soldats fusillés la veille. L’une des femmes s’appelait Celia ; on m’a dit qu’elle était l’épouse d’un anarchiste nommé Durruti, qui combattait dans l’armée républicaine contre Franco sur le front d’Aragon. Une autre s’appelait Margarita Navascués, et son mari se trouvait également en zone républicaine. La troisième était une jeune femme de 22 ans, prénommée Simona Blasco. Les deux premières tenaient dans ses bras un enfant d’environ un an, ou un peu plus. C’étaient leurs filles. « Et qu’est-ce qu’ils vont faire de ces créatures ? » ai-je demandé. On me répondit que deux religieuses avaient déjà été appelées à la prison pour qu’on les conduise à la maternité. Mais la tâche de leur arracher leurs filles n’était pas aussi facile qu’ils le supposaient.
J’étais entré dans la chapelle, où tout était prêt pour la messe. De là, j’entendis des cris déchirants de femmes. Quel concert horrible et poignant… ! Cris, gémissements, sanglots, hurlements de :
– « Ma fille… ! Ne me l’enlevez pas ! Je vous en supplie, ne me la volez pas. Qu’on la tue avec moi… ! Je veux l’emmener dans l’autre monde… ! »
– « Je ne veux pas laisser ma fille à ces bourreaux ! Tuez-la avec moi ! Ma fille chérie… Qu’est -ce que tu vas devenir… ! »
Et d’autres phrases de ce style. Pendant ce temps, avait éclaté une lutte féroce : les gardiens qui tentaient d’arracher les bébés des bras et du sein de leurs mères, tandis que les pauvres mères qui défendaient leurs trésors de toutes leurs forces. Je n’ai pas vu cette scène depuis la chapelle, une scène à vous briser de douleur un cœur de pierre. Mais les gardiens de prison me rapportaient ce qui se passait.
Je ne savais que faire. Attendre que les pauvres femmes entrent dans la chapelle ? Me rendre à la salle d’identification, distante de douze pas de la chapelle ? Peut-être cette dernière option n’est-elle pas prudente, et je ne sais même pas si on me l’autorisera, car le tribunal militaire s’y trouve, avec le directeur et ses assistants. Tout un chacun peut imaginer mon état d’esprit. En entendant les enfants pleurer et qui refusaient de quitter les bras de leur mère, terrifiés à la vue des gardes, en entendant les cris déchirants de ces pauvres femmes, j’avais l’impression que mon cœur se brisait en morceaux, et qu’on m’arrachait l’âme. N’y avait-il donc aucun moyen de remédier à l’horrible malheur de ces mères et de ces enfants innocents ? Jamais je n’aurais cru devoir assister à une telle scène dans un pays civilisé ! Dans aucun pays civilisé ! Jamais je n’aurais cru qu’il puisse exister un roi ou un chef ou un Caudillo sur terre ayant le pouvoir d’ordonner une chose pareille. À quiconque prendrait cette décision, je dirais : « Soit vous pardonnez à ces pauvres mères, soit vous êtes un être sans cœur et dépourvu de toute humanité… ! » Voilà ce que je me disait intérieurement.
[…] Dès que les gardes se furent emparés des enfants, ils attachèrent les mains des mères et de la jeune femme, puis firent de même avec l’homme, et nous sortîmes aussitôt dans la rue où le véhicule nous attendait. Montèrent dans la voiture les deux prêtres, les quatre prisonniers et quelques gardes civils.
Pendant le trajet vers le mur du cimetière (1), les femmes continuaient à crier d’angoisse, à sangloter, à protester, et aussi à apostropher durement les autorités : « Ma fille ! » (criaient-elles en pleurant), « adieu, qu’est-ce que tu vas devenir ? Rendez-la-moi, tuez-la avec moi ! Bourreaux ! Cruels ! Tigres ! Vous n’avez pas le droit de me voler ma pauvre fille ! » En même temps qu’elle prononçaient ces mots et d’autres du même genre, elles se levaient et regardaient la prison que nous laissions derrière nous, et elles levaient les mains au ciel et faisaient mine de sauter du véhicule… J’essayai de leur parler. Mais elles ne m’écoutaieent pas. La jeune Simona Blasco était un peu moins décomposée que ses compagnes et prêtait attention à ce que je leur disais. Et je crois qu’elle a embrassé mon crucifix ; mais je n’en suis pas sûr.
Lorsque nous aperçûmes les soldats, qui étaient au moins une centaine, une des femmes cria :
-Tant d’hommes pour tuer trois femmes… !
« Ce ne sont pas des hommes, ce sont des tigres… ! » ajouta l’un de ses compagnes.
« Il y aura qui viendront pour venger notre mort… ! » ajouta la troisième femme en sautant du camion.
Ces dernières paroles furent prononcées par la jeune Simona Blasco. Et nous nous mîmes en marche vers le lieu d’exécution. La marche la plus horrible de ma vie. Les trois femmes avançaient d’un pas chancelant, les mains liés, leurs robes défaites, les cheveux en désordre, flottant sur leur front et quelques mèches retombant sur leurs épaules ; et en même temps, elles sanglotaient et protestaient contre les cruautés dont elles étaient l’objet.
Les femmes et l’homme alignés, dos aux fusils et face au mur [du cimetière], on distinguait certains soldats qui laissaient transparaître une profonde émotion. Ils étaient répartis en groupes de six, vingt-quatre au total. On se dépêcha pour l’exécution afin de mettre fin à ce spectacle si poignant pour tout le monde . L’officier commandant leva son sabre… puis l’abaissa rapidement, traçant la ligne de la mort. La salve retentit. Les gémissements cessèrent…
Je leur accordai l’absolution. C’était la deuxième fois que je leur donnais. Avant que le lieutenant ne porte le coup de grâce, je m’éloignai de ce lieu comme un automate. J’étais tourmenté par l’idée que ces âmes n’avaient pas reçu le soin suffisant. Pourquoi ne les avait-on pas conduits à la chapelle ? Pourquoi cette précipitation à les faire sortir de prison ? Sans doute pour éviter que les cris des trois femmes n’inquiètent les autres détenues… […]
Gumersindo de Estella, Fusilados de Zaragoza – tres años de asistencia espiritual a los reos, 2003, p. 62-66
(1) : il s’agit du mur du cimetière où ont lieu les exécutions. La prison et le cimetière sont distants d’environ 400 mètres.
Traduction de l’espagnol proposée par Gilles Legroux
Version originale du texte en espagnol
Dia 22 de setiembre (1937). Tres mujeres
Yo creía que habría siquiera un día de tregua. Pues no la hubo. Cuando el dia 21 me disponía a acostarme, me traen el recado siguiente: “De parte del director de la prisión, que mañana vaya a la cárcel a madrugada; que ya sabe el objeto…».
Ya antes de las cinco de la mañana del día 22 subíamos a la prisión el P. Víctor y yo en el auto del médico.
-¿Cuántos hay para ser ejecutados hoy? -pregunté al entrar.
-Tres mujeres y un hombre-f ue la contestación.
No pude contener un gesto de extrañeza y desagrado. Pensé en mis adentros que para matar a una mujer es necesario un delito más grave que para matar a un hombre. ¿Tan peligrosa puede ser una mujer para un régimen o un Estado? Un oficial de prisiones me dijo que esas mujeres y un hombre (que sería fusilado también con ellas) habían intentado pasar a la zona de la República en la misma camioneta de los soldados fusilados el día anterior. Una de las mujeres se llamaba Celia; dijeron que era esposa de un anarquista apellidado Durruti que luchaba en ejército republicano contra Franco, en el frente de Aragón. Otra denominábase Margarita Navascués, la cual tenía también su marido en la zona de la República. La tercera era una jovencita por nombre Simona Blasco, de 22 años de edad. Cada una de las dos primeras tenía, en la carcel, en sus brazos una criatura de un año de edad cada una o poco mas. Eran hijitas suyas. «¿Y qué van a hacer con las dos criaturas? pregunté. Me contestó alguien que ya habían sido llamadas dos religiosas a la prisión para que las llevaran a la Casa de Maternidad. Pero la fanea de arrebatarles las hijas no era tan fácil como suponían.
Yo había entrado en la capilla, en la que estaba todo preparado para la misa. Desde allí oí gritos desgarradores de mujeres. ¡ Qué concierto tan horrible y tan emocionante…! Ayes, lamentos, sollozos, gritos de :
-¡Hija mía…! ¡No me la quiten! ¡Por compasión, no me la roben. Que la maten conmigo…! ¡Me la quiero llevar al otro mundo…!
-¡No quiero dejar a mi hija con estos verdugos…! ¡Matadla conmigo!, ¡hija de mi alma… Qué será de ti…!
Y otras frases de este estilo. Entre tanto se había entablado un lucha feroz: los guardias que intentaban arrancar a viva fuerza las criaturas del pecho y brazos de sus madres y las pobres madres que defendían sus tesoros a brazo partido. Yo no vi desde la capilla esta escena que hubiera partido de dolor a las piedras. Pero los oficiales de la cárcel iban refiriendo lo que acontecía.
No sabía qué hacer. ¿Esperar a que entren en la capilla las pobres mujeres? ¿Iré yo a la salita de identificación, que dista de la capilla doce pasos? Quizá esto último no es prudente, ni sé si me lo permitirán, por que allí está el juzgado militar, el director con sus auxiliares. Puede suponer cualquiera cuál era mi estado de ánimo. Al oír llorar a las criaturas que no querían salir de los brazos de sus madres y que se espantaban al ver a los guardias, al oír los gritos desgarradores de las infelices mujeres, sentía que el corazón se me despedazaba, me parecía que me arrancaban el alma a jirones. ¿Y no hay modo de remediar la horrible desgracia de las madres y de las criaturas inocentes..? Jamás creí que hubiera tenido que presenciar escena semejantes en païs civilizado! A cualquiera en país civilizado! Nunca creí que existiera en la tierra un rey o jefe o caudillo que tenga facultad para disponer semejante cosa. A cualquiera que eso dispusiera le diría : «¡O indulta Vd. a esas pobres madres, o es Usted un ser sin entrañas y sin sentimeientos humanitarios…! Esto pensaba yo interiormente.
El hombre que había de ser fusilado con las mujeres, entró en la capilla. Pero no recuerdo de él sino que aparentaba unos cuarenta años o algo menos. Su aspecto era vulgar, vestía pobremente. No habló apenas nada. Como no tengo apuntes acerca de él y, por otra parte, la escena de las pobres mujeres y sus gritos de angustia me embargaron toda la atención, no recuerdo si se confesó y si cumplió los deberes religiosos. Me parece recordar que no y que aquel día no se celebró la santa misa. En el momento en que los guardias se apoderaron de las criaturas, ataron las manos a las madres y a la joven, y lo mismo hicieron con el varón, y seguidamente salimos hacia la calle donde nos esperaba el vehículo. En él tomamos asiento los dos padres, los cuatro reos y algunos guardias civiles.
Durante la marcha hacia la tapia del cementerio, continuaban las mujeres sus gritos de angustia, sus sollozos, sus protestas y también apóstrofes durísimos contra las autoridades: «Hija mía (decían llorando y a voz en cuello), adiós, ¿qué será de ti…? ¡Que me la devuelvan, que la maten conmigo…! ¡Verdugos! ¡Crueles! ¡Tigres…! ¡No tenéis derecho a robarme mi pobre hija…!». Y diciendo estas y parecidas frases, se levantaban del asiento y miraban hacia la cárcel de la que nos íbamos alejando, y levantaban las manos al alto y hacían ademán de saltar del vehículo… Yo intenté dirigirles la palabra. Pero no me escuchaban. La joven Simona Blasco estaba algo menos descompuesta que sus compañeras y se fijaba en lo que les decía. Y creo que besó mi crucifijo; pero no estoy seguro de ello.
Cuando divisamos a los soldados, que eran lo menos un centenar, una de las mujeres gritó:
-¡Tantos hombres para matar a tres mujeres…!
-¡Esos no son hombres, son tigres…! -añadió una de sus compañeras.
-¡Ya quedarán quienes vengarán nuestra muerte…! -añadió la tercera al saltar del camión.
Esta última frase fue pronunciada por la joven Simona Blasco. Y comenzamos la marcha hacia el lugar de la ejecución. La marcha más horrible de mi vida. Las tres mujeres caminaban con paso vacilante, atadas las manos, el vestido descuidado, el cabello revuelto y desgreñado flotando sobre la frente y sobre los hombros algunas crenchas [sic] lacias; y al mismo tiempo sollozando y protestando contra las crueldades de que eran objeto.
Colocadas en línea, de espalda a los fusiles y mirando a la tapia tanto ellas como el varón, se destacaron algunos soldados que daban muestras de profunda impresión. Distribuyéronlos en grupillos de seis en total veinticuatro. Y hube prisa para la ejecución a fin de acabar con el espectáculo de emoción tan fuerte para todos, Levanté el sable el jefe… Lo bajó rápido describiendo la Línea de muerte, Sonó la descarga cerrada. Y cesaron los ayes…
Les di la absolución. Era la segunda que les daba. Y antes de que el teniente descargara los tiros de gracia, me alejé de aquel lugar caminando como un autómata. Me torturaba el pensamiento de que aquellas almas no habían sido atendidas suficientemente. ¿Por qué no se les llevó a la capilla? ¿Por qué tanta prisa para sacarlas de la cárcel? Sin duda, para que las demás reclusas no se soliviantaran con los gritos de las tres mujeres…
Al llegar a la puerta de mi convento, vi que me esperaban varias jóvenes, que eran de las que frecuentaban nuestra iglesia y pertenecían a la Acción Católica. Me preguntaron si Simona Blasco se había confesado antes de ser fusilada. Les dije que no había entrado en la capilla. Dieron muestras de gran sentimiento y una de ellas prorrumpió en llanto. Después me dijeron que Simona tenía un hermano que estaba en el frente de batalla, luchando en las líneas de Franco; que Simona era muy buena; que rezaba mucho por su hermano ante la imagen de la Virgen del Pilar y que cuando oraba, se ponía garbanzos debajo de las rodillas para sufrir como penitencia, a fin de merecer que su hermano tuviera buena suerte, Simona era amiga de ellas.
Gumersindo de Estella, Fusilados de Zaragoza – tres años de asistencia espiritual a los reos, 2003, p.62-66