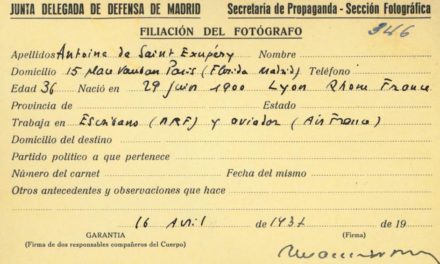Parmi les violations des droits humains et multiples scandales qui ont émaillé l’Espagne franquiste, l’affaire des bébés volés (Bebés robados) fut une des plus choquantes et des plus durables, puisqu’elle perdura largement après la mort de Franco, au temps de la démocratie, jusqu’en 1990.
Les associations de victimes avancent le chiffre hallucinant et à peine croyable de 300.000 bébés volés. Mais si on considère que ce scandale dura un demi-siècle, on obtient une moyenne annuelle de 6000 bébés, qui est plausible.
L’autre originalité de ce trafic d’enfants fut la part prise par des institutions liées à l’Eglise catholique espagnole. Celle-ci avait obtenu sous Franco une position privilégiée dans le domaine de l’enseignement et de la santé conçue comme une œuvre de charité. De nombreuses maternités dépendaient de congrégations religieuses et offraient donc le cadre adéquat au trafic de bébés. En deux mots, il s’agissait d’enlever, par différents moyens, des bébés nés du « péché » de mères célibataires pauvres pour les donner à de bonnes familles catholiques en mal d’enfant.
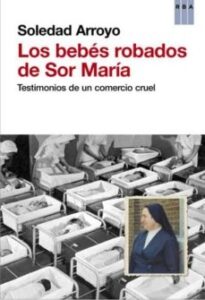
Les secrets de la grande voleuse d’enfants (extraits)
[…] Sœur Maria est morte [le 22 janvier 2013, à 88 ans]. Et avec elle, ont également disparu ses désormais célèbres carnets à couverture bleue, sa magnifique mémoire et sa superbe. «Elle avait toujours avec elle un cahier à couverture bleue, de la taille d’une feuille de papier. C’était une liste de parents qui avaient fait une demande d’adoption d’un enfant, avec les informations essentielles : noms, numéro de téléphone, adresse et des annotations sur l’argent. Tout y était écrit, y compris à quelle famille elle avait attribué tel enfant. Un jour, Sœur María a dû s’absenter et elle m’a expliqué qu’un couple allait venir et qu’il fallait les recevoir. L’ordre était clair : il fallait les inscrire en premier sur la liste. Quand la famille est arrivée, j’ai compris qu’elle les mettait en premier pour leur compte courant… Cette manœuvre de la religieuse m’a semblé fatale. Je me suis sentie utilisée. »
Ce n’est pas seulement Mayté qui le dit, la femme qui fait le portrait de la religieuse née en avril 1925 et avec qui elle a fait son service social à la maternité madrilène de Santa Cristina. Celles qui côtoyèrent la religieuse la décrivent comme autoritaire, rigide, arrogante, stricte et même sans pitié. Un profil peu adéquate pour une assistante sociale.
Mais sœur Maria était plus que cela. «Elle commandait beaucoup», raconte Montse, une assistante qui a travaillé à la maternité. « Et surtout, elle était capable d’affronter n’importe qui pour arriver à ses fins. »Elle se levait tôt et traversait la maternité de long en large. « On voyait toujours les autres religieuses et les infirmières aux mêmes endroits, mais elle, tu pouvais la trouver n’importe où », explique Mari, qui était femme de ménage à Santa Cristina.
« Laissez les enfants venir à moi », écrivait la religieuse ‘voleuse’ sur ses cartes de vœux de Noël. L’un des endroits où on la retrouvait fréquemment était en train de regarder les voitures qui se trouvaient dans le bureau à chaque étage. Celles d’entre nous qui travaillaient là-bas savaient qu’elle consultait l’état civil des femmes, car quand il y avait une femme célibataire, sœur María allait la trouver ». Cela semblait être son obsession : les femmes célibataires jeunes aux situations personnelles et économiques compliquées. Mila, une sage-femme chevronnée qui a étudié à Santa Cristina, se souvient que «Sœur María ne perdait pas de temps à des bêtises et commençait à nous faire la leçon dès le début. Nous devions l’avertir si une mère célibataire était admise à la maternité… « Qu’est-ce que ces femmes vont faire de ces enfants. Le mieux, c’est qu’elles donnent leurs enfants à l’adoption », répétait-elle.
Après avoir identifié des donneuses potentielles de bébés, elle entamait sa croisade avec des arguments bien rôdés : « As-tu pensé que cette créature pourrait avoir un avenir si tu lui permettais d’aller dans une bonne famille, avec des moyens? « Comme une araignée, elle tissait sa toile », explique Mila. « elles subissaient un lavage de cerveau de telle manière », ajoute Mari, « que beaucoup cédaient et signaient le consentement pour donner leurs enfants ».
Sa collègue femme de ménage, Ignacia Mármol, n’a pas réussi à effacer de sa mémoire la douleur de certaines mères : « J’ai vu beaucoup de femmes pleurer. Et donner des coups de pied, des coups de poing dans les lits pour demander pour leurs enfants. Ils disaient à la mère que l’enfant était mort, normalement c’est Sœur María qui s’en occupait. Et, bien sûr, il y avait des femmes qui ne se l’expliquaient pas : elles avaient eu le bébé, on l’avaient emmené à la crèche , et le bébé était mort… Où étaient les bébés ? Parce que je nettoyais le local, cela faisait partie de mon service. Où étaient ces enfants si, pendant les cinq ans que j’y ai été, je n’ai vu qu’une douzaine de cadavres d’enfants ? Je n’en ai pas vu plus ». Que les familles « aient des moyens » était un critère décisif pour que Sœur María mette un bébé dans les bras d’un couple marié. Parce que là-bas, les adoptions n’étaient pas bon marché. Les témoignages parlent d’entre 50. 000 et le million de pesetas. Cela était versée, soi-disant, pour couvrir les dépenses engendrées par la mère donneuse.
Formulaires et factures
Mari explique que « on en voyait beaucoup avec un certain niveau économique. Avec eux, elle [sœur María] était douce comme de la soie, rien à voir avec le traitement habituel qu’elle nous infligeait. Polie, respectueuse, souriante… Son bureau n’était pas dans ma zone, mais il y a eu un jour où j’ai dû y aller et la porte du bureau de Sœur María était entrouverte. J’ai pu voir un couple marié assis devant la table de la religieuse . La femme tenait un bébé dans les bras. J’ai remarqué que sur la table il y avait une petite pile de billets. J’ai calculé environ 250 000 pesetas ». […][Ce] que la religieuse n’est jamais venue avouer : les femmes étaient endormies pour leur enlever leurs enfants. Elles subissaient ce qu’on appelle « l’accouchement dirigé » : un goutte-à-goutte de pentothal sodique qui éliminait les douleurs et aussi la conscience pendant l’accouchement.
Conchi sut qu’ils étaient en train de l’endormir : « Ils m’ont mis la perfusion et ils m’ont piqué avec quelque chose. J’ai demandé ce qu’ils me donnaient. Ils m’ont dit que c’était pour me calmer, me détendre. « Mais si je ne suis pas nerveuse, je n’ai pas besoin de me détendre. Je viens pour accoucher », ai-je répondu. Peu de temps après, j’ai vérifié que ce qu’ils faisaient réellement était de m’endormir. Puis j’ai entendu le médecin d’un ton très fâché, comme s’il récriminait quelqu’un : « Elle va accoucher et elle n’est pas encore endormie ! »».
Ces anesthésies ont ensuite été payées, entre autres dépenses, par les parents adoptifs, comme le montre la documentation.
Les femmes se réveillaient dans des chambres individuelles à l’étage privé où elles se rétablissaient à l’ isolement. Ces factures étaient également payées par les parents adoptifs, sans aucun doute une bonne affaire pour la maternité. Elvira s’en souvient : « Les jours qui ont suivi mon admission, j’ai été placée dans une chambre qui semblait isolée, silencieuse. Personne n’entrait, ni pour demander, ni pour entendre mes plaintes. Je me suis aussi rendue compte que ma poitrine était bandée et qu’elle m’oppressait.
Poitrine bandée, isolement, penthotal…[…]
Soledad Arroyo , los secretos de la gran ladrona de niños, publié dans le quotidien El Mundo, 21 décembre 2013