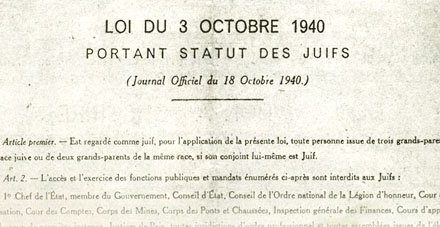Arrestation de juifs à Paris
« Dès mon retour [de vacances], le 16 août, ma mère et ma soeur prirent quelques jours de repos, elles aussi à Meudon. Nous restâmes seuls, mon père et moi, à notre domicile, 18, boulevard du temple, dans le XIe arrondissement, à Paris.
Ce 20 août 1941, le temps était magnifique. À 8h30, notre nouveau contremaître Jekusiel Zarobczyk arriva comme à l’accoutumée. Il n’avait rien remarqué d’anormal. C’était un homme encore jeune, de trente-cinq ans environ, récemment démobilisé du contingent polonais formé à Coëtquidam. Toujours de bonne humeur, il fredonnait des chansons de marche françaises, apprises pendant son incorporation.
Vers 9 heures, la sonnette retentit, mon père ouvre la porte et se trouve devant un inspecteur en civil, français, qui le toise : « Gliksberg Mordka ? » Sans aucune explication, il lui intime l’ordre de se préparer et de le suivre immédiatement. Du haut de mes dix-sept ans et de ma qualité de Français, je tente de m’interposer ; pas de réponse. Le policier entre alors dans l’appartement et découvre une porte-placard conduisant à l’atelier. Il la pousse et trouve Zarobczyk à son travail. Il l’interpelle sur le champ. Le malheureux était en blouse blanche, il passe son veston et sort sans rien dire, avec un triste sourire, mi-sceptique, mi-fataliste. La thèse selon laquelle les policiers français n’arrêtaient les Juifs que sur liste est ici solennellement infirmée. En effet, ce compagnon n’était pas domicilié à notre adresse et n’aurait pas dû être inquiété si l’inspecteur n’avait effectué que sa « mission ». C’est uniquement par le zèle intempestif de ce fonctionnaire que notre coreligionnaire perdit la vie.
Nous descendîmes tous trois l’escalier. Mon père emportait la petite valise habituelle. Son bagage se composait notamment de quelques grandes feuilles de papier de soie, précaution qui devait, provisoirement, lui sauver la vie. [Le père pourra échanger ces feuilles utilisées comme papier à cigarette contre de la nourriture.] Il serrait aussi, en plus de ses papiers d’identité, son attestation d’inaptitude au service armé. Au début de la guerre, à quarante-sept ans, il s’était engagé volontaire dans les tristement célèbres régiments de marches de volontaires étrangers (RMVE) pour participer à la lutte antinazie. Le conseil de révision de la caserne de Reuilly l’ayant trouvé de santé précaire l’avait exempté. Devant le porche, attendait déjà Heftman, notre voisin et ami ; très courageux, il laissait son épouse et trois enfant en bas âge. À côté de lui, monsieur Schwob, Français alsacien, que personne dans l’immeuble n’avait jamais perçu comme Juif. Ancien combattant de Verdun, il arborait sur son veston noir sa médaille militaire et sa croix de guerre. Complètement hébété, il ne comprenait manifestement pas ce que lui voulaient ces policiers français qui ne répondaient à aucune question.
Je courus vers la boulangerie rue d’Angoulême et rapportai deux pains « fendus », grosses miches de deux kilos chacune, pour mon père et ses compagnons.
L’ordre de monter dans les autobus stationnés devant chaque portail fut donné. Nous nous séparâmes, j’embrassai mon père avec tristesse. Lui, très digne, habitué depuis toujours à l’injustice du monde envers les Juifs me quitta avec un pâle sourire. Je reculai alors de quelques pas pour le voir installé à l’intérieur du véhicule. À ce moment précis, l’un des inspecteurs, me montrant du doigt, interrogea son collègue :
« Et celui-là ?
– Il est avec les autres », répondit-il, en désignant un autre groupe.
Cette méprise me sauva. Prestement je m’éclipsai en rentrant sous la voûte, hors de la vue des policiers.
Resté seul, décontenancé, j’espérai quelques paroles de réconfort des voisins non-juifs ou de la concierge. Rien, pas un mot, on arrêtait des Juifs, c’était normal. Remontant dans l’appartement maintenant vide, je vis s’éloigner les autobus familiers de la ligne « E », les fameux Madeleine-Bastille, emmenant leurs « cargaisons » d’innocents, condamnés d’avance pour crime de naissance. »
Armand Gliksberg. Kaddish pour les miens. Chronique d’un demi-siècle d’antisémitisme (1892 – 1942). Paris, Mille et Une Nuits, 2004, pp. 237 – 240.
Avec les autres personnes arrêtées, le père d’Armand Gliksberg est conduit à Drancy où il séjourne jusqu’à ce que sa santé fragile lui permette d’être libéré et de rentre chez lui, très affaibli. La famille vit désormais dans l’angoisse d’une nouvelle arrestation. De nationalité française, Armand passe finalement en zone libre par le train. Lorsque ses parents, après beaucoup d’hésitation, se décident à franchir clandestinement la ligne de démarcation, ils sont livrés par leur passeur qui touche, des Allemands, 50 francs par personne, sans compter le montant important qu’il leur avait demandé pour les conduire en zone libre. Déportés, après un nouveau et bref séjour à Drancy, son père, sa mère et sa soeur meurent à Auschwitz aussitôt après leur arrivée, le 26 août 1942.
Armand Gliksberg Kaddish pour les miens. Chronique d’un demi-siècle d’antisémitisme (1892 – 1942) Paris, Mille et Une Nuits, 2004, pp. 237 – 240.