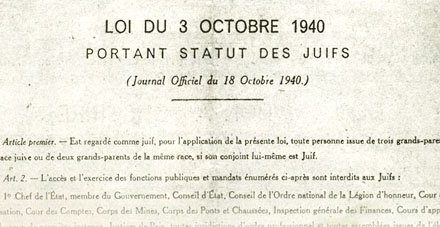« La disparition de Nicole et de sa mère s’inscrit dans la tragédie juive qui jette un voile sur notre bonheur familial ces années-là. Début 1943, mes parents jugent prudent de faire partir mes grands-parents en zone sud où, en effet, ils ne seront pas inquiétés. Ils organisent leur départ avec un passeur. Munis de faux actes de donation dont le papier trop blanc trahit l’âge, ils vont essayer de sauver le contenu de l’appartement de Neuilly. Avec la complicité de Monsieur Tailleur, déménageur dont Papa soigne les enfants, ils transfèrent les meubles et différents objets dans un dépôt protégé – des biens qu’après la guerre ils ne récupéreront pas. Mon frère et moi participons à l’opération avec un grand jeune homme qui nous avoue appartenir à la Résistance. Quelques jours après, mon père est convoqué dans un immeuble neuf, à l’angle du boulevard Malesherbes et du boulevard de Courcelles, par un service allemand qui a eu vent du déménagement. La veille, nous avons passé la nuit à exposer l’acte de donation à la lune dans l’espoir, absurde et vain, qu’il acquière une patine. Le lendemain à midi, mon père revient, blême. « Jamais, nous dit-il, je ne me suis senti aussi humilié. » Et il nous raconte : reçu par un officier allemand très courtois, qui lui reproche d’avoir soustrait des biens juifs [Françoise Verny est d’ascendance juive par sa mère] (la concierge de Neuilly nous avait dénoncé), mon père s’étonne : « Mais mon capitaine, je ne comprends pas vos motivations : en France, depuis l’affaire Dreyfus, il n’y a plus de « problème juif », l’antisémitisme a disparu. » « Vraiment ? » répond l’officier, et il ouvre une grande armoire où sont empilées enveloppes et cartes : « Si j’en juge par le nombre de dénonciations qui nous sont adressées, l’affaire n’est pas close. » Mon père baisse les yeux, bouleversé.
Cet honnête homme ne pensait pas que ses compatriotes étaient capables de tant d’ignominie. Il ignorait le mal et respectait la tradition humaniste de son pays. Je n’oublierai jamais le désespoir de ce grand naïf. Comme Monsieur Alexandre, le père de Nicole, il était porté par l’optimisme, protégé par une vision lumineuse de la France, aveuglé. Et pourtant : à l’automne 1941, on organise à Paris une exposition sur les Juifs ; mon père veut nous y emmener, mon frère et moi, pour nourrir notre haine du racisme. Ma mère s’y oppose, par superstition, je suppose. »
Extrait de Françoise Verny Serons-nous vivantes le 2 janvier 1950 ? Paris, Grasset, 2005, pp. 75 – 79.
Complices ?
« Avons-nous été, nous Français, les complices actifs de la Shoah ? Certains dénoncent par esprit de vengeance, par cupidité, ou par pure méchanceté. Des policiers français procèdent aux arrestations, qui plus tard se verront décerner la fourragère rouge pour leur action en faveur de la libération de Paris. Le camp de Drancy est gardé par des gendarmes. De hauts fonctionnaires français, en zone libre aussi bien qu’en zone occupée, ordonnent des déportations. Et ces journalistes, ces publicitaires qui appellent à l’extermination des Juifs. Crime il y eut, avec la bénédiction plus ou moins feutrée d’une partie de l’épiscopat français. Et l’antisémitisme chrétien demeure une réalité qui pollue les âmes, entre 1940 et 1945. Je voudrais être sûre qu’à la veille de l’an 2000, il a été éradiqué…
Tous ces crimes, petits et grands (mais y a-t-il alors de petits crimes ?), doivent-ils nous faire oublier le dévouement et le courage des autres ?
Les procès ont éclairé pour moi ce que j’avais vécu sans bien comprendre. Malgré tout, je ne suis pas sûre d’approuver les grandes machineries judiciaires qui désignent les responsables français des crimes contre l’humanité. Outre qu’une prescription devrait jouer plus de cinquante ans après. Papon a-t-il cru qu’en obéissant aux ordres de l’occupant, il permettait d’éviter le pire au reste de la population ? J’ai le plus profond mépris pour ce « petit » fonctionnaire capable de calculs sordides, mais je comprends également les dirigeants de la Résistance comme mon mari, Charles Verny, qui furent hostiles à son procès, ou le général de Gaulle qui le garda si longtemps au service de l’Etat. Les hommes qui ont survécu ne sont pas pour les uns des saints, pour les autres des montres. Toute créature mérite notre pitié. En dehors des mesures d’urgence qu’impliquait l’immédiate après-guerre, la sagesse cynique de De Gaulle au moment de l’épuration traduit un profond réalisme ; je songe au procès des « malgré-nous », ces Alsaciens enrôlés de force par les nazis. Ils n’ont pas résisté, mais après tout, si l’on considère l’ensemble de la population française, rares furent les résistants. »
Extrait de Françoise Verny Serons-nous vivantes le 2 janvier 1950 ? Paris, Grasset, 2005, pp. 78 – 81.
Éditeur et écrivain, Françoise Verny, décédée en 2004, a rédigé, peu avant sa mort, un petit livre consacré à son amitié avec une jeune Française arrêtée et déportée par les Allemands, parce que juive.