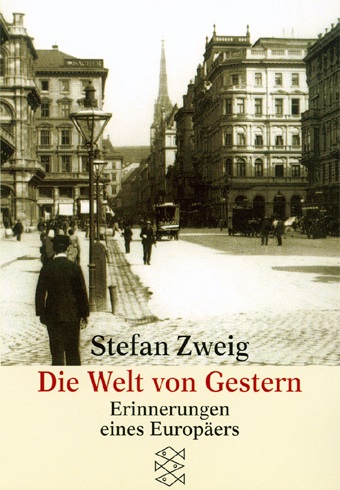Stefan Zweig, avant 1942
L’optimisme
« Il est peut-être difficile de peindre à la génération actuelle, qui a été élevée dans les catastrophes, les écroulements et les crises, pour laquelle la guerre a été une possibilité permanente, attendue presque quotidiennement, l’optimisme, la confiance dans le monde qui nous animaient, nous, les jeunes, depuis le début de ce siècle. Quarante années de paix avaient fortifié l’organisme économique des pays, la technique avait accéléré le rythme de l’existence, les découvertes scientifiques avaient empli de fierté l’esprit de cette génération ; un essor commençait, qui se faisait presque également sentir dans tous les pays de notre Europe. Les villes devenaient plus belles et plus populeuses d’année en année, le Berlin de 1905 ne ressemblait plus à celui que j’avais connu en 1901, la Résidence était devenue une grande capitale cosmopolite, et le Berlin de 1910, à son tour, la dépassait de beaucoup. Chaque fois que l’on revenait à Vienne, à Milan, à Paris, à Londres, à Amsterdam, on était étonné et comblé de joie. Les rues se faisaient plus larges, plus fastueuses, les bâtiments publics plus imposants, les magasins étaient plus luxueux et aménagés avec plus de goût. On sentait en toutes choses que la richesse s’accroissait et se répandait plus largement. Même nous, les écrivains, le remarquions à nos tirages qui, en ce seul espace de dix années, avaient triplé, quintuplé, décuplé. Partout s’ouvraient de nouveaux théâtres, de nouvelles bibliothèques, de nouveaux musées. Toutes sortes de commodités, comme les salles de bains et le téléphone, naguère le privilège de cercles très étroits, pénétraient dans les milieux petits-bourgeois et, depuis que le temps de travail avait été réduit, le prolétariat s’élevait pour prendre sa part au moins aux petites joies et commodités de l’existence. Partout on allait de l’avant. Quiconque risquait gagnait à coup sûr. Qui achetait une maison, un livre, un tableau, en voyait monter le prix ; plus une entreprise était audacieuse, et plus on était sûr qu’elle serait d’un bon rapport. Une merveilleuse insouciance avait ainsi gagné le monde, car enfin qu’est-ce qui aurait bien pu interrompre cette ascension, entraver cet essor qui tirait sans cesse de nouvelles forces de son propre élan ? Jamais l’Europe n’avait été plus puissante, plus riche, plus belle, jamais elle n’avait cru plus intimement à un avenir encore meilleur. Personne, à l’exception de quelques vieillards déjà décrépis, ne regrettait plus, comme autrefois, le « bon vieux temps ».
Mais ce n’étaient pas seulement les villes qui changeaient ; les hommes eux-mêmes devenaient plus beaux et plus sains grâce au sport, à la nourriture meilleure, à la réduction de la durée du travail et à une relation plus intime avec la nature. On avait découvert que l’hiver, jadis saison morne, que les hommes passaient dans les auberges à jouer aux cartes d’un air chagrin ou à s’ennuyer dans des pièces surchauffées, pouvait dispenser un soleil filtré, un nectar pour les poumons, une volupté de la peau où affluait un sang léger. Et les montagnes, les lacs, la mer n’étaient plus si éloignés que par le passé. La bicyclette, l’automobile, les chemins de fer électriques avaient raccourci les distances et donné au monde un nouveau sentiment de l’espace. Le dimanche, des milliers et des dizaines de milliers de touristes en anoraks aux couleurs vives descendaient les pentes vertigineuses sur leurs skis et leurs luges, partout on construisait des palais des sports et des piscines. Et c’est justement à la piscine qu’on pouvait observer distinctement le changement survenu. Tandis qu’au temps de ma jeunesse un homme vraiment bien fait frappait parmi ces gros cous, ces panses volumineuses et ces poitrines creuses, maintenant des corps assouplis par la gymnastique, brunis par le soleil, durcis par le sport rivalisaient dans un joyeux concours à l’antique. Personne, sinon les plus pauvres, ne restait plus à la maison le dimanche, toute la jeunesse partait en excursion, grimpait et luttait, rompue à tout espèce d’exercice. (…) on était devenu curieux de savoir si le monde était partout aussi beau, et d’une beauté différente ; tandis que naguère seuls les privilégiés avaient vu les pays étrangers, des employés de banque et de petits industriels voyageaient en Italie, en France. Les voyages étaient devenus moins onéreux, plus commodes, et c’était par-dessus tout le nouveau courage, la nouvelle audace des hommes qui les rendait aussi plus hardis dans leurs pérégrinations, moins craintifs et économes dans leur manière de vivre – bien plus, on avait honte de se montrer craintif. Toute la génération décidait d’être plus juvénile… »
Sources et éditions : Stefan Zweig, Die Welt von Gestern, Bermann-Fischer Verlag AB, Stockholm, 1944 / Le Monde d’hier. Souvenirs d’un Européen, Paris, Belfond 1982, 1993 pour la traduction française par Serge Niémetz / Le Livre de Poche, 1996, p. 230-233.
Autre extrait
« Le XIXe siècle, dans son idéalisme libéral, était sincèrement convaincu qu’il se trouvait sur la route rectiligne et infaillible du « meilleur des mondes possibles ». On considérait avec dédain les époques révolues, avec leurs guerres, leurs famines et leurs révoltes, comme une ère où l’humanité était encore mineure et insuffisamment éclairée. Mais à présent, il ne s’en fallait plus que de quelques décennies pour que les dernières survivances du mal et de la violence fussent définitivement dépassées, et cette foi en un « Progrès » ininterrompu et irrésistible avait véritablement, en ce temps-là, toute la force d’une religion. On croyait déjà plus en ce « Progrès » qu’en la Bible, et cet évangile semblait irréfutablement démontré chaque jour par les nouveaux miracles de la science et de la technique. Et en effet, à la fin de ce siècle de paix, une ascension générale se faisait toujours plus visible, toujours plus rapide, toujours plus diverse. Dans les rues, la nuit, au lieu des pâles luminaires, brillaient des lampes électriques ; les grands magasins portaient des artères principales jusque dans les faubourgs leur nouvelle splendeur tentatrice ; déjà, grâce au téléphone, les hommes pouvaient converser à distance, déjà ils volaient avec une vélocité nouvelle dans des voitures sans chevaux, déjà ils s’élançaient dans les airs, accomplissant le rêve d’Icare. Le confort des demeures aristocratiques se répandait dans les maisons bourgeoises, on n’avait plus à sortir chercher l’eau à la fontaine ou dans le couloir, à allumer péniblement le feu du fourneau ; l’hygiène progressait partout, la crasse disparaissait. Les hommes devenaient plus beaux, plus robustes, plus sains depuis que le sport trempait leur corps comme de l’acier ; on rencontrait de plus en plus rarement dans les rues des infirmes, des goitreux, des mutilés, et tous ces miracles, c’était l’oeuvre de la science, cet archange du progrès ; d’année en année, on donnait de nouveaux droits à l’individu, la justice se faisait plus douce et plus humaine, et même le problème des problèmes, la pauvreté des grandes masses, ne semblait plus insoluble. Avec le droit de vote, on accordait à des classes de plus en plus étendues la possibilité de défendre leurs intérêts par des voies légales, sociologues et professeurs rivalisaient de zèle pour rendre plus saine et même plus heureuse la vie des prolétaires – quoi d’étonnant, dès lors, si ce siècle se chauffait complaisamment au soleil de ses réussites et ne considérait la fin d’une décennie que comme le prélude à une autre, meilleure encore ? On croyait aussi peu à des rechutes vers la barbarie, telles que des guerres entre les peuples d’Europe, qu’aux spectres ou aux sorciers ; nos pères étaient tout pénétrés de leur confiance opiniâtre dans le pouvoir infaillible de ces forces de liaison qu’étaient la tolérance et l’esprit de conciliation. Ils pensaient sincèrement que les frontières des divergences entre nations et confessions se fondraient peu à peu dans une humanité commune et qu’ainsi la paix et la sécurité, les plus précieux des biens, seraient imparties à tout le genre humain. »
Sources et éditions : Stefan Zweig, Die Welt von Gestern, Bermann-Fischer Verlag AB, Stockholm, 1944 / Le Monde d’hier. Souvenirs d’un Européen, Paris, Belfond 1982, 1993 pour la traduction française par Serge Niémetz / Le Livre de Poche, 1996, p. 17-18.
et le côté obscur...
« Elle était merveilleuse, cette vague tonique de force qui, de tous les rivages de l’Europe, battait contre nos coeurs. mais ce qui nous rendait si heureux recelait en même temps un danger que nous ne soupçonnions pas. La tempête de fierté et de confiance qui soufflait alors sur l’Europe charriait aussi des nuages. L’essor avait peut-être été trop rapide. Les États, les villes avaient acquis trop vite leur puissance, et le sentiment de leur force incite toujours les hommes, comme les États, à en user ou à en abuser. La France regorgeait de richesses. Mais elle en voulait davantage encore, elle voulait encore une colonie, bien qu’elle n’eût pas assez d’hommes, et de loin, pour peupler les anciennes ; pour le Maroc, on faillit en venir à la guerre. L’Italie voulait la Cyrénaïque, l’Autriche annexait la Bosnie. La Serbie et la Bulgarie se lançaient contre la Turquie, et l’Allemagne, encore tenue à l’écart, serrait déjà les poings pour porter un coup furieux. Partout le sang montait à la tête des États, y portant la congestion. La volonté fertile de consolidation intérieure commençait partout, en même temps, comme s’il s’agissait d’une infection bacillaire, à se transformer en désir d’expansion. Les industriels français, qui gagnaient gros, menaient une campagne de haine contre les Allemands, qui s’engraissaient de leur côté, parce que les uns et les autres voulaient livrer plus de canons – les Krupp et les Schneider du Creusot. Les compagnies de navigation hambourgeoises, avec leurs dividendes formidables, travaillaient contre celles de Southampton, les paysans hongrois contre les Serbes, les grands trusts les uns contre les autres ; la conjoncture les avait tous rendus enragés de gagner toujours plus dans leur concurrence sauvage. Si aujourd’hui on se demande à tête reposée pourquoi l’Europe est entrée en guerre en 1914, on ne trouve pas un seul motif raisonnable, pas même un prétexte. Il ne s’agissait aucunement d’idées, il s’agissait à peine des petits districts frontaliers ; je ne puis l’expliquer autrement que par cet excès de puissance, que comme une conséquence tragique de ce dynamisme interne qui s’était accumulé depuis ces quarante années de paix et voulait se décharger violemment. Chaque État avait soudain le sentiment d’être fort et oubliait qu’il en était exactement de même du voisin ; chacun voulait davantage et nous étions justement abusés par le sentiment que nous aimions le plus : notre commun optimisme. Car chacun se flattait qu’à la dernière minute l’autre prendrait peur et reculerait ; ainsi les diplomates commencèrent leur jeu de bluff réciproque. Quatre fois, cinq fois, à Agadir, dans la guerre des Balkans, en Albanie, on s’en tint au jeu ; mais les grandes coalitions resserraient sans cesse leurs liens, se militarisaient toujours plus. En Allemagne, on établit en pleine paix un impôt de guerre ; en France, on prolongea la durée du service ; finalement les forces en excès durent se décharger, et les signes météorologiques dans les Balkans indiquaient la direction d’où les nuages approchaient déjà de l’Europe.
Ce n’était pas encore la panique, mais une constante inquiétude couvait partout ; nous éprouvions toujours un léger malaise quand les coups de feu crépitaient dans les Balkans. La guerre allait-elle vraiment nous assaillir sans que nous sachions pourquoi ni dans quel dessein ? Lentement – beaucoup trop lentement, beaucoup trop timidement, comme nous le savons aujourd’hui ! – les forces opposées à la guerre se rassemblaient. Il y avait le parti socialiste, des millions d’êtres de ce côté de la frontière, des millions de l’autre côté, qui dans leur programme renaient la guerre ; il y avait les puissants groupes catholiques sous la direction du pape et quelques konzerns internationaux, il y avait un petit nombre d’hommes politiques raisonnables, qui s’élevaient contre ces menées souterraines. Et nous aussi, nous étions dans les rangs des ennemis de la guerre, nous autres écrivains, mais toujours isolés dans notre individualisme, au lieu d’être unis et résolus. L’attitude de la plupart des intellectuels était malheureusement celle de l’indifférence passive, car par la faute de notre optimisme, le problème de la guerre, avec toutes ses conséquences morales, n’était absolument pas entré dans notre horizon intérieur. »
Sources et éditions : Stefan Zweig, Die Welt von Gestern, Bermann-Fischer Verlag AB, Stockholm, 1944 / Le Monde d’hier. Souvenirs d’un Européen, Paris, Belfond 1982, 1993 pour la traduction française par Serge Niémetz / Le Livre de Poche, 1996, p. 235-237.
L’opinion de Stefan Zweig, 30 ans après
« La tempête de fierté et de confiance qui soufflait alors sur l’Europe charriait aussi des nuages. L’essor avait peut-être été trop rapide. (…)
La France regorgeait de richesses. Mais elle en voulait davantage encore, elle voulait encore une colonie, bien qu’elle n’eût pas assez d’hommes, et de loin, pour peupler les anciennes ; pour le Maroc, on faillit en venir à la guerre. L’Italie voulait la Cyrénaïque, l’Autriche annexait la Bosnie. La Serbie et la Bulgarie se lançaient contre la Turquie, et l’Allemagne, encore tenue à l’écart, serrait déjà les poings pour porter un coup furieux.
Partout le sang montait à la tête des États, y portant la congestion. La volonté fertile de consolidation intérieure commençait partout… à se transformer en désir d’expansion. Les industriels français, qui gagnaient gros, menaient une campagne de haine contre les Allemands, qui s’engraissaient de leur côté, parce que les uns et les autres voulaient livrer plus de canons – les Krupp et les Schneider du Creusot. Les compagnies de navigation hambourgeoises, avec leurs dividendes formidables, travaillaient contre celles de Southampton, les paysans hongrois contre les serbes, les grands trusts les uns contre les autres ; la conjoncture les avait tous rendus enragés de gagner toujours plus dans leur concurrence sauvage. Si aujourd’hui on se demande à tête reposée pourquoi l’Europe est entrée en guerre en 1914, on ne trouve pas un seul motif raisonnable (…) ; je ne puis l’expliquer autrement que par cet excès de puissance, que comme une conséquence tragique de ce dynamisme interne qui s’était accumulé depuis ces quarante années de paix et voulait se décharger violemment. Chaque État avait soudain le sentiment d’être fort et oubliait qu’il en était exactement de même du voisin (…). Car chacun se flattait qu’à la dernière minute l’autre prendrait peur et reculerait; ainsi les diplomates commencèrent leur jeu de bluff réciproque. Quatre fois, cinq fois, à Agadir, dans la guerre des Balkans, en Albanie, on s’en tint au jeu; mais les grandes coalitions resserraient sans cesse leurs liens, se militarisaient toujours plus. (…) ; finalement les forces en excès durent se décharger, et les signes météorologiques dans les Balkans indiquaient la direction d’où les nuages approchaient déjà de l’Europe. »
Stefan Zweig, « Le monde d’hier », 1944, Livre de Poche, 1993, p. 235-236.
idem un peu plus complet
« Elle était merveilleuse, cette vague tonique qui, de tous les rivages de l’Europe, battait contre nos coeurs. Mais ce qui nous rendait si heureux recelait en même temps un danger que nous ne soupçonnions pas. La tempête de fierté et de confiance qui soufflait alors sur l’Europe charriait aussi des nuages. L’essor avait peut-être été trop rapide. Les États, les villes avaient acquis trop vite leur puissance, et le sentiment de leur force incite toujours les hommes, comme les États, à en user ou à en abuser. La France regorgeait de richesses. Mais elle voulait davantage encore, elle voulait encore une colonie, bien qu’elle n’eût pas assez d’hommes, et de loin, pour peupler les anciennes. Pour le Maroc, on faillit en venir à la guerre. L’Italie voulait la Cyrénaïque, l’Autriche annexait la Bosnie. La Serbie et la Bulgarie se lançaient contre la Turquie ; et l’Allemagne, encore tenue à l’écart, serrait déjà les poings pour y porter un coup furieux. Partout, le sang montait à la tête des États, un portant la congestion. La volonté fertile de consolidation intérieure commençait partout, en même temps, comme s’il s’agissait d’une infection bacillaire, à se transformer en désir d’expansion. Les industriels français, qui gagnaient gros, menaient une campagne de haine contre les Allemands, qui s’engraissaient de leur côté, parce que les uns et les autres voulaient livrer plus de canons – les Krupp et les Schneider du Creusot. Les compagnies de navigation hambourgeoises, avec leurs dividendes formidables, travaillaient contre celles de Southampton, les paysans hongrois contre les serbes, les grands trusts les uns contre les autres ; la conjoncture les avait tous rendus enragés de gagner toujours plus dans leur concurrence sauvage.
Si aujourd’hui on se demande à tête reposée pourquoi l’Europe est entrée en guerre en 1914, on ne trouve pas un seul motif raisonnable, pas même un prétexte. Il ne s’agissait aucunement d’idées, il s’agissait à peine de petits districts frontaliers ; je ne puis l’expliquer autrement que par cet excès de puissance, que comme une conséquence tragique de ce dynamisme interne qui s’était accumulé durant ces quarante années de paix et voulait se décharger violemment. Chaque État avait soudain le sentiment d’être fort et oubliait qu’il en était exactement de même du voisin ; chacun voulait davantage et nous étions justement abusés par le sentiment que nous aimions le plus : notre commun optimisme. Car chacun se flattait qu’à la dernière minute, l’autre prendrait peur et reculerait ; ainsi, les diplomates commencèrent leur jeu de bluff réciproque. Quatre fois, cinq fois, à Agadir, dans la guerre des Balkans, en Albanie, on s’en tint au jeu ; mais les grandes coalitions resserraient sans cesse leurs liens, se militarisaient toujours plus. En Allemagne, on établit en pleine paix un impôt de guerre ; en France, on prolongea la durée du service ; finalement, les forces en excès durent se décharger, et les signes météorologiques dans les Balkans indiquaient la direction d’où les nuages approchaient déjà de l’Europe. »
Stefan Zweig (1881-1942), Les rayons et les ombres sur l’Europe, 1944, éd. posthume.