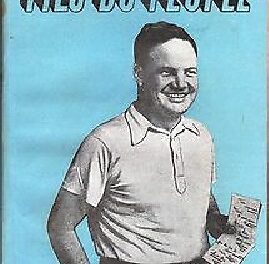L’article que voici constitue une version synthétique d’un ouvrage paru quelques jours auparavantMarguerite Donnadieu, Philippe Roques, L’empire français, Gallimard, 1940. et signé par Philippe Roques et Marguerite Donnadieu. Le livre est une commande de Mandel dont Roques, plus tard résistantBref passage sur la correspondance de Roques et ses liens avec Mandel cf. D. C., « Un résistant ? Maurice Satineau : un parlementaire colonial dans la tourmente (1940-1945)», Outre-mers, revue d’histoire, n°386-387, juin 2015, p. 130-144., est un très proche collaborateur. La jeune Marguerite Donnadieu démissionne en novembre 1940 du ministère des Colonies. Elle désavoue plus tard l’ouvrage et l’article. Le projet du livre reflétait l’esprit de Mandel qui comptait sur la cohésion entre empire et colonies dans la guerre à venir. Peu de temps auparavant, en juin 1939, c’est en arguant de cette nécessaire cohésion coloniale qu’il avait, à la demande de députés antillais, fait fermer un dancing du Boul’Mich’ qui n’acceptait pas les clients noirsIl s’agit du Victoria, 47 boulevard Saint-Michel, à Paris cf. D. C., Nous qui ne cultivons pas le préjugé de race. Du racisme en France ? Histoire(s) d’un siècle de doute, Paris, éditions du Félin, 14 octobre 2021, p. 187-189..
La méthode colonisatrice de la France, par Mme M. Donnadieu (extraits)
« […] Notre conception impériale est, en effet, la négation même du racisme. La France a donné à tous ses sujets d’outre-mer, sans faire de distinction entre les races, les mêmes possibilités de développement et les mêmes espoirs.
L’indigène n’a jamais été traité en vaincu […] Certes, ce n’est pas à lui qu’il appartient de décider à quel moment il pourra user de ses capacités. C’est à nous, au moment voulu, d’alléger notre tutelle […]
Notre politique consiste en une action concertée, d’ordre médical, éducatif, voire économique, qui tend à faire de l’indigène un homme sain, instruit au moins des principes élémentaires qui gouvernent son existence quotidienne, capable, dès lors, d’organiser son économie familiale tout en conservant sa culture, sa langue, ses traditions locales La première manifestation de cette politique, la plus urgente, ce fut l’action médicale. L’effet de notre présence fut de sauver de la mort des millions d’indigènes jusque-là à la merci de la plus bénigne des maladies […]
Lorsqu’il s’agit d’émanciper l’indigène, la France se préoccupe avant tout de ne jamais le détourner de ce qui semble être le destin naturel de sa race […] Rendons hommage dans ce domaine aux missionnaires […]
C’est en répandant largement l’instruction que nous sommes arrivés à former dans chaque colonie une élite capable de remplir les fonctions administratives et destinée aussi à diffuser dans les masses les principes de notre civilisation.
Notre devoir consistait à donner au plus riche comme au plus pauvre sa chance de réussite; aussi a-t-on essayé de généraliser dans nos possessions l’instruction publique. Mais, la population de nos colonies étant agricole, l’extension parallèle de l’enseignement professionnel agricole, artisanal, ménager a permis d’éviter que les indigènes n’aillent en trop grand nombre vers des carrières administratives et ne délaissent leurs terres et leurs cultures […]
L’accession à la citoyenneté peut se faire d’une façon massive, comme pour nos vieilles colonies des Antilles, de la Réunion et de l’Afrique du Nord, pratiquement assimilées à des départements français. Elle peut être élargie, comme récemment à Madagascar ou en Indochine, au Sénégal, et enfin être encore l’exception, comme dans nos colonies d’Afrique occidentale et équatoriale. D’aucuns voient dans cette inégalité une certaine injustice. Il va sans dire que dans les colonies cadettes, l’indigène non encore éduqué ignore la portée et le sens des droits civiques. Il faudra du temps encore pour qu’un noir du Gabon prenne conscience qu’il relève politiquement d’un territoire qui dépasse de beaucoup le cadre de son village […]
L’illustration, 11 mai 1940.

La méthode colonisatrice de la France, par Mme M. Donnadieu (version intégrale)
«Septembre 1939. Depuis quelques heures la France et l’Angleterre viennent de signifier à l’Allemagne qu’elles vont prendre les armes pour la sauvegarde de leurs libertés.
Et voici que s’amoncellent sur le bureau du ministre des Colonies des câbles provenant de nos territoires lointains et qui sont autant de témoignages de loyalisme et de fidélité à la mère patrie. Du plus humble des indigènes au chef le plus vénéré, tous répondent avec le même enthousiasme à l’appel de la France. De son côté l’Allemagne sait égale-ment que cette communauté spirituelle de l’Empire français présente pour elle de grands dangers. Comment, d’ailleurs, ne détesterait-elle pas cet Empire, dont l’équilibre intérieur est assuré simplement par le consentement unanime de ses membres, elle qui ne peut assurer sa puissance que par des forces de police et le recours à la terreur organisée ?
Notre conception impériale est, en effet, la négation même du racisme. La France a donné à tous ses sujets d’outre-mer, sans faire de distinction entre les races, les mêmes possibilités de développement et les mêmes espoirs.
L’indigène n’a jamais été traité en vaincu ; non seulement nous avons des devoirs envers lui, mais nous lui reconnaissons des droits sociaux et politiques et surtout celui d’acquérir des connaissances nouvelles. Certes, ce n’est pas à lui qu’il appartient de décider à quel moment il pourra user de ses capacités. C’est à nous, au moment voulu, d’alléger notre tutelle.
De même que dans une entreprise le père n’associe son fils à ses affaires que lorsque celui-ci est en âge de l’aider, de même, lorsque les ressortissants de l’Empire se révèlent capables de s’administrer eux-mêmes, la France leur en reconnaît volontiers le droit. L’exercice de ce droit, que ce soit dans le domaine administratif ou politique, est parfaitement compatible avec l’autorité suprême que nous exerçons. Qui mieux est, il nous est dicté par notre intérêt. Les Anglais dans leur seule colonie des Indes emploient huit millions d’indigènes ; en Indochine française également l’administration locale compte d’année en année plus d’Annamites. Au fur et à mesure qu’un territoire s’enrichit, des cadres de direction sont nécessaires : les services publics s’organisent, l’instruction se généralise, la création de comités de contrôle économique et financier s’impose.
On ne conçoit pas un pays prospère sans que ses habitants jouissent d’un certain standing de vie qui témoigne autant de leur nouveau sens du confort que de leurs progrès civiques. A quoi nous servirait d’éduquer l’indigène si ce n’est à des fins utiles à lui-même comme à nous ? Son intérêt est intimement lié au nôtre.
Notre politique consiste en une action concertée, d’ordre médical, éducatif, voire économique, qui tend à faire de l’indigène un homme sain, instruit au moins des principes élémentaires qui gouvernent son existence quotidienne, capable, dès lors, d’organiser son économie familiale tout en conservant sa culture, sa langue, ses traditions locales La première manifestation de cette politique, la plus urgente, ce fut l’action médicale. L’effet de notre présence fut de sauver de la mort des millions d’indigènes jusque-là à la merci de la plus bénigne des maladies.
Par une politique sanitaire appropriée à chaque colonie, à chaque mentalité indigène et à la nature de chaque maladie nous avons vaincu la plupart des épidémies coloniales. La maladie du sommeil rongeait l’Afrique depuis des centaines d’années. Sa foudroyante propagation demandait qu’on agît vite. La formation d’équipes mobiles, la campagne d’hygiène sociale, l’assainissement ont été menés de front. Le malade étant le grand élément contaminateur, c’est lui qu’il fallait poursuivre, isoler et soigner. La victoire a été grandiose : au Cameroun, la mortalité due à la maladie du sommeil était de 64 %, elle est actuellement de 0,4 %. (Voir L’Illustration des 7 nov. 1925, 27 fév. 1926, 17 mai 1930 et 23 oct. 1937.)
De même la peste qui régnait à Madagascar a été endiguée par une campagne de vaccination massive possible grâce à une action psychologique destinée à amener le malade à s’associer à nos efforts.
La lèpre, par la lenteur de son évolution, permet au malade de vivre longtemps. Nous avons donc construit dans toutes nos colonies de nombreuses léproseries, villages organisés où chacun reprend ses activités ordinaires normales.
Le plus précieux de nos collaborateurs dans cette lutte gigantesque a été l’indigène lui-même. Dans toutes nos colonies, des cadres et auxiliaires indigènes ont été créés. Leur aide a été décisive car au début de la colonisation nous ne disposions que de médecins français. Mais il ne s’agissait pas simplement de recruter des médecins, il fallait innover en matière médicale, scientifiques nouvelles. L’Institut Pasteur de Paris a créé des filiales dans toutes les colonies françaises, centres de recherches dont le rayonnement est parfois mondial. L’Institut de la lèpre à Bamako, l’Institut antipaludique de Cochinchine, l’Institut de la peste à Tananarive possèdent des équipes de chimistes de premier ordre qui préparent sur place des vaccins conformes aux conditions locales de la prophylaxie.
Peu à peu délivrés de ces maladies sociales qui régnaient en permanence, mieux alimentés, aguerris par l’éducation physique, les indigènes se ressentent profondément de notre action bienfaisante. La mortalité due à l’état permanent de sous-alimentation et à la syphilis décimait la population de l’Afrique équatoriale et en partie celle de l’Annam. Elle est aujourd’hui l’exception.
Lorsqu’il s’agit d’émanciper l’indigène, la France se préoccupe avant tout de ne jamais le détourner de ce qui semble être le destin naturel de sa race. Au contraire elle s’efforce de l’amener à une existence conforme à ses aptitudes et à son passé. On s’est heurté cependant à des nécessités d’ordre pratique ; c’est de notre enseignement que dépendait la solution de ce problème, qu’il a fallu concilier avec les les principes qui inspiraient notre colonisation. Rendons hommage dans ce domaine aux missionnaires, qui, les premiers, prirent en main l’enfance indigène et fondèrent des crèches et des écoles. Ces pionniers de la vertu et de la pensée française ne répugnèrent à aucune tâche, à aucune épreuve et leur catholicisme agissant, a posé les jalons de notre politique indigène tout entière.
C’est en répandant largement l’instruction que nous sommes arrivés à former dans chaque colonie une élite capable de remplir les fonctions administratives et destinée aussi à diffuser dans les masses les principes de notre civilisation.
Notre devoir consistait à donner au plus riche comme au plus pauvre sa chance de réussite; aussi a-t-on essayé de généraliser dans nos possessions l’instruction publique. Mais, la population de nos colonies étant agricole, l’extension parallèle de l’enseignement professionnel agricole, artisanal, ménager a permis d’éviter que les indigènes n’aillent en trop grand nombre vers des carrières administratives et ne délaissent leurs terres et leurs cultures.
Des écoles d’agriculture existent dans toutes nos colonies, qui livrent chaque année à la terre de nouveaux contingents d’agriculteurs instruits des méthodes nouvelles. En Afrique occidentale française, colonie agricole par excellence, où « du Tchad à l’Atlantique on labourait à la houe », l’école rurale a un rôle capital à jouer ; d’elle dépend en effet la mise en valeur des terres. Dans le même esprit notre politique de l’artisanat consiste à mettre au point les techniques anciennes et évite d’industrialiser cette branche importante de l’activité indigène. Est-ce à dire que les colons se verront interdire de dépasser le stade d’une économie agricole même perfectionnée ? L’industrialisation coloniale, comme bien des problèmes économiques, touche à la politique indigène. Elle contribuerait à créer une classe ouvrière qui modifierait profondément le rythme et la forme de la vie des indigènes. II semble que loin d’être érigée en principe elle pose des questions d’opportunité sociale et économique.
Notre intervention s’imposait aussi dans un autre domaine, celui de la justice. Avant notre venue la justice coutumière variait à l’extrême, suivant les tribus, les provinces et même les villages.
Notre effort a surtout porté sur la simplification et la codification de la procédure indigène, jusque-là longue et coûteuse. En Indochine, nous avons unifié le droit oral en un code de droit annamite. La justice indigène est rendue par des tribunaux spéciaux et par des techniciens de droit local aux divers degrés. Le respect de la coutume n’a été appliqué qu’en matière de droit civil, car en matière criminelle elle était incompatible avec le nouvel ordre public que nous imposions à nos possessions.
Quelle devait être la fin naturelle de cette politique indigène sinon celle de l’association politique ? Justifiée par l’intérêt des deux parties, elle est dans la logique de notre action. Il est normal qu’un homme nouvellement instruit de l’histoire de son pays, économie, du sens de son régime politique nourrisse des idées personnelles sur la façon de le diriger. En lui refusant le moyen de les exprimer on risquerait de faire de lui un mécontent ou même un révolté. Cette association se retrouve donc à tous les degrés. Quoique la citoyenneté en soit le couronnement, ce n’est pas seulement le citoyen indigène qui s’initie et s’associe à la vie de son pays. Partout où il existait des assemblées indigènes locales, comme le djerma en Algérie ou les assemblées de notables en Indochine, la France s’est attachée à les conserver. Sans doute leurs décisions restent révocables par l’autorité administrative, mais celle-ci en tient compte dans la mesure du possible et elle se fait ainsi une idée juste des vœux de ses ressortissants.
L’accession à la citoyenneté peut se faire d’une façon massive, comme pour nos vieilles colonies des Antilles, de la Réunion et de l’Afrique du Nord, pratiquement assimilées à des départements français. Elle peut être élargie, comme récemment à Madagascar ou en Indochine, au Sénégal, et enfin être encore l’exception, comme dans nos colonies d’Afrique occidentale et équatoriale. D’aucuns voient dans cette inégalité une certaine injustice. Il va sans dire que dans les colonies cadettes, l’indigène non encore éduqué ignore la portée et le sens des droits civiques. Il faudra du temps encore pour qu’un noir du Gabon prenne conscience qu’il relève politiquement d’un territoire qui dépasse de beaucoup le cadre de son village. Le chef de sa tribu, qui à ses yeux, incarne le pouvoir politique, se l’est vu conférer par la coutume ou pour des raisons religieuses. Entre les mains d’un tel individu, le bulletin de vote serait un danger, car il s’en servirait sur les conseils néfastes du sorcier ou du marabout. L’octroi du droit de vote implique une probité de cœur et d’esprit qui ne va pas sans la culture et l’intelligence.
Lorsqu’on reproche à la France de maintenir ses populations noires dans un état de tutelle politique, c’est donc un jugement sans valeur, Pour contrebalancer cette inégalité nécessaire, on avait imaginé une citoyenneté seconde, dite d’Empire, qui aurait été octroyée à tous les sujets d’outre-mer. Ce projet n’a pas abouti. Il n’aurait eu de portée pratique que si un parlement d’Empire avait été créé, analogue à la conférence des dominions, bien que celle-ci, en raison de la décentralisation impériale anglaise, n’ait que la valeur d’un symbole.
Mais cette idée n’est pas encore réalisable en raison de l’inégalité civique de nos populations coloniales.
En terminant, remarquons que la guerre aura été une grande expérience. Il n’est pas un seul indigène qui n’ait prêté aux, échos des derniers événements une oreille attentive ; le plus ignorant de tous a reconnu là une rumeur qui lui était familière : celle des armes. II a compris ce dont souffrait la France et s’est rapproché d’elle davantage ; il a voulu l’aider par le don de sa personne. C’est la plus valable des expériences humaines qui pouvaient être instituées aux colonies.
La guerre a posé aux indigènes un véritable cas de conscience. Chacun était libre de rester sourd à l’appel de la patrie, et tous ont répondu.»
L’illustration, 11 mai 1940.