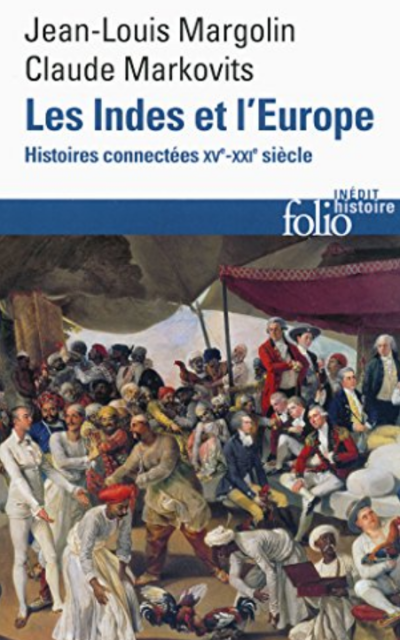Il est difficile aujourd’hui de traiter d’histoire moderne sans avoir intériorisé quelques-unes des notions élémentaires diffusées par des auteurs comme Romain Bertrand, Sanjay Subrahmanyam, Kenneth Pomeranz et tant d’autres.
Comme d’autres dans cette veine, ce livre n’a pas pour objet l’étude d’un espace limité dont on aurait artificiellement coupé les liens avec l’extérieur comme on le fait systématiquement pour les monographies locales et régionales, pour les histoires nationales, voire pour une histoire trop circonscrite à une seule colonie, sans autre considération pour les multiples connections qui la relient au monde.
Paru en 2015, l’ouvrage de Jean-Louis Margolin et Claude Markovits, historiens qu’on ne présente plus, n’a sans doute pas reçu toute la publicité qu’il méritait compte tenu du regard qu’il initie sur les relations commerciales entre les Indes et l’Europe mais aussi sur la distribution des rôles dans l’industrialisation, les échanges culturels et les échanges de savoir : un domaine où le stéréotype du sens unique règne encore en maître. La lecture de ce large extrait ne peut qu’être utile à qui souhaite aborder l’époque moderne et la rencontre des différents mondes.
Nul doute que cette lecture donne envie de lire l’ouvrage, qui, outre le poche, est aujourd’hui disponible au format électronique.
Cet ouvrage est un exercice d’« histoire connectée » mais il ne prétend pas pour autant écrire une histoire à parts égales », pour reprendre l’irénique formule de Romain BertrandRomain Bertrand, L’histoire à parts égales. Récit d’une rencontre Orient-Occident (XVIe-XVIIe siècle), Seuil, 2011. Outre que le monde, passé aussi bien que présent, est plus fait de discontinuités et d’inégalités que d’harmonie préétablie, il y a concrètement trop d’asymétrie entre les corpus respectifs de sources européennes et sud-asiatiques pour soutenir une telle ambition. Ainsi, pour ce qui est de la période 1500-1750, face à des dizaines de textes européens sur l’Asie méridionale, d’intérêt variable bien entendu, on n’a pu identifier que trois textes sud-asiatiques mentionnant directement les Européens dont l’un est en arabe, et deux sont en persan. Dans l’immense corpus de textes sanscrits, on trouve seulement une vague allusion dans un ouvrage plutôt obscur. Certes, ce silence, dira-t-on, est à sa façon éloquent, à condition cependant de ne pas le sur-interpréter. Comment alors écrire une histoire non pas « à parts égales », mais « équilibrée », qui évite le piège de l’européocentrisme sans tomber dans les excès d’un post-colonialisme mal maîtrisé ? C’était le défi à relever.
Dès lors qu’il cerne la nature de la connexion, l’historien est amené à renvoyer dos à dos l’école d’inspiration plus ou moins « impérialiste », même reconvertie en histoire de l’expansion européenne, et les écoles « nationalistes ». Tandis que la première voyait dans l’arrivée des Européens une conséquence inéluctable de l’avance de l’Europe sur le reste du monde, et un phénomène plutôt positif, les secondes soulignaient la déstabilisation catastrophique d’un ordre plutôt harmonieux. Sur le premier point, rappelons que les premiers Européens à se lancer dans l’aventure sud-asiatique n’appartenaient pas aux régions les plus avancées du continent, aux grands centres de capitalisme marchand qu’étaient alors les Flandres et l’Italie du Nord mais à un petit royaume sud-européen encore très « féodal ››. Et la nature contingente de l’arrivée des Portugais en Asie est évidente. Quand, dans un acte d’hubris qui reste sans équivalent dans l’histoire de l’humanité, les monarchies ibériques se furent partagé en 1494 à Tordesillas le monde à découvrir suivant une ligne imaginaire située à 370 milles à l’ouest des îles du Cap-Vert, les Portugais n’avaient qu’une très vague idée de ce qui leur revenait. Il fallut trois ans pour organiser la petite expédition de Vasco de GamaVoir à ce sujet la chronique par Serge Gruzinski de Sanjay Subrahmanyam, Vasco de Gama. Légende et tribulations du vice-roi des Indes, Seuil, 2011., et, quand ce dernier atteignit enfin Calicut en quête « de chrétiens et d’épices », il ne trouva ni les uns ni les autres. Pour expliquer la poursuite de l’aventure portugaise, il faut faire intervenir la folie du monarque, Manuel Ier de Portugal, un mystique influencé par les prophéties « joachimites ›› sur la reconquête de Jérusalem par les chrétiens et la fin prochaine de la « secte infâme de MafamedeLa réflexion sur cet imaginaire pourra se nourrir entre autres de la lecture de John Tolan, Mahomet l’Européen. Histoire des représentations du Prophète en Occident, traduit de l’anglais par Cécile Deniard, Albin Michel, 2018. ». Ceux qui voient dans les premiers voyages portugais les prodromes d’un capitalisme européen triomphant et s’imposant au reste du monde se trompent donc. C’est une idéologie médiévale issue des Croisades et de la Reconquista qui inspire les premiers fidalgos, même si l’appât du gain est bien entendu une forte motivation, et si les capitalistes florentins et augsbourgeois ont vite fait de déceler dans le commerce des épices des possibilités juteuses.
Quant à l’ordre harmonieux que l’intrusion européenne aurait déstabilisé, il s’agit d’un mythe, d’ailleurs largement inventé par des Européens à partir de la fin du XVIIIe siècle. Les sociétés sud-asiatiques étaient guerrières, commerciales et agitées de contradictions (y compris religieuses), proches sur ces points des sociétés européennes contemporaines ; en outre, jusqu’à la fin du XVIIIe siècle l’intrusion des Européens n’eut sur ces sociétés que des effets modestes. L’historiographie la plus récente fait justement ressortir ces similitudes, par exemple la « révolution commerciale » qu’aurait connue l’Asie du Sud-Est au XVe siècle, si brillamment analysée par Anthony ReidAnthony Reid, Charting the Shape of Early Modern Southeast Asia, Chiang Mai, Silkworm Books, 1999, Seattle, University of Washington Press, 2000.. Ce sont des mondes commensurables qui se trouvent connectés à partir du début du XVIe siècle par une route maritime, la Carreira da Indià qu’emprunte un nombre croissant de vaisseaux. Ils amenaient sur les rivages d’Asie quelques milliers d’Européens, dont certains firent souche localement, en particulier les fameux casados, Portugais mariés à des femmes indigènes converties au catholicisme. On peut aussi mentionner, au XVIIe siècle, les quelques dizaines de bourgeois hollandais régisseurs de plantations aux îles Banda (Moluques), dans lesquelles ils font travailler une main-d’œuvre esclave. Il y a enfin des missionnaires, dont le plus fameux, le Jésuite italien Roberto de Nobili, adopte le mode de vie d’un brahmane dans l’espoir d’obtenir la conversion d’hommes de haute caste. Mais la plupart des Européens restent des oiseaux de passage,désireux de rentrer chez eux et y réussissant le plus souvent, si toutefois ils n’ont pas été fauchés par les « fièvres ».
CommensurabilitéSur la question de l’incommensurabilité/commensurabilité, voir notamment Romain Bertrand (op. cit.) pour l’analyse qu’il fait des différences de milieux entre commerçants néerlandais de la Première navigation et la société de cour qu’ils trouvent à Java ainsi que Sanjay Subrahmanyam, « Par-delà l’incommensurabilité : pour une histoire connectée des empires aux temps modernes », Revue d’histoire moderne & contemporaine, 2007/5 (n° 54-4bis), p. 34-53. DOI : 10.3917/rhmc.545.0034. URL : https://www.cairn.info/revue-d-histoire-moderne-et-contemporaine-2007-5-page-34.htm. et similitude au moins apparente ne signifient cependant pas compréhension mutuelle, d’autant que les flux sont caractérisés par un fort degré d’asymétrie. Pour un arrivage en Asie d’Européens par milliers, l’historien observe un mouvement inverse d’Asiatiques vers l’Europe quasi insignifiant : le groupe le plus fourni est sans doute constitué des charpentiers indiens, quelques dizaines, qui viennent travailler aux chantiers navals lisboètes, et dont certains font souche localement. Pour des achats européens de marchandises qui s’élargissent des épices vers les tissus, les ventes de vin et de lainages en Asie méridionale demeurent symboliques, obligeant, pour solder les comptes, à d’importantes sorties d’espèces d’Europe ou d’Amérique ibérique. Dans la phase qui précède la colonisation, les contacts directs entre Europe et Asie méridionale restent si limités qu’ils favorisent les persistance de mythes des deux côtés : fantasmes sur la richesse et la cruauté asiatiques, d’un côté, caricatures des « gens à chapeaux » dans les poses parfois les plus ridicules, de l’autre, comme on le voit sur les miniatures ou les parois des temples en Inde. L’effet visible produit par les Européens sur les sociétés sud-asiatiques paraît au total assez infime : en dehors de la naissance de quelques villes coloniales, qui restent des enclaves, et constituent des cités assez modestes en comparaison des capitales autochtones, il se résume pour l’essentiel à l’introduction de plantes américaines dont l’une au moins, le piment, connaîtra un succès extraordinaire, et à quelques cas d’acculturation par conversion au catholicisme parmi les populations côtières (les seules conversions massives concernent les Philippines espagnoles).
La connexion entre Europe et Asie demeura donc quantitativement limitée, et discontinue, dans l’espace comme dans le temps – ce jusque dans la période de la colonisation à grande échelle […]
L’effet en retour de l’intrusion des Européens en Asie méridionale fut pour sa part moins mesuré qu’on ne le croit généralement. La découverte de sociétés policées n’ayant pas connu la révélation chrétienne contribua au bouleversement des idées qui caractérisera la Renaissance. Par ailleurs, les voyages aidèrent au développement de nouveaux savoirs linguistiques, cartographiques et botaniques en particulier. La compilation du Hortus Malabaricus Indicus, réalisée au Kerala à la demande d’un gouverneur hollandais servit de matériau à Linné pour sa classification des plantes. Outre les épices, déjà familières des tables européennes au moins depuis le XIIe siècle, arrivèrent aussi en Europe les objets divers, aux formes parfois extravagantes, qui remplirent les cabinets de curiosités […], ainsi que les animaux « exotiques », comme les éléphants ou 1es rhinocéros qui inspirèrent les artistes de la Renaissance, un Dürer ou un Raphaël. L’imaginaire européen fut grandement stimulé par ce contact avec l’Asie méridionale.
Mais celle-ci était aussi une grande puissance économique dont l’expansion dut beaucoup aux navires d’Occident. À partir de la fin du XVIIe affluèrent en Europe les « indiennes » ou « calicots » (de Calicut), les tissus de coton fabriqués en Inde, utilisés d’abord surtout pour l’ameublement et la décoration. Certains fabricants songèrent à mixer coton et et lin pour produire des « futaines », faisant ainsi pénétrer les tissus de coton dans le domaine de l’habillement en Europe. A la fin du XVIIe siècle, un directeur de l’East India Company eut l’idée de faire fabriquer en Inde deux cent mille pièces de tissus pour le marché européen, introduisant ainsi le « prêt-à-porter » dans la mode vestimentaire. L’Asie méridionale, entrée d’abord dans les demeures des Européens, commença à parer leurs corps. Les conséquences à long terme pour les économies européenne et asiatique furent considérables. Tandis qu’au XVIIIe siècle la mode des indiennes se répandait à travers toute l’Europe, les fabricants européens, incapables de reproduire la qualité des produits indiens du fait de la supériorité des Indiens en matière de teinture, tentèrent de se protéger de la concurrence par des mesures douanières. Mais, ne réussissant pas à exclure totalement les indiennes du marché, ils choisirent la voie de la substitution d’importations en développant l’innovation technologique avec la spinning Jenny puis le métier d’Arkwright, qui leur permirent d’abaisser leurs coûts et de devenir enfin compétitifs. Ainsi peut-on estimer que l’afflux des tissus indiens en Europe fut largement à l’origine de la révolution industrielleSur la question de l’industrialisation, on se reportera aux chroniques de la Cliothèque sur l’ouvrage de Kenneth Pomeranz, Une grande divergence, Albin Michel, «L’évolution de l’humanité», Maison des Sciences de l’Homme, 2010 sachant que la question n’est pas limitée aux relations Europe-Asie en raison du débat initié en son temps par Eric Williams (Capitalism and Slavery, Chapel Hill, Univ. of North Carolina Press, 1944, 1994), sur la part financière débattue de la traite négrière atlantique dans l’industrialisation.. En outre, suivant l’hypothèse peut être osée d’A. R. T. KemasangA. R. Taunus Kemasang, « Tea — midwife and nurse to capitalism ». Race & Class, 2009, 51(1), 69–83. https://doi.org/10.1177/0306396809106164. […], l’amélioration de l’état de santé et de la capacité de travail par temps froid liée depuis les premières décennies du XVIIIe siècle en Grande-Bretagne à la consommation massive de thé […] aurait permis un important accroissement de la productivité. Ceci va en tout cas à l’encontre des idées reçues sur l’avance de l’Europe.
Jean-Louis Margolin, Claude Markovits, Les Indes et l’Europe. Histoires connectées XVe-XXIe siècle, Gallimard, coll. « Folio », 2015, p. 736-744. Disponible en édition électronique (EPUB, etc.)