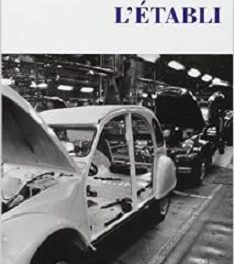Thomas More, précurseur du libéralisme
Extrait de « Utopia »
« Mon cher ami, je te dirais franchement mon intime conviction : il me semble que partout où la propriété privée existe, partout où l’argent est la mesure de toutes les choses, il est bien difficile de réaliser un régime politique fondé sur la justice ou sur la prospérité ; à moins que tu n’estimes que la justice se réalise là où les meilleures choses vont aux pires sujets, à moins que tu ne penses que la prospérité s’instaure là où toutes les richesses sont réparties entre très peu de personnes : et même celles-ci ne peuvent se dire pleinement à leur aise quand tous les autres sont dans la misère. (…)
A vrai dire, je pense le contraire : on ne peut bien vivre là où tout est en commun. Comment l’abondance de produits peut-elle se réaliser là où chacun essaye de se soustraire au travail, étant donné qu’il n’est point stimulé par la pensée de son propre profit et que la confiance dans le travail de l’autre le rend indolent ? »
« De optimo reipublicae statu deque nova insula Utopia, libellus vere aureus, nec minus salutaris quam festivus, clarissimi disertissimique viri THOMAE MORI inclitae civitatis Londinensis civis & Vicecomitis », Bâle, 1518, Livre premier. (Traduction de A. Cairoli)
Le libéralisme
« Ainsi, en écartant entièrement tous ces systèmes ou de préférences ou d’entraves, le système simple et facile de la liberté naturelle vient se présenter de lui-même et se trouve tout établi.
Tout homme, tant qu’il n’enfreint pas les lois de la justice, demeure en pleine liberté de suivre la route que lui montre son intérêt et de porter où il lui plaît son industrie et son capital, concurremment avec ceux de tout autre homme ou de toute autre classe d’hommes.
Le souverain se trouve entièrement débarrassé d’une charge qu’il ne pourrait essayer de remplir sans s’exposer infailliblement à se voir sans cesse tromper de mille manières, et pour l’accomplissement convenable de laquelle il n’y a aucune sagesse humaine ni connaissance qui puissent suffire, la charge d’être le surintendant [le chef] de l’industrie des particuliers et de la diriger vers les emplois les mieux assortis à l’intérêt général de la société. Dans le système de la liberté naturelle, le souverain n’a que trois devoirs à remplir : trois devoirs, à la vérité, d’une haute importance, mais clairs, simples et à la portée d’une intelligence ordinaire. Le premier, c’est le devoir de défendre la société de tout acte de violence ou d’invasion de la part d’autres sociétés indépendantes. Le second, c’est le devoir de protéger, autant qu’il est possible chaque membre de la société contre l’injustice ou l’oppression de tout autre membre, ou bien le devoir d’établir une administration exacte de la justice. Et le troisième, c’est le devoir d’ériger ou d’entretenir certains ouvrages publics et certaines institutions que l’intérêt privé d’un particulier ou de quelques particuliers ne pourrait jamais les porter à ériger ou à entretenir, parce que jamais le profit n’en rembourserait la dépense à un particulier ou à quelques particuliers, quoiqu’à l’égard d’une grande société ce profit fasse beaucoup plus que rembourser les dépenses. »
Extraits d’Adam Smith, Recherche sur la nature et les causes de la richesse des nations, 1776
« La lutte des classes » version libérale…(Mayet, 1786)
« Pour assurer et maintenir la prospérité de nos manufactures, il est nécessaire que l’ouvrier ne s’enrichisse jamais, qu’il n’ait précisément que ce qu’il lui faut pour se bien nourrir et se vêtir. Dans une certaine classe du peuple, trop d’aisance assouplit l’industrie, engendre l’oisiveté et tous les vices qui en dépendent. A mesure que l’ouvrier s’enrichit, il devient difficile sur le choix et le salaire du travail. Le salaire de la main-d’oeuvre une fois augmenté, il s’accroît en raison des avantages qu’il procure. C’est un torrent qui a rompu (…). Personne n’ignore que c’est principalement au bas prix de la main-d’oeuvre que les fabriques de Lyon doivent leur étonnante prospérité. Si la nécessité cesse de contraindre l’ouvrier à recevoir de l’occupation, quelque salaire qu’on lui offre, s’il parvient à se dégager de cette espèce de servitude, si ses profits excèdent ses besoins au point qu’il puisse subsister quelque temps sans le secours de ses mains, il emploiera ce temps à former une ligue. N’ignorant pas que le marchand ne peut éternellement se passer de lui, il osera, à son tour, lui prescrire les lois qui mettront celui-ci hors d’état de soutenir toute concurrence avec les manufactures étrangères, et, de ce renversement auquel le bien-être de l’ouvrier aura donné lieu, proviendra la ruine totale de la fabrique. Il est donc très important aux fabriquants de Lyon de retenir l’ouvrier dans un besoin continuel de travail, de ne jamais oublier que le bas prix de la main d’oeuvre leur est non seulement avantageux par lui-même, mais qu’il le devient encore en rendant l’ouvrier plus laborieux, plus réglé dans ses moeurs, plus soumis à leurs volontés. »
Ecrit pas l’économiste Mayet dans son « Mémoire sur le fabriques de Lyon » en 1786.
cité d’après P. Léon, Economies et sociétés pré-industrielles, tome II (1650-1780), Paris, éd. A. Colin, coll U, Série histoire moderne, 1970
Valeur d’une marchandise et valeur-travail
« Ce n’est pas l’utilité qui est la mesure de la valeur échangeable, quoiqu’elle lui soit absolument essentielle. Si un objet n’était d’aucune utilité, ou, en d’autres termes, si nous ne pouvions le faire servir à nos jouissances, ou en tirer quelque avantage, il ne posséderait aucune valeur échangeable quelle que fût d’ailleurs sa rareté, ou quantité de travail nécessaire pour l’acquérir.
Les choses, une fois qu’elles sont reconnues utiles par elles-mêmes, tirent leur valeur échangeable de deux sources, de leur rareté et de la quantité de travail nécessaire pour l’acquérir.
Il y a des choses dont la valeur ne dépend que de leur rareté. Nul travail ne pouvant en augmenter la quantité, leur valeur ne peut baisser par suite d’une plus grande abondance. Tels sont les tableaux précieux, les statues, les livres et les médailles rares (…)
Ils ne forment cependant qu’une très petite partie des marchandises qu’on échange journellement. Le plus grand nombre des objets que l’on désire posséder étant le fruit de l’industrie, on peut le multiplier, non seulement dans un pays, mais dans plusieurs (…)
Quand donc nous parlons des marchandises, de leur valeur échangeable, et des principes qui règlent les prix relatifs, nous n’avons en vue que celles de ces marchandises dont la quantité peut s’accroître par l’industrie de l’homme, dont la production est encouragée par la concurrence, et n’est contrariée par aucune entrave.
Dans l’enfance des sociétés la valeur échangeable des choses, ou la règle qui fixe la quantité que l’on doit donner d’un objet pour un autre, ne dépend que de la quantité comparative de travail qui a été employée à la production de chacun d’eux. »
D. Ricardo, Des principes de l’économie politique et de l’impôt, 1817 Flammarion éd, 1971, p. 25
(cité par Jacques Bouillon et coll., Le XIXe siècle et ses racines, histoire/seconde, Bordas, Paris, 1981, p. 163)
Friedrich List
Système national d’économie politique, 1833.
Extraits de la préface de l’édition de 1833
« Si, comme on le dit, la préface d’un livre doit en raconter l’origine, j’ai ici à retracer près de la moitié de ma vie ; car plus de vingt trois ans se sont écoulés depuis que le premier doute s’est élevé en moi sur la vérité de ma théorie régnante en économie politique, depuis que je m’occupe de scruter les erreurs de cette théorie et de rechercher les causes principales que leur ont donné naissance.(…) Les fonctions que je remplissais m’en ont fourni la première occasion ; ma destinée m’a entraîné malgré moi et avec une force irrésistible, une fois entré dans la voie du doute et de l’examen , à continuer d’y marcher.
Les Allemands de mon époque se rappelleront quelle profonde atteinte la prospérité de l’Allemagne avait éprouvée en 1818. J’avais alors à préparer un cours d’économie politique ; j’avais, tout aussi bien qu’un autre, étudié ce qu’on avait pensé et écrit à ce sujet, mais je ne voulais pas me borner à m’instruire la jeunesse de l’état de la science ; je tenais à lui enseigner aussi les moyens de l’ordre économique capables de développer le bien-être, la culture et la puissance de l’Allemagne. La théorie présentait le principe de la liberté du commerce. Ce principe me paraissait raisonnable, assurément, et, de plus, éprouvé par l’expérience, lorsque je considérais les effets de l’abolition des douanes provinciales de France, et ceux de l’union des trois royaumes britanniques ; mais les prodigieux résultats du système continental et les suites désastreuses de sa suppression étaient trop près de moi pour que je pusse n’en point tenir compte ; ils me semblèrent donner à ma doctrine un éclatant démenti, et en tâchant de m’expliquer cette contradiction, je vins à reconnaître que toute cette doctrine n’était vraie qu’autant que toutes les nations pratiqueraient entre elles la liberté de commerce comme elle avait été pratiquée par les provinces en question. Je fus conduit ainsi à la notion de la nationalité ; je trouvai que la théorie n’avait vu que l’humanité et les individus, et point les nations. Il devint évident pour moi qu’entre deux pays très avancés la libre concurrence ne peut être qu’avantageuse à l’un et à l’autre, s’ils se trouvent au même degré d’éducation industrielle, et qu’une nation en arrière, par un destin fâcheux, sous le rapport de l’industrie, du commerce et de la navigation, qui, d’ailleurs, possède des ressources matérielles et morales nécessaires pour son développement, doit avant tout exercer ses forces afin de se rendre capable de soutenir la lutte avec les nations qui l’ont devancée. En un mot, En un mot, je distinguai entre l’économie cosmopolite et l’économie politique, et je me dis que l’Allemagne devait abolir ses douanes provinciales ; puis, à l’aide d’un système commun vis-à-vis de l’étranger, s’efforcer d’atteindre le même degré de développement en industrie et en commerce, auquel d’autres nations étaient parvenues au moyen de leur politique commerciale. (…) »
1- présenter l’auteur, le contexte économique et politique de l’Allemagne en 1818.
2- Quel constat fait-il de la situation économique de son pays ?
3- Que cherche-t-il à promouvoir et quelles sont alors ses propositions ?
4- A quel avenir sont vouées les propositions de F.List en matière économique ?
Benjamin Constant (1829)
« J’ai défendu quarante ans le même principe, liberté en tout, en religion, en philosophie, en littérature, en industrie, en politique : et par liberté, j’entends le triomphe de l’individualité, tant sur l’autorité qui voudrait gouverner par le despotisme (1), que sur les masses qui réclament le droit d’asservir la minorité à la majorité (2). Le despotisme n’a aucun droit. La majorité a celui de contraindre la minorité à respecter l’ordre : mais tout ce qui ne trouble pas l’ordre, tout ce qui n’est qu’intérieur, comme l’opinion ; tout ce qui, dans la manifestation de l’opinion, ne nuit pas à autrui, soit en provoquant des violences matérielles, soit en s’opposant à une manifestation contraire; tout ce qui, en fait d’industrie, laisse l’industrie rivale s’exercer librement, est individuel, et ne saurait être légitimement soumis au pouvoir social.
(…)
En fait de gouvernement, l’égalité la plus absolue des droits répartis entre tous les individus agglomérés en corps de nation doit être et sera bientôt, dans tous les pays civilisés, la première condition de l’existence de tout gouvernement. Les fonctions seront différentes, les formes seront combinées de manière à maintenir l’ordre; mais des limites fixes seront tracées à tous les pouvoirs, parce que les pouvoirs ne sont que les moyens, et que la conservation et l’exercice des droits sont le but. Par conséquent il y aura des variations possibles, des changements progressifs dans les fonctions, les formes, l’étendue, la compétence, les dénominations des pouvoirs: mais le fond sera nécessairement, sous ces diverses dénominations ou ces diverses formes, l’égalité de droits que nous venons d’indiquer; et tous ceux qui posséderont ces droits seront autorisés à concourir à leur défense, c’est-à-dire à participer par un mode quelconque à la confection des lois qui détermineront l’action du gouvernement. »
Benjamin Constant, « Mélanges de littérature et de politique », in Ecrits politiques
Notes :
1) Forme de gouvernement dans lequel le pouvoir est absolu, sans limites, arbitraire, et se trouve concentré dans les mains d’un seul.
2) Pour les libéraux du XIXème siècle comme Tocqueville, Constant ou Mill, la démocratisation progressive de la société entraîne un risque de « tyrannie de la majorité ». Conscients des dérives de la Révolution française, les libéraux sont soucieux de protéger les libertés individuelles pour garantir aux minorités la possibilité de penser et d’agir comme elles l’entendent tant qu’elles ne font pas de tort flagrant à autrui.
autre extrait
« En fait d’économie politique, il y aura, quant à la propriété, respect et protection, parce que la propriété est une convention légale, nécessaire à l’époque : mais la disposition, la division, la subdivision, la circulation et la dissémination de la propriété, ne rencontreront aucune restriction, aucune entrave, parce que la liberté illimitée de conserver, d’aliéner, de morceler, de dénaturer la propriété, est, dans notre état social, le droit inhérent, le besoin essentiel de tous ceux qui possèdent. Tous les genres de propriété seront également sacrés aux yeux de la loi ; mais chacune prendra le rang et jouira de l’influence que lui assigne la nature des choses. La propriété industrielle se placera, sans que la loi s’en mêle, chaque jour plus au-dessus de la propriété foncière, parce que, ainsi que nous l’avons dit ailleurs, la propriété foncière est la valeur de la chose; l’industrielle, la valeur de l’homme (1). Il y aura de plus, relativement à l’industrie, liberté, concurrence, absence de toute intervention de l’autorité, soit pour préserver les individus de leurs propres erreurs (c’est à leur expérience à les éclairer), soit pour assurer au public de meilleurs objets de consommation (c’est à son expérience à guider ses choix), et tout monopole, tout privilège, toute corporation protégée au détriment de l’activité et des entreprises individuelles, disparaîtra sans retour.
En fait d’opinion, de croyances, de lumières, il y aura neutralité complète de la part du gouvernement, parce que le gouvernement, composé d’hommes de la même nature que ceux qu’il gouverne, n’a pas plus qu’eux des opinions incontestables, des croyances certaines, ou des lumières infaillibles. On lui accordera tout au plus la faculté de réunir et de conserver tous les matériaux de l’instruction, d’établir des dépôts (2), ouverts à tous, dans lesquels chacun la puise à son gré, pour en faire usage à sa guise, sans qu’aucune direction lui soit imprimée.
Tel est, je le pense, l’état social vers lequel l’espèce humaine commence à marcher. Atteindre cet état social est le besoin, et sera par conséquent la destinée de l’époque. Vouloir rester en deçà serait peu sage; aller au-delà serait prématuré. »
Benjamin Constant, « Mélanges de littérature et de politique », in Ecrits politiques
Notes :
1) Avec la révolution industrielle, la propriété des terres (= propriété foncière) prend moins d’importance que celle des industries (= propriété industrielle). Les aristocrates, favorables à l’Ancien Régime, étaient plutôt des propriétaires terriens, alors les bourgeois libéraux sont ceux qui font vivre la nouvelle économie fondée sur l’industrie.
2) Constant veut sans doute parler ici de bibliothèques publiques ouvertes à tous.
Lamartine : L’étatisation des chemins de fer
« D’abord, j’ai commencé par le dire, je veux des chemins de fer. Entendons-nous, Messieurs, je n’en veux pas improviser étourdiment un réseau complet, entrepris sur mille points à la fois, achevé sur aucun, et jetant le pays dans une expérience de deux milliards ; mais j’en veux d’abord un, un grand, le plus nécessaire de tous, parce qu’il va se renouer à tout un système de voies parallèles déjà organisé sur vos frontières du Nord. Je veux celui de Bruxelles avant tout. Je veux ensuite celui de Paris à Strasbourg, puis celui de Paris à Marseille. Je veux donc des chemins de fer immédiatement entrepris, et promptement et réellement terminés…… Vous avez des offres, des gages, des certitudes … Mais quand les capitaux seraient tous atteints de folie, quand des compagnies se présenteraient sans tarifs exagérés, sans minimum d’intérêt, sans monopole d’actions, je vous dirais : refusez-les encore.
Oui, refusez-les, pour ne pas vous déclarer incapables, pour ne pas engager votre sol et inféoder votre avenir de viabilité à une puissance d’intérêt individuel, rivale de la puissance de la nation ; pour ne pas vous enlever à vous, nation, la liberté de vos mouvements, la détermination de vos lignes, l’indépendance de vos tarifs, les améliorations, les expériences, les rectifications que vous aurez à tenter ; en un mot, pour ne pas vous dépouiller de la disponibilité complète et votre action actuelle et surtout future dans l’oeuvre de vos chemins de fer.
Ah ! Messieurs, il y a un sentiment qui m’a toujours puissamment travaillé en lisant l’histoire ou en voyant des faits… C’est l’incompatibilité de la liberté sincère, progressive, avec l’existence des corps dans un État et dans une civilisation…… Jamais gouvernement, jamais nation n’aura constitué en dehors d’elle une puissance d’argent, d’exploitation, et même de politique, plus menaçante et plus envahissante que vous n’allez le faire en livrant votre sol, votre administration, et cinq ou six milliards à vos compagnies.
Je vous prophétise avec certitude, elles seront maîtresses du gouvernement et des Chambres avant dix ans… Mais, disent les préopinants, l’État est incapable. L’État est incapable ? Je vais commencer par vous demander à vous, si les compagnies, de quelque nature qu’elles soient, ont donné jusqu’ici tant de preuves de leur merveilleuse capacité ? Leur histoire, hors une seule exception, et encore rentre-t-elle dans mon système, leur histoire n’est que celle de nos désastres, de nos ruines, de nos catastrophes industrielles et coloniales. Rien de grand ne s’est fait, de grand, de monumental en France, et je dirais dans le monde, que par l’État : et comment cela serait-il autrement ? Vous avez beau calomnié la force publique, la puissance de l’association universelle et gouvernementale n’a-t-elle pas des conditions de capacité et d’omnipotence mille fois supérieures à celles des associations individuelles ? (…) »
Alphonse de Lamartine, L’étatisation des chemins de fer, Discours prononcé à la Chambre des députés, Paris, 9 mai 1838
« Lamartine : L’étatisation des chemins de fer », dans Grands moments d’éloquence parlementaire, Assemblée Nationale, http://www.assemblee-nationale.fr/histoire/7ei.asp, 6 mai 2013, 19h
L’auteur de ce document est Alphonse Marie Louis de Prat de Lamartine, plus connu sous le nom d’Alphonse de Lamartine. Cet homme politique français fut aussi écrivain de romans, poèmes et pièces de théâtre, c’est pourquoi il est reconnu pour avoir été un excellent orateur. Il fut député à Paris de 1833 à 1851 et joua un important rôle dans la Révolution de février 1848. C’est lui-même qui proclama la Deuxième République en France.
John Stuart Mill (1859)
« [La liberté humaine] comprend d’abord le domaine intime de la conscience qui nécessite la liberté de conscience au sens le plus large: liberté de penser et de sentir, liberté absolue d’opinions et de sentiments sur tous les sujets, pratiques ou spéculatifs, scientifiques, moraux ou théologiques. La liberté d’exprimer et de publier des opinions peut sembler soumise à un principe différent, puisqu’elle appartient à cette partie de conduite de l’individu qui concerne autrui ; mais comme elle est presque aussi importante que la liberté de penser elle-même, et qu’elle repose dans une large mesure sur les mêmes raisons, ces deux libertés sont pratiquement indissociables. C’est par ailleurs un principe qui requiert la liberté des goûts et des occupations, la liberté de tracer le plan de notre vie suivant notre caractère, d’agir à notre guise et risquer toutes les conséquences qui en résulteront, et cela sans en être empêché par nos semblables tant que nous ne leur nuisons pas, même s’ils trouvaient notre conduite insensée, perverse ou mauvaise. En dernier lieu, c’est de cette liberté propre à chaque individu que résulte, dans les mêmes limites, la liberté d’association entre individus : la liberté de s’unir dans n’importe quel but, à condition qu’il soit inoffensif pour autrui, que les associés soient majeurs et qu’il n’y ait eu dans leur enrôlement ni contrainte ni tromperie.
Une société – quelle que soit la forme de son gouvernement – n’est pas libre, à moins de respecter globalement ces libertés; et aucune n’est complètement libre si elles n’y sont pas absolues et sans réserves. La seule liberté digne de ce nom est de travailler à notre propre avancement à notre gré, aussi longtemps que nous ne cherchons pas à priver les autres du leur ou à entraver leurs efforts pour l’obtenir. Chacun est le gardien naturel de sa propre santé aussi bien physique que mentale et spirituelle. L’humanité gagnera davantage à laisser chaque homme vivre comme bon lui semble qu’à le contraindre à vivre comme bon semble aux autres. »
John Stuart Mill, De la liberté
autre extrait
« Justement parce que la tyrannie de l’opinion (1) est telle qu’elle fait de l’excentricité une honte, il est souhaitable, pour ouvrir une brèche dans cette tyrannie, que les gens soient excentriques.(…)
J’ai dit qu’il était important de laisser le plus de champ possible aux choses contraires à l’usage (2), afin qu’on puisse voir en temps voulu lesquelles méritent de passer dans l’usage. (…)
Il suffit d’avoir une dose suffisante de sens commun et d’expérience pour tracer le plan de vie le meilleur, non pas parce qu’il est le meilleur en soi, mais parce qu’il est personnel. Les êtres humains ne sont pas des moutons; et même les moutons ne se ressemblent pas au point qu’on ne puisse pas les distinguer. Un homme ne trouve un habit ou une paire de souliers qui lui vont que s’ils sont faits sur mesure ou s’il dispose d’un magasin entier pour faire son choix. Trouve-t-on plus facilement chaussure à son pied que vie à sa convenance? (…) Ne serait-ce que parce que les hommes n’ont pas tous les mêmes goûts, il ne faut pas tenter de les fabriquer tous sur le même modèle. (…) Pourquoi donc la tolérance devrait-elle seulement se limiter, dans le sentiment du public, aux goûts et aux modes de vie qui arrachent l’assentiment par le nombre de leurs adhérents? Il n’y a personne (si ce n’est dans les institutions monastiques) pour nier complètement la diversité des goûts. Une personne peut, sans encourir de blâme, aimer ou ne pas aimer le canotage, le cigare, la musique, la gymnastique, les échecs, les cartes ou l’étude, et cela parce que les partisans et les ennemis de toutes ces choses sont trop nombreux pour être réduits au silence.
Mais les hommes – et plus encore les femmes – qui peuvent être accusés soit de faire « ce que personne ne fait », soit de ne pas faire « ce que tout le monde fait », peuvent se voir autant dénigrés que s’ils avaient commis quelque grave délit moral. »
John Stuart Mill, De la liberté
Notes :
1) Pour les libéraux du XIXème siècle comme Tocqueville, Constant ou Mill, la démocratisation progressive de la société entraîne un risque de « tyrannie de la majorité » ou « tyrannie de l’opinion ». Conscients des dérives de la Révolution française, les libéraux sont soucieux de protéger les libertés individuelles pour garantir aux minorités la possibilité de penser et d’agir comme elles l’entendent tant qu’elles ne font pas de tort flagrant à autrui.
2) Contraire aux habitudes et aux coutumes.
Le Saint-simonisme
Nous supposons que la France perde subitement ses cinquante premiers physiciens, ses cinquante premiers chimistes, ses cinquante premiers physiologistes … ses cinquante premiers mécaniciens, … ses cinquante premiers tanneurs, ses cinquante premiers teinturiers, ses cinquante premiers mineurs, etc.
Comme ces hommes sont les Français les plus essentiellement producteurs, ceux qui donnent les produits les plus importants, ceux qui dirigent les travaux les plus utiles à la nation et qui la rendent productive dans les sciences, dans les beaux-arts et dans les arts et métiers, ils sont réellement la fleur de la société française; ils sont de tous les Français les plus utiles à leur pays, ceux qui lui procurent le plus de gloire, qui hâtent le plus sa civilisation ainsi que sa prospérité: la nation deviendrait un corps sans âme à l’instant où elle les perdrait…
Passons à une autre supposition. Admettons que la France conserve tous les hommes de génie qu’elle possède dans les sciences, dans les beaux-arts et dans les arts et métiers, mais qu’elle ait le malheur de perdre le même jour Monsieur, frère du roi, Mgr le duc d’Angoulème, Mme la duchesse de Bourbon, etc… Qu’elle perde en même temps tous les grands officiers de la Couronne, tous les ministres d’Etat avec ou sans département, tous les conseillers d’Etat, tous les maîtres des requêtes, tous ses maréchaux, etc. et en sus de cela, les dix mille propriétaires parmi les plus riches parmi ceux qui vivent noblement .
Cet accident affligerait certainement les Français, parce qu’ils sont bons, parce qu’ils ne sauraient voir avec indifférence la disparition subite d’un aussi grand nombre de leurs compatriotes. Mais cette perte des trente mille individus réputés les plus importants de l’Etat ne leur causerait de chagrin que sous un rapport purement sentimental, car il n’en résulterait aucun mal politique pour l’Etat…
Ces suppositions font voir que la société actuelle est véritablement le monde renversé;
Puisque la nation a admis pour principe fondamental que les pauvres devaient être généreux à l’égard des riches, et qu’en conséquence les moins aisés se privent journellement d’une partie de leur nécessaire pour augmenter le superflu des gros propriétaires;
…Puisque l’ignorance, la superstition, la paresse et le goût des plaisirs dispendieux forment l’apanage des chefs suprêmes de la société, et que les gens capables, économes et laborieux ne sont employés qu’en subalterne et comme des instruments;
Puisque, en un mot, dans tous les genres d’occupation, ce sont des hommes incapables qui se trouvent chargés du soin de diriger les gens capables; que ce sont, sous le rapport de la moralité, les hommes les plus immoraux qui sont appelés à former les citoyens et que, sous le rapport de la justice distributive, ce sont les grands coupables qui sont préposés pour punir les fautes des petits délinquants.
Quoique cet extrait soit fort court, nous croyons avoir suffisamment prouvé que le corps politique était malade; que sa maladie était grave et dangereuse; qu’elle était la plus fâcheuse qu’il pût éprouver, puisque son ensemble et toutes ses parties s’en trouvaient affectés en même temps.
Saint-Simon, extrait de l’Organisateur (1819)
Socialisme utopique
« Il n’est pas de désir plus général que celui de doubler son revenu par un coup de fortune, comme un riche mariage, un héritage, une sinécure [poste qui permet de gagner de l’argent sans réellement travailler] ; et si l’on trouvait le moyen d’élever le revenu de chacun, non pas au double, mais au quadruple, en valeur réelle, une telle découverte serait assurément la plus digne de l’attention générale. Tel sera le fruit de la méthode sociétaire naturelle; en France, le produit annuel, estimé six milliards, s’élèvera à vingt-quatre, dès la première année du régime sociétaire. (…)
Le titre de Nouveau Monde industriel m’a paru le plus exact pour désigner ce nouvel ordre, ce bel ordre sociétaire qui, entre autres propriétés, possède celle de créer l’attraction industrielle : on y verra nos oisifs, même les petites maîtresses, être sur pied dès les quatre heures du matin, en hiver comme en été, pour se livrer avec ardeurs aux travaux utiles, aux soins des jardins et basses-cours, aux fonctions du ménage, des fabriques et autres, pour lesquelles le mécanisme civilisé inspire du dégoût à toute la classe riche. (…)
Un préjugé a de tout temps empêché les recherches sur l’association ; on a dit : Il est impossible de réunir en gestion domestique trois ou quatre ménages, sans que la discorde ne s’y manifeste au bout d’une semaine, surtout parmi les femmes ; il est d’autant plus impossible d’associer trente ou quarante familles, et à plus forte raison trois ou quatre cents.
C’est très faussement raisonné : car si Dieu veut l’économie et la mécanique, il n’a pu spéculer [songer] que sur l’association du plus grand nombre possible (…). Il dirige l’univers matériel par attraction [= loi de la gravitation universelle] ; s’il employait un autre ressort pour la direction du monde social, il n’y aurait pas unité, mais duplicité d’action [état de ce qui est double et devrait être unique] dans son système. »
Extraits de Charles Fourier, Le nouveau monde industriel et sociétaire, 1829
Constitution de la Communauté Icarienne
Ce texte se rapporte au deuxième essai de la formation d’une Communauté icarienne aux Etats-Unis (en Illinois aux USA) par Cabet et ses disciples. Cela restera un échec.
« Constitution de la Communauté Icarienne
Votée à l’unanimité le 21 février 1850, révisée, discutée et votée de nouveau à l’unanimité le 4 Mai 1851. »
« Art.1.- Les Icariens forment entre eux une véritable Société. Ils sont tous Associés. (…)
Art. 4.- Elle [la société] est établie aussi dans l’intérêt de l’Humanité tout entière, par dévouement à celle-ci, pour présenter une système de société capable de la rendre heureuse, pour prouver par l’expérience que la Communauté, basée sur la Fraternité, est réalisable et possible. (…)
Art.8.- Elle est destinée à devenir une Cité et un État soumis aux lois générales des États- Unis. (…)
Art.12.- Son capital social comprend la fortune de tous les associés. Chacun apporte à la société tout ce qui lui appartient, sans aucune exception. (…)
Art.19.- La Fraternité des Hommes et des Peuples est le principe fondamental et générateur de la Communauté icarienne. (…)
Art.26.- Les Icariens proclament l’Égalité naturelle, sociale ou civile et politique, sans aucun privilège. Ils se reconnaissent tous égaux en droits et en devoirs. (…)
Art.44.- La Fraternité et le Communisme conduisent (…) à la concentration et à l’Unité, qui produisent la force et la puissance. (…)
Art.52.- L’un des principes de la Communauté icarienne, c’est le respect pour la loi et la soumission de la minorité à la majorité. (…)
Art.60.- Tous les travailleurs sont nourris, logés, vêtus, fournis de tout par la Communauté ; par conséquent le salaire est inutile et supprimé. (…)
Art.62.- Les impôts de toute espèce sont inutiles et supprimés ; il n’y a pas d’autre impôt que le travail, rendu court, facile, sans fatigue et sans dangers, attrayant même, au moyen de l’instruction et des machines multipliées à l’infini. (…)
Art.66.- Les machines y sont multipliées sans borne, pour aider et garantir le travailleur, même pour le remplacer, de manière que l’homme puisse un jour n’être plus qu’un créateur et un directeur de machines. (…)
Art.108.- La Communauté garantit : 1° aux femmes en masse, de la part des hommes en masse, respect et égards ; 2°aux enfants, amour ; 3° aux vieillards, égards et respect ; 4° à tous, dévouement et protection. (…)
Art.119.- L’Assemblée générale est composée de tous les hommes définitivement admis et âgés de vingt ans. (…)
Art.120.- Les femmes y sont admises dans une place séparée, avec voix conclusive. Elles sont appelées à donner leur avis sur toues les questions qui les concernent particulièrement. (…)
Art. 175.- Le peuple icarien a essentiellement le droit de réviser et de modifier sa Constitution.- Mais il peut, dans son intérêt, établir des règles et des formes pour que la Constitution ne soit pas exposée à des changements trop précipités ou trop fréquents. (…) »
Les Socialistes et les Communistes en 1848
« On appelait socialistes en 1847, deux sortes de gens. D’abord les adhérents des différents systèmes utopistes, et notamment les owenistes [disciples d’Owen] d’Angleterre, les fouriéristes [disciples de Fourier] en France. Ils ne formaient plus alors que des sectes agonisantes. D’un autre côté, les innombrables médicastres qui voulaient, à l’aide d’un tas de panacées, et avec toutes sortes de rapiéçages, supprimer les misères sociales, sans faire le moindre tort au capital et au profit. C’étaient dans les deux cas des gens placés à l’écart du mouvement ouvrier et qui cherchaient plutôt un appui dans les classes «cultivées». Au contraire, ceux des ouvriers qui, convaincus de l’insuffisance des simples bouleversements politiques, réclamaient une transformation fondamentale de la société, se dénommaient alors communistes. C’était un communisme à peine dégrossi que le leur, purement instructif [sic] , parfois un peu grossier ; mais il était assez puissant pour donner naissance à deux systèmes de communisme utopique : en France l’Icarie [pays imaginaire, titre du livre « Le voyage en Icarie »] de Cabet et en Allemagne le système de Weitling. Le mot de socialisme en 1847 désignait un mouvement bourgeois ; le mot de communisme, un mouvement ouvrier. Ce socialisme, du moins dans l’Europe continentale, avait son entrée dans les salons ; pour le communisme, c’était exactement le contraire. »
Préface à la 3e édition du « Manifeste du parti communiste », 1890, écrite par Friedrich Engels, l’ami de Karl Marx.
Cité dans « 1848 en Europe » par Jean le Yaouanq, PUF, docciers Clio, 1974, p. 33, document 20.
LE DÉVELOPPEMENT DU MOUVEMENT OUVRIER
ADRESSE DES OUVRIÈRES DE LYON AUX FEMMES DU CREUSOT
Le 21 mars 1870, 1500 mineurs du Creusot se mettent en grève pour une augmentation de salaire et une diminution des heures de travail. Les femmes des mineurs en grève firent preuve alors d’une remarquable combativité : l’adresse suivante, émanant des ouvrières lyonnaises, a été publiée dans La Marseillaise, le journal de Rochefort et des sections parisiennes de l’Internationale, le 13 avril 1870. Elle valut aussitôt à cet organe des poursuites judiciaires pour « attaque au principe de la propriété et atteinte au moral de l’armée.
« Citoyennes,
Votre attitude ferme et énergique en face des insolentes provocations de la féodalité du jour est vivement appréciée par les travailleurs de tous les pays et nous, nous éprouvons le besoin de vous adresser nos félicitations.
Ne faiblissez pas, citoyennes, montrez à cette aristocratie impudente et rapace que les exploités, aujourd’hui unis et solidaires, ne se laisseront plus intimider par ces odieux procédés ; on peut encore aujourd’hui les affamer, les emprisonner, mais non pas les dompter, car ils savent que la dernière victoire leur appartient.
Ce jour-là, les oppresseurs de toute race auront accumuler tant de griefs, soulevé tant d’indignation, que, sans être prophète, on peut prévoir une éclatante revanche.
Et cependant, nos gouvernants pouvaient parer à ces éventualités en acceptant les réformes sociales et économiques à mesure qu’elles s’imposaient. Mais non ! pour régler les différends entre les exploiteurs et les exploités, entre les parasites et les producteurs, l’empire n’a rien trouver de mieux que le chassepot [fusil] qu’il vient de mettre à la disposition de la classe des capitalistes, sa complice et son alliée, et celle-ci, derrière un rempart de 800’000 poitrines de soldats, jette insolemment le défit au monde travailleur !
Eh bien le défi est relevé, la guerre est désormais déclarée et elle ne cessera que le jour où le prolétariat sera vainqueur, où les mineurs pourront dire : à nous les mines ! – les cultivateurs : à nous la terre ! et les ouvriers de tous les métiers : à nous l’atelier !
Vous le voyez, amies, cette lutte que vous soutenez si vaillamment n’est que la première phase d’une révolution économique et sociale gigantesque dont l’histoire n’offre aucun exemple car sa devise est « plus d’exploiteurs, rien que des travailleurs ».
Permettez-nous un conseil, citoyennes : vous êtes énergiques, n’oubliez pas que vous êtes filles du peuple, mères de famille. Parlez le langage de la vérité aux soldats qui vont entourent, victimes du malheur, courbés comme vous sous le joug du despotisme. Dîtes à ces malheureux enfants du peuple, que ces hommes qu’ils ont l’ordre de poursuivre ne sont pas, comme on le leur fait entendre, des fauteurs de troubles, suspects soudoyés par un parti politique quelconque, mais bien vos pères, vos frères, vos époux, vos amis, d’honnêtes citoyens, leurs frères dans l’ordre social et n’ayant commis d’autres crimes que celui de revendiquer le droit le plus sacré de l’homme, celui de vivre en travaillant. De telles parole, soyez-en certaines, les impressionneront, les feront réfléchir sur le triste rôle qu’on leur impose vis-à-vis de vous et si vous parvenez à gagner à la cause des opprimés, qui est la leur, les cinq mille soldats campés au Creusot, vous aurez bien mériter du prolétariat.
Et maintenant, citoyennes, en attendant le triomphe de la cause des travailleurs, nous vous serrons fraternellement les mains et vous crions : courage et espoir. »
Cité par Pierre Ponsot, Les grèves de 1870 et la Commune de 1871 au Creusot, pp. 28 à 30. Editions sociales, 1958.
Règlement en cas de grève, syndicat des peintres en bâtiments, 1899, en France.
« Les syndiqués s’engagent à ne subir aucune injustice sous quelle forme qu’elle se présente ; ils pourront quitter leur travail après en avoir averti le comité syndical, et sur avis, dans les cas suivants :
1° Chaque fois qu’une atteinte aura été portée au tarif [salaire] accepté ;
2° Chaque fois qu’un prix [salaire] nouveau débattu et accepté par la majorité de l’atelier aura été repoussé par le patron ;
3° Quand un syndiqué aura été renvoyé parce qu’il fait partie du syndicat ;
4° En cas de différends ou de contestations avec leurs patrons, les syndiqués devront avertir un membre du bureau dans le plus bref délai.
Les syndiqués ne devront pas abandonner leur travail avant que le comité ait délibéré sur le conflit. Le comité entrera en pourparlers avec le patron, mais il ne pourra faire aucune concession sans l’assentiment des ouvriers lésés.
Après la démarche du comité, si la conciliation n’a pu s’opérer, le comité convoque le syndicat, qui prendra les mesures en conséquence.
Dès que la grève sera déclarée, le bureau de la chambre syndicale devra assister à toutes les réunions tenues par les grévistes, qui seront faites exclusivement le soir.
Tout syndiqués ne se conformant pas aux articles précédents feront la grève à leurs risques et périls.
Tout membre non-syndiqué n’aura droit à aucun secours de grève, à moins de décision prise en Assemblée générale.
La dissolution de la chambre ne pourra être proposée qu’en Assemblée générale et à la majorité des trois quarts des membres inscrits.
Les fonds restants en caisse seront employés à des œuvres de bienfaisance, et déterminés en assemblée générale. »
in Documents d’Histoire, O. Voilliard, Paris 1964, éd. Armand Colin, pp. 63-64
L’Anarchisme
Bakounine contre Marx
« Dans l’Etat populaire de M. Marx, nous dit-on, il n’y aura point de classe privilégiée. Tous seront égaux, non seulement au point de vue juridique et politique, mais aussi économique (…). Il n’y aura donc plus de classe, mais un gouvernement et, remarquez-le bien, un gouvernement excessivement compliqué, qui ne se contentera pas de gouverner et d’administrer les masses politiquement, mais encore les administrera économiquement, en concentrant entre ses mains la production et la juste répartition des richesses, la culture de la terre, l’établissement et le développement des fabriques, l’organisation et la direction du commerce, enfin l’application du capital à la production par le seul banquier, l’Etat. Tout cela exigera une science immense et beaucoup de têtes débordantes de cervelle dans ce gouvernement. Ce sera le règne de l’intelligence scientifique, le plus aristocratique, le plus despotique, le plus arrogant et le plus méprisant de tous les régimes. Il y aura une nouvelle classe, une hiérarchie nouvelle de savants réels et fictifs, et le monde se partagera en une minorité dominant au nom de la science, et une immense majorité ignorante. Et alors gare à la masse des ignorants!
(…) Ainsi, aucun Etat, si démocratiques que soient ses formes, voire la république la plus rouge, populaire uniquement au sens de ce mensonge connu sous le nom de représentation du peuple, n’est en mesure de donner à celui-ci ce dont il a besoin, c’est-à-dire la libre organisation de ses propres intérêts, de bas en haut, sans aucune immixtion, tutelle ou contrainte d’en haut, parce que tout Etat, même le plus républicain et le plus démocratique, même pseudo-populaire comme l’Etat imaginé par M. Marx, n’est pas autre chose que le gouvernement des masses de haut en bas par une minorité savante et par cela même privilégiée, soi-disant comprenant mieux les véritables intérêts du peuple que le peuple lui-même. »
Bakounine, Lettres aux compagnons du Jura, in J.W. Makhaiski, Le socialisme des intellectuels, Seuil 1979.
idem, découpage différent et autre référence
« Dans l’Etat populaire de M. Marx, nous dit-on, il n’y aura point de classe privilégiée. Tous seront égaux, non seulement au point de vue juridique et politique, mais aussi économique (…). Il n’y aura donc plus de classe, mais un gouvernement et, remarquez-le bien, un gouvernement excessivement compliqué, qui ne se contentera pas de gouverner et d’administrer les masses politiquement, mais encore les administrera économiquement, en concentrant entre ses mains la production et la juste répartition des richesses, la culture de la terre, l’établissement et le développement des fabriques, l’organisation et la direction du commerce, enfin l’application du capital à la production par le seul banquier, l’Etat. Tout cela exigera une science immense et beaucoup de têtes débordantes de cervelle dans ce gouvernement. Ce sera le règne de l’intelligence scientifique, le plus aristocratique, le plus despotique, le plus arrogant et le plus méprisant de tous les régimes. Il y aura une nouvelle classe, une hiérarchie nouvelle de savants réels et fictifs, et le monde se partagera en une minorité dominant au nom de la science, et une immense majorité ignorante. Et alors gare à la masse des ignorants!
Un tel régime ne manquera pas de soulever de très sérieux mécontentements dans cette masse, et, pour la contenir, le gouvernement illuminateur et émancipateur de M. Marx aura besoin d’une force armée non moins sérieuse. Car le gouvernement doit être fort, dit M. Engels, pour maintenir dans l’ordre ces millions d’analphabètes dont le soulèvement brutal pourrait tout détruire et tout renverser, même un gouvernement dirigé par des têtes débordantes de cervelle.
Vous voyez bien qu’à travers toutes les phrases et toutes les promesses démocratiques et socialistes du programme de M. Marx, on retrouve dans son État tout ce qui constitue la propre nature despotique et brutale de tous les États, quelle que soit la forme de leur gouvernement, et qu’à la fin des comptes l’État populaire, tant recommandé par M. Marx, et l’État aristocratico-monarchique, maintenu avec autant d’habileté que de puissance par M. de Bismarck, s’identifient complètement par la nature de leur but tant intérieur qu’extérieur. À l’extérieur, c’est le même déploiement de la force militaire, c’est-à- dire la conquête ; et à l’intérieur c’est le même emploi de cette force armée, dernier argument de tous les pouvoirs politiques menacés, contre les masses qui, fatiguées de croire, d’espérer, de se résigner et d’obéir toujours, se révoltent. »
Bakounine, Œuvres – Tome IV.
FRAGMENT, formant une suite de L’Empire Knouto-Germanique, Locarno, 1872, pages 476-478
L’anarchisme dans le Jura suisse dans les années 1870
«(…) L’organisation même de l’industrie horlogère, qui permet aux hommes de se connaître parfaitement l’un et l’autre, et de travailler dans leurs propres maisons, où ils ont la liberté de parler, explique pourquoi le niveau intellectuel de cette population est plus élevé que celui des ouvriers qui passent toute leur vie, et cela dès l’enfance, dans les fabriques. (…) Je vis (…) que les ouvriers n’étaient pas une masse menée par une minorité dont ils servaient les buts politiques ; leurs leaders étaient simplement des camarades plus entreprenants – des initiateurs plutôt que des chefs. (…)
L’exposé théorique de l’anarchie tel qu’il était présenté alors par la Fédération jurassienne, et surtout par Bakounine, la critique du socialisme d’État – la crainte d’un despotisme économique, beaucoup plus dangereux que le simple despotisme politique – que j’entendis formuler là, et le caractère révolutionnaire de l’agitation, sollicitaient fortement mon attention. Mais les principes égalitaires que je rencontrais dans les montagnes du Jura, l’indépendance de pensée et de langage que je voyais se développer chez les ouvriers, et leur développement absolu à la cause du parti, tout cela exerçait sur mes sentiments une influence de plus en plus forte ; et quand je quittai ces montagnes, après un séjour de quelques jours au milieu des horlogers, mes opinions étaient fixées. J’étais anarchiste. (…)
Bakounine (…) avait aidé les camarades du Jura à mettre de l’ordre dans leurs idées et à formuler leurs aspirations (…). Dès qu’il vit que le modeste petit journal que Guillaume commençait à publier [au] Locle dans le Jura faisait entendre dans le mouvement socialiste des idées nouvelles et indépendantes, il vient [au] Locle, s’entretint pendant des journées et des nuits entières avec ses nouveaux amis sur la nécessité historique de faire un nouveau pas dans le sens anarchique ; il écrivit pour ce journal une série d’articles profonds et brillants sur le progrès historique de l’humanité vers la liberté ; il communiqua son enthousiasme de liberté à ses nouveaux amis, et créa ce centre de propagande d’où l’anarchisme rayonna dans la suite sur toutes les parties de l’Europe. (…)»
Pierre KROPOTKINE, « Autour de ma vie. Mémoires. » Paris, 1910, rapporté par Claude REICHLER et Roland RUFFIEUX, « Le Voyage en Suisse. Anthologie des voyageurs français et européens de la Renaissance au XXe siècle. » Paris, Robert Laffont, coll. « Bouquins », 1998.
Une Colonie utopiste anarchiste : Cecilia
« A Gênes, le 20 février 1890, un petit groupe de colons anarchistes embarque à bord du bateau Città di Genova, qui les conduira sur le territoire de Palmeira, dans l’Etat brésilien de Parána. Leur tentative de communauté anarchiste, la colonie Cecilia, disparaîtra en avril 1894 dans la tourmente de la guerre civile brésilienne.
Les anarchistes, dont Rossi et ses compagnons, dénoncent l’esprit totalitaire de la plupart des projets utopiques; ils souhaitent vivre dans une société sans organisation, sans bureaucratie, sans règle ni discipline. Les compagnons de la Cecilia prônent un mode de vie et une économie collectivistes ; ils organisent donc une communauté sans religion, sans propriété privée et sans rapports hiérarchiques. Ils critiquent également l’archétype de la famille et expérimentent l’amour libre affin de briser le système familial. Ils croient en l’éducation naturelle de l’Homme.
Le manque d’intimité, causé par la transparence des faits et gestes des colons et l’absence de propriété privée leur posera beaucoup de problèmes. En effet, il leur apparaît difficile d’abandonner toutes leurs pratiques individualistes ainsi que leurs préjugés religieux et sociaux. Le contraste de leur mode de vie avec celui, quasiment féodal, qui régit la société brésilienne à l’époque est également source de problèmes.
A l’époque de la vague de violence anarchiste en Europe (1892-1894) faisant écho aux théories de la propagande par le fait, Rossi et ses compagnons tentent pacifiquement de faire triompher ce qu’ils appellent la propagande par l’exemple.
La chanson de la Cecilia
Cette chanson révolutionnaire anonyme, La colonia Cecilia, de l’époque de Rossi a été traduite par moi-même. » (Thomas Fournier, élève au Collège de Saussure, 2008)
original trouvé sur http://it.wikisource.org/wiki/La_colonia_Cecilia
« L’eco delle foreste
dalle città insorte al nostro grido
Or di vendetta sì, ora di morte
liberiamoci dal nemico.
All’erta compagni dall’animo forte
più non ci turbino il dolore e la morte
All’erta compagni, formiamo l’unione
evviva evviva la rivoluzione.
Ti lascio Italia, terra di ladri
coi miei compagni vado in esilio
e tutti uniti, a lavorare
e formeremo una colonia sociale.
E tu borghese, ne paghi il fio
tutto precipita, re patria e dio
e l’Anarchia forte e gloriosa
e vittoriosa trionferà,
sì sì trionferà la nostra causa
e noi godremo dei diritti sociali
saremo liberi, saremo uguali
la nostra idea trionferà. »
traduction :
« L’écho des forêts,
Sort des villes à notre cri
Heure de vengeance, heure de mort
Libérons-nous de l’ennemi.
À la montée, camarades, de l’esprit fort
Ne nous troublent plus la douleur ni la mort
À la montée,camarades,nous formons l’union
Et vive la révolution.
Je te laisse Italie, terre de voleurs
Avec mes camarades, je pars en exil
Et tous unis à travailler
Nous formerons une colonie sociale.
Et toi, bourgeois, paies-en le tribut
Tout tombe, roi, patrie et dieu.
L’anarchie forte, glorieuse
Et victorieuse triomphera.
Oui, notre cause triomphera et
Nous jouirons des droits sociaux.
Nous serons libres, nous serons égaux,
Notre idée triomphera.
Un libéralisme social
Paroles de Napoléon III
« Depuis longtemps on proclame cette vérité qu’il faut multiplier les moyens d’échange pour rendre le commerce florissant ; que sans commerce, l’industrie reste stationnaire et conserve des prix élevés qui s’opposent au progrès de la consommation ; que sans une industrie prospère qui développe les capitaux, l’agriculture elle-même demeure dans l’enfance. Tout s’enchaîne donc dans le développement de la prospérité publique (…).
Aujourd’hui, non seulement nos grandes exploitations sont gênées par une foule de règlements restrictifs, mais encore le bien-être de ceux qui travaillent est loin d’être arrivé au développement qu’il atteint dans un pays voisin (…).
En ce qui touche l’agriculture, il faut la faire participer aux bienfaits des institutions de crédit [prêt d’argent]; défricher les forêts situées dans les plaines et reboiser les montagnes ; affecter tous les ans une somme considérable aux grands travaux de dessèchement, d’irrigation, de défrichement (…).
Pour encourager la production industrielle, il faut affranchir de tout droit les matières indispensables à l’industrie et lui prêter à un taux modéré les capitaux qui l’aideront à perfectionner son matériel.
Un des plus grands services à rendre au pays est de faciliter le transport des matières premières pour l’agriculture et l’industrie ; à cet effet, le ministre des travaux publics fera exécuter des voies de communication, canaux, routes, chemins de fer, qui auront pour but d’amener la houille et les engrais (…). »
Texte publié dans Le Moniteur , 15 janvier 1860 [journal officiel à Paris]
Libre-échangisme ou protectionnisme
« En somme, le libre-échange ne convient qu’à deux espèces de nations : à celle en état de barbarie, qui n’a pas d’industrie; Dieu merci, ce n’est pas là notre position; et à celle qui est la plus avancée en industrie, malheureusement ce n’est pas nous, c’est l’Angleterre; aussi s’efforce-t-elle de nous entraîner dans la voie du libre-échange pour ruiner le travail national … »
Extrait d’une allocution prononcée par M. Fournet, industriel français, en 1860.
Vive le riche
« La richesse a un autre rôle que celui d’acheter ces produits raffinés dont la production et la consommation sont indispensables ; elle seule peut fournir des capitaux au génie inventeur, génie hardi, téméraire, exposé à se tromper souvent, et à ruiner ceux qui le commanditent. Voici par exemple une invention nouvelle, qui doit changer la face du monde : son inventeur la prône, et la donne pour ce qu’elle est, pour une merveille. Mais bien d’autres ont en dit autant des inventions les plus ridicules. Il faut essayer, risquer de grands capitaux, et pour risquer pouvoir perdre. Le pauvre, l’homme aisé lui-même, le peuvent-ils ? L’appât du gain les tente quelquefois, et ils perdent à ces témérités le modeste fruit de leurs économies. Loin de les y exciter, on doit les en décourager au contraire. Mais le riche qui a beaucoup plus qu’il ne lui faut pour vivre, le riche peut perdre, dès lors peut risquer, et tandis qu’il est livré aux dissipations d’une société élégante, ou aux agitations de la politique, ou aux distractions des voyages, laissant ses capitaux accumulés chez le banquier en crédit, il lui confie son superflu qui sert à encourager les entreprises nouvelles.
Il perd ou gagne à ces entreprises. Il est peu à plaindre, s’il perd. Il devient plus riche s’il gagne, et peut encourager un autre génie plus hardi encore. »
extrait d’Adolphe THIERS, « De la propriété », Paris, Paulin Lheureux, 1848
Thiers, homme politique français et historien, fut plusieurs fois ministre entre 1830 et 1848, et puis de nouveau de 1870 à 1873.
A bas le pauvre
» Un homme qui est né dans un monde déjà possédé, s’il ne peut obtenir de ses parents la subsistance qu’il peut justement leur demander, et si la société n’a pas besoin de son travail, n’a aucun droit de réclamer la plus petite portion de nourriture, et ,en fait, il est de trop. Au grand banquet de la nature, il n’y a pas de couvert vacant pour lui. »
» Livrons cet homme à la peine prononcée par la nature. Il faut qu’il sache que les lois de la nature, c’est-à-dire les lois de Dieu, l’ont condamné à vivre péniblement ; qu’il ne peut exercer contre la société aucune espèce de droit pour obtenir d’elle la moindre portion de nourriture au-delà de ce que peut acheter son travail. »
Malthus
L’auteur est un économiste anglais (1766-1834) qui a publié l’Essai sur le principe de population (1798) dont sont extraits les deux passages ci-dessous.
Un « self-made man » fier de lui (par Charles DICKENS, 1812-1870)
Ce texte décrit la satisfaction d’avoir réussi par eux-mêmes des premiers capitalistes anglais.
» (…) C’était un homme riche : banquier, négociant, manufacturier, et je ne sais quoi encore. C’était un gros homme vulgaire au regard fixe, au rire métallique. (…) Un homme qui ne s’arrêtait pas de proclamer (…) son ignorance passée et sa pauvreté passée. Un homme qui était un fanfaron d’humilité. (…)
– Comment ai-je réussi à m’en sortir, je n’en sais rien, reprit Mr. Bounderby. C’est sans doute que j’avais un caractère décidé. J’ai montré plus tard dans la vie que j’avais un caractère décidé et je suppose que je l’avais déjà à ce moment-là. Toujours est-il que je suis là (…) et je ne le dois à personne d’autre qu’à moi-même. (…) Il était dit, je pense, que je me tirerais d’affaire. (…) Je m’en suis tiré bien que personne ne m’ait tendu la perche. Vagabond, petit commissionnaire, vagabond, homme de peine, portier, commis, directeur en chef, associé en second, Josiah Bounderby de Coketown. Tels sont mes antécédents et voilà où je suis arrivé. Josiah Bounderby de Coketown a appris à lire ses lettres d’après l’extérieur des boutiques, Mrs Gradgrind, et la première fois que j’ai pu lire l’heure sur un cadran, ce fut en étudiant l’horloge du clocher de l’église St. Giles, à Londres, sous la direction d’un aveugle estropié qui avait été condamné pour vol (…). Venez donc parler à Josiah Bounderby de Coketown (…) de toute votre ribambelle d’écoles, et Josiah Bounderby de Coketown vous dira carrément ; très bien, parfait ; lui n’a pas eu ces avantages, mais donnez-nous des hommes pratiques, des hommes aux poings solides ; l’éducation qui a fait de lui ce qu’il est ne conviendrait pas à tout le monde, il le sait bien ; pourtant c’est cette éducation-là qu’il a reçue et (…) vous ne le forcerez pas à taire les faits de sa vie. (…)
M. Bounderby jeta son chapeau sur la tête – il le jetait toujours de la sorte, afin de montrer qu’il avait été bien trop occupé à se faire lui-même pour apprendre la façon de mettre son chapeau – et les mains dans les poches il s’en alla nonchalamment dans le vestibule. » Je ne porte jamais de gants « , avait-il coutume de dire ; » ce n’est pas avec des gants que j’ai grimpé dans l’échelle sociale. Autrement je ne serais pas monté si haut. » (…)
Mr. Bounderby étant célibataire, c’était une dame d’âge respectable qui veillait au bon fonctionnement de sa maison moyennant un traitement annuel. Cette dame s’appelait Mrs. Sparsit, et (…) était noblement apparentée. (…) De même que par vantardise il se plaisait à rabaisser sa propre extraction, de même lui plaisait-il de rehausser celle de Mrs. Sparsit. Dans la mesure où il interdisait à sa propre jeunesse d’avoir été servie par la moindre circonstance favorable, il embellissait la carrière de Mrs. Sparsit de tous les avantages. (…)
Bien plus, il avait répandu si loin à la ronde la renommée de son repoussoir que les tiers s’en emparaient pour en jouer en maintes occasions avec beaucoup de brio. C’était un des traits les plus exaspérants de Bounderby que non seulement il chantait ses propres louanges, mais encore encourageait les autres à les chanter. Son besoin d’applaudissement était devenu moralement contagieux. (…) »
Charles DICKENS, « Hard Times », chapitre IV, 1854.
Une conception bourgeoise de l’éducation.
Voici une image caricaturale qui montre bien l’état d’esprit de la bourgeoisie.
« Je vous présente un petit gaillard qui nous donnera bien de la satisfaction ! Hier, il s’est mis à pleurer en me voyant faire la paye aux ouvriers ! »

Caricature de L. Malteste pour « L’Assiette au beurre », 1906 (Blio. Nat., Paris)
reproduit dans Jacques Bouillon (coll.), « Le XIXe siècle et ses racines », Bordas, Paris, 1981, p. 157
LE CULTE DES APPARENCES À PARIS DANS LES ANNÉES 1880
Un extrait de « Bel-Ami » de Guy de Maupassant (1850-1893).
« Forestier (…) se tût, réfléchit quelques secondes, puis demanda :
– Es-tu bachelier ?
– Non. J’ai échoué deux fois.
– Ça ne fait rien, du moment que tu as poussé tes études jusqu’au bout. Si on parle de Cicéron ou de Tibère, tu sais à peu près ce que c’est ?
– Oui, à peu près.
– Bon, personne n’en sait davantage, à l’exception d’une vingtaine d’imbéciles qui ne sont pas fichus de se tirer d’affaire. Ça n’est pas difficile de passer pour fort, va ; le tout est de ne pas se faire pincer en flagrant délit d’ignorance. (…) »
Forestier invite ensuite son interlocuteur à un dîner.
« Duroy hésitait, rougissant, perplexe. Il murmura enfin : – C’est que… je n’ai pas de tenue convenable.
Forestier fut stupéfait : – Tu n’as pas d’habit ? Bigre ! en voilà une chose d’indispensable pourtant. À Paris, vois-tu, il vaudrait mieux n’avoir pas de lit que pas d’habit. (…) »
Forestier prête l’argent nécessaire à Duroy. Habillé correctement, il se rend au dîner.
« Il s’assit sur un fauteuil que [la maîtresse de maison] lui désignait, et quand il sentit plier sous lui le velours élastique et doux du siège, quand il se sentit enfoncé, appuyé, étreint par ce meuble caressant dont le dossier et les bras capitonnés le soutenaient délicatement, il lui sembla qu’il entrait dans une vie nouvelle et charmante, qu’il prenait possession de quelqu’un, qu’il était sauvé (…). »
Quelque temps plus tard, Duroy se promène sur une grande avenue parisienne.
« Duroy marchait lentement, buvant l’air léger, savoureux comme une friandise de printemps. Il passa l’Arc de triomphe de l’Étoile et s’engagea dans la grande avenue, du côté opposé aux cavaliers. Il les regardait, trottant ou galopant, hommes et femmes, les riches du monde, et c’est à peine s’il les enviait maintenant. Il les connaissait presque tous de nom, savait le chiffre de leur fortune et l’histoire secrète de leur vie (…).
Les amazones passaient, minces et moulées dans le drap sombre de leur taille, avec ce quelque chose de hautain et d’inabordable qu’ont beaucoup de femmes à cheval ; et Duroy s’amusait à réciter à mi-voix, comme on récite des litanies dans une église, les noms, titres et qualités des amants qu’elles avaient eus ou qu’on leur prêtait (…).
Puis il prononça tout haut : « tas d’hypocrites ! » et chercha de l’oeil les cavaliers sur qui couraient les plus grosses histoires.
Il en vit beaucoup soupçonnés de tricher au jeu (…). D’autres, fort célèbres, vivaient uniquement des rentes de leurs femmes, c’était connu (…). Beaucoup avaient payé leurs dettes (acte honorable) sans qu’on eût jamais deviné d’où leur était venu l’argent nécessaire (mystère bien louche). Il vit (…) des hommes si respectés que les petits bourgeois se découvraient sur leur passage, mais dont les tripotages effrontés, dans les grandes entreprises nationales, n’étaient un mystère pour aucun de ceux qui savaient les dessous du monde.
Tous avait l’air hautain; la lèvre fière, l’oeil insolent, ceux à favoris et ceux à moustaches.(…) »
Guy de MAUPASSANT, « Bel-Ami » [1885].
L’Etat libéral : gardien de l’ordre
Lettre du ministre de l’Intérieur Léon Faucher à un préfet de département français, le 2 février 1849.
Le préfet est le représentant du gouvernement dans son département.
« Monsieur le Préfet,
Depuis quelques mois, et par suite du ralentissement des principales industries, des coalitions d’ouvriers et des grèves se produisent fréquemment ; comme de pareils incidents réagissent d’une manière fâcheuse sur les intérêts privés et sur la tranquillité publique, je crois nécessaire de vous rappeler les principe que l’administration doit prendre pour règle en pareille occurrence.
L’autorité ne doit jamais s’immiscer dans les questions de salaire. Le prix de la main-d’oeuvre hausse dans les temps où l’industrie est active, parce qu’alors il y a une grande demande de bras ; il baisse quand l’industrie ralentit, parce que le travail est plus offert que demandé. Le niveau est donné par les circonstances. Faites comprendre aux ouvriers ces vérités élémentaires. Il faut parler d’abord le langage de la raison et de la sympathie pour être ensuite plus fort en leur parlant la langage sévère de la loi.
Ce n’est pas que la société, dans la personne de ceux qui la représentent, doive se montrer indifférente à des conflits qui touchent de si près à l’existence des familles, à la propriété de l’industrie, au maintien de l’ordre ; mais n’agissez que par la voie de conseil. Que tous soient bien convaincus de votre profonde sollicitude pour les intérêts en souffrance, et de votre détermination constante de maintenir la liberté des transactions et du travail.
Si des désordres éclatent, votre premier devoir sera de les réprimer, pour que le droit réciproque de l’ouvrier et du fabriquant soit librement débattu. Il faut que nul ne puisse être contraint de fléchir sous la pression de la menace. »
Interview d’un grand patron du XIXème
Une interview d’Henri Schneider (patron des Etablissements Schneider au Creusot).
« – Est-il indispensable que le directeur d’une usine en absorbe tous les bénéfices ?
– Pensez-vous qu’il ne faut pas de l’argent pour faire marcher une » boîte » comme celle-ci ? Le capital qui alimente tous les jours les usines, les outillages perfectionnés, le capital, sans lequel rien n’est possible, qui nourrit l’ouvrier lui-même ! Ne représente-t-il donc pas une force qui doit avoir sa part de bénéfices ? Il y a un ouvrier, parmi les mille que j’ai employés, qui gagnait cent sous par jour ; il s’est dit : » Tiens ! Bibi n’a besoin que de quatre francs pour vivre. Bibi va mettre vingt sous de côté tous les jours ! « , et au bout d’un an il a 365 francs ; il recommence l’année suivante, dix ans, vingt ans de suite, et voilà un capitaliste ! Presque un petit patron ! Son fils pourra agrandir le capital paternel et c’est peut-être une grande fortune qui commence. La trouverez-vous mal gagnée ?
– Mais si l’ouvrier a cinq enfants, comment mettra-t-il de l’argent de côté ?
– Ça, c’est une loi fatale… On tâche, ici, de corriger, le plus qu’on peut, cette inégalité, mais comment la supprimer ? Le patron a des devoirs étroits à remplir vis-à-vis des salariés.
– Croyez-vous que la concentration des capitaux et des moyens de production a atteint son maximum ou doit encore se développer ?
– Il n’y a pas de maximum ! Ça marche toujours, ça n’a pas de bornes, ça !
– La journée de huit heures ?
– Oh ! Je veux bien ! dit M. Schneider si tout le monde est d’accord. Seulement les salaires diminueront ou le prix des produits augmentera, c’est tout comme ! Au fond la journée de huit heures, c’est encore un dada, dans cinq ou six ans, on n’y pensera plus. Pour moi, la vérité, c’est qu’un ouvrier bien portant peut très bien faire ses dix heures par jour et qu’on doit le laisser libre de travailler davantage si cela lui fait plaisir. »
extrait de J. Huret, « Enquête sur la question sociale en Europe », 1897.
tiré du manuel « Histoire Première », Hachette, 1997, sous la direction de J. M. Lambin, p. 25
Contre les lois sociales, entraves à l’individu
« La civilisation occidentale a dû tout son essor à la vigueur de l’individu, à l’esprit d’initiative, de hardiesse en même temps que de prévoyance et de capitalisation. Ces qualités qui distinguent l’Européen et l’Américain de même souche des autres races, tout le système d’État soi-disant paternel (…) tend à les comprimer d’abord, à les éliminer ensuite. L’individu n’aura plus à prendre souci de lui-même, ni la famille d’elle-même ; énergique ou non, actif ou somnolent, capable ou borné, il aura un sort fixé d’avance, ne variant que dans d’étroites limites, un mécanisme automatique, celui de l’obligation législative, de l’assistance d’État, garantira son avenir. Nous considérons ce système comme détestable, propre à transformer en perpétuels enfants, en êtres engourdis et somnolents, les membres des nations civilisées. »
extrait de Paul Leroy-Beaulieu, « Le prochain gouffre : le projet de loi sur les retraites », in L’Économiste français, 11 mai 1901.
tiré du manuel « Histoire Première » de Bertrand-Lacoste, 1997, collection J. Le Pellec, p. 49
Pour les réformes ; la SFIO en 1902
« Nous voulons collaborer avec toute la gauche pour une oeuvre d’action républicaine et réformatrice. Nous voulons en même temps poursuivre les fins supérieures en vue desquelles le prolétariat s’est organisé. (…)
Oui, nous voulons l’abolition du salariat. (…) Mais cette émancipation sociale, cette émancipation économique suppose un prolétariat libre, éduqué, éclairé, elle suppose par conséquent une démocratie organisée et agissante où toutes les forces, où toutes les idées d’avenir peuvent se développer, elle suppose en même temps une série de réformes qui, en ajoutant aujourd’hui un peu de bien-être, un peu de garantie, un peu de lumière à la vie des salariés, leur permettent de regarder plus loin, de lever les yeux vers l’avenir et de préparer un ordre nouveau.
C’est pourquoi nous sommes doublement attachés à la république, comme républicains et comme socialistes, et c’est pourquoi nous sommes doublement attachés à la politique de réformes, comme démocrates et comme socialistes. »
Jean Jaurès, discours devant la Chambre des députés, 1902.
tiré du manuel « Histoire Première » de Bertrand-Lacoste, 1997, collection J. Le Pellec, p. 51
Débat en Suisse sur la nationalisation des chemins de fer
« Quoiqu’il en soit, les étatistes sont habiles à profiter de ces dispositions diverses pour augmenter de plus en plus le rôle et les fonctions de l’Etat. Méconnaissant sa véritable mission, qui est avant tout de sauvegarder les droits et les libertés de chacun, ils veulent transformer en services publics toutes sortes d’industrie et de commerce, ce qui lui donnera sans doute une importance énorme, mais ce qui l’empêchera d’être ensuite neutre lorsqu’il s’agira d’édicter les lois et d’en contrôler l’exécution. Fâcheuse tendance qu’on ne saurait combattre trop vivement, car ce n’est pas en prenant lui-même en mains la direction des intérêts économiques de chacun, mais c’est en s’appliquant à respecter et à faire respecter l’initiative privée tant qu’elle s’exerce dans les limites compatibles avec le respect des droits d’autrui, c’est en outre en secondant avec mesure et circonspection l’effort individuel au lieu de s’y substituer que l’Etat contribuera, autant qu’il est en sa nature de le faire utilement, au bien et à la prospérité de la nation.
Qu’est-ce d’ailleurs que l’Etat ? D’un côté, c’est tout le monde, surtout dans une démocratie comme la nôtre; mais à l’autre extrémité, l’Etat finit toujours ou presque toujours par se résumer dans un fonctionnaire, un simple mortel, qui n’est pas en mesure de tout savoir, de tout pouvoir, de tout vouloir, qui peut être oublieux, qui aime souvent son repos, qui a parfois un caractère difficile, qui en tout cas a ses passions et ses faiblesses, ses bons et ses mauvais moments, et qui, en général, pour arriver à sa place et s’y maintenir, a besoin de faire appel à la politique, c’est-à-dire à l’esprit de parti, cet esprit qui aveugle si aisément les hommes les mieux intentionnés. Toutes ces raisons et d’autres font que l’Etat ne doit pas être chargé de besognes industrielles et commerciales dans lesquelles la concurrence est l’âme du progrès. C’est un fait établi par de multiples expériences que tout monopole remis à l’Etat ne tarde généralement pas à tomber dans une routine dépensière et devient même à la longue, dans les pays les plus honnêtes, une source de corruption. Pour des motifs semblables, il n’est pas bon non plus de reconnaître à l’Etat, en matière quelconque, le droit de corriger les inégalités de la fortune, de prendre aux uns pour donner aux autres ou de décréter des obligations morales qui devraient relever seulement de la conscience individuelle. Dans notre époque, on penche trop de ce côté, avec toutes sortes de bonnes intentions, j’en conviens, mais on ne tardera pas à voir, je l’espère, que notre démocratie fédérative doit absolument remonter cette pente dangereuse si elle ne veut pas verser tout à fait dans le socialisme d’Etat. »
extrait d’une Conférence donnée à Genève le 20 février 1896 et publiée la même année.
Droz Numa, La démocratie fédérative et le socialisme d’État, Paris/Genève : Felix Alcan/CH. Eggimann & Cie, 1896, p. 29-31. Le texte a été réédité en 1916 chez Atar à Genève.
Informations:
– Après avoir été ouvrier graveur, instituteur et journaliste, Numa Droz (1844-1899) fit une carrière politique complète au sein du parti radical, d’abord à Neuchâtel, puis sur le plan fédéral. De 1875 à 1892, il est Conseiller fédéral. Après cette date, il fut directeur du Bureau international des chemins de fer. Ses idées politiques ont évolué avec l’âge.
– Suite à de nombreuses faillites et après un long débat, le gouvernement suisse racheta les principales compagnies privées de chemins de fer suisses et créa ainsi les CFF (les Chemins de Fer Fédéraux) en 1898.
De nouvelles méthodes de travail : le taylorisme
« Les américains et les anglais sont les meilleurs hommes de sport du monde ; si un ouvrier américain joue au base-ball ou un anglais au cricket, il emploie toutes ses facultés pour assurer la victoire à son camp et gagner le plus grand nombre possible de points. Ce sentiment universel est si fort, qu’un homme qui se ménage en pareille circonstance, est disqualifié et méprisé de tous ceux qui l’entourent. Quand ce même ouvrier retourne à l’usine le lendemain, loin de s’efforcer de travailler de son mieux, il s’arrange le plus souvent, pour faire délibérément le moins de travail possible. Dans beaucoup de cas, ce travail ne représente que le tiers ou la moitié de la tâche d’une journée consciencieusement remplie ; car s’il s’efforçait d’abattre le plus d’ouvrage possible, cet ouvrier serait persécuté par ses camarades d’atelier, plus encore que s’il était ménage devant ses camarades de jeu. Cette flânerie, caractérisée par la limitation systématique de la production, est à peu près universelle dans les usines ; elle se remarque aussi dans les affaires et on peut assurer, sans crainte d’être contredit, qu’elle constitue le pire défaut de la classe ouvrière en Angleterre et en Amérique (… ). La disparition de cette flânerie provoquerait un tel abaissement du prix de revient, que nos marchés intérieurs et extérieurs seraient considérablement élargis ; ainsi disparaîtrait une des causes fondamentales de nos difficultés sociales, le paupérisme et cette infortune serait soulagée d’une manière plus efficace et plus complète que par les remèdes appliqués jusqu’ici. On assurerait des salaires élevés, une tâche journalière plus courte et des conditions meilleures de travail et d’habitation. S’il est évident que la prospérité ne peut exister que comme un corollaire de l’effort conscient de chaque travailleur pour produire la tâche journalière la plus forte possible, comment se fait-il que la grande majorité des hommes fasse délibérément le contraire et qu’il soit impossible, en général, à un homme de bonne volonté, d’atteindre son rendement maximum Il y a à cela trois causes principales que l’on peut résumer ainsi 1° L’erreur existant depuis un temps immémorial chez les ouvriers, que l’augmentation du rendement de chaque homme ou de chaque machine aurait pour conséquence de faire congédier un certain nombre d’ouvriers. 2° Les systèmes défectueux d’organisation qui sont communément employés et qui forcent, pour ainsi dire, chaque ouvrier de flâner, pour sauvegarder ses intérêts. 3° Les méthodes empiriques à peu près universellement employées, grâce auxquelles l’effort de l’ouvrier est mal utilisé. (…) Pour faire exécuter le travail conformément à des lois scientifiques, la direction doit étudier et exécuter elle-même, beaucoup de tâches actuellement abandonnées à l’initiative de l’ouvrier. Chacune des opérations faites à l’atelier, doit être précédée d’une ou plusieurs études préparatoires de la direction qui permettront à l’ouvrier de faire son travail, mieux et plus vite qu’auparavant. Il lui faudra recevoir chaque jour, de bonne grâce, les conseils et les instructions de ses chefs, moyennant quoi il ne sera plus bousculé ni pressé par son contremaître ou laissé à sa propre inspiration. Cette coopération étroite, intime, personnelle, entre la direction et les ouvriers, est l’essence de l’organisation scientifique moderne. »
Frédéric Winslow TAYLOR, Principes d’ organisation scientifique des usines, 1911
« la moralité est peut-être moins fondée sur l’abnégation que sur une action éclairée au service des intérêts de chacun »
« (…) l’interdépendance commerciale, typique de la banque comme d’aucune autre profession ou activité, le fait que l’intérêt et la solvabilité d’un individu soient liés à ceux de l’ensemble, que la confiance dans le respect des obligations mutuelles soit indispensable afin d’éviter l’effondrement de pans entiers de l’édifice, tout cela tend à prouver que la moralité est peut-être moins fondée sur l’abnégation que sur une action éclairée au service des intérêts de chacun, et sur une compréhension plus nette et plus exhaustive de tous les liens qui nous unissent les uns aux autres. Et cette compréhension plus nette ne peut manquer d’améliorer non seulement les relations d’un groupe avec un autre, mais les relations de tous les hommes avec tous les autres hommes, afin de créer une conscience débouchant sur une coopération plus efficace entre les hommes et sur une société meilleure. »
citation de Norman Angell, 17 janvier 1912.