« Pour indiquer les conditions de travail et la marche du mouvement ouvrier dans la région de Vizille, je me contenterai de raconter ce que j’ai vu, ce que j’ai senti, les luttes auxquelles j’ai participé, je retracerai, en un mot, ma vie un peu mouvementée d’ouvrière soyeuse et de militante syndicaliste.
Les anciennes conditions de travail
Je suis entrée comme apprentie chez MM. Durand frères, au Péage-de-Vizille, au commencement de 1883. J’avais alors douze ans. Il y avait, à cette époque, dans l’usine, environ 800 tisseuses. On y travaillait 12 heures, et quelquefois 13 et 14 heures par jour ; les métiers battaient 80 coups à la minute ; les ouvrières étaient alors rares qui avaient à conduire deux métiers, et à peine si quelques unes faisaient rouler trois métiers, à deux. On arrivait à gagner de 130 à 150 francs par mois ; et avec cela, un bon travail et de la très bonne matière : ce n’était pas comme aujourd’hui, où on fabrique de la soie artificielle avec du mûrier auquel on fait subir une préparation spéciale, comme qui dirait pour la fabrication de la pâte à papier (sur 100 balles de soie, 80 en moyenne sont de cette soie artificielle). Quelques années plus tard, au début de 1888, je vins travailler à Vizille, à la maison Duplan. Là, on gagnait un peu plus parce que le matériel y était perfectionné. Les métiers battaient 120 coups à la minute et les patrons soyeux engageaient le plus possible leurs ouvrières à conduire deux métiers à la fois. Cela s’accentua lorsqu’arriva la grande mode de la mousseline. Il en résulta un commencement de baisse des salaires, mais comme il n’y avait aucune organisation, personne n’osa protester. Dès lors, chaque année apporta de nouvelles modifications mécaniques, de nouveaux métiers, de nouvelles transformations ; et avec chaque perfectionnement du matériel, c’était une nouvelle diminution des salaires.
La grève
Cela dura jusqu’en 1902, où les ouvriers se réveillèrent enfin et s’organisèrent en syndicats, avec le concours de militants syndicalistes de la Bourse du Travail de Grenoble. Alors, ce furent des cris incessants du côté du patronat. Tous les procédés pour faire échouer nos efforts furent employés. Mais ils n’aboutirent à rien. En 1904, M. Duplan rapporta d’Amérique un système nouveau de bloc-navette, grâce auquel les métiers purent battre 290 à 300 coups à la minute. La conséquence fut qu’on voulut imposer une diminution de 60 % au personnel. Voici la façon dont M. Duplan agit, ou plutôt fit agir son directeur. Il fit arrêter d’abord toute la préparation : dévideuses, bobineuses, ourdisseuses, en disant que, ma foi, il n’y avait plus de travail et que l’on rappellerait les ouvrières dès que l’ouvrage reprendrait. Au bout de trois semaines, comme une partie des tisseuses chômait en même temps que les ouvrières de la préparation, une délégation fut envoyée auprès du directeur. Celui-ci nous répondit qu’il y avait bien du travail, mais qu’il serait moins payé que par le passé, à cause des maisons concurrentes qui travaillaient à meilleur marché […] Une réunion eut lieu le 9 mars 1905, où les ouvrières, à l’unanimité moins deux voix, décidèrent la grève […] Dès qu’il fut rentré, le patron fit appeler la délégation et nous raconta un tas d’histoires, dont nous ne crûmes pas un mot. Il avait préparé un papier pour la circonstance, où il avait inscrit ses nouveaux prix : les articles mousseline dits 120 dents, qui nous étaient précédemment payés 0,14 F.ne devaient plus nous être réglés que 0,007 F. et on ne pouvait en tisser plus de 20 mètres par jour ; un autre article, payé 0,10 F. était abaissé à 0,05 F […] On pense quelle fut notre réponse. Nous acceptâmes la guerre à outrance. Quelques jours après, le juge de paix offrit son arbitrage, mais le patron ne répondit pas : il était retourné à Cannes. Au bout d’un mois de cette résistance improvisée, nous dûmes faire appel à des camarades du dehors. Nous organisâmes des soupes communistes, que tous nos amis de Grenoble et de Lyon trouvèrent fort bien. Les secours matériels et moraux ne nous firent pas défaut, et nos cantines eurent un grand succès : les jours de marché, les paysans étaient nombreux qui venaient goûter notre soupe. Puisque je raconte nos efforts, que je dise comment nous avions organisé nos repas. A midi, on donnait à chacun 300 grammes de viande, 300 grammes de pain et une portion de légumes ; pour les enfants au-dessous de douze,les portions étaient réduites ; à six heures du soir, soupe avec pommes de terre et légumes. Cela dura 104 jours. Les petits commerçants nous étaient hostiles au début, mais peu à peu ils se mirent de notre côté, et les dons en nature ou en espèces vinrent alimenter chaque jour nos marmites. Nous étions 200 grévistes femmes […] Après le troisième mois, les pourparlers recommencèrent, le patron nous fit appeler de nouveau à la mairie et nous soumit de nouveaux tarifs : nous les refusâmes. Il espérait que, la misère nous ayant brisées, nous pourrions plus facilement capituler. Mais cette fois encore, nous résistâmes. M. Duplan se tourna alors vers le préfet, qui désigna un arbitre : c’était un patron, qui ne valait pas mieux que le nôtre, et cette tentative échoua encore. Alors, en désespoir de cause, le patron envoya la femme de son chauffeur et celle de son comptable racoler les ouvrières à domicile : dix-neuf se laissèrent séduire. Ces quelques renégates décidèrent du sort de la grève, qui finit rapidement […] »
Lucie Baud dans Le Mouvement socialiste, juin 1908.


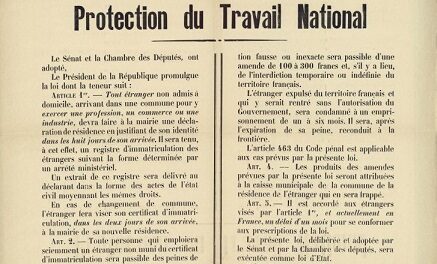

![Image illustrant l'article Manuel_du_vélocipède___publié_[...]Grand_Jacques de Clio Texte](https://clio-texte.clionautes.org/wp-content/uploads/cliotexte/2021/08/manuel-du-velocipede---publie--grand-jacques-440x264.jpeg)








