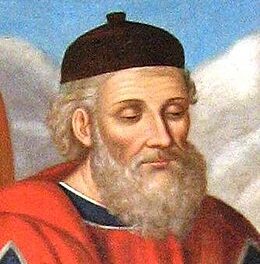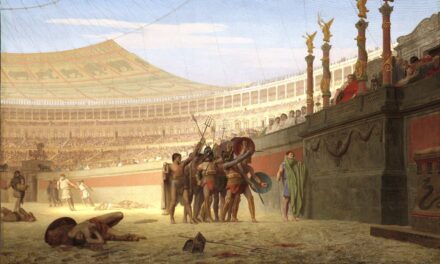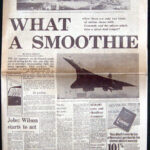Ammien Marcellin (330-400 ap. J.-C.) est un syrien d’origine grecque, né à Antioche. Officier dans la cavalerie, il entreprend une œuvre d’historien importante dont seuls les derniers livres nous sont parvenus. Nous savons qu’il s’est rendu en Gaule où il rencontra Julien. Il se trouvait à ses côtés lors de l’expédition de cet empereur contre les Perses. Ammien Marcellin rencontra un réel succès avec son Histoire dont le passage ci-dessous est extrait.
La description des Alpes proposée par Ammien Marcellin s’inscrit dans une filiation faisant de ce territoire un lieu hostile, voire menaçant. Le danger y est omniprésent et les montagnes sont des « remparts » où neiges et précipices font chuter à l’envi…
« 1. Cette partie des Gaules, en raison de la masse de leurs montagnes à pic, effrayantes par leurs neiges éternelles, était presque inconnue auparavant des habitants du reste du monde, sauf dans les régions côtières. Des remparts l’enserrent de toutes parts, disposés par la nature comme par la main de l’homme.
2….Là où elle s’élève vers le soleil levant, elle fait place au massif des Alpes Cottiennes. Le roi Cottius, une fois les Gaules soumises, caché tout seul dans leurs défilés et confiant dans les difficultés d’une région sans chemins, lorsque finalement son esprit de rébellion se fut apaisé, fut admis dans l’amitié de l’empereur Octavien et, en guise de présent mémorable, il construisit au prix de grands travaux des raccourcis commodes aux voyageurs, entre les anciennes voies alpines sur lesquelles je dirai un peu plus tard ce que j’ai appris.
3. Dans ces Alpes Cottiennes qui commencent à la ville de Suse, se dresse une haute chaîne que presque personne ne peut franchir sans danger.
4. Le voyageur qui vient des Gaules trouve en effet une pente assez douce, mais sur l’autre versant, les murailles de rochers en surplomb offrent un spectacle terrifiant: surtout au printemps, lorsque les glaces et les neiges fondent au souffle plus chaud des vents et qu’à travers les gorges entre deux à pic et les ravins dissimulés par des congères, hommes et bêtes descendent à pas hésitants et s’abattent ainsi que les attelages. Et le seul remède que l’on ait trouvé pour éviter leur perte est celui-ci : la plupart des véhicules sont attachés par de grosses cordes, retenus par derrière par l’effort vigoureux des hommes et des bœufs, et, marchant à peine d’un pas traînant, descendent les pentes avec un peu plus de sécurité. Ces difficultés, comme je l’ai dit, se présentent au printemps.
5. En hiver, la terre couverte par les froids d’une croûte de glace, étant comme polie et par la même glissante, rend la marche incertaine et provoque les chutes ; et les larges vallées, où en terrain plat la glace ôte toute sécurité, engloutissent parfois les voyageurs. C’est pour cette raison que les gens qui connaissent bien le pays enfoncent aux endroits les plus sûrs des pieux de bois dressés, afin que leur ligne continue guide le voyageur sans dommage. Si ces pieux disparaissent sous les neiges ou s’ils sont renversés par les ruisseaux qui coulent de la montagne, il est difficile de passer par les sentiers, même avec des indigènes pour vous montrer le chemin.
6. À partir du point culminant de cette montée, du côté de l’Italie, un plateau s’étend sur une distance de sept milles jusqu’au poste dit de Mars, et de là une autre hauteur, plus élevée et difficilement franchissable, atteint jusqu’au sommet de la Matrone, qui doit son nom à la chute qu’y fit une femme noble. De ce point là, un chemin en pente, mais plus aisé, est praticable jusqu’à la forteresse de Briançon.
7. Le tombeau de ce petit roi, dont nous avons rappelé qu’il bâtit des routes, est à Suse, tout proche des murailles, et ses mânes sont pieusement honorés pour la double raison qu’il avait gouverné ses sujets avec justice et que, devenu l’allié de l’Empire romain, il a procuré à son peuple une paix éternelle.
8. Et bien que la route que nous avons décrite soit la route centrale, la plus courte et la plus fréquentée, cependant beaucoup d’autres encore ont été, bien auparavant, construites à des époques diverses ».
Ammien Marcellin Histoire, XV, 10, 1 à 8.