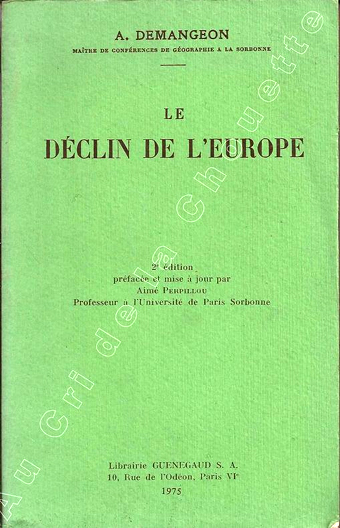
Nous autres, civilisations, nous savons maintenant que nous sommes mortelles.
«Nous autres, civilisations, nous savons maintenant que nous sommes mortelles.
Nous avions entendu parler de mondes disparus tout entiers, d’empires coulés à pic avec tous leurs hommes et tous leurs engins; descendus au fond inexplorable des siècles avec leurs dieux et leurs lois, leurs académies et leurs sciences pures et appliquées, avec leurs grammaires, leurs dictionnaires, leurs classiques, leurs romantiques et leurs symbolistes, leurs critiques et les critiques de leurs critiques. Nous savions bien que toute la terre apparente est faite de cendres, que la cendre signifie quelque chose. Nous apercevions à travers l’épaisseur de l’histoire, les fantômes d’immenses navires qui furent chargés de richesse et d’esprit. Nous ne pouvions pas les compter. Mais ces naufrages, après tout, n’étaient pas notre affaire.
Élam, Ninive, Babylone étaient de beaux noms vagues, et la ruine totale de ces mondes avait aussi peu de signification pour nous que leur existence même. Mais France, Angleterre, Russie… ce seraient aussi de beaux noms. Lusitania aussi est un beau nom. Et nous voyons maintenant que l’abîme de l’histoire est assez grand pour tout le monde. Nous sentons qu’une civilisation a la même fragilité qu’une vie. Les circonstances qui enverraient les œuvres de Keats et celles de Baudelaire rejoindre les œuvres de Ménandre ne sont plus du tout inconcevables : elles sont dans les journaux […]
Je n’en citerai qu’un exemple : les grandes vertus des peuples allemands ont engendré plus de maux que l’oisiveté jamais n’a créé de vices. Nous avons vu, de nos yeux vu, le travail consciencieux, l’instruction la plus solide, la discipline et l’application les plus sérieuses, adaptés à d’épouvantables desseins.
Tant d’horreurs n’auraient pas été possibles sans tant de vertus. Il a fallu, sans doute, beaucoup de science pour tuer tant d’hommes, dissiper tant de biens, anéantir tant de villes en si peu de temps; mais il a fallu non moins de qualités morales. Savoir et Devoir, vous êtes donc suspects ? […]
Il y a des milliers de jeunes écrivains et de jeunes artistes qui sont morts. Il y a l’illusion perdue d’une culture européenne et la démonstration de l’impuissance de la connaissance à sauver quoi que ce soit; il y a la science, atteinte mortellement dans ses ambitions morales, et comme déshonorée par la cruauté de ses applications; il y a l’idéalisme, difficilement vainqueur, profondément meurtri, responsable de ses rêves; le réalisme déçu, battu, accablé de crimes et de fautes; la convoitise et le renoncement également bafoués ; les croyances confondues dans les camps, croix contre croix, croissant contre croissant; il y a les sceptiques eux-mêmes désarçonnés par des événements si soudains, si violents, si émouvants, et qui jouent avec nos pensées comme le chat avec la souris, — les sceptiques perdent leurs doutes, les retrouvent, les reperdent, et ne savent plus se servir des mouvements de leur esprit.
L’oscillation du navire a été si forte que les lampes les mieux suspendues se sont à la fin renversées […]»
Paul Valéry, La crise de l’esprit, 1919, 1ère lettre, Première publication en anglais, dans l’hebdomadaire londonien Athenæus, avril-mai 1919.
Une prise de conscience du déclin de l’Europe
L’auteur, Demangeon, nous livre une vision parfaitement claire, voire visionnaire, de la situation future du continent européen sous la forme d’un questionnement.
«Pour nous, ce que nous voulons tenter ici, c’est de considérer le déplacement de la fortune qui apparaît comme l’un des faits capitaux de la guerre, non pas du point de vue social, mais du point de vue international. Il n’est douteux pour personne que l’Europe, qui régissait le monde jusque vers la fin du XIXème siècle, perde sa suprématie au profit d’autres pays ; nous assistons au déplacement du centre de gravité du monde hors d’Europe ; nous voyons sa fortune passer aux mains des peuples de l’Amérique et de l’Asie.
Jusqu’ici c’était un fait élémentaire de géographie économique que l’Europe dominait le monde de toute la supériorité de sa haute et antique civilisation. Son influence et son prestige rayonnaient depuis des siècles jusqu’aux extrémités de la terre. Elle dénombrait avec fierté les pays qu’elle avait découverts et lancés dans le courant de la vie générale, les peuples qu’elle avait nourris de sa substance et façonnés à son image, les sociétés qu’elle avaient contraintes à l’imiter et à la servir.
Quand on songe aux conséquences de la grande guerre, qui vient de se terminer, sur cette prodigieuse fortune, on peut se demander si l’étoile de l’Europe ne pâlit pas et si le conflit dont elle a tant souffert n’a pas commencé pour elle une crise vitale qui présage la décadence. En décimant ses multitudes d’hommes, vastes réserves de vie où puisait le monde entier ; en gaspillant ses richesses matérielles, précieux patrimoine gagné par le travail des générations ; en détournant pendant plusieurs années les esprits et les bras du labeur productif vers la destruction barbare ; en éveillant par cet abandon les initiatives latentes ou endormies de ses rivaux, la guerre n’aura-t-elle pas porté un coup fatal à l’hégémonie de l’Europe sur le monde ?
Déjà la fin du XIXème siècle nous avait révélé la vitalité et la puissance de certaines relations extra-européennes, les unes comme les Etats-Unis nourries du sang même de l’Europe, les autres comme le Japon , formées par ses modèles et ses conseils. En précipitant l’essor de ces nouveaux venus, en provoquant l’appauvrissement des vertus productrices de l’Europe, en créant ainsi un profond déséquilibre entre eux et nous, la guerre n’a-t-elle pas ouvert pour notre vieux continent une crise d’hégémonie et d’expansion ?
Dépeuplée et appauvrie, l’Europe sera-t-elle apte à maintenir sur le monde le faisceau de liens économiques qui compose sa fortune privilégiée ? Sera-t-elle toujours la grande banque qui fournissait des capitaux aux régions neuves ? Comme puissances capitalistes, le Japon et surtout les États-Unis sont devenus ses rivaux. Sera-t-elle toujours la grande entreprise d’armement qui transportait de mer en mer les hommes et les produits de toute la terre ? D’autres marines se construisent et s’équipent qui lui disputent ce rôle fructueux de roulier des mers. Sera-t-elle toujours la grande usine qui vendait aux peuples jeunes ses collections d’articles manufacturés ? Aux États-Unis et au Japon naissent et grandissent des industries qui visent les mêmes débouchés. Sera-t-elle toujours la grande puissance économique du monde ? Elle n’est déjà plus la seule à l’exploiter, à le coloniser, à le financer.
On peut donc dire que nous assistons au déclin de l’Europe. Il est intéressant de chercher sur quels points de la terre on commence à voir son domaine se démembrer et quels sont les pays qui profitent de ce déplacement de fortune. Il apparaît nettement que, sur des territoires différents et à des titres divers, les héritiers de l’Europe sont les États-Unis et le Japon. Depuis longtemps la doctrine Monroe avait marqué des limites aux ambitions politiques de l’Europe sur le continent américain ; l’essor prodigieux des États-Unis dans la production industrielle impose de même des limites à l’expansion économique de l’Europe ; l’Amérique latine, longtemps fief de notre commerce, cède peu à peu à l’attraction yankee ; bien plus, par une curieuse inversion des courants d’influences, la vieille Europe s’ouvre à la jeune Amérique comme une terre de colonisation. En Extrême-Orient, le Japon cherche à réaliser dans l’ordre économique la formule que ses missionnaires et ses diplomates propagent depuis les Indes jusqu’à la Sibérie : l’Asie aux Asiatiques. Et voici que les races, parmi lesquelles l’Europe avait longtemps recruté des esclaves et des ouvriers, commencent à réclamer le traitement politique qui sera le premier fondement de leur indépendance économique : c’est toute l’Europe qui chancelle.»
Extrait de l’introduction d’A. Demangeon, Le déclin de l’Europe, Paris, 1920.
Le Maroc après la Grande guerre
« En ces heures d’allégresse inoubliables, j’ai cru de mon devoir de chef de Gouvernement de signaler discrètement que la fin des hostilités ne marquerait pas la disparition des difficultés ni le retour immédiat à la vie normale. Ici même, au Maroc, la plupart des problèmes que la guerre avait posés subsistent toujours. Au point de vue militaire c’est par une aggravation de la crise des effectifs que se font sentir les premières conséquences de la victoire […] L’action de l’ennemi sur les régions dissidentes ne s’est pas éteinte du jour au lendemain. Il a posé, là aussi, des mines à retardement. Dans les régions lointaine, les dissidents, que les nouvelles n’atteignent que lentement, ne croient pas encore à notre victoire et ne constatent qu’un fait matériel, c’est que nos effectifs fondent de plus en plus et que pas une troupe n’est encore revenue de France, affirmant matériellement nos succès. Il y a enfin les causes profondes de résistance bien antérieures à la guerre, qui subsisteront après elle chez ces populations, la passion de l’indépendance, le fanatisme xénophobe et l’esprit de résistance à l’ordre et à l’organisation […]
Je veux que la dominante des paroles que je vous adresse aujourd’hui soit la confiance et la gratitude. Confiance et gratitude envers le peuple marocain. N’oublions jamais le spectacle qu’il a donné et le loyal concours qu’il nous a apporté[…] Cette attitude au cours de la guerre, nous ne saurions jamais l’oublier, et nous devons la reconnaître par le respect que nous apporterons à leurs personnes, à leurs statuts, à leurs coutumes, à tout ce qui fait l’âme d’un peuple, car il serait vraiment trop paradoxal qu’à l’heure où les droits des peuples ont été un des plus nobles stimulants de notre lutte et une des conditions de notre victoire, nous les méconnaissions pour ceux-là seuls chez qui nous avons planté notre drapeau. »
Louis Hubert Lyautey (1854-1954), «Discours de Casablanca», 1er janvier 1919.











