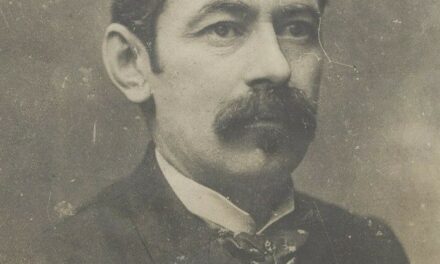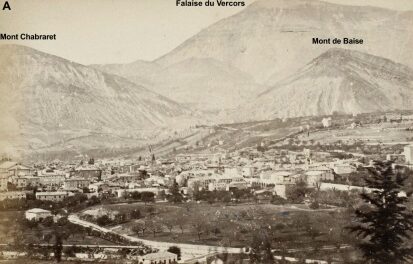Le terme de « décivilisation » a connu ces derniers temps un regain de popularité. Mais son usage politique et son instrumentalisation ne doivent pas faire oublier l’origine du terme et ses différents usages qui sont reliés à la période de la colonisation. Plusieurs auteurs ont ainsi employé le mot décivilisation et l’ont conceptualisé, bien avant 1939.
Le premier que nous retiendrons est Gustave Toudouze [1847-1904]. Fils de Gabriel Toudouze, architecte et graveur, et d’Adèle-Anaïs Colin, peintre descendante d’une famille de statuaire, Gustave Toudouze est un romancier français, également dramaturge et journaliste. Il fréquente les milieux littéraires, des « dimanches » de Flaubert au « Grenier » d’Edmond de Goncourt, en passant par la colonie artistique bretonne de Camaret-sur-Mer. Il fréquente également Zola, Daudet, Dumas fils et Guy de Maupassant qui lui dédie la nouvelle En voyage.
En 1870, lorsque éclate la guerre contre la Prusse, il s’engage comme volontaire dans les gardes mobiles de la Seine. Nommé caporal de la 1ère escouade à la 7ème compagnie du 6ème bataillon, il fait toute la campagne et vit le siège de Paris. Gustave Toudouze porte alors le double galon de laine rouge et un pompon vert, signe distinctif du bataillon.
Auteur prolifique, Gustave Toudouze publie en 1887 Le pompon vert, sous-titré « le livre du souvenir » basé sur ses notes rédigées durant la guerre et le siège de Paris. C’est ce roman autobiographique qui tient une place à part dans son œuvre qu’il emploie le mot de « décivilisation ».
Si jamais nous avons failli y rester, mâtin de mâtin ! c’est bien ce jour-là ! Du coup, la campagne était bien finie pour nous, la pauvre première escouade eût été décimée raide, dans les grands prix, selon l’expression caractéristique du moblot Germain Crozon, un rude gars, cependant, et qui ne boudait pas devant le danger, certes non I Mais, ce jour-là ! Ah ce jour-là !…
Pour tout dire, sur les dix hommes qui composaient l’escouade, à l’appel du soir il en aurait manqué cinq, y compris le caporal. Hein ! quel remue-ménage parmi les camarades, quand on aurait appris la nouvelle ! En fermant à demi les yeux, pour mieux rassembler mes souvenir et les rassembler là, devant moi, comme si je les alignais avec la main, je revois la chose dans ses moindres détails, dans la grosse secousse de son frisson, sous la pluie d’or de ce pâle soleil d’hiver qui nous donnait, au plateau d’Avron, une vague idée de la lumière polaire. Le 10 décembre, un samedi, le matin, on bavardait ferme entre les planches du gourbi, tout en taillant dans la boule de son de superbes tartines qu’on s’amusait à faire griller, à la pointe du sabre-baïonnette, au-dessus du brasier entretenu, jour et nuit, au centre de notre installation, dans une grossière enceinte de briques juxtaposées circulairement Un vrai régal ! C’était incalculable ce qu’on avalait de ces tranches de pain grillé, en les trempant, avec une gourmande volupté, dans le quart de métal plein d’un café fumant, moulu à l’arabe, à coups de crosse de fusil, et où il y avait autant à manger qu’à boire.
Chaque jour il fallait acheter, en supplément, du pain au cantinier, le réglementaire demi-pain par homme et par jour ne suffisant pas à nos appétits voraces, développés à l’excès, poussés à la boulimie, par cette existence continuelle en plein air, avec des travaux de tranchées et d’abatis d’arbres à nous creuser le ventre jusqu’aux talons.
Douze jours de bivouac, d’intempéries atroces, de fatigues corporelles énormes, de vie extraordinairement active du côté physique, de perpétuels et renaissants qui-vive, avaient si bizarrement influé sur nous que la bête semblait avoir peu à peu absorbé l’homme, se glissant dans sa peau, dans son sang, dans ses muscles, et, qu’avant tout, par-dessus tout, la grande, l’incessante préoccupation était la nourriture.
Ce qui se produisait en nous, c’était comme une décivilisation progressive, un étrange et rapide retour à l’état bestial, aux instincts animaux, un effacement absolu de l’esprit devant le corps.
N’ayant d’eau que juste pour faire la soupe, le café et pour boire, on avait dû forcément renoncer aux soins de propreté. On n’y pensait même plus, par ce froid sibérien, dans cette promiscuité continue avec la terre, avec la nature, dans cette vie d’étable que nous menions, sur nos litières de paille.La peau des visages, des mains, se tannait, calcinée par la flamme des feux de branchages, giflée férocement par l’implacable bise d’un hiver exceptionnel, à 114 mètres d’altitude, balayée par les rafales de neige, lavée de pluies glaciales.
Une certaine dureté au mal, une plus facile résistance physique à l’abaissement terrible de la température, semblaient nous venir de cette déchéance, cuirassant notre épiderme, en alourdissant notre intelligence.
Gustave Toudouze Le pompon vert, Paris, 1890, Boivin et Cie, extrait du chapitre « en robe de soie », pages 81-83.