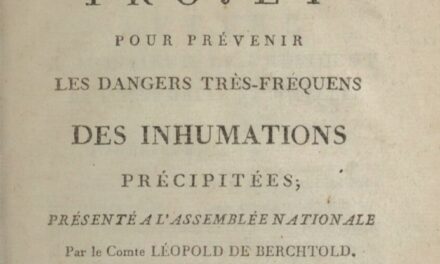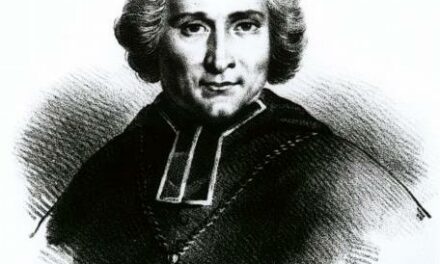Pamphlet anti-droits de l’homme
Rivarol écrit ce pamphlet publié dans la revue périodique « les Actes des Apôtres » en 1790 ; il fait semblant de s’adresser à l’Assemblée nationale.

« Messieurs,
Ce serait en vain que vous auriez changé les moeurs de la nation et de l’univers entier, l’oeuvre serait incomplète et il est de votre sagesse, ainsi que de votre gloire, d’achever [finir votre tâche] par un décret qui régénère le monde physique, et le rende conforme au monde moral que vous venez de créer. (…)
L’immortel Américain dont vous portiez le deuil, il y a peu de jours, comme les représentants consternés de sa perte, Franklin, avait arraché le sceptre aux tyrans et aux cieux la foudre. Vous ne lui céderez pas [vous ferez aussi bien], messieurs, en déployant toute l’étendue du pouvoir qui vous est réservé, vous vous assurerez la reconnaissance des races futures, jusqu’au temps qu’il vous plaira de fixer la consommation des siècles [la fin des temps].
Je propose de décréter les articles ci-après :
Article premier : à compter du 14 juillet prochain, les jours seront égaux aux nuits pour toute la surface de la terre, le jour commençant à 5 heures.
Article II : au moment où le jour finira, la lune commencera à luire et elle sera dans son plein jusqu’au lever du soleil.
Article III : il régnera constamment d’une extrémité à l’autre du globe une température modérée et toujours égale.
Article IV : la foudre et la grêle ne tomberont jamais que sur les forêts. L’humanité sera à jamais préservée des inondations, et la terre, dans toute son étendue ne recevra plus que de salutaires rosées qui la feront fructifier à l’avantage de tous ses habitants sans distinction.
(…) »
A vos plumes citoyens !, Découvertes No 42, 1988, pp. 136-137.
Mémoires de Rivarol
Antoine Rivarol écrivit ces deux textes pour le Journal politique et national entre mai et octobre 1789. Rivarol s’exilera en 1792. Le recueil de ses articles a été publié après sa mort en recueil sous le titre de Mémoires.
Il n’est point de siècle de lumières pour la populace
« Malheur à ceux qui remuent le fond d’une nation ! Il n’est point de siècle de lumières pour la populace ; elle n’est ni française , ni anglaise, ni espagnole. La populace est toujours et en tout pays la même, toujours cannibale , toujours anthropophage ; et quand elle se venge de ses magistrats, elle punit des crimes qui ne sont pas toujours avérés par des crimes certains. Souvenez-vous, députés des Français , que lorsqu’on soulève un peuple, on lui donne toujours plus d’énergie qu’il n’en faut pour arriver au but qu’on se propose, et que cet excédent de force l’emporte bientôt au delà de toutes les bornes. Vous allez, en ce moment, donner des lois fixes et une constitution à une grande nation, et vous voulez que cette constitution soit précédée d’une déclaration pure et simple des droits de l’homme. Législateurs, fondateurs d’un nouvel ordre de choses, vous voulez faire marcher devant vous cette metaphysique que les anciens législateurs ont toujours eu la sagesse de cacher dans les fondements de leurs édifices. Ah ! ne soyez pas plus savants que la nature. Si vous voulez qu’un grand peuple jouisse de l’ombrage et se nourrisse des fruits de l’arbre que vous plantez, ne laissez pas ses racines à découvert. Craignez que des hommes auxquels vous n’avez parlé que de leurs droits, et jamais de leurs devoirs, que des hommes qui n’ont plus à redouter l’autorité royale , qui n’entendent rien aux opérations d’une assemblée législative, et qui en ont conçu des espérances exagérées, ne veuillent passer de l’égalité civile que donnent les lois à l’égalité absolue des propriétés, de la haine des rangs à celle des pouvoirs, et que de leurs mains, rougies du sang des nobles, ils ne veuillent aussi massacrer leurs magistrats. Il faut aux peuples des vérités usuelles , et non des abstractions ; et lorsqu’ils sortent d’un long esclavage, on doit leur présenter la liberté avec précaution et peu à peu, comme on ménage la nourriture à ces équipages affamés qu’on rencontre souvent en pleine mer dans les voyages de long cours. N’oubliez pas enfin, députés de la France, que si les rois se perdent pour vouloir trop régner, les assemblées législatives ne se perdent pas moins pour vouloir trop innover. »
Extrait des Mémoires de Rivarol, Paris, 1824, pages 64-66.
Sur les causes de la Révolution
« On ne cesse de parler, en France et dans le reste de l’Europe , des causes de cette révolution. On peut les diviser en causes éloignées et en causes prochaines, les unes et les autres sont trop nombreuses pour les rappeler toutes. La populace de Paris et celle même de toutes les villes du royaume, ont encore bien des crimes à faire avant d’égaler les sottises de la cour. Tout le règne actuel peut se réduire à quinze ans de faiblesse et à un jour de force mal employée.
(…)
On doit presque tout à la liberté de la presse. Les philosophes ont appris au peuple à se moquer des prêtres, et les prêtres ne sont plus en état de faire respecter les rois ; source évidente de l’affaiblissement des pouvoirs. L’imprimerie est l’artillerie de la pensée. Il n’est pas permis de parler en public, mais il est permis de tout écrire ; et si on ne peut avoir une armée d’auditeurs, on peut avoir une armée de lecteurs.
On doit beaucoup aussi à ceux qui ont éteint la maison du roi : ils ont privé le trône d’un appui et d’un éclat nécessaires ; les hommes ne sont pas de purs esprits, et les yeux ont leurs besoins ; par-là, ils ont aliéné les cœurs d’une foule de gentilshommes qui, de serviteurs heureux et soumis à Versailles, sont devenus des raisonneurs désœuvrés et mécontents dans les provinces.
(…)
L’extrême population dans un État est aussi une des causes de la chute des pouvoirs et des révolutions. Tout prospère chez un peuple au gré de ceux qui le gouvernent, lorsqu’il y a plus de travaux à faire que d’hommes à employer : mais quand les bras l’emportent par le nombre sur les travaux à faire, il reste alors beaucoup d’hommes inutiles, c’est-à-dire dangereux. Alors il faut recourir aux émigrations, et fonder des colonies, ou donner à ces peuples une forte constitution pour les contenir. Mais malheureusement si, au lieu de leur donner cette constitution, le prince les assemble pour qu’ils se la donnent eux-mêmes, alors c’est cette partie oisive et remuante qui domine, et tout est perdu.»
Extraits des Mémoires de Rivarol, Paris, 1824, p. 74-75 et 80.
Et si…
« On convient unanimement que, si le roi était monté à cheval, et qu’il se fût montré à l’armée, elle eût été fidèle et Paris tranquille ; mais on n’avait songé à rien. Cette armée, en arrivant, manquait de tout : elle fut nourrie et pourvue par ceux qu’elle venait réprimer. Le moyen que ses pédagogues pussent la diriger contre ses nouveaux bienfaiteurs ! Elle a suivi l’exemple des Gardes Françaises qui, au fond, n’ont jamais été dans Paris que des bourgeois armés.
D’ailleurs, après avoir fait la faute d’assembler les États-généraux aux portes de Paris, c’était commettre une imprudence que d’y rassembler les troupes. Les bourgeois de cette grande ville et une foule d’émissaires se répandirent dans le camp, et semèrent l’or à pleines mains ; de sorte que, huit jours après leur arrivée, il était à peu près certain que les troupes n’obéiraient pas. Le roi, en congédiant l’armée, ne consulta sans doute que la clémence ; mais il aurait dû la congédier encore, en ne consultant que la prudence. On dira peut-être que le roi aurait dû suivre l’armée : ceci suppose un autre système, un autre ordre de choses et un tout autre roi.
Comme rien n’avait été prévu, rien ne se trouva gardé. La Bastille emportée, trente mille fusils et cent pièces de canon entre les mains du peuple, une milice de soixante mille bourgeois, un sénat permanent à l’Hôtel-de-Ville et dans les soixante districts, l’Assemblée nationale se mettant sous leur sauvegarde ; et le roi forcé de venir à Paris approuver leurs fureurs et légitimer leur rébellion ; tels ont été les derniers symptômes et les signes les plus éclatants de la révolution : car la défection de l’armée n’est point une des causes de la révolution : elle est la révolution même.
L’extrême population dans un État est aussi une des causes de la chute des pouvoirs et des révolutions. Tout prospère chez un peuple au gré de ceux qui le gouvernent, lorsqu’il y a plus de travaux à faire que d’hommes à employer : mais quand les bras l’emportent par le nombre sur les travaux à faire, il reste alors beaucoup d’hommes inutiles, c’est-à-dire dangereux. Alors il faut recourir aux émigrations, et fonder des colonies, ou donner à ces peuples une forte constitution pour les contenir. Mais malheureusement si, au lieu de leur donner cette constitution, le prince les assemble pour qu’ils se la donnent eux-mêmes, alors c’est cette partie oisive et remuante qui domine, et tout est perdu.
Nous n’avons parlé, dans l’énumération de ces causes, ni de ce qu’on reproche à la reine, ni des déprédations de quelques favoris : ce sont là des sujets de mécontentement, et non des causes de révolution ; seulement peut-on dire que des faveurs entassées sans ménagement sur quelques individus ont découragé et aliéné une grande partie de la noblesse et du clergé, et que, ce sont ces mêmes nobles et ces prélats, réunis aux parlements, qui ont été les instigateurs et les premières victimes de la révolution ? Cela devait être, puisqu’en dernier résultat tout mouvement national n’est qu’un choc de l’égalité naturelle contre les privilèges, et, s’il faut le dire, du pauvre contre le riche. Du moment en effet que les privilèges sont si coupables, il est difficile que les grandes propriétés ne soient pas un peu odieuses ; et voilà pourquoi d’un bout du royaume à l’autre, ceux qui n’ont rien se sont armés contre ceux qui possèdent, et que le sort de l’État dépend aujourd’hui du succès qu’auront les milices bourgeoises contre les brigands.
Il reste maintenant à examiner quel serait l’état actuel des choses, si l’autorité royale n’avait pas été anéantie par la défection de l’armée. »
Extraits des Mémoires de Rivarol,Paris, Baudoin, 1824, p. 78-81
numérisé sur books.google.com
LES ANGLAIS ET LA RÉVOLUTION FRANCAISE
« Caractère spécial de la Révolution française : la bassesse »,
suivi de « Sur l’égalité des hommes et leur admission uniforme à tous les emplois »
« Quand des hommes de haut rang sacrifient toutes les idées de dignité à une ambition sans objet défini, et poursuivent d’indignes desseins avec de vils instruments, tous les esprits s’abaissent et s’avilissent. Est-ce que pour le moment nous ne voyons pas quelque chose d’analogue en France ? Est-ce que le résultat n’en est pas ignominieux et déshonorant ? Une sorte de bassesse dans la politique régnante, une tendance persistante à avilir, en même temps que les individus, toute la dignité et l’importance de l’Etat ? Il y a des révolutions dont les chefs furent des hommes qui, tout en essayant ou en accomplissant des changements dans la chose publique, sanctifiaient du moins leur ambition en donnant plus de dignité au peuple dont ils troublaient la paix. Ils avaient de grandes vues, ils voulaient donner des lois à leur pays, ils ne se proposaient pas de la détruire. C’étaient des hommes de grands talents civils et militaires, et, s’ils étaient la terreur de leur âge, ils en étaient aussi l’ornement. Ils ne ressemblaient pas à des courtiers juifs disputant ensemble à qui guérira le mieux, par la circulation frauduleuse d’un papier déprécié, la misère et la ruine déchaînées sur leur pays par leurs absurdes conseils. Ces fauteurs de troubles n’étaient pas tant des usurpateurs que des hommes revendiquant leur place naturelle dans la société.
Tel était notre Cromwell. Telle fut, chez vous, la race toute entière des Guise, des Condé, et des Coligny. Tel fut aussi votre Richelieu qui, en des temps moins troublés, se laissa encore guider par l’esprit de la guerre civile. Tels encore votre Henri IV et votre Sully (…).
Ceux qui tentent de niveler n’égalisent jamais. Dans toute société composée de différentes classes de citoyens, il faut qu’une de ces classes soit supérieure aux autres. C’est pourquoi les niveleurs ne font que changer et pervertir l’ordre naturel des choses ; ils surchargent l’édifice social en plaçant à son faîte ce dont la solidité de la construction voudrait qu’on fasse les fondements.
Vous n’imaginez point, n’est-ce pas, que je veuille réserver le pouvoir, l’autorité, les distinctions uniquement au sang, aux noms et aux titres. Non, monsieur, la vertu et la sagesse réelles ou présumées, sont seules des titres à exercer le pouvoir. Malheur au pays qui condamnerait à l’obscurité ce qui doit illustrer et glorifier un Etat ! Mais malheur aussi au pays qui, passant d’un extrême à l’autre, considère une éducation inférieure, une vue étroite et resserrée des choses, une profession sordide et mercenaire, comme les meilleurs titres à exercer le commandement ! Tous les postes devraient être ouverts : mais non pas indifféremment à tous. Il n’y a pas de rotation, pas de tirage au sort, pas de système électoral basé sur l’un ou l’autre de ces principes, qui puissent, en général, être bons dans un gouvernement qui s’occupe de vastes desseins et cela parce que ces méthodes ne tendent, ni directement, ni indirectement, à sélectionner les hommes en vue des devoirs qu’ils ont à accomplir, ou à mettre les individus à la place qu’ils doivent occuper (…).
On dit que vingt-quatre millions d’hommes doivent l’emporter sur deux cent mille. D’accord si la Constitution d’un royaume est un problème arithmétique. Pour des hommes qui peuvent raisonner avec calme, c’est ridicule. La volonté du grand nombre et son intérêt diffèrent bien souvent l’un de l’autre, et la différence sera énorme si le grand nombre fait le mauvais choix. A l’heure présente, vous semblez en toute chose vous être fourvoyés hors de la grande route de la nature. La propriété de la France n’est plus ce qui gouverne le pays, par suite la propriété est détruite, et la liberté raisonnable n’existe plus. Et, pour ce qui est de l’avenir, croyez-vous sérieusement que le territoire de la France, divisé d’après le système républicain en 83 municipalités indépendantes, pourra jamais être gouverné comme un seul corps ou mis en mouvement par l’impulsion d’une seule tête ? Ces petits états ne supporteront pas longtemps leur infériorité par rapport à la république de Paris. Ils ne supporteront pas que ce seul corps fasse son monopole de la captivité du roi et d’un droit de suprématie sur l’Assemblée qui s’appelle nationale. Les hommes qui ont fait la Constitution ont oublié que dès lors qu’ils ont eu construit un gouvernement démocratique, ils avaient virtuellement démembré leur pays. »
Extraits de BURKE, Réflexions sur la révolution française, 1790 (trad. de 1912).
Edmund Burke (1728-1797), homme politique conservateur anglais, quitta le parti des whigs à cause de son opposition résolue à la Révolution française en 1791.
Son chef-d’oeuvre fut ses Reflections on the Revolution in France (1790).
En voici trois autres extraits
Réflexions rédigées au mois de décembre 1791
« Le dogme politique, au moyen duquel les agents du nouveau système de la France se proposent de réunir les factieux de toutes les nations, est que, dans tous les pays, la majorité du peuple qui paie les impositions, constitue le légitime et véritable souverain ; que ses droits sont incontestables, inviolables et imprescriptibles ; que cette majorité peut légalement corriger, modifier, ou changer la forme du gouvernement ; que les magistrats, quelle que soit leur dénomination, ne sont jamais que des fonctionnaires, qui doivent exécuter les ordres de cette majorité, soit qu’elle fasse des règlements particuliers, ou des lois générales ; que ce système de gouvernement est le seul raisonnable, et que tous les autres sont l’ouvrage de la tyrannie et de l’usurpation.
Pour réduire ce principe en pratique, les républicains de France et leurs agrégés chez les autres nations s’occupent, sans relâche, de détruire jusqu’aux traces des anciens établissements, et de former des républiques basées sur la déclaration des droits de l’homme. Sur les principes de ces droits de l’homme, ils prétendent instituer dans chaque pays, les fondements d’un gouvernement municipal pour parvenir à ce qu’ils nomment l’égalité de représentation. Il doit en résulter insensiblement un conseil général qui représentera tous les gouvernements municipaux, et cette représentation sera revêtue de tout le pouvoir national. Il ne sera plus question de titre ou d’office héréditaire ; toutes les classes seront égales, à l’exception de la différence que l’argent produira toujours. La noblesse et les établissements religieux seront abolis ; les prêtres et les magistrats seront électifs, pensionnés et destituables à volonté.
Convaincus que leur plan ne peut pas convenir aux possesseurs des grandes propriétés territoriales héréditaires, ils ont résolu d’aplanir cet obstacle, en réduisant les propriétaires à la classe des paysans , chargés de l’approvisionnement des villes, et de placer le pouvoir effectif du gouvernement entre les mains des marchands, banquiers qui les habitent, particulièrement des membres des clubs, des avocats , procureurs, notaires, journalistes, et de ces cabales d’hommes de lettres qu’on nomme des académies. Leur république doit avoir aussi ce qu’ils appellent un premier fonctionnaire, avec la dénomination de roi, ou telle autre qu’il leur plaira de lui donner ; Mais cet officier ne doit plus être considéré comme un souverain, ni le peuple comme ses sujets. Le sens, et jusqu’au son de ces mots leur serait insupportable.
Ce système ayant été primitivement conçu et exécuté en France, ce pays devient naturellement le chef-lieu de toutes les factions formées sur les mêmes principes, en quelque endroit qu’elles puissent naître, comme autrefois Athènes fut le chef et l’allié général des factions démocratiques , partout où elles se manifestaient.
Dans tous les pays de l’Europe, ce système a une foule de partisans, et particulièrement en Angleterre, où ils forment déjà un corps composé des trois principales sectes des non-conformistes, auxquels se sont déjà joints les factieux et les hommes turbulents de toutes les classes et de tous les partis ; des Wighs, des Tories, tous les demi-philosophes, les athées, les Sociniens , les déistes, tous ceux qui haïssent le clergé et envient la noblesse , un grand nombre de riches capitalistes, et tous les membres de la compagnie des grandes Indes, presque sans exception : ces derniers, mécontents de ne pas jouir d’une importance proportionnée à leur opulence, ont déjà formé un club, que je considère comme très-redoutable : quoique paisible aujourd’hui, il pourrait agir, dans l’occasion, d’une manière très funeste.
On n’avait à redouter, autrefois, comme instruments des révolutions, que l’audace des indigents, et l’ambition de quelques grands personnages. Ce qui vient de se passer en France, nous apprend entr’autres choses, que les causes qui peuvent renverser un gouvernement n’étaient pas encore toutes bien connues. Les capitalistes, les négociants, les riches artisans, et les hommes de lettres considérés jusqu’ici généralement comme la portion de la société la plus paisible, ou même la plus timide, sont les principaux acteurs de la révolution française. Mais le fait est qu’à mesure que la quantité et la circulation du numéraire augmentent, à mesure que les nouveautés politiques, littéraires, se multiplient, ceux qui répandent l’argent et l’instruction acquièrent un supplément d’importance. Ceci ne tarda pas à se découvrir et, en France, les hommes de ces classes commencèrent à concevoir, pour la première fois, des vues d’ambition : ils convoitèrent toutes les places du nouveau système, et le renouvellement de tous les offices civils et militaires d’un Vaste Royaume leur offrit une perspective si brillante qu’ils en furent éblouis : elle les électrisa ; l’esprit naturel de leur état disparut, et ils prirent un nouveau caractère. »
Edmond Burke, Oeuvres posthumes sur la Révolution Française, Londres, 1799, p. 46-51 numérisé sur books.google.com
« Les citoyens véritablement actifs, c’est-à-dire, ceux dont j’ai parlé plus haut, ont tous quelqu’intérêt personnel dans les intrigues relatives à leur gouvernement local ou général. Les renouvellements établis par l’assemblée nationale, présentent, à la multitude , des objets d’ambition très-capables de créer un nouveau genre d’intérêts politiques, très-différents de celui de la naissance et de la propriété. Ce plan de rotation affaiblit l’état, considéré collectivement comme un corps, et entrave ses opérations ; mais il donne de la force et de l’unanimité au système démocratique. Sept cent cinquante individus, élevés tous les deux ans au pouvoir suprême, ont déjà produit quinze cents politiques actifs et hardis. C’est un nombre très-considérable , même dans un pays aussi vaste que la France. Les nouveaux législateurs ne peuvent plus se contenter d’occupations ordinaires, ils ne veulent plus redescendre à la classe de simple citoyen , ni exercer paisiblement une industrie obscure ou peu importante. Tandis qu’ils siègent dans l’assemblée, il leur est défendu d’exercer aucun autre emploi public ; mais ils y restent si peu de temps que cet inconvénient est à peine sensible. D’ailleurs, durant cette espèce de noviciat, ils jouissent d’un revenu, que la plupart d’entr’eux devraient trouver immense. Lorsqu’il est fini, ils obtiennent toujours un emploi lucratif; et lorsqu’ils ont du crédit dans l’assemblée, ils font mettre en place des individus dont ils partagent les émoluments.
Ce recrutement périodique du corps qui exerce l’autorité suprême, produira en peu d’années plusieurs milliers d’ex-législateurs , et ce nombre est toutefois fort peu de chose en comparaison de la multitude d’officiers municipaux des districts et des départements, qui, après avoir exercé lucrativement une portion du pouvoir, s’agiteront en tout sens, pour rentrer en place. La plupart de ces intrigants nécessiteux s’inquiètent fort peu de la gloire ou de la prospérité nationale. Peu leur importe qu’elle augmente ou perde son crédit, pourvu qu’ils conservent personnellement de l’influence, et qu’ils fassent ce qu’ils appellent leurs affaires. L’indifférence de l’assemblée pour les colonies dont dépendent tous les avantages et le succès du commerce de la France, démontre suffisamment que la considération de leurs gains sordides, et de leurs intérêts personnels , est la seule qui puisse leur entrer dans la tête.
Il est vrai que malgré leurs intrigues, le mécontentement perce de toutes parts, mais il n’en résulte que des persécutions contre ceux qui le manifestent, et l’exil suivi de la confiscation pour ceux qui vont chercher ailleurs la sûreté qui n’existe plus dans leur patrie. A l’imitation du comité des recherches de l’assemblée, chaque commune a un comité de surveillance ; et dans les petits endroits, la tyrannie est si proche de ses objets, que toutes les actions des individus lui sont promptement connues, et tous les complots étouffés dès leur naissance. Le pouvoir des comités est absolu et irrésistible. Ces municipalités ont si peu de relation entre elles, que la connaissance de ce qui arrive dans l’une, n’excède point ses limites, ou n’est répandue que par l’entremise des clubs qui entretiennent une correspondance très-active , et donnent la couleur qu’il leur plaît aux incidents qu’ils jugent à propos d’insérer dans leurs missives. Ils ont tous avec l’autorité centrale, une sorte de communication qu’ils peuvent étendre ou restreindre à leur fantaisie, au moyen de quoi les informations étant toutes, entre les mains de la faction dominante, les plaintes et les mouvements que les vexations produisent dans une municipalité, sont rarement connus des communes qui l’environnent, et personne n’ose servir de chef aux mécontents. L’ancien gouvernement avait si bien réussi à faire abandonner des nobles l’intérêt des provinces, qu’il n’en existe pas un qui ait dans deux districts, du pouvoir, du crédit, ni même de l’influence, ou qui fut capable de les réunir pour une entreprise quelconque. A la vérité, l’individu qui s’aviserait de rassembler seulement dix hommes, pourrait être assuré de coucher le même soir dans une prison. Il ne faut pas juger la situation de la France sur ce qu’on a pu observer ailleurs. Ce pays ne ressemble plus à un autre. On s’abuserait si on voulait raisonner sur ce sujet, d’après l’histoire, ou des évènements arrivés récemment ailleurs.
Jamais il n’exista, dans mon opinion , un gouvernement intérieurement aussi nerveux que les municipalités de la France. Si jamais il s’élève une révolte contre le présent système, il faut qu’elle commence dans le berceau de la révolution, c’est-à-dire, dans la capitale. Paris est la seule ville où il reste quelque possibilité de communication, mais ceux qui l’habitent, et qui ont des valets dans leurs maisons, doivent s’en méfier comme d’autant d’espions et d’ennemis domestiques. »
Extraits de Edmond BURKE, Œuvres posthumes sur la Révolution française, Londres, 1799, p. 87-91
numérisé sur books.google.com
« La situation de la France est fort simple ; on n’y trouve que deux espèces d’individus, des opprimés et des persécuteurs, ou des bourreaux et des victimes.
Les premiers ont entre leurs mains toute l’autorité de l’état, la force-armée, les revenus publics, la confiscation des biens appartenant à des individus ou à des corps. En soudoyant la dernière classe, ils l’ont détournée de ses occupations ; c’est de leurs largesses qu’elle subsiste, et elle est, en conséquence, toujours disposée à leur obéir aveuglément. Ils ont fait abjurer Dieu par les prêtres et par le peuple ; ils ont tâché d’extirper de leurs cœurs et de leurs esprits, tous les principes de la morale, et tous les sentiments de la nature. Leur objet est d’en faire des sauvages féroces et incapables de supporter un système fondé sur l’ordre et la vertu.
Les opprimés appartiennent à une classe plus aisée ; c’est un faible reste des bourgeois échappés à la proscription des propriétaires. Quoique nombreux, ils sont trop disséminés pour être redoutables. Dans les villes, la nature de leurs occupations les rend sédentaires et faibles. Dans la campagne, la nécessité de cultiver pour vivre les retient dans leurs fermes.
Les gardes nationaux ont été réformés et organisés d’une manière différente. Tous ceux qui paraissent suspects sont soigneusement désarmés. On a formé partout des comités de surveillance. C’est une inquisition dont la rigueur surpasse de beaucoup tout ce que l’imagination humaine avait précédemment inventé dans ce genre. Deux personnes qui se rencontrent accidentellement, ne peuvent avoir ensemble un quart-d’heure de conversation particulière, sans être épiés, inculpés, et courir des risques pour leur liberté, ou même pour leurs vies. On en a exécuté un grand nombre, et la confiscation est toujours un article de la sentence. A Paris, et dans d’autres villes, on distribue chaque jour, à tous les individus, une ration de pain ; et, pour l’obtenir, il faut avoir une carte signée des agents du gouvernement ; les prisons regorgent d’hommes, de femmes et d’enfants des deux sexes ; le nombre des captifs dans toute la France, monte, dit-on, à plus de cent mille. Si un père de famille entreprend de résister à la tyrannie, ou d’éluder le pouvoir des tyrans par la fuite, ses biens sont séquestrés, sa maison saisie, sa femme et ses enfants réduits à l’indigence, et quelquefois incarcérés à la place du fugitif. Ils rendent les enfants responsables pour leur père, et le père pour ses enfants. C’est au moyen de cette responsabilité, qu’ils retiennent sous les drapeaux les soldats levés en masse, et conduits de force aux armées.
Ils ont encore inventé une ressource qui mérite qu’on en fasse mention. Des commissaires de l’assemblée nationale, choisis parmi ses membres, parcourent perpétuellement les provinces, et visitent les armées. Partout où ils se trouvent, toute autre autorité civile ou militaire leur est subordonnée. Ils exercent individuellement tous les pouvoirs de l’assemblée. Ils changent, suspendent, destituent et remplacent à leur fantaisie ; au moyen de quoi les habitants ne jouissent pas de la plus faible portion d’autorité délibérative. »
Extraits de Edmond BURKE, Œuvres posthumes sur la Révolution française, Londres, 1799, p. 180-182
numérisé sur books.google.com
Déclaration du gouvernement britannique le 29 octobre 1793
« Les intentions qui avaient été proclamées de réformer les abus du gouvernement français, d’établir la liberté individuelle sur des bases solides, (…) toutes ces vues salutaires se sont malheureusement évanouies. A leur place a succédé un système destructeur de l’ordre public, maintenu en place par des expulsions, des confiscations, des emprisonnements, des massacres (…) et, finalement, par l’exécrable assassinat d’un souverain juste et bienfaisant. Les nations voisines ont été exposées aux attaques répétées. (…) Cet état de choses ne peut exister en France sans entraîner toutes les puissances environnantes dans un même danger (…), sans leur donner le droit d’arrêter la progression de ce mal. »
Cité dans Berstein et Milza, « Histoire Seconde« , éditions Hatier, 1996, p.241.
—-
Sur les causes de la Révolution : problème de la dette
« Il fallut, à l’époque de la paix*, pourvoir à l’acquittement de la dette. Après avoir soutenu la guerre, sans impôts, il était impossible d’imposer au moment de la paix, époque où les peuples sont habitués à voir diminuer leurs charges. Les ministres des finances se trouvèrent forcés de suivre le système des emprunts adopté par Necker, et l’exemple du haut prix de ses emprunts ne permit pas, pendant quelque temps, d’en faire à des conditions modérées. On suivit le système de Necker. La confiance des prêteurs le soutint quelque temps, encouragée par l’appui de conditions avantageuses. Les emprunts viagers surtout procurèrent des moyens prompts et considérables au gouvernement, en offrant à l’étranger spéculateur des intérêts considérables, et au Français avide de jouir, des moyens de satisfaire son goût pour le luxe. Mais bientôt à l’impossibilité d’imposer, se joignit la difficulté d’emprunter. C’est alors que le ministre des finances [Charles-Alexandre de Calonne, de 1783 à 1787] conçut le projet d’assembler les notables et de leur présenter un plan, qui substituait des remèdes curatifs aux vains palliatifs employés jusqu’alors. L’abolition des impôts les plus onéreux, la diminution de plusieurs, la suppression des rigueurs fiscales, une imposition en nature sur les produits, dont il y a des exemples en plusieurs pays et même en France, l’économie dans les frais de perception, l’assujettissement des privilégiés aux charges, tels étaient les moyens proposés ; si quelques-uns étaient susceptibles de difficultés, l’ensemble était favorable au peuple, et avantageux à l’Etat. Il était hasardeux, en appréciant le siècle, les esprits, et jugeant leur direction, d’assembler les notables, mais il est à présumer que si les partisans de Necker n’avaient pas dominé le public, s’ils n’avaient pas intrigué contre le ministre des finances, les notables auraient pu remédier aux affaires. Ils auraient substitué au crédit du roi un crédit national, puisque son organisation aurait été déterminée par des hommes, qu’on pouvait regarder, en quelque sorte, comme les représentants de la Nation. Leur sentiment en matière d’impôt aurait été éclairé et décisif et le roi, muni de leurs avis, aurait pu, sans craindre de mécontenter le peuple, forcer les parlements à l’enregistrement des édits arrêtés par les notables. L’assemblée des notables leur était supérieure par le rang des personnes, et leurs lumières sur l’administration. Comment auraient-ils pu se refuser à sanctionner des édits discutés, rédigés par des citoyens distingués, de tous les états, et de toutes les provinces du royaume ? Les notables s’assemblèrent, et les haines particulières, l’intrigue, l’ambition firent avorter les projets régénérateurs. Le ministre des finances fut disgracié et son administration calomniée. Un parlement osa faire imprimer qu’il était l’auteur du déficit ; il résultait de cette étrange assertion, et des calculs à l’appui, que ce ministre avait dépensé environ deux milliards par année en temps de paix. Je cite ce fait comme un monument de la grossière ignorance des parlements en administration. M. de Calonne fut remplacé par un prélat soupçonné d’avoir contrarié toutes ses opérations, afin de s’élever à sa place. L’archevêque de Toulouse s’était acquis depuis longtemps une grande réputation dans les affaires, et fixait l’attention du public qui le regardait comme l’homme le plus capable d’administrer les finances. »
*Le traité de Versailles en 1782 reconnaît l’indépendance américaine et consacre également la paix entre la France et l’Angleterre (note de M. Delon)
in Sénac de Meilhan, Des principes et des causes de la Révolution en France ;
suivi d’extraits de Du gouvernement, des moeurs et des conditions en France avant la Révolution , Paris, Desjonquères, 1987 (1790), p. 65-66
du même auteur un extrait d’un roman…
Une Révolution accidentelle
« Je n’entreprendrai certainement pas d’écrire l’histoire de l’incroyable révolution de la France : c’est une tâche que je laisse à des hommes plus habiles, et il faut attendre que l’avenir ait dévoilé des ressorts qui nous sont inconnus. Je vous surprendrai au reste, en vous disant qu’après avoir attentivement réfléchi sur la Révolution, elle ne me paraît pas devoir former pour la postérité, un corps d’histoire aussi intéressant qu’il paraît d’abord devoir l’être, si ce n’est par ses effets ultérieurs. Voici sur quoi je me fonde, pour être de ce sentiment : il n’y a d’intéressant dans l’histoire, comme dans les tragédies, que la lutte de divers partis, qui tient l’esprit en suspens ; mais dans la Révolution tout a été emporté d’un mouvement extrême, sans rencontrer d’obstacles, et le caractère de ceux qui ont eu part à l’ancien gouvernement, est le seul principe de sa totale subversion. Ce n’est point par une suite d’événements, et par l’assemblage de matériaux depuis longtemps préparés, que le plus incroyable changement a été opéré et la Révolution est purement accidentelle. Plusieurs l’attribuent aux écrits des philosophes, dont l’influence a été sensible en France ; et particulièrement, depuis qu’ils ont fait corps, sous le nom d’Encyclopédistes ; mais si l’on suit attentivement la marche de la Révolution, il sera facile de voir, que les écrivains appelés philosophes, ont pu la fortifier, mais ne l’ont pas déterminée ; parce qu’une maison a été bâtie avec les pierres d’une carrière voisine, serait-on fondé à dire qu’elle n’a été construite qu’en raison de ce voisinage ? Il est bien plus probable, que le dessein conçu, on s’est servi des matériaux qui étaient à portée. La philosophie répandue dans les écrits modernes n’a pas été le principe de la Révolution ; mais une fois commencée, par quelque principe que ce soit, on s’en est appuyé ; c’est lorsque les esprits ont été en mouvement, qu’on a cherché dans J .-J . Rousseau, et d’autres auteurs, des maximes et des principes favorables au système que les circonstances donnaient espoir d’établir. Un esprit subtil chercherait donc en vain, dans les temps antérieurs, des germes qui se sont peu à peu développés. Le caractère de quelques personnes tracé, et la faiblesse de l’opposition mise dans tout son jour, la Révolution en devient un effet presque nécessaire ; sa marche a été déterminée et hâtée par cette faiblesse ; le défaut de résistance a rendu tout possible, et semblable à un torrent qui ne trouve aucune digue, elle a tout dévasté. Alors l’intérêt manque, parce qu’il n’y a point de combats, dans lesquels l’esprit admire les efforts respectifs du courage, l’habileté de l’attaque et de la défense, et dont la curiosité cherche à deviner l’issue. Les événements de la Révolution sont à la fois, et trop uniformes et trop atroces, pour ne pas rebuter le lecteur : toujours des massacres, des supplices, des emprisonnements (…) »
Sénac de Meilhan, L’émigré, Paris, Gallimard, (Coll. Folio classique), 2004 (1797), Lettre LXXV, p. 233-5