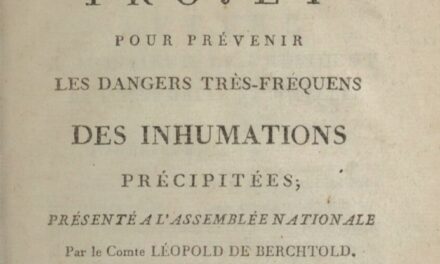En cette journée historique du Mercredi 7 novembre, le député Jean-Baptiste Mailhe (né à Toulouse en 1754 – mort à Paris en 1834) fait part à l’Assemblée du rapport relatif au jugement de Louis XVI. C’est à partir de ce jour et du décret adopté par la Convention que va s’enclancher la machine judiciaire qui conduira le « citoyen Capet » au pied de la guillotine :
(…)
Mailhe, au nom du comité de législation : « Louis XVI est-il jugeable pour les crimes qu’on lui impute d’avoir commis sur le trône constitutionnel ? Par qui doit-il être jugé ? Sera-t-il traduit devant les tribunaux ordinaires comme tout autre citoyen accusé de crimes d’État ? Déléguerez-vous le droit de le juger à un tribunal formé par les assemblées électorales des quatre-vingt-trois départements ? N’est-il pas plus naturel que la Convention nationale le juge elle-même ? Est-il nécessaire ou convenable de soumettre le jugement à la ratification de tous les membres de la république, réunis en assemblées primaires ?
Voilà les questions que votre comité de législation a longtemps et profondément agitées. La première est la plus simple de toutes, et cependant c’est celle qui demande la plus mûre discussion, non pas pour vous, non pas pour cette grande majorité du peuple français qui a mesuré toute l’étendue de sa souveraineté, mais pour le petit nombre de ceux qui croient entrevoir, dans la Constitution, l’impunité de Louis XVI, et qui attendent la solution de leurs doutes, mais pour les nations qui sont encore gouvernées par des rois, et que vous devez instruire, mais pour l’universalité du genre humain qui vous contemple, qui s’agite entre le besoin et la crainte de punir ses tyrans, et qui ne se déterminera peut-être que d’après l’opinion qu’il aura de votre justice.
J’ouvre cette Constitution, qui avait consacré le despotisme sous le nom de royauté héréditaire. J’y trouve que la personne du roi était inviolable et sacrée; j’y trouve que, si le roi ne prêtait pas le serment prescrit, ou si, après l’avoir prêté, il le rétractait; que s’il se mettait à la tête d’une armée, et en dirigeait les forces contre la nation, ou s’il ne s’opposait pas, par un acte formel, à une telle entreprise qui s’exécuterait en son nom; que si, étant sorti du royaume, il n’y rentrait pas après une invitation du corps législatif et dans un délai déterminé, il serait censé, dans chacun de ces cas, avoir abdiqué la royauté. J’y trouve qu’après l’abdication expresse ou légale, le roi devait être dans la classe des citoyens, et qu’il pourrait être accusé et jugé comme eux pour les actes postérieurs à son abdication.
Cela veut-il dire que le roi, tant qu’il serait assez adroit pour éluder les cas de déchéance, pourrait impunément s’abandonner aux passions les plus féroces ? Cela veut-il dire qu’il pourrait faire servir sa puissance constitutionnelle au renversement de la Constitution ? Que si, après avoir clandestinement appelé à son secours des hordes de brigands étrangers, si, après avoir fait verser le sang de plusieurs milliers de citoyens, il venait à échouer dans ses entreprises contre la liberté, il en serait quitte pour la perte d’un sceptre qui lui était odieux parce qu’il n’était pas de fer, et que la nation, longtemps trahie, longtemps opprimée, n’aurait pas le droit, en se réveillant, de faire éclater une vengeance effective, et de donner un grand exemple à l’univers ?
Peut-être était-ce là l’esprit de ceux qui provoquèrent ces articles que Louis XVI ne manquera pas d’invoquer en sa faveur; mais, pressés de s’expliquer, ils ne répondraient que par des subtilités évasives, ils auraient rougi d’avouer qu’il entrât dans leurs vues de reconduire Louis XVI au despotisme par l’attrait d’une pareille impunité; semblables, sous certains rapports, à l’aristocratie sénatoriale de Rome, qui préparait le peuple à la servitude par des nominations fréquentes de dictateur, et qui, pour y procéder, s’enveloppait dans les ombres de la nuit et du secret, comme si elle avait eu honte, dit Jean-Jacques, de mettre un homme au-dessus de la loi.
Voyons quels furent les vrais motifs et l’objet de l’inviolabilité royale; c’est le vrai moyen d’en saisir le vrai sens, et de juger si elle peut être opposée à la nation elle-même.
La France, disait-on, ne peut pas se soutenir sans monarchie, ni la monarchie sans être entourée de l’inviolabilité. Si le roi pouvait être accusé ou jugé par le corps législatif, il serait dans sa dépendance et dès lors, ou la royauté serait bientôt renversée par ce corps, qui, usurpant tous les pouvoirs, deviendrait tyrannique, ou elle serait sans énergie, sans action pour faire exécuter la loi. Dans tous les cas, il n’y aurait plus de liberté. Ce n’est donc pas pour l’intérêt du roi, mais pour l’intérêt même de la nation, que le roi doit être inviolable. On convenait cependant, que cette inviolabilité était menaçante pour la liberté, mais on prétendit y remédier par la responsabilité des ministres.
Voilà par quels sophismes on cherchait à égarer la nation ! Ignorait-on que la royauté avait longtemps subsisté, et dans Sparte et chez d’autres anciens peuples, sans la redoutable égide de l’inviolabilité ? Que les rois y étaient soumis à des tribunaux populaires ? Que leur dépendance, leur jugement et leur condamnation, bien loin de nuire à la liberté, en étaient l’unique garant ? Plus sage que les Spartiates, la nation française a commencé par abattre la royauté avant de s’occuper du sort de la personne d’un roi coupable, et déjà elle a prouvé combien elle était calomniée ou trahie, quand on disait que le gouvernement monarchique était un besoin pour sa puissance et sa gloire.
Mais revenons à l’inviolabilité royale. Du propre aveu de ses défenseurs, elle avait pour objet unique l’intérêt de la nation, le maintien de son repos et de sa liberté, et jamais elle ne devait être nuisible, parce que le roi était condamné à ne pouvoir faire exécuter aucun ordre qui ne fût signé par un ministre, et que les agents répondaient sur leurs têtes de tous les délits d’administration.
Si Louis XVI avait toujours mesuré à cette balance l’exercice de son pouvoir, il aurait le spécieux prétexte de vous dire : Dans tout ce que j’ai fait, j’avais en vue le bonheur de la nation, j’ai pu me tromper, mais le sentiment de mon inviolabilité m’encourageait à essayer mes idées de bien public. Je les ai toutes soumises à mes agents; je n’ai rien ordonné qui ne porte le sceau de leur responsabilité, voyez leurs registres; c’est donc à eux seuls qu’il faut vous en prendre, puisqu’ils doivent seuls garantir mes erreurs.
Qu’il est loin de pouvoir tenir un tel langage, s’il a violé la loi qui lui commandait d’avoir un agent toujours prêt à répondre de ses erreurs ou de ses délits; s’il a tourné contre la nation la prérogative qu’il avait reçue pour elle; s’il a industrieusement éludé le préservatif de la liberté individuelle et publique ! Nous pressentions depuis longtemps qu’on préparait le tombeau de la nation, mais les mains employées pour le creuser étaient invisibles.
La trahison se promenait sur toutes les têtes citoyennes sans pouvoir être aperçue. La foudre allait éclater avant l’apparition de l’éclair, et Louis XVI, qui, pour mieux tromper la nation, aurait travaillé sans relâche à lui rendre suspects les membres les plus purs du corps législatif, Louis XVI, qui, dans un temps même où il se serait cru si près de recueillir le fruit de ses perfidies, venait faire retentir cette salle auguste de ses hypocrites protestations d’attachement à la liberté, ne serait pas personnellement responsable des maux qu’il aurait personnellement occasionnés ! Il dira que sa personne ne pouvait pas être séparée des fonctions de la royauté, qu’inviolable comme roi, pour tous les faits administratifs, il l’était, comme individu, pour tous les faits personnels.
Je répondrai qu’il est accusé de n’avoir que trop justifié la possibilité de cette séparation. Son inviolabilité, comme chef du pouvoir exécutif, avait pour unique base une fiction qui rejetait le délit et la peine sur la tète de ses agents mais il a renoncé à l’effet de cette fiction, s’il a ourdi ses complots sans le concours de ses ministres ordinaires, ou sans agents visibles, ou s’il les a mis hors de l’atteinte d’une surveillance active, et, comme il répugne, même aux bases de la constitution acceptée par Louis XVI, qu’il y eût infraction à la loi sans responsabilité, Louis XVI était naturellement et nécessairement accusable, pour tous ceux de ses délits dont il était impossible de charger ses agents. J’ajoute que la Constitution prononçait la déchéance du roi dans le cas où il ne se serait pas opposé, par un acte formel, aux entreprises d’une force dirigée en son nom contre la nation. Or, un roi perfide pouvait déployer une opposition illusoire et non formelle.
Il fallait donc décider si cette opposition avait été réelle ou simulée. Mais pour cela il était évidemment nécessaire d’examiner la conduite du roi, de le mettre en cause, de le juger. Dans l’état où étaient alors les choses, ce droit ne pouvait appartenir qu’à la première des autorités constituées. Il était donc des cas où la constitution elle-même réduisait expressément l’inviolabilité royale, et la soumettait au jugement du corps législatif. Faut-il conclure de là que le corps législatif avait le droit de prononcer sur tous les crimes personnels du roi ? La raison le commandait sans doute, mais les termes de la Constitution y résistaient.
Je remplis un ministère de vérité; je serais coupable si je la déguisais, soit dans les principes, soit dans les faits. La puissance réelle du corps législatif, à l’égard du roi, était bornée par la Constitution à juger les cas de déchéance qu’elle avait prévus. Dans ces cas même, il ne pouvait prononcer que la peine de déchéance. Hors ces cas, la personne du roi était indépendante du corps législatif. Hors ces cas, le corps législatif ne pouvait s’ingérer d’aucune fonction judiciaire. A cet égard, il n’avait dans ses mains que les décrets d’accusation, et, quand il aurait pu en lancer un contre Louis XVI, à quel tribunal l’aurait-il renvoyé ? Placé parallèlement par la Constitution à côté du corps législatif, le roi était au-dessus de toutes les autorités constituées. Mais le corps législatif était-il lié par les principes de l’inviolabilité royale, qu’il dût sacrifier le salut public à la crainte de les enfreindre ? Devait-il imiter les soldats d’un peuple superstitieux qui, voyant devant l’armée ennemie un premier rang d’animaux que le peuple tenait pour sacrés n’osèrent point tirer, et laissèrent à jamais périr la liberté dans leur patrie ? Qu’on demande compte aux hommes du 10 août de la digue qu’ils opposèrent au torrent des trahisons ! Qu’on demande compte au corps législatif des décrets qui suspendirent Louis XVI de ses fonctions et le firent transférer au Temple ! Ils répondront tous : Nous avons sauvé la liberté, rendez grâces à notre courage !
Ce corps législatif, que les partisans du despotisme accusaient avec tout l’art de la récrimination, de vouloir avilir l’autorité royale pour l’ajouter à la sienne et s’y perpétuer, n’eut pas plus tôt frappé les grands coups qui l’ont fait proclamer partout le sauveur de la France, qu’il dit à la nation : « Nous remettons dans tes mains les pouvoirs que tu nous avais confiés; si nous les avons excédés, c’est provisoirement et pour ton salut. Juge-nous, juge la Constitution, juge la royauté, juge Louis XVI, et voit s’il te convient de maintenir ou de reconstruire les bases de ta liberté ».
Citoyens, la nation a parlé. La nation vous a choisis pour être les organes de ses volontés souveraines. Ici toutes les difficultés disparaissent, ici l’inviolabilité royale est comme si elle n’avait jamais existé. Je l’ai déjà dit, cette inviolabilité avait pour objet d’assurer l’énergie du pouvoir exécutif par son indépendance à l’égard du corps législatif.
De là il résultait bien que ce corps n’avait pas le droit de juger le roi dans les cas non prévus par la Constitution. De là, il résultait bien que dans aucun cas il ne pouvait être jugé par les autres autorités constituées dont il était le supérieur, mais il n’en résultait pas qu’il ne pût être jugé par la nation : car, pour extraire une pareille conséquence, il faudrait pouvoir dire que, par l’acte constitutionnel, le roi était supérieur à la nation.
Louis XVI dira peut-être : En ratifiant, en exécutant la Constitution décrétée par ses représentants, le peuple français reconnut l’inviolabilité qui m’y était accordée. Il reconnut que je ne pouvais être accusé que pour des délits postérieurs à ma déchéance. Il les lia par cette disposition aussi bien que les autorités constituées; puisqu’elle ne lui avait pas expressément réservé le droit de me rechercher en vertu de sa souveraineté, pour des délits antérieurs.
Non, la nation n’était pas liée par l’inviolabilité royale, elle ne pouvait même pas l’être; il n’existait pas de réciprocité entre la nation et le roi. Louis XVI n’était roi que par la Constitution : la nation était souveraine sans Constitution et sans roi. Elle ne tient sa souveraineté que de la nature; elle ne peut l’aliéner un seul instant. Ce principe éternel était rappelé dans la Constitution même. Or, la nation ne l’aurait-elle pas aliénée, cette souveraineté, si elle avait renoncé au droit d’examiner, de juger toutes les actions d’un homme qu’elle aurait mis à la tête de son administration ?
Il était inviolable aussi par la constitution, le corps législatif. Il était indépendant du roi et de toutes les autres autorités constitués, aucun de ses membres ne pouvait être criminellement poursuivi devant les tribunaux, sans qu’il l’eût ordonné par un décret formel; mais s’il avait abusé de cette inviolabilité, de cette indépendance, et que la nation se fût levée pour l’interroger sur ses malversations, pensez-vous qu’il lui eût suffi d’alléguer une prérogative qui lui avait été concédée, non pas pour lui, mais pour l’intérêt général ?
L’inviolabilité du roi ainsi que celle du corps législatif, était destinée à prévenir les entreprises de l’un sur l’autorité de l’autre. De là devait naître un équilibre qu’on avait supposé nécessaire pour le maintien de la liberté.
D’après ces principes, et si le roi avait été fidèle à ses devoirs, il avait le droit d’appeler la puissance nationale contre toute entreprise qui aurait menacé son inviolabilité; mais appelé lui-même devant le tribunal de la nation, comment et sous quel prétexte pourrait-il invoquer aujourd’hui une inviolabilité qu’il n’avait reçue que pour la défendre, et dont il ne s’est servi que pour l’opprimer ?
Mais Louis XVI n’a-t-il pas été jugé ? N’a-t-il pas été puni par la privation du sceptre constitutionnel ? Peut-il être soumis à un second jugement, à une seconde peine ? Cette objection, si on la fait, ne sera pas exacte.
Si la Constitution devait subsister, et que le corps législatif eût prononcé la déchéance de Louis XVI, conformément à cet acte qui lui donnait un successeur, cette déchéance serait une peine, et la constitution résisterait à une peine ultérieure. Mais la nation, qui a le droit imprescriptible de changer sa constitution, a chargé ses représentants d’en construire une nouvelle.
Investis de la plénitude de son pouvoir, vous n’avez pas dit que Louis XVI était indigne d’être roi, mais vous avez dit qu’il n’y avait plus de roi en France. Ce n’est pas parce que Louis XVI était coupable que vous avez aboli la royauté, mais parce qu’il n’y a pas de liberté sans égalité, ni d’égalité sans république…. »
(On applaudit)
« …Vous n’avez donc ni jugé, ni puni Louis XVI : vous n’avez pas même envisagé en cela sa personne. Il n’était roi que par le bienfait d’une constitution monarchique; il a tout naturellement cessé de l’être par le premier élan de la nation vers une constitution républicaine.
Mais on vous contestera même la possibilité de condamner Louis XVI à une peine : on vous rappellera a la déclaration des droits; on vous dira que nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit et légalement appliquée. On vous demandera où est la loi qui pouvait être appliquée aux crimes dont Louis XVI est prévenu. Où est la loi ? Elle est dans le code pénal. C’est la loi qui punit les prévarications des fonctionnaires publics, car vous savez que Louis XVI n’était aux yeux de la loi que le premier des fonctionnaires. C’est la loi qui frappe les traîtres et les conspirateurs. C’est la loi qui appesantit son glaive sur la tête de tout homme assez lâche ou assez audacieux pour attenter à la liberté sociale.
En vain dira-t-on que ces lois, venant à la suite et en exécution de l’acte constitutionnel, n’étaient pas applicables aux crimes d’un roi que cet acte déclarait inviolable. Sans doute elles ne pouvaient pas être appliquées par les autorités que la constitution avait placées au-dessus d’un roi, mais cette prérogative royale était évidemment nulle devant la nation.
Est-ce d’ailleurs dans le nouveau code français seulement que ces lois se retrouvent ? N’existaient-elles pas de tous les temps et dans tous les pays ? Ne sont-elles pas aussi anciennes que les sociétés ?
Partout les rois n’ont été créés que pour faire exécuter les lois communes à tous, que pour protéger, par la direction des forces sociales, les propriétés, la liberté, la vie de chacun des associés, et garantir de l’oppression la société entière. Partout ils ont dû être inviolable, dans ce sens que les offenser, c’eût été offenser la nation qu’ils représentaient. Mais s’ils violaient leurs serments, s’ils offensaient eux-mêmes la nation dans ses droits suprêmes ou dans ceux de ses membres, s’ils tuaient la liberté au lieu de la défendre, la nation n’avait-elle pas, par la nature même des choses, le droit impérissable de les appeler devant son tribunal, et de leur faire subir la peine des oppresseurs ou des brigands ? Chez les Celtes nos ancêtres, le peuple se réservait toujours le droit contre le prince. Mais pourquoi cette réserve ? Le droit qu’a toute nation de juger et de condamner ses rois, n’est-il pas une condition nécessairement inhérente à l’acte social qui les plaça sur le trône ? N’est-il pas une conséquence éternelle, inaliénable de la souveraineté nationale ?
Quand un citoyen français arrêta sur les bords de la Seine-Inférieure le cercueil de Guillaume-le-Conquérant, en l’accusant de lui avoir pris son terrain, et ne laissa porter le corps de ce prince dans le lieu de sa sépulture, qu’après qu’on ait eut restitué sa propriété; quand Don Henri, jugé par les États de Castille, subit d’abord en effigie, et ensuite en réalité, la dégradation la plus ignominieuse; quand Jeanne de Naples fut poursuivie criminellement comme meurtrière de son époux; quand les rois français, cités devant des assemblées d’évêques et de seigneurs qui se disaient les représentants de la nation, y étaient déposés et condamnés à avoir les cheveux coupés, et à passer le reste de leur vie dans un couvent; quand don Alphonse et un fils de Gustave Wasa furent déclarés déchus de leur trône, et privés pour jamais de leur liberté, le premier, par les États de Portugal; le second, par les États de Suède; quant Charles Ier perdit la tête sur un échafaud; quand tous ces princes et tant d’autres expièrent leurs crimes par une fin honteuse ou tragique, il n’y avait pas de lois expresses qui eussent spécifié la peine des rois coupables : mais il est de la nature même de la souveraineté nationale de suppléer, s’il le faut, au silence des lois écrites, de déployer l’appareil des supplices attachés à la violation de son premier acte social, ou d’appliquer aux crimes des rois les peines relatives aux crimes des autres citoyens.
Tous les rois de l’Europe ont persuadé à la stupidité des nations qu’ils tiennent leur couronne du ciel. Il les ont accoutumées à les regarder comme des images de la Divinité qui commande aux hommes; à croire que leur personne est inviolable et sacrée, et ne peut être atteinte par aucune loi.
Eh bien ! Si la nation espagnole, par exemple, éclairée par le génie français, se levait enfin, et disait à son roi : « Je ne me donnai originairement des rois que pour être les exécuteurs de mes volontés; ils abusèrent de la puissance que je leur avais confiée; ils devinrent despotes : je vais me ressaisir de ma souveraineté; je la soumis à une constitution qui devait garantir mes droits; tous les ans, dans des assemblées de représentants, j’expliquais mes intentions sur la paix ou la guerre, sur l’impôt, sur toutes les branches d’administration; dans l’intervalle, un magistrat opposait, en mon nom, une barrière perpétuelle à l’extension de l’autorité royale. Un tyran renversa toutes mes lois conservatrices : je voulus les rétablir; mais je fus écrasée par la puissance extérieure de Charles-Quint. Après l’extinction de sa race en Espagne, j’aurais pu recouvrer ma liberté; mais les forces redoutables de deux maisons rivales ne me laissèrent que le choix d’un nouveau tyran. Enfin, je suis libre. Vient devant mon tribunal; viens y rendre compte de toutes les actions royales ». Citoyens, croyez-vous que l’impunité dont Charles IV a joui jusqu’à ce jour, fût un titre pour le soustraire a ce tribunal national ?
Si le peuple autrichien, si le peuple hongrois se levait aussi, et disait à François II : « Non content de perpétuer sur moi le despotisme de tes ancêtres, tu es allé attaquer la liberté dans son pays natal. Les Français s’étaient déclarés les amis de tous les peuples, et tu m’as exposé à leur haine, à leur exécration. De peur que la liberté n’arrivât jusqu’à moi, tu as voulu la bannir de la terre entière. Tu as prostitué mes subsistances et mon sang à cet infâme projet. Tu m’as forcé de défendre la cause des tyrans contre la cause des nations. Lâche infracteur des droits de la nation, du droit des gens, des droits éternels des peuples, il ne te reste que la honte des attentats avortés. Mais penses-tu que, réveillé enfin de mon assoupissement, je veuille plus longtemps partager ton infamie ? Il m’importe de me laver de l’opprobre dont tu m’as couvert aux yeux des Français et de toutes les nations; et ce n’est que dans ton sang que je puis le laver ».
Je vous le demande encore, citoyens, croyez-vous que le despotisme de Hongrie eût le droit d’opposer à cette justice nationale le fantôme de son inviolabilité, ou le silence des lois écrites sur les crimes des tyrans?
Mais Louis XVI est-il donc dans une position plus favorable ? Quel est le forfait, quel est l’attentat qu’il n’ait pas commis ou protégé contre les bases de l’institution sociale et contre les propriétés et les personnes ? Lorsque la nation française se réveilla, pour la première fois, en 1789, au lieu de le punir, comme elle le pouvait, comme elle le devait, elle eut la générosité de le maintenir sur le trône; elle voulut le rendre juste à force de bienfaits. Dans le premier ordre des articles constitutionnels, elle déclara la personne du roi inviolable et sacrée.
La constitution était achevée au mois de juin 1791, Louis XVI en avait accepté tous les articles, lorsqu’il partit avec une précipitation et une clandestinité qui annonçaient l’intention de s’aller joindre aux despotes qui déjà menaçaient la liberté en France. Le corps constituant lui demanda compte de sa fuite et de ses projets. Louis XVI répondit par des suppositions démenties par ses écrits; mais par cela même il reconnut que le corps constituant avait le droit de le juger et de le punir.
Il fut en effet question de le juger. Ses partisans alléguèrent, son inviolabilité déjà décrétée; ils épuisèrent tout leur zèle et tous leurs efforts pour prouver que le maintien de cette inviolabilité était nécessaire à celui de la liberté; mais ce motif et cet objet ne se référaient, comme je l’ai déjà rappelé, qu’à la prétendue nécessité de rendre le pouvoir exécutif indépendant du corps législatif; jamais ils ne prétendirent que cette inviolabilité, déjà consacrée, pût être opposée à une assemblée revêtue de tous les pouvoirs de la nation. Ils n’auraient pas même pu se permettre une assertion semblable, sans se mettre en contradiction avec la marche du corps constituant qui avait fait arrêter le roi à Varennes, et qui l’avait suspendu de ses fonctions, qui lui avait ordonné de répondre par écrit sur l’objet de sa fuite, et qui n’aurait eu le droit de prendre aucune de ses mesures s’il n’avait pas jugé que le principe de l’inviolabilité royale devait fléchir devant le tribunal souverain.
Louis XVI accepta de nouveau la constitution en masse; mais cette dernière acceptation était-elle plus franche que ses acceptations partielles, ou n’étaient-elles toutes qu’un jeu pour se maintenir sur le trône, et se ménager le pouvoir de relever le despotisme sur les débris de cette même constitution ? Avez-vous oublié la fameuse protestation du 21 juin ? Il annonçait qu’il n’était pas libre, que toutes ses acceptations jusqu’alors avaient été forcées. C’était donner aux puissances étrangères le signal de venir à son secours. Elles n’arrivaient pas assez tôt. Il voulait se rendre lui-même auprès d’elles pour presser leurs préparatifs et leur marche.
Que fit-il après l’acceptation générale du mois de septembre, pour détruire au dehors l’effet de cette protestation ? Si, au lieu de rappeler, contenir ou déjouer ses frères et les autres émigrés, qui depuis les premiers instants de la révolution mendiaient en son nom la coalition des despotes, il les soudoya avec les bienfaits de la nation, et paralysa toutes les mesures précautionelles du corps législatif; si, au lieu de prévenir ou d’arrêter l’invasion prussienne et autrichienne, il organisa la trahison dans toutes les places limitrophes et intérieures, n’en faudrait-il pas conclure qu’après son acceptation, comme auparavant, il aurait été constamment en guerre avec la nation ? Et il viendrait aujourd’hui opposer à la justice cette constitution par laquelle il n’aurait jamais voulu être lié lui même; cette constitution dont il ne se serait servi que pour faire inonder de sang le territoire français, et préparer l’exécution de ses complots contre la liberté !
Quoi ! Si un tyran avait poignardé ma femme ou mon fils, il n’est pas de constitution qui pût ou me punir de m’être laissé entraîner par ce premier mouvement de l’âme qui m’aurait commandé de répondre aux cris de leur vengeance par la mort de leur assassin, ou m’empêcher d’appeler sur sa tête l’animadversion des lois divines et humaines parce que les droits et les devoirs de la nature sont d’un ordre supérieur à toutes les institutions; et tout un peuple, dont les droits sont également fondés sur les bases sacrées de la nature, n’aurait pas le droit de se venger de la perfidie d’un homme qui, ayant accepté la mission d’exécuter ses lois suprêmes avec le pouvoir nécessaire pour la remplir, en aurait abusé pour se constituer son oppresseur et son meurtrier.
Citoyens, pensez-vous qu’il vous soit permis de vous écarter de ce grand principe de justice naturelle et sociale ? Vos devoirs ne sont-ils pas tracés sur tous les objets qui vous environnent, soit au loin, soit immédiatement ? Ne sont-ils pas tracés sur les cendres encore fumantes de la courageuse cité de Lille, sur les portes de Longwy et de Verdun, marquées du sceau de la trahison et de l’infamie, sur les insultes exercées par une inondation de cannibales qui n’ont pu soutenir un seul instant les regards des soldats de la liberté, mais qui, pendant quelques jours, avaient été forts des perfidies imputées à Louis XVI ? N’avez-vous pas encore sous vos yeux l’empreinte du plomb parricide qui, dans la journée du 10 août, menaçait la nation jusque dans le sanctuaire de ses lois ? N’entendez-vous pas retentir au fond de vos coeurs la voix des citoyens qui périrent devant le château des Tuileries, et les réclamations de tant d’autres nouveaux Décius, qui, en s’immolant pour la patrie, ont emporté dans leur tombeau l’espoir d’être vengés ? N’entendez-vous pas toute la république vous rappeler que c’est là un des premiers objets de votre mission ? Ne voyez-vous pas toutes les nations de l’univers, toutes les générations présentes et futures se presser autour de vous et attendre avec une silencieuse impatience que vous leur appreniez si celui qui fut originairement chargé de faire exécuter les lois, a jamais pu se rendre indépendant de ceux qui firent les lois; si l’inviolabilité royale a le droit d’égorger impunément les citoyens et les sociétés; si un monarque est un dieu dont il faut bénir les coups, ou un homme dont il faut punir les forfaits ?… »
(On applaudit)
« … Louis XVI est jugeable. Il doit être jugé pour les crimes qu’il a commis sur le trône. Mais par qui et comment doit-il être jugé ? Le renverrez-vous devant le tribunal du lieu de son domicile, ou devant celui du lieu où ses crimes ont été commis ? Ceux qui ont proposé ce mode au comité de législation, disaient que Louis XVI ne doit plus jouir d’aucun privilège. Puisque l’inviolabilité constitutionnelle, ajoutent-ils, ne peut pas le mettre à l’abri d’être jugé, pourquoi serait-il distingué des autres citoyens, soit pour le mode de son jugement, soit pour la nature du tribunal ?
On répondit que tous les tribunaux actuellement existants ont été créés par la constitution; que l’effet de l’inviolabilité du roi était de ne pouvoir être jugé par aucune des autorités constituées; que cette inviolabilité ne disparaissait que devant la nation; que la nation seule avait le droit de rechercher Louis XVI pour des crimes constitutionnels, et que par conséquent il faut ou que la Convention nationale prononce elle-même sur ses crimes, ou qu’elle le renvoie à un tribunal formé par la nation entière.
Alors le comité n’a plus balancé qu’entre les deux dernières propositions. Ceux qui ne voulaient pas que la Convention nationale jugeât elle-même Louis XVI, ont présenté un projet qui a été longtemps débattu. Selon ce projet, la Convention nationale exercerait les fonctions de juré d’accusation; elle nommerait six de ses membres, dont deux rempliraient auprès d’elle les fonctions de directeurs de jury, et les quatre autres poursuivraient l’accusation si elle était admise. Louis XVI serait conduit à la barre; les deux directeurs exposeraient en sa présence les chefs d’accusation; analyseraient les pièces, et présenteraient l’acte qui doit en être le résultat. Louis XVI pourrait dire, ou par lui-même, ou par les conseils dont il serait assisté, tout ce qu’il jugerait utile à sa défense. Ensuite l’assemblée admettrait ou rejetterait l’accusation.
Si l’accusation était admise, les quatre membres de la Convention destinés à faire les fonctions de grands procurateurs, poursuivraient l’accusation devant un tribunal et un jury qui seraient formés l’un et l’autre de la manière suivante : Les corps électoraux nommeraient dans chaque département deux citoyens chargés de faire les fonctions de jurés. La liste de cent soixante-six jurés serait présentée à Louis XVI, qui aurait la faculté d’en rejeter quatre-vingt-trois. S’il n’usait pas de cette faculté, la réduction serait opérée par le sort. Le tribunal serait composé de douze jurés tirés au sort parmi les présidents des tribunaux criminels des quatre-vingt-trois départements. Le jury donnerait sa déclaration à la pluralité absolue des suffrages. Le tribunal appliquerait la peine. Il faudrait prévoir le cas du partage. Le comité a rejeté ce projet, et a préféré celui de faire juger Louis XVI par la Convention nationale elle-même.
Mais comment doit-elle le juger ? On a proposé au comité un mode qui tend à porter dans la Convention nationale les diverses formes indiquées par la loi pour le jugement des accusés. D’après ce mode, il faudrait d’abord nommer, par la voie du sort, ceux des députés qui devraient remplir les fonctions de directeurs du jury d’accusation, celles d’accusateurs publics, celles de juges. Ensuite, les autres membres de la Convention seraient placés, par la voie du sort, on dans le jury d’accusation ou dans le jury de jugement. Ce mode n’a d’autre mérite que celui d’éviter à l’accusé de retrouver les mêmes individus exerçant, dans le cours de son procès, deux fonctions différentes.
Mais est-il vrai que la Convention nationale, si elle se détermine à juger elle-même Louis XVI, doive s’assujettir aux formes prescrites par les procès criminels ?
On reproche au parlement d’Angleterre d’avoir violé les formes; mais, à cet égard, l’on ne s’entend pas communément, et il est essentiel de fixer nos idées sur ce procès célèbre. Charles Stuart était inviolable comme Louis XVI; il avait trahi la nation qui l’avait placé sur le trône indépendant de tous les corps établis par la constitution anglaise, il ne pouvait être accusé ni jugé par aucun d’eux; il ne pouvait l’être que par la nation.
Lorsqu’il fut arrêté, la chambre des pairs était toute dans son parti, elle ne voulait que sauver le roi et le despotisme royal. La chambre des communes se saisit de l’exercice de toute l’autorité parlementaire, et sans doute elle en avait le droit dans les circonstances où elle se trouvait. Mais le parlement lui-même n’était qu’un corps constitué. Il ne représentait pas la nation dans la plénitude de sa souveraineté. Il ne la représentait que par la constitution. Il ne pouvait donc ni juger le roi, ni déléguer le droit de le juger. Il devait faire ce qu’a fait en France le corps législatif. Il devait inviter la nation anglaise à former une Convention. Si la chambre des communes avait pris ce parti, c’était la dernière heure de la royauté en Angleterre. Jamais ce célèbre publiciste, qui serait le premier des hommes s’il n’avait prostitué sa plume a l’apologie de la monarchie et de la noblesse, n’aurait eu le prétexte de dire que « ce fut un assez beau spectacle de voir les efforts impuissants des Anglais pour rétablir parmi eux la république, de voir le peuple étonné cherchant la démocratie et ne la trouvant nulle part; de le voir enfin, après bien des mouvements, des chocs et des secousses, forcé de se reposer dans le gouvernement même qu’il avait proscrit ». Malheureusement la chambre des communes était dirigée par le génie de Cromwell, qui, voulant devenir roi sous le nom de Protecteur, aurait trouvé dans une Convention nationale le tombeau de son ambition.
Ce n’est donc pas la violation des formes prescrites en Angleterre pour les jugements criminels, mais c’est le défaut d’un pouvoir national, c’est le protectorat de Cromwel, qui a jeté sur le procès de Charles Stuart cet odieux qu’on trouve retracé dans les écrits les plus philosophiques. Charles Stuart méritait la mort; mais son supplice ne pouvait être ordonné que par la nation ou par un tribunal choisi par elle.
Dans le cours ordinaire de la justice, les formes sont considérées comme la sauvegarde de la fortune, de la liberté, de la vie des citoyens; c’est que le juge qui s’en écarte ou qui les enfreint peut être accusé avec fondement, ou d’ignorer les principes de la justice, ou de vouloir substituer sa volonté et ses passions à la volonté de la loi. Mais le grand appareil des procédures criminelles serait évidemment inutile si la société prononçait elle-même sur les crimes de ses membres; car une société qui fait elle-même ses lois ne peut être soupçonnée, ni d’ignorer les principes de justice par lesquels elle a voulu être régie, ni de vouloir se laisser entraîner par des passions désordonnées envers les membres qui la composent.
Des tribunaux particuliers, distribués sur diverses parties de l’empire, peuvent être mus et conduits par des intérêts locaux, par des motifs singuliers, par des vengeances personnelles. C’est pour prévenir ces inconvénients, autant qu’il est possible, qu’on a distingué, séparé les fonctions qui doivent préparer ou administrer la justice, qu’on a introduit les déclinatoires, les récusations, et toutes ces formes qui circonscrivent les tribunaux dans les cercles qu’il ne leur est pas permis de dépasser.
Mais ces considérations particulières disparaissent devant une société politique : si elle est intéressée à punir ses membres lorsqu’ils sont coupables envers elle, elle l’est plus encore à les trouver tous innocents. Sa gloire, ainsi que sa force, est à les conserver tous, à les environner tous également de son amour, de sa protection, à moins qu’ils s’en soient visiblement rendus indignes, ou qu’ils n’aient provoqué sa vengeance par des actes destructifs de l’intérêt général. Une société qui, en prononçant sur le sort d’un de ses membres, se déterminerait par des motifs non puisés dans l’intérêt de tous, tendrait évidemment à sa destruction, et un corps politique ne peut jamais être supposé vouloir se nuire à lui-même.
Or, la Convention nationale représente entièrement et parfaitement la république française. La nation a donné pour juges à Louis XVI les hommes qu’elle a choisis pour agiter, pour décider ses propres intérêts, les hommes à qui elle a confié son repos, sa gloire et son bonheur, les hommes qu’elle a chargés de fixer ses grandes destinées, celles de tous les citoyens, celles de la France entière.
A moins que Louis XVI ne demande des juges susceptibles d’être corrompus par l’or des cours étrangères, pourrait-il désirer un tribunal qui fût censé moins suspect ou plus impassible ? Prétendre récuser la Convention nationale ou quelqu’un de ses membres, ce serait vouloir récuser toute la nation, ce serait attaquer la société jusque dans ses bases. Qu’importent ici les actions ou les opinions qui ont préparé l’abolition de la monarchie ? Tous les Français partagent votre haine pour la tyrannie, tous abhorrent également la royauté, qui ne diffère du despotisme que par le nom. Mais ce sentiment est étranger à Louis XVI. Vous avez à prononcer sur les crimes d’un roi; mais l’accusé n’est plus roi : il a repris son titre originel, il est homme. S’il fut innocent, qu’il se justifie; s’il fut coupable, son sort doit servir d’exemple aux nations…. »
(On applaudit)
« …Le jugement que vous porterez sur le ci-devant roi doit-il être soumis à la ratification de tous les citoyens réunis en assemblées de communes ou en assemblées primaires ? Cette question a été encore agitée dans votre comité : il croit qu’elle doit être rejetée.
A Rome, les consuls jugeaient toutes les affaires criminelles : lorsqu’il s’agissait d’un crime de lèse-majesté populaire, ou seulement d’un délit qui fût de nature à mériter une peine capitale, la sentence devait être soumise au peuple qui condamnait ou absolvait en dernier ressort.
A Sparte, quand un roi était accusé d’avoir enfreint les lois ou trahi les intérêts de la patrie, il était jugé par un tribunal composé de son collège, du sénat et des éphores, et il avait le droit d’attaquer le jugement par un appel au peuple assemblé.
Mais ni les consuls de Rome, ni les rois, le sénat et les éphores de Sparte, n’étaient revêtus d’une représentation véritablement nationale. Ils étaient si éloignés d’avoir ou de mériter le plein exercice de cette souveraineté populaire, dont la Convention nationale se trouve investie !
D’ailleurs, ce qu’on appelait le peuple romain ou le peuple spartiate n’était que le peuple d’une ville régnant sur toutes les provinces de la république. Or, quelque nombreux que fût ce peuple renfermé dans des murs communs, il lui était possible de se réunir, de discuter, de délibérer, de juger; et c’est ce qui n’est point praticable pour le peuple français.
Mais s’il ne peut pas se réunir, comment voulez-vous lui soumettre un jugement ? Comment pourrait-il prononcer lui-même un jugement ? Le peuple français n’aura pas besoin de se réunir en masse pour accepter ou refuser la constitution que vous lui présenterez. Chaque citoyen en interrogeant son coeur, y trouvera ce qu’il devra répondre. Mais pour prononcer sur la vie d’un homme, il faut avoir sous les yeux les pièces de conviction, il faut entendre l’accusé, s’il réclame le droit naturel de parler lui-même à ses juges; ces deux conditions élémentaires, qui ne pourraient pas être violées sans injustice, sont tellement impossibles à remplir que je me dispense de rappeler une infinité d’autres considérations qui vous forceraient également à rejeter le projet de soumettre votre jugement à la ratification de tous les membre de la république.
Je n’ai rien dit de Marie-Antoinette… »
(On applaudit.)
« … Elle n’est point dans le décret qui a commandé le rapport que je vous fais au nom du comité. Elle ne devait ni ne pouvait y être. D’où lui serait venu le droit de faire confondre sa cause avec celle de Louis XVI ? La tête des femmes qui portaient le nom de reine, en France, a-t-elle jamais été plus inviolable ou plus sacrée que celle de la foule des rebelles ou des conspirateurs ? Quand vous vous occuperez d’elle, vous examinerez s’il y a lieu de la décréter d’accusation, et ce n’est que devant les tribunaux ordinaires que votre décret pourra être envoyé… »
(On applaudit.)
« …Je n’ai pas non plus parlé de Louis-Charles. Cet enfant n’est pas encore coupable. Il n’a pas encore eut le temps de partager les iniquités des Bourbons. Vous avez à balancer ses destinées avec l’intérêt de la république.
Vous aurez à prononcer sur cette grande opinion échappée du coeur de Montesquieu : « Il y a dans les États où l’on fait le plus de cas de la liberté, des lois qui la violent contre un seul … Et j’avoue, ajoute-t-il, que l’usage des peuples les plus libres qui aient jamais été sur la terre me fait croire qu’il y a des cas où il faut mettre pour un moment un voile sur la liberté, comme l’on cache les statues des dieux ».
L’époque n’est peut-être pas éloignée où les précautions des peuples libres seront plus nécessaires. L’ébranlement des trônes qui paraissaient les mieux affermis; l’active et bienfaisante prospérité des armées de la république française; l’électricité politique qui travaille l’humanité entière, tout annonce la chute prochaine des rois et le rétablissement des sociétés sur leurs bases primitives. Alors les tyrans qui pourront échapper à la vengeance des peuples, ou dont la punition exemplaire ne sera plus commandée par l’intérêt du genre humain, pourront tranquillement promener leur opprobre. Alors ces tyrans, et tous ceux qui pourraient être tentés de les imiter, ne seront pas plus à craindre que Denys à Corinthe.
Voici les bases du décret que le comité m’a chargé de vous présenter.
Louis XVI peut être jugé;
Il sera jugé par la Convention nationale;
Trois commissaires pris dans l’assemblée seront chargés de recueillir toutes les pièces, renseignements et preuves relatifs aux délits imputés à Louis XVI;
Les commissaires termineront le rapport énonciatif des délits dont Louis XVI se trouvera prévenu;
Si cet acte est adopté, il sera imprimé, communiqué à Louis XVI et à ses défenseurs, s’il juge à propos d’en choisir;
Les originaux des mêmes pièces, si Louis XVI
en demande la communication, seront portés au Temple, après qu’il en aura été fait, pour rester aux archives, des copies collationnées, et ensuite rapportées aux archives nationales par douze commissaires de l’assemblée qui ne pourront s’en dessaisir ni les perdre de vue;
La Convention nationale fixera le jour auquel Louis XVI comparaîtra devant elle;
Louis XVI, soit par lui soit par ses conseils, présentera sa défense par écrit et signée de lui, ou verbalement;
La Convention nationale portera son jugement par appel nominal.
(Le rapporteur descend de la tribune au milieu des applaudissements unanimes et réitérés de l’assemblée et des spectateurs. On demande l’impression du rapport, l’envoi aux départements et à l’armée).
(…)
Source : « Journal officiel de la Convention Nationale – La Convention Nationale (1792-1793), Procès-verbaux officiels des séances depuis le 21 septembre 1792, Constitution de la grande assemblée révolutionnaire, jusqu’au 21 janvier 1793, exécution du roi Louis XVI, seule édition authentique et inaltérée contenant les portraits des principaux conventionnels et des autres personnages connus de cette sublime époque », auteur non mentionné, Librairie B. Simon & Cie, Paris, sans date, pages 247 à 254.