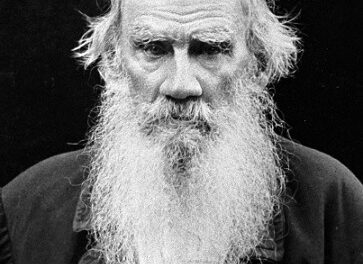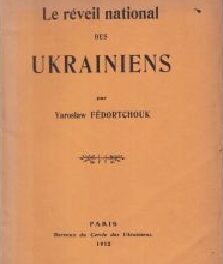Les 3 partages de la Pologne.—>
Les 3 partages de la Pologne.—>
« (…) Je ne connais nulle contrée dont l’abord soit, en hiver, plus mélancolique que celui de la Pologne russe. (…) À droite et à gauche de la route, les villages surgissent, et presque aussitôt disparaissent. Mais quels pauvres villages ! Les maisons, délabrées pour la plupart, sont faites de troncs d’arbres mal dégrossis et posés les uns sur les autres. Les routes ne consistent qu’en deux ornières profondes, pleines d’eau : pas de chaussée : à la moindre pluie, la route est ruisseau ; à la moindre neige, il n’y a plus que la plaine, couverte à l’infini de son linceul blanc ; – rien n’indique le chemin, si ce n’est les poteaux qui, de distance en distance, jalonnent la route.
Les paysans d’ici sont vêtus d’une capote de grossier drap gris, tombant presque jusqu’aux talons : tous ont de grandes bottes montant jusqu’au genou ; les uns sont coiffés du bonnet carré, polonais, les autres d’un grossier chapeau de feutre noir ou brun ; la plupart portent autour des reins, sur leur capote, la ceinture de coton rouge à franges. Les femmes sont aussi très pauvrement habillées (…). Ce qui m’a frappé, tout d’abord, c’est que la tristesse, une tristesse résignée, est l’expression dominante de leur physionomie, la fatigue extrême, une sorte d’hébètement, de stupidité, qui semble s’imprimer de bonne heure sur leurs traits, me font peine à voir. Malgré moi, je songe au terrible portrait que La Bruyère a tracé des paysans de son temps (…). Quel de nos paysans, je dis le plus misérable, se reconnaîtrait aujourd’hui dans ce portrait ? (…) » [pp. 7-9]
« (…) Quand un étranger arrive ici, il doit, avant toute chose, déposer son passeport au commissariat de police ; on lui délivre une carte de séjour qui est comme une permission d’habiter la ville. Ce petit papier est imprimé en quatre langues, fourmille de fautes, coûte trente kopecks et est valable pour trois mois. Si, au bout de ce temps, on oublie de le renouveler, amende.
La police russe, dit-on, sait tout. Sans doute, on exagère un peu, mais il est certain qu’elle doit savoir beaucoup, car elle a de bons moyens de se renseigner. Il y a, sous la porte cochère de chaque maison, une liste portant le nom, le prénom et la profession de tous les locataires, ainsi que le numéro de leur logement. Si quelqu’un change de logis, l’administrateur de la maison, – chaque maison a le sien, qui est responsable, – en informe la police, et le nouveau propriétaire délivre un billet qui doit être visé à l’ancienne résidence, puis rapporté à la nouvelle, où il demeure entre les mains du commissaire de quartier jusqu’à changement nouveau. Ce billet porte le signalement de l’individu, la date de son entrée et de sa sortie, comme ferait un billet d’écrou. De la sorte, on peut toujours savoir, à un jour près, ce qu’a fait tel ou tel individu et où il a été : les billets se suivent, s’enchaînent, le dernier renvoyant au précédent et ainsi de suite. (…)
Le double de toutes ces cartes est envoyé par les divers commissariats à l’adressnü stol (bureau des adresses) : c’est une subdivision du bureau central de la police. Moyennant trois kopecks, dans cette ville de quatre cent mille habitants [Varsovie], le bureau vous donne immédiatement l’adresse qui vous est nécessaire, ou, si votre homme est parti, on vous donne la date de son départ et le lieu où il a déclaré aller. Bref, en tout et pour tout, la police est maîtresse et le fait bien voir. (…) » [pp. 19-20]
« (…) Ce soir, en tournant le coin de ma rue pour rentrer chez moi vers six heures, je me suis trouvé en face d’une grande foule qui m’a barré le chemin au point que j’ai dû me réfugier sous une porte cochère pour n’être point entraîné. C’était un troupeau de paysans, mâles et femelles, marchant la plupart pieds nus, portant de lourds paquets de hardes, plus semblables à des bêtes qu’à des hommes, tant la fatigue tirait leurs traits, tant la poussière du chemin avait noirci leurs visages. Le premier, sorte de guide, portait une croix, d’autres des châsses, des bannières, des cierges. Tous chantaient, ou plutôt hurlaient d’une voix affreusement enrouée. Ils marchaient en désordre, refoulant tout ce qu’ils trouvaient devant eux. C’était vraiment pitié de les voir.
Ce sont des pauvres campagnards de contrées éloignées qui reviennent d’un pèlerinage. Ils ont déjà fait à pied une cinquantaine de lieues, en ont encore autant à faire pour regagner leurs village. À cause du choléra, il en est mort une centaine en route… n’importe ! ceux qui restent marchent toujours. (…) Les uns ont fait le voeu d’aller pieds nus, et ils vont pieds nus ; d’autres ont fait voeu de ne vivre que d’aumônes et ils ne vivent que d’aumônes. Nous sommes, Dieu merci ! plus avancés que cela : en France, on va à Lourdes par partie de plaisir, – dans certaines provinces, on y va même par procuration : c’est le progrès. (…) » [pp. 23-24]
« (…) Après le souper, nous avons causé un instant. Je me suis trouvé à côté du comte Z., polonais presque français, car il a longtemps habité Paris et manie fort bien notre langue. Je l’ai prié de me renseigner sur l’abolition du servage, dont j’ai entendu parler beaucoup et très diversement depuis que je suis ici.
« C’est une chose, m’a-t-il dit, qu’il est difficile que je vous explique. Vos sentiments français se révolteront quand je vous aurai dit que je n’approuve pas cette mesure, et vous refuserez sans doute de me croire si j’ajoute que nos paysans s’en sont jusqu’ici fort mal trouvés. – Que vous soyez pour le maintien du servage, ai-je répondu franchement, cela ne m’étonne guère, car vous y perdez trop ; mais pour les paysans… – Justement. La plupart des paysans se plaignent plus encore que nous autres nobles. Vous imaginez-vous par hazard [sic] qu’il suffise d’un oukase impérial pour affranchir de fait des millions d’hommes qui n’ont jamais connu d’autre condition que le servage ? La question est plus compliquée qu’il ne paraît. Comprenez bien ; les paysans autrefois n’avaient pas un pouce de terre : le seigneur était seul possesseur du sol : il donnait des champs à ferme à ses serfs : ceux-ci ne pouvant payer en argent, payaient en journée de travail, en corvées : ils vivaient ainsi, eux et leurs familles, vendaient encore du superflu, et les corvées servaient à cultiver le bien du seigneur. Il arrivait dès lors assez fréquemment qu’un paysan devenait riche : c’était, par exemple, lorsqu’il avait une nombreuse famille. Il s’engageait à payer, par semaine, quinze, vingt jours de corvée qu’il faisait faire par ses enfants ou ses domestiques, et il prenait un fermage proportionnel. Aujourd’hui, il n’y a plus de corvée ; le paysan a des terres qu’on lui a données. Il est tout aussi attaché à la glèbe, non plus certes par force, mais par la nécessité de vivre, car où aller ? Autrefois, le seigneur (…) faisait soigner le serf malade, empêchait la veuve et les orphelins de mourir de faim, donnait du blé en temps de disette, du bétail en temps d’épizootie. Aujourd’hui, les paysans sont libres, mais c’est à leurs risques et périls : ils n’ont ni moins de travail, ni moins de privations à endurer, et ils ont en plus un terrible souci, celui de vivre, de faire vivre leurs femmes et leurs enfants.
– Sans doute. J’entends bien vos raisons. Vos serfs étaient non-seulement indignes, mais encore incapables de la liberté. (…) Cependant, je ne suis pas tout à fait convaincu. Vous m’avez fait le portrait du seigneur exemplaire, père plutôt que seigneur : parlez-moi donc un peu maintenant de celui dont les paysans disaient : « Il nous prend tout, jusqu’à nos femmes et nos filles : notre âme même est à lui » ; de celui qui appelait ses paysans fils de chiens (psiakreff) et les traitaient comme tels… Non : si pénible que soit aujourd’hui la condition des paysans, je crois qu’elle l’est moins qu’autrefois : si la génération actuelle n’a pas vu mûrir tous les fruits de l’oukase impérial, c’est que l’apprentissage de la liberté est long et pénible. (…) – Je vous le disais bien, a réparti le comte Z. en souriant, que ne vous ne sauriez avoir là-dessus que des idées françaises. (…) » [pp. 45-47]
« (…)Lorsque le tsar affranchit tous les serfs, toute l’Europe applaudit par un sentiment d’humanité facile à comprendre (…). Les paysans, au contraire, ne comprirent pas d’abord ce qu’on leur voulait, ce qu’on leur donnait. Quelques-uns crurent bonnement que liberté était synonyme d’égalité : le lendemain de l’émancipation, ils allaient chez leurs anciens seigneurs, leur faire visite d’égal à égal : ils entraient, gardant leur bonnet sur la tête, prenaient des cigarettes sur la table sans plus de façon. (…) En d’autres contrées, principalement sur les bords de la Volga, les paysans refusèrent d’obéir à l’oukase impérial, refusèrent de devenir libres, se soulevèrent pour conserver l’antique servitude : il fallut envoyer des troupes qui reçurent l’ordre de faire feu, et, en effet, firent feu sur ces mutins, dont certain nombre furent à jamais délivrés par ce moyen : on ne put les faire libres qu’à ce prix. (…) » [pp. 102-103]
« (…) L’inflexible hiérarchie russe qui sépare si profondément les hommes durant leur vie, les sépare aussi dans la mort. Ce n’est pas la même terre qui reçoit le cadavre du général et celui du moujik. Les cimetières orthodoxes sont en effet divisés en trois parties bien distinctes. La première est réservée aux grandes personnes, aux officiers supérieures ; la seconde [sic] aux gentilshommes et aux officiers de tout grade ; le troisième aux soldats, paysans et autre menue plèbe. Quelle catastrophe si on enterrait un jour un général à côté d’un porteur d’eau ! (…) » [pp. 55-56]
« (…) J’ai croisé hier un enterrement catholique sortant de l’hôpital : le convoi des pauvres. Cela m’a paru ignoble, non pas même triste. Le corbillard d’en allait tout seul au milieu de la rue ; le porte-croix et le prêtre, barrette en tête, son chapeau d’une main, son parapluie de l’autre, marchaient sur le trottoir. Derrière eux, le chantre, vêtu d’un pardessus déchiré, coiffé d’une casquette, braillait à tue-tête. On aurait dit une chanson à boire. Je ne vis jamais rien de si ennuyé que ce prêtre. (…) » [pp. 63-64]
« (…) Décidément Karolowa (c’est le nom de ma servante), nourrit une rude haine contre les Juifs ; haine religieuse, la pire de toutes. Elle les accuse invariablement de tous les malheurs qui surviennent, et principalement de sa ruine ; car elle a tenu autrefois un petit commerce de farine. (…) Cependant, elle est très pieuse, pousse à l’extrême scrupule l’accomplissement de ses devoirs religieux : elle est très honnête, très bonne même, hormis ce défaut (…).
De nos jours, grâce à Dieu, en France, un Juif est tenu pour Français, soumis en tout, d’ailleurs, aux lois du pays, et nous ne mesurons guère notre estime pour lui qu’à son honnêteté. En Pologne, un Juif n’est pas un Polonais, il est un Juif, et comme tel, a priori méprisé, haï. (…) » [pp. 87-88]
Extraits de Norbert DELACROIX, Carnet de voyage d’un Franc-comtois. Notes sur la Pologne [1877-1878]. Lons-le-Saunier, Imprimerie Declume Frères, 1884, 122 p.