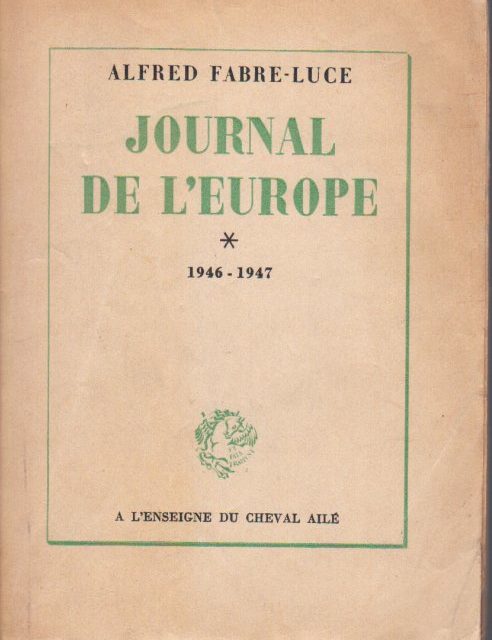Alfred Fabre-Luce (1899-1983) passa pour un esprit libre et indépendant. On le connait également pour sa parenté par alliance avec Valéry Giscard d’Estaing, dont il raconte la soirée électorale de 1974 au Cercle interallié dans Les Cent Premiers jours de Giscard (Laffont, 1975). Libéral, il semble avoir été inquiété en 1943 pour un ouvrage intitulé Journal de La France, lequel lui amena aussi des ennuis à la libération. Très critique vis-à-vis de la Résistance et d’une épuration dont il tend à exagérer l’ampleur, il attend en 1947 la Troisième Guerre mondiale, plaide pour l’Europe supranationale (après avoir moqué et écarté en deux lignes le plan Monnet dont il laisse entendre qu’on ne parlera plus guère) et se persuade que de Gaulle, qu’il voit avant tout comme un diviseur, est décidé un jour à reprendre le pouvoir, sans en avoir l’envergure. C’est ce qu’il raconte dans un ouvrage publié en 1947 chez un éditeur suisse par ailleurs connu pour son ouverture aux anciens de Vichy.
Que son but final soit l’exercice total du pouvoir, c’est lui-même qui nous en assure, dans un livre aussi utile pour la compréhension de son action politique que Mein Kampf l’est pour celle de Hitler. Relisons donc Le Fil de l’Épée. Nous y trouverons, à la base même de la pensée gaulliste, la croyance au « Chef et l’idée que ce « Chef » doit s’imposer par des moyens plus mystiques que rationnels. « Les hommes, écrit l’auteur, ne se passent point, au fond, d’être dirigés, non plus que de manger, boire et dormir. Ces animaux politiques ont besoin d’organisation, c’est-à-dire d’ordre et de chefs ». Il imagine « un artiste de l’effort », qui « ne voit à la vie d’autre raison que d’imprimer sa marque aux événements et qui, de la rive où le fixent les jours ordinaires, ne rêve qu’à la houle de l’Histoire ». (Cet artiste, on le reconnaît en juin 1946 à Bayeux, où Gaulle commence sa croisade de libération intérieure dans le décor même de la première Libération ; en mars 1947, à Bruneval, où tandis qu’il annonce du haut d’une falaise le « rassemblement du peuple français », sa haute silhouette se découpe, entourée de drapeaux, sur la mer). Voici la recette du magicien : « Le prestige ne peut aller sans mystère, car on ne révère pas ce que lion connaît trop bien » (c’est pourquoi le Général a connu son plus grand prestige à Londres pendant la guerre. En 1947, le rôle de candidat en tournée lui convient moins bien : il manque de bonhomie et son grand corps l’encombre). Il faut adopter « un système de ne point se livrer, un parti-pris de garder par devers soi quelque secret de surprise qui risque à toute heure d’intervenir » (dans son interview du 24 avril 1947, l’ex-Président du Gouvernement ne fera que reprendre cette rêverie du jeune officier).
Charles de Gaulle se situe dans cette grande lignée de pessimistes, de machiavélistes, d’admirateurs de la Force, où se recrutent généralement les « Chefs ». « Sans la Force, écrit-il, pourrait-on concevoir la vie ? Recours à la pensée, instrument de l’action, condition du mouvement, il faut cette accoucheuse pour tirer au jour le progrès ». C’est l’accent de Mussolini, de Georges Sorel, de René Quinton.
Ne soyons pas effarouchés ? La politique est, en effet, la partie que jouent entre eux de froids ambitieux (seuls les niais se laissent prendre aux assurances pacifiques d’un Hitler, à la dissolution du Komintern par Staline, à la démission de Charles de Gaulle) […]
Quand André Malraux, au nom du Général de Gaulle, réclame en réunion publique des élections syndicales « libres », il récuse implicitement les votes à mains levées des premiers jours de la Libération, il s’élève contre un certain terrorisme de la Résistance. Pourquoi laisserions-nous le Général maintenir ce terrorisme à son profit ?
Il y a pourtant en France une autre forme d’autorité concevable : celle du père de famille qui essaie de réconcilier ses enfants et de leur conserver les bienfaits de la Paix. Mais elle ne pourrait, semble-t-il, être exercée que par l’héritier d’une tradition monarchique incontestée ou par un grand citoyen étranger aux luttes de la politique (c’était la position de Pétain en 1940.) L’homme qui prétend se hisser au pouvoir à force de propagande est obligé d’exploiter des passions. Le courant qui le porte crée automatiquement un contre-courant. Il ne peut donc être qu’un diviseur. Gaulle oppose à la fois Vichy et la Résistance, et, à l’intérieur de celle-ci, une Droite et une Gauche. Il ne semble pas que, dans la meilleure des hypothèses, il puisse égaler la réussite parlementaire de Pétain, qui eut pour lui, non seulement les modérés et les radicaux, mais la majorité du parti socialiste, alors à son apogée. Aujourd’hui, la seule existence d’un groupe communiste formant le tiers de l’assemblée suffit à exclure cette quasi-unanimité. Le Général doit donc chercher sa majorité nettement à droite. C’est pourquoi, dès maintenant, son nom signifie : Réaction. Les précautions qu’il prend pour empêcher l’adhésion compromettante au R. P. F. des anciens membres des Ligues fascistes montrent bien qu’il considère lui-même son projet comme propre à leur plaire. S’il écarte ces hommes, il accueille du moins leurs frères ou leurs cousins (la France ne saurait renouveler sa population à chaque revirement de la mode politique : aussi les gaullistes, dès que leur nombre s’accroit, sont-ils nécessairement d’anciens maréchalistes). Ces fascistes avaient seulement méconnu que le hitlérisme français ne pouvait être qu’anti-hitlérien. Avec ce correctif, leur idéal peut encore se réaliser. On ne saurait, pensent-ils, vaincre les communistes qu’en se situant sur le même plan qu’eux : celui de la force et de la ruse. Effectivement, les communistes, croyant reconnaître des adversaires à leur taille, leur témoignent un certain respect. De part et d’autre on se prépare à la guerre civile.
Le Général de Gaulle réussira-t-il tout de même un jour à devenir le personnage national qu’il prétend être ? C’est la question que se posent aujourd’hui, dans tous les partis, de bons Français. Rien ne les assure encore qu’il soit capable de cette métamorphose. Quand il s’essaie au rôle d’Henri IV, c’est en gardant un air napoléonien. Quand il affecte de parler « entre résistants » à ses auditeurs, on croit entendre une menace voilée : « Si tu ne dis pas que tu as été un matamore, je te ferai déclarer indigne ». Quand il évoque ses compagnons, on aperçoit, étrangement mêlée aux héros, une tourbe de profiteurs administratifs – promotion d’incompétents qui attend de lui la confirmation de ses pouvoirs. Quand il préconise la réconciliation européenne, de terribles souvenirs se lèvent. Ne ferait-il pas mieux de passer la main en disant, comme Clemenceau au Sénat, en 1919 : « L’Allemagne est un grand peuple. Il faudra vous entendre avec lui. Moi je l’ai trop haï… » Telle n’est pas, disent les gaullistes, la position du problème. L’homme du 18 juin est seul capable d’enterrer entre les deux pays la hache de la guerre, comme Poincaré en 1926, parce qu’il avait revalorisé le franc et occupé la Ruhr, était seul capable de dévaluer et de couvrir la politique de Locarno… Cette loi d’ironie n’est pas infaillible. Aussi beaucoup refusent-ils encore de se laisser hypnotiser par un nom répété, par une légende en grande partie mensongère. Invités à choisir entre de Gaulle et Thorez, ils espèrent plutôt que ces adversaires s’useront l’un contre l’autre et que la France appellera pour la diriger un arbitre au lieu d’un partisan. Mais après tout, soit par l’échec d’un ambitieux, soit par le reniement que lui-même apportera de ses erreurs, l’heure de la Justice approche. Et puis, dans l’état de déchéance du pays, les querelles de personnes ont perdu une part de leur importance. Ce qui compte, c’est, à travers tel ou tel agent, la lente formation de l’Europe. Une autorité supranationale, voilà le dictateur qu’il faut élever au-dessus de nos chefs de clan, au lieu de le chercher parmi eux.
Alfred Fabre-Luce, Le journal de l’Europe (1946-1947), Genève,
Le Cheval ailé, 1947, p. 140-142 ; 145-148.