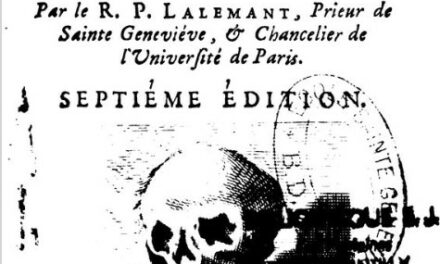En avril 1975, les Khmers rouges s’emparent de Phnom-Penh, la capitale du Cambodge. La population est immédiatement déportée dans les campagnes. Commence alors un véritable génocide au Cambodge qui ne finira qu’avec l’invasion vietnamienne du début de l’année 1979.
Le bilan imprécis du génocide au Cambodge est de 400.000 à 900.000 exécutions sommaires et de 700.000 à 1.200.000 morts par privations et mauvais traitements, soit de 1 à 2 millions de morts pour une population de 7 millions d’habitants. (cf. L’Histoire No 247, octobre 2000)
Comparatisme entre génocides
« Au sein des débats sur le comparatisme entre les génocides, il est peut-être important de s’appuyer aussi sur ces comparaisons effectives pour en tirer des leçons. Ce que le droit international a finalement qualifié de génocide est visiblement l’une des formes privilégiées de la politique au XXe siècle. On pose la triple question de son rapport au passé, de sa nature et de son avenir. Par rapport à tous les massacres de l’histoire, la forme-extermination semble bien posséder une originalité, même si elle puise dans un arsenal parfois ancien de formes de détestation (cas de l’antijudaïsme). Violence d’Etat poussée à l’extrême, elle échappe à la logique de la guerre et de la prédation, se dirige préférentiellement vers sa propre population, et trouve en fin de compte sa clef dans une perspective d’autopurification, de reniement de ses propres conditions de possibilités en vue de la formation d’un peuple authentique, qui peut aller jusqu’à l’extermination de soi-même. La finalité n’est donc plus à chercher seulement du côté de l’élimination de la victime mais aussi du côté d’une crise radicale de la constitution identitaire. Le nazisme est l’exemple le plus massif, mais les génocides cambodgiens et rwandais sont les cas les plus purs. On peut penser que les Etats industrialisés ont tourné cette page, trop coûteuse, mais qu’ils la laissent en héritage à des entités (pas forcément des Etats) dominées, dont les identités ont peu à peu volé en éclat sous la pression de décennies de colonisation puis de mondialisation. Il était difficile de prévoir, mais aurait pu supputer, que les peuples dominés ne se contenteraient pas d’appliquer cette logique à eux-mêmes, faisant des femmes par exemple la part exterminable à merci, mais qu’ils la retourneraient contre leurs « maîtres » (aux deux sens du terme, ceux qui les dominent et ceux qui leur ont tout appris), en aspirant à les égaler dans l’horreur ».
Bertrand Ogilvie, L’homme jetable. Essai sur l’exterminisme et la violence extrême, Ed. Amsterdam, Paris, 2012, pp.124-125.
La folie khmère rouge
« (…) On nous a dit qu’il fallait réaliser notre autosuffisance pour la nourriture, et nous plantons autant de manioc que nous le pouvons. Mais nous commençons à manquer de nourriture. Les enfants ont faim. Souvent, devant leur mine triste, je ne sais comment leur expliquer que, du jour au lendemain, nos conditions de vie ont été bouleversées. Comment leur faire comprendre que les privilèges d’autrefois – la nourriture en était un – n’existent plus ? Cependant, en comparaison de ce qui se passera plus tard, les chefs khmers rouges ne sont pas trop durs avec nous jusqu’à la saison des moissons. Il n’y aura pas encore vraiment de famine d’ici la fin de 1975, moment où Angkar volera toute notre récolte – d’abord il y aura seulement la disette. (…)
Les rations de riz baissent toujours ; nos provisions cachées dans des tissus qui nous servent de matelas sont progressivement grignotées. Les autres familles font du troc avec les paysans de base. Nous nous débrouillons au cours de ces premiers mois, d’autant plus que la surveillance n’est pas encore trop étroite. Ce ne sera qu’à partir de 1976 que la faim poussera les hommes aux pires abominations. Certains, épuisés par le dur labeur de la journée, mangeront l’assiette destinée à leurs enfants. Les cris, la colère, les sanglots déchireront les familles et nul ne sera épargné. L’ami de toujours deviendra brusquement l’ennemi ; quant aux époux, il leur arrivera de dénoncer leur conjoint en public. (…) »
Henri LOCARD, M’UNG Sonn, Prisonnier de l’Angkar. Paris, Fayard, 1993, 382 p.
« Pendant la première moitié de 1978, on vit affluer des milliers de gens de Svay Rieng à Thanak Run. (…) C’étaient surtout des paysans mais il y avait aussi des évacués de Phnom Penh de 1975. (…) Les khmers rouges nous dirent que ces gens étaient tous « nos ennemis ». « Ne leur faites pas confiance », répétaient-ils. Au cours des mois suivants, 50 à 80 pour cent de ces gens, surtout les enfants, moururent ou furent tués. Je fus témoin d’un grand nombre de ces tueries. (…)
Au début ils emmenaient juste les maris « pour aider au démarrage d’une autre coopérative ». Mais les maris ne revenaient jamais, et au bout de deux ou trois mois les khmers rouges venaient chercher le reste de la famille et les emmenaient. On leur disait de préparer leurs affaires pour aller rejoindre leurs maris et pères. Cinquante à cent personnes se mettaient en route à 10 heures du soir, accompagnées par quatre ou cinq miliciens et deux ou trois charrettes. Ils chargeaient toutes les affaires dans les charrettes. Mais les charrettes ne les suivaient pas. Elles allaient droit à la réserve du chef de district. Les gens étaient massacrés à coups de gourdin. (… )
Les Khmers rouges demandent aussi à des évacués de 1975 de tuer des gens de Svay Rieng. C’étaient des jeunes de vingt à trente ans qui ne voulaient pas mais qui risquaient la mort s’ils n’exécutaient pas les ordres des Khmers rouges. À leur retour, ils me racontèrent ce qui s’était passé. On donna des pioches à dix évacués de 1975 et on leur dit de tuer cent personnes de Svay Rieng à qui on avait ordonné d’ôter leurs vêtements. Ils devaient les frapper à la nuque. (…) Ils tuèrent même les jeunes enfants d’un seul coup de pioche. (…) »
Témoignage de Lan recueilli à Créteil le 18 novembre 1979.



![Image illustrant l'article Amiens_capitale_provinciale___étude_[...]Deyon_Pierre_bpt6k3366710m de Clio Texte](https://clio-texte.clionautes.org/wp-content/uploads/cliotexte/2023/08/amiens-capitale-provinciale---etude--deyon-pierre-bpt6k3366710m-440x264.jpeg)