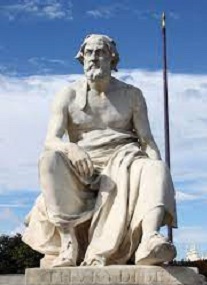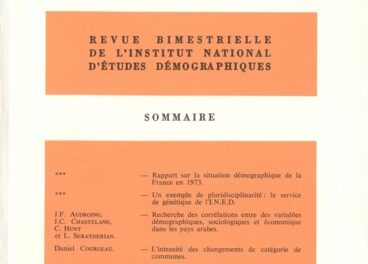Avec son contemporain Hérodote, Thucydide est considéré à juste titre comme le premier véritable historien de l’Antiquité. L’histoire de la Guerre du Péloponnèse, rédigée à la fin du Vème siècle avant J.C, est un jalon essentiel dans la constitution de l’Histoire en tant que discipline visant à la connaissance rationnelle du passé.
Au début du livre II, Thucydide nous offre un récit de la peste d’Athènes qui a ravagé la population athénienne à partir de l’été 430, pendant la deuxième année de la guerre du Peloponnèse ; c’est celle dont Périclès a été la victime la plus célèbre. Il faut entendre ici le mot peste comme un terme générique désignant une épidémie dont l’origine est obscure, qui s’abat subitement sur une population et qui fauche à l’aveuglette des milliers de vies. Selon les symptômes décrits par Thucydide, les épidémiologistes actuels penchent pour une épidémie de typhus mais le doute subsiste sur sa nature véritable.
Le récit de Thucydide présente un grand intérêt historique car il s’agit d’une part du témoignage d’un « homme qui a été lui-même atteint et qui a vu souffrir d’autres personnes ». Mais surtout, parce que Thucydide nous a transmis la plus ancienne relation détaillée d’une épidémie meurtrière en Occident. Il s’agit donc en quelque sorte d’un archétype qui a pu inspirer ou servir de modèle à d’autres auteurs. Nous verrons plus loin qu’on peut en effet relever un certain nombre de caractéristiques que l’on retrouve souvent dans les « récits d’épidémies » ultérieurs.
La peste d’Athènes (extraits)
[…] Dès le début de l’été [430 avant J.C], les Péloponnésiens et leurs alliés, avec les deux tiers de leurs troupes, comme la première fois, envahirent l’Attique, sous le commandement d’Arkhidamos, fils de Zeuxidamos, roi de Lacédémone. Ils y campèrent et ravagèrent le pays. Ils n’étaient que depuis quelques jours en Attique, quand la maladie se déclara à Athènes ; elle s’était abattue, dit-on, auparavant en plusieurs endroits, notamment à Lemnos ; mais nulle part on ne se rappelait pareil fléau et des victimes si nombreuses. Les médecins étaient impuissants, car ils ignoraient au début la nature de la maladie ; de plus, en contact plus étroit avec les malades, ils étaient plus particulièrement atteints. Toute science humaine était inefficace ; en vain on multipliait les supplications dans les temples ; en vain on avait recours aux oracles ou à de semblables pratiques ; tout était inutile ; finalement on y renonça, vaincu par le fléau.
Le mal, dit-on, fit son apparition en Éthiopie, au-dessus de l’Égypte : de là il descendit en Égypte et en Libye et se répandit sur la majeure partie des territoires du Roi [pharaon]. Il se déclara subitement à Athènes et, comme il fit au Pirée ses premières victimes, on colporta le bruit que les Péloponnésiens avaient empoisonné les puits ; car au Pirée il n’y avait pas encore de fontaines. Il atteignit ensuite la ville haute et c’est là que la mortalité fut de beaucoup la plus élevée. Que chacun, médecin ou non, se prononce selon ses capacités sur les origines probables de cette épidémie, sur les causes qui ont pu occasionner une pareille perturbation, je me contenterai d’en décrire les caractères et les symptômes capables de faire diagnostiquer le mal au cas où elle se reproduirait. Voilà ce que je me propose, en homme qui a été lui-même atteint et qui a vu souffrir d’autres personnes.
[ Thucydide décrit les symptômes de la maladie].
La maladie, impossible à décrire, sévissait avec une violence qui déconcertait la nature humaine. […]
On mourait, soit faute de soins, soit en dépit des soins qu’on vous prodiguait. Aucun remède, pour ainsi dire, ne se montra d’une efficacité générale ; car cela même qui soulageait l’un, nuisait à l’autre. Aucun tempérament, qu’il fût robuste ou faible, ne résista au mal. Tous étaient indistinctement emportés, quel que fût le régime suivi. Ce qui était le plus terrible, c’était le découragement qui s’emparait de chacun aux premières attaques : immédiatement les malades perdaient tout espoir et, loin de résister, s’abandonnaient entièrement. Ils se contaminaient en se soignant réciproquement et mouraient comme des troupeaux. C’est ce qui fit le plus de victimes. Ceux qui par crainte évitaient tout contact avec les malades périssaient dans l’abandon : plusieurs maisons se vidèrent ainsi faute de secours. Ceux qui approchaient les malades périssaient également, surtout ceux qui se piquaient de courage : mus par le sentiment de l’honneur, ils négligeaient toute précaution, allaient soigner leurs amis ; car, à la fin, les gens de la maison eux-mêmes se lassaient, vaincus par l’excès du mal, d’entendre les gémissements des moribonds. C’étaient ceux qui avaient échappé à la maladie qui se montraient les plus compatissants pour les mourants et les malades, car connaissant déjà le mal, ils étaient en sécurité. En effet les rechutes n’étaient pas mortelles. Enviés par tes autres, dans l’excès de leur bonne fortune présente, ils se laissaient bercer par l’espoir d’échapper à l’avenir à toute maladie.
Ce qui aggrava le fléau, ce fut l’affluence des gens de la campagne dans la ville : ces réfugiés étaient particulièrement touchés. Comme ils n’avaient pas de maisons et qu’au fort de l’été ils vivaient dans des baraques où on étouffait, ils rendaient l’âme au milieu d’une affreuse confusion ; ils mouraient pêle-mêle et les cadavres s’entassaient les uns sur les autres ; on les voyait, moribonds, se rouler au milieu des rues et autour de toutes les fontaines pour s’y désaltérer. Les lieux sacrés où ils campaient étaient pleins de cadavres qu’on n’enlevait pas. La violence du mal était telle qu’on ne savait plus que devenir et que t’on perdait tout respect de ce qui est divin et respectable. Toutes les coutumes auparavant en vigueur pour les sépultures furent bouleversées. On inhumait comme on pouvait. Beaucoup avaient recours à d’inconvenantes sépultures, aussi bien manquait-on des objets nécessaires, depuis qu’on avait perdu tant de monde. Les uns déposaient leurs morts sur des bûchers qui ne leur appartenaient pas, devançant ceux qui les avaient construits et y mettaient le feu ; d’autres sur un bûcher déjà allumé, jetaient leurs morts par-dessus les autres cadavres et s’enfuyaient. La maladie déclencha également dans la ville d’autres désordres plus graves. Chacun se livra à la poursuite du plaisir avec une audace qu’il cachait auparavant. Á la vue de ces brusques changements, des riches qui mouraient subitement et des pauvres qui s’enrichissaient tout à coup des biens des morts, on chercha les profits et les jouissances rapides, puisque la vie et les richesses étaient également éphémères. Nul ne montrait d’empressement à atteindre avec quelque peine un but honnête ; car on ne savait pas si on vivrait assez pour y parvenir. Le plaisir et les moyens pour l’atteindre, voilà ce qu’on jugeait beau et utile. Nul n’était retenu ni par la crainte des dieux, ni par les lois humaines ; on ne faisait pas plus de cas de la piété que de l’impiété, depuis que l’on voyait tout le monde périr indistinctement ; de plus, on ne pensait pas vivre assez longtemps pour avoir à rendre compte de ses fautes. Ce qui importait bien davantage, c’était l’arrêt déjà rendu et menaçant ; avant de le subir mieux valait tirer de la vie quelque jouissance.
Tels furent les maux dont les Athéniens furent accablés : à l’intérieur les morts, au dehors la dévastation des campagnes. […]
Thucydide, Histoire de la guerre du Péloponnèse, livre II, extraits
Commentaires
Considérant que le texte de Thucydide est un archétype de récit historique relatant une épidémie meurtrière, il nous a semblé qu’une analyse permettant d’en dégager les caractéristiques majeures pouvait être utile, dans la perspective d’une démarche comparative avec d’autres récits du même genre concernant d’autres épidémies, à d’autres époques.
- Origines et causes du mal
- S’interrogeant sur l’origine du fléau qui s’abat sur Athènes, Thucydide évoque un mal venu d’ailleurs, en l’occurrence du sud de la Méditerranée, principalement d’Égypte et de Lybie avant de remonter ensuite vers la Grèce. Il suggère donc une circulation de l’épidémie liée probablement à la navigation sur la Méditerranée, mais cette hypothèse n’est à aucun moment exprimée par l’auteur.
- Il mentionne également une cause humaine sur laquelle il ne s’attarde guère et à laquelle il ne semble pas croire : » le bruit que les Péloponnésiens avaient empoisonné les puits ». La recherche de coupables, de boucs émissaires pour expliquer l’incompréhensible est un trait qu’on retrouve dans la plupart des épidémies et dont on pourrait donner de multiples exemples, la peste noire de 1348 ou bien l’épidémie de choléra de 1832 à Paris ; le thème de l’empoisonnement de l’eau étant lui aussi un élément récurrent qui a traversé les âges pour devenir une des thématiques de l’antijudaïsme au Moyen-Age. De nos jours, le thème de l’empoisonnement, qui ne concerne plus l’eau mais la vaccination, est au cœur de certaines théories du complot.
- En revanche, Thucydide, fidèle à sa démarche rationaliste, écarte les causes surnaturelles et religieuses. Et c’est la principale différence avec les récits d’épidémies ultérieurs écrits par des auteurs chrétiens, prompts à évoquer la colère et le châtiment divins pour expliquer le fléau qui s’abat sur l’humanité pécheresse.
- Enfin, suivant sa démarche d’historien, Thucydide replace l’épidémie dans le contexte de la Guerre du Péloponnèse, considérant que « ce qui aggrava le fléau, ce fut l’affluence des gens de la campagne dans la ville », c’est à dire les paysans de l’Attique contraints de se réfugier pendant l’été à l’intérieur des hauts murs. L’affaiblissement des corps lié à la guerre et la surpopulation ont sans nul doute été des facteurs décisifs de l’aggravation de l’épidémie.
2. L’impuissance et le désespoir face à la violence du mal
Thucydide insiste sur des caractères qu’on retrouve dans la plupart des récits d’épidémies postérieurs :
- La soudaineté, la nouveauté et la violence du mal qui s’abat sur la communauté, un mal qui semble frapper au hasard, les faibles comme les forts. C’est ce qui provoque le désespoir, la panique ou le découragement.
- L’impuissance face à la maladie : impuissance des médecins, des dieux même auxquels on finit par renoncer à demander la protection.
- La présence visible, envahissante de la mort et des morts dans l’espace public, espace en principe organisé pour la vie collective : « moribonds […] au milieu des rues, […] lieux sacrés […] pleins de cadavres ».
- Enfin, un fléau qui remet en cause l’ordre et le fonctionnement traditionnel de la société.
3. Un bouleversement brutal de l’ordre du monde : la dimension morale du récit de Thucydide.
La dernière partie du récit de Thucydide, qui est aussi la plus longue, s’attache à décrire le bouleversement de l’ordre traditionnel engendré par l’irruption brutale de la mort à l’intérieur des murs d’Athènes. Cette dimension philosophique et morale est un aspect qu’on retrouve fréquemment chez la plupart des auteurs de récit d’épidémies. Chez certains auteurs , l’historien s’efface au profit du moraliste, ce qui n’est pas le cas chez Thucydide.
L’analyse morale de Thucydide est globalement pessimiste. Confronté au fléau mortel de la peste, ce qu’on appelle la civilisation se révèle être un vernis fragile. Les hommes oublient les usages les plus courants : le respect des dieux, le respect des morts. Les règles morales élémentaires sont bafouées dans la recherche éperdue de plaisirs éphémères, Éros et Thanatos marchant main dans la main…
Cependant, l’auteur note aussi que certains « se piquaient de courage : mus par le sentiment de l’honneur, ils négligeaient toute précaution, allaient soigner leurs amis ».
Un fléau en quelque sorte qui révèle chez l’Homme le pire et le meilleur… S’agit-il chez Thucydide d’un discours de moraliste ou bien d’un récit d’historien, témoin de son temps? À vous de choisir…