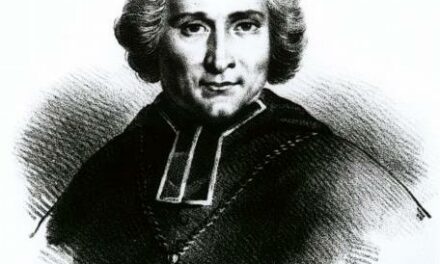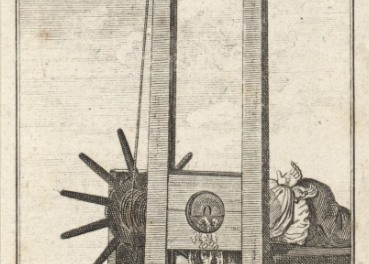Un bilan de la campagne de Russie (juin-décembre 1812)
Au départ : 617 000 hommes, dont 300 000 Français et 1 372 canons
Au retour : 75 000 hommes dont 20 000 Français et 60 canons
Chiffres tirés de LAMBIN (s. d.), Histoire-Géographie, initiation économique, Paris, Hachette, 1992.
Répartition des pertes de la campagne de Russie (juin-décembre 1812)
morts au combat ………..100 000
morts de froid………….200 000
blessés abandonnés……….50 000
prisonniers…………….100 000
déserteurs et disparus……92 000
Chiffres tirés de LAMBIN (s. d.), Histoire-Géographie, initiation économique, Paris, Hachette, 1992.
Un bilan de la Campagne de Russie de 1812
« À son entrée en Russie, en juin 1812, [La Grande Armée] comptait 700’000 hommes ; 30’000 seulement, suivis d’une longue cohorte de traînards, repassèrent le Niémen [fleuve à la frontière de la Russie]. Napoléon laissait derrière lui 400’000 morts et 100’000 prisonniers. »
Article PREMIER EMPIRE, par Jean TULARD, professeur à l’Université de Paris-IV-Sorbonne, in CD-ROM Encyclopaedia Universalis (v. 4), 1998.
Napoléon justifie la guerre de Russie
« Au surplus, a-t-il [Napoléon] dit, à la suite de beaucoup d’antécédents, cette guerre [de Russie] eût dû être la plus populaire des temps modernes : c’était celle du bon sens et des vrais intérêts ; celle du repos et de la sécurité de tous : elle était purement pacifique et conservatrice ; tout à fait européenne et continentale. Son succès allait consacrer une balance, des combinaisons nouvelles qui eussent fait disparaître les périls du temps, pour les remplacer par un avenir tranquille ; et l’ambition n’entrait pour rien dans mes vues. En relevant la Pologne, cette véritable clé de toute la voûte, j’accordais que ce fût un Roi de Prusse, un Archiduc d’Autriche, ou tout autre qui en occupât le trône ; je ne prétendais rien acquérir ; je ne me réservais que la gloire du bien, les bénédictions de l’avenir. Croirait-on que ce dût être là où j’échouerais et trouverais ma perte ? Jamais je n’avais mieux fait, jamais je ne méritais davantage; mais comme si l’opinion avait aussi ses épidémies, voilà qu’en un instant il n’y eut plus qu’un cri, qu’un sentiment contre moi : on me proclama le tyran des Rois , moi qui avais retrempé leur existence ; et je ne fus plus que le destructeur des droits des peuples, moi qui avais tant fait et qui allais tant entreprendre pour eux. Et les peuples et les Rois, ces ennemis irréconciliables, se sont alliés, ont conspiré de concert contre moi ! On n’a plus tenu aucun compte de tous les actes de ma vie ! Je me disais bien que l’esprit des peuples me serait revenu avec la victoire ; mais je la manquai, et je me suis trouvé accablé. Voilà pourtant les hommes et mon histoire ! Mais les peuples et les Rois, et peut-être tous les deux, me regretteront! Et ma mémoire sera suffisamment vengée de l’injustice faite à ma personne, cela est indubitable. »
In Las Cases, Mémorial de Sainte-Hélène, ou journal où se trouve consigné, jour par jour, ce qu’a dit et fait Napoléon durant dix-huit mois, tome septième, Paris, Lebègue, 1823, p. 11-13 sur http ://gallica.bnf.fr/
Napoléon justifie sa défaite en Russie
« J’ai échoué contre les Russes ; de là ils sont inattaquables chez eux, invincibles ; mais pourtant à quoi cela a-t-il tenu ? Qu’on le demande à leurs fortes têtes, à leurs hommes sages et réfléchis ? Qu’on consulte Alexandre [le tsar de Russie] lui-même et ses sentiments d’alors ? Sont-ce les efforts des Russes qui m’ont anéanti ? Non, la chose n’est due qu’à de purs accidents, qu’à de véritables fatalités : c’est une capitale incendiée [Moscou] en dépit de ses habitants, et par des intrigues étrangères ; c’est un hiver , une congélation dont l’apparition subite et l’excès furent une espèce de phénomène ; ce sont de faux rapports, de sottes intrigues, de la trahison, de la bêtise, bien des choses enfin qu’on saura peut-être un jour, et qui pourront atténuer ou justifier les deux fautes grossières, en diplomatie et en guerre, qu’on a le droit de m’adresser : celle de m’être livré à une telle entreprise, en laissant sur mes ailes, devenues bientôt mes derrières, deux cabinets [gouvernements ?] dont je n’étais pas le maître, et deux armées alliées que le moindre échec devait me rendre ennemies. Mais pour tout conclure enfin sur ce point, et même annuler tout ce qui précède d’un seul mot, c’est que cette fameuse guerre, cette audacieuse entreprise, je ne les avais pas voulues ; je n’avais pas eu l’envie de me battre ; Alexandre pas davantage, mais une fois en présence, les circonstances nous poussèrent l’un sur l’autre ; la fatalité fit le reste. »
In Las Cases, Mémorial de Sainte-Hélène, ou journal où se trouve consigné, jour par jour, ce qu’a dit et fait Napoléon durant dix-huit mois, tome septième, Paris, Lebègue, 1823, p. 176-8 sur http ://gallica.bnf.fr/
Proclamation de Napoléon, du 22 juin 1812
Avancé en Pologne avec la Grande Armée, Napoléon passe en revue quelques troupes le 21 juin puis, le lendemain, rédige une proclamation solennelle qui a été lue le 23 aux troupes.
« Soldats !
La deuxième guerre de Pologne est commencée. La première s’est terminée à Friedland et à Tilsit : à Tilsit, la Russie a juré éternellement alliance à la France et la guerre à l’Angleterre. Elle viole aujourd’hui ses serments. Elle ne veut donner aucune explication de son étrange conduite que les Aigles Françaises n’aient repassé le Rhin, laissant par là nos alliés à sa discrétion. La Russie est entraînée par la fatalité ! Ses destins doivent s’accomplir. Nous croirait-elle donc dégénérés ? Ne serions-nous donc plus les soldats d’Austerlitz ? Elle nous place entre le déshonneur et la guerre. Le choix ne saurait être douteux, marchons donc en avant ! Passons le Niémen ! Portons la guerre sur son territoire. La seconde guerre de Pologne sera glorieuse aux armées françaises, comme la première. Mais la paix que nous conclurons portera en elle sa garantie, et mettra un terme à cette orgueilleuse influence que la Russie exerce depuis cinquante ans sur les affaires de l’Europe. »
Rey, Marie-Pierre. L’effroyable tragédie. Une nouvelle histoire de la campagne de Russie. Paris, Flammarion, 2012, p. 82.
Proclamation du gouvernement provisoire de Vilnius du 7 juillet 1812
Accueilli en libérateur, Napoléon est entré le 28 juin à Vilnius. Il met en place des autorités officiellement autonomes mais, en réalité, sous le contrôle étroit des Français. Soucieux d’enrôler le plus possible d’hommes dans la Grande Armée, il fait publier par l’autorité nouvellement instituée une proclamation aux accents patriotiques que la réalité démentira vite : les Lituaniens et les Polonais vont rapidement subir tous les désagréments et tout le poids de l’occupation française.
« Polonais !
Vous êtes sous les drapeaux russes : ce service vous était permis alors que vous n’aviez plus de patrie ; mais tout est changé aujourd’hui. La Pologne est ressuscitée ; c’est pour son entier rétablissement qu’il s’agit de combattre maintenant ; c’est pour obliger les Russes à reconnaître des droits dont nous avons été dépouillés par l’injustice et l’usurpation. La confédération générale de la Pologne et de la Lituanie rappelle tous les Polonais au service de la Russie. Généraux, officiers, soldats polonais ! Entendez la voix de la patrie ; abandonnez les drapeaux de vos oppresseurs ; accourez tous auprès de nous, afin de vous ranger sous l’aigle des Jagellon, des Casimir, des Sobiewski ! La patrie vous le demande ; l’honneur et la religion vous l’ordonnent également. »
Cité par Rey, Marie-Pierre. L’effroyable tragédie. Une nouvelle histoire de la campagne de Russie. Paris, Flammarion, 2012, p. 110.
Vilnius et la Lituanie pillée par la Grande Armée
La mise en place d’autorités autonomes locales ne masque pas longtemps la réalité : la Pologne et la Lituanie sont bel et bien occupées par les troupes françaises et mettent toute la région au pillage. Agée de 19 ans au moment des événements, la comtesse de Sophie Tisenhaus, future comtesse de Choiseul-Gouffier, se souvient de ces heures sombres dans ses souvenirs publiés en 1862.
« Tout était au pillage. Il se commettait hors de la ville et dans les campagnes des désordres inouïs. Les églises pillées, les vases sacrés souillés ; même les cimetières n’étaient pas respectés, les malheureuses femmes outragées ! On était accablé des récits les plus affligeants. Il faut dire la vérité : Napoléon écoutait toutes les plaintes, dédommageait largement tout ce qui pouvait être dédommagé. Il s’écriait d’une voix de tonnerre à ébranler les murs du palais, en présence des chefs de l’armée qui baissaient la tête et même leur dos bien bas devant la fureur de Jupiter Tonnant : « Messieurs, vous me déshonorez ! Vous me perdez. »
Et à qui la faute ! (…) On s’était cru en pays ennemi, et l’on agissait en conséquence. On fusillait les pillards. Ils allaient à l’exécution avec une insouciance incroyable, la petite pipe à la bouche. Que leur importait de mourir plus tôt ou plus tard. L’armée avait manqué de pain trois jours.
Partout sur leur chemin les Russes avaient brûlé les magasins de prévoyance et les moulins.
(…) On avait proposé à Alexandre de ne faire qu’un désert de la Lituanie. On donnait aux soldats à Vilna un pain mal pétri, mal cuit, une espèce de galette qui se collait à la muraille en la jetant contre.
(…) On manquait de fourrage pour la cavalerie, et l’on nourrissait les chevaux de blé coupé sur champ à fin juin ! Ils crevaient comme des mouches, pauvres bêtes, et on jetait les cadavres dans la rivière. Le cuisinier de mon père refusait de nous servir du poisson et des écrevisses, à cause de la putréfaction. Enfin le découragement gagnait toutes les classes. Mon père était soucieux ; cette campagne lui paraissait être celle d’un jeune homme sans expérience. »
Cité par Rey, Marie-Pierre. L’effroyable tragédie. Une nouvelle histoire de la campagne de Russie. Paris, Flammarion, 2012, p. 112.
Manifeste impérial russe du 9 juillet 1812
Rédigé le 9 juillet par le tsar Alexandre, ce manifeste est lu aux troupes russes le lendemain, dans le camp fortifié de Drissa.
« Soldats !
(…) Vous allez cueillir de nouveaux lauriers dignes de vous-mêmes et de vos ancêtres. Ce jour, autrefois signalé par la bataille de Poltava, doit vous rappeler les exploits de vos pères ! Le souvenir de leur valeur, l’éclat de leur renommée vous engagent à surpasser l’un et l’autre par la gloire de vos actions ! Les ennemis de votre pays connaissent déjà la vigueur de vos bras. Allez donc dans l’esprit de vos pères, et anéantissez l’ennemi qui ose attaquer votre religion et votre honneur jusque dans vos foyers, au milieu de vos femmes et de vos enfants.
Dieu, témoin de la justice de notre cause, sanctifiera vos bras par la bénédiction divine. »
Rey, Marie-Pierre. L’effroyable tragédie. Une nouvelle histoire de la campagne de Russie. Paris, Flammarion, 2012, p. 104.
Proclamation du tsar Alexandre à la grande nation russe, du 18 juillet 1812

« L’ennemi a pénétré dans notre territoire et il continue de porter ses armes à l’intérieur de la Russie, espérant par la force et les tentations secouer et bouleverser la tranquillité de notre Grand Etat. Il s’est mis en tête l’intention mauvaise d’en détruire la gloire et la prospérité. Le cœur empli de malice et la flatterie à la bouche, il apporte pour elle des chaînes et des fers éternels. Nous avons demandé à Dieu de nous aider à lui opposer nos troupes, mais nous ne pouvons ni ne devons dissimuler à nos sujets que les forces de l’ennemi sont nombreuses et qu’il nous faut réunir d’autres troupes pour former comme une seconde enceinte qui défendra les maison, les femmes et les enfants de chacun et de tous. Nous en avons déjà appelé à Moscou, notre première capitale, mais aujourd’hui, nous en appelons à nos fidèles sujets, à tous les ordres et à tous les états religieux et civils, les invitant, par leur soulèvement unanime et général, à concourir contre les desseins et les attentats de l’ennemi. Qu’il trouve à chacun de ses pas les fils fidèles de la Russie qui le frapperont par tous les moyens et de toutes leurs forces, sans écouter aucune de ses malices, aucun de ses mensonges. Qu’il rencontre en chaque noble un Pojarski, en chaque clerc un Palitsyne, en chaque bourgeois un Minime. Nobles ! De tout temps vous avez été les sauveurs de la patrie. Saint-Synode et Clergé ! Par vos prières ardentes vous avez toujours appelé la Grâce sur la tête de la Russie. Peuple russe ! Brave descendance des braves Slaves ! Tu as plus d’une fois brisé les dents des lions et des tigres qui s’élançaient vers toi. Unissez-vous ! Avec la croix dans le cœur et les armes dans les mains, aucune force humaine ne pourra vous vaincre. »
Rey, Marie-Pierre. L’effroyable tragédie. Une nouvelle histoire de la campagne de Russie. Paris, Flammarion, 2012, p. 107.
La Grande Armée face à la tactique de la terre brûlée
Dès l’approche de la Russie et plus encore après le franchissement du Niémen, la Grande Armée se trouve face à une pénurie grave de ressources pour les soldats comme pour les chevaux. Livrés à eux-mêmes, les soldats s’en prennent à tout ce qu’ils trouvent : personnes et biens matériels sont les cibles de leur violence dans un contexte qui s’aggrave au fur et à mesure qu’ils avancent en terre russe. Originaire du Wurtemberg, Jakob Walter décrit ces scènes de pillages.
« S’ils n’avaient pas dissimulé leurs provisions, leur mobilier eût été épargné alors que nous étions obligés de soulever les planches, briser les solives, retourner sens dessus dessous tout ce qui était couvert, avant de découvrir quelque chose. (…)
Dans un autre village, soigneusement exploré, rien ne fut trouvé dans les maisons. Ainsi, poussés par la faim, nous creusâmes le sol. Là, avec plusieurs autres, nous déplaçâmes une large pile de bois qui venait juste d’être installée. Nous fouillâmes encore et tombâmes sur un plancher. Il y avait en dessous une ouverture de dix à douze pieds de profondeur. A l’intérieur de cet espace étaient rangées des jarres et du blé couverts de paille. Quand nous eûmes pris tout le grain, nous ouvrîmes les jarres et vîmes une substance dure, de couleur blanche, ayant l’apparence de la cire solidifiée. Elle était si dure qu’on eut de la peine à en détacher un morceau avec un sabre. Mais, aussitôt qu’elle fut approchée du feu, cette substance se transforma en un miel de grande pureté. Désormais j’étais pourvu de miel pour une semaine. Mais il me faudrait le manger sans pain. »
Cité par Rey, Marie-Pierre. L’effroyable tragédie. Une nouvelle histoire de la campagne de Russie. Paris, Flammarion, 2012, pp. 122 – 123.
Napoléon refuse prendre ses quartiers d’hiver en Russie
A la fin du mois de juillet 1812, Napoléon est pris d’un doute. Les Russes viennent de signer un traité de paix avec les Turcs, ce qui permet au tsar de concentrer ses efforts contre la Grande Armée. La Grande Armée pourrait prendre dans la région de Vitebsk ses quartiers d’hiver et s’y renforcer. Mais, après un échange avec son état-major, où la majorité penche pour cette solution, c’est le contraire que décide Napoléon, suivant en cela l’opinion de Murat favorable à la poursuite immédiate des opérations pour obtenir enfin la bataille décisive à laquelle se refusent les troupes russes jusque-là.
« Que je prenne mes quartiers d’hiver au mois de juillet ! Une expédition comme celle-ci peut-elle se diviser en plusieurs campagnes ? Croyez-moi, la question est sérieuse, et je m’en suis occupé. Nos troupes se portent volontiers en avant, la guerre d’invasion leur plaît. Mais une défense stationnaire et prolongée n’est pas dans le génie français. Nous arrêter derrières des rivières, y rester cantonner dans des huttes, manœuvrer tous les jours pour être à la même place après huit mois de privations et d’ennuis… Est-ce ainsi que nous sommes dans l’habitude d’agir ? Et puis l’hiver ne nous menace pas seulement de ses frimas, il nous menace encore d’intrigues diplomatiques qui peuvent se brasser derrière nous. Ces alliés que nous venons de séduire, qui sont encore tout étonnés de ne plus nous combattre, ont été tout glorieux de nous suivre, leur laisserons-nous le temps de réfléchir à la bizarrerie de leur position nouvelle ? Prévenons donc l’hiver et les réflexions ! Il nous faut frapper promptement les grands coups, sous peine de tout compromettre ; il faut être à Moscou dans un mois, sous peine de n’y entrer jamais. »
Emile Marco de Saint-Hilaire, cité par Rey, Marie-Pierre. L’effroyable tragédie. Une nouvelle histoire de la campagne de Russie. Paris, Flammarion, 2012, pp. 124 – 125.
Un portrait de Koutouzov
Au service de la Russie, le comte de Longeron, émigré français, a laissé ce portrait sans complaisance du commandant en chef des troupes russes engagées contre la Grande Armée. Malgré leurs différents, le tsar lui laissera jusqu’au bout toute la conduite des opérations, se gardant prudemment d’engager son autorité et son prestige dans un commandement dont il se disait incapable.
« On ne pouvait avoir plus d’esprit que Koutouzov, on ne pouvait avoir moins de caractère ; on ne pouvait réunir plus d’adresse et d’astuce, on ne pouvait posséder moins de véritables talents et plus d’immoralité. Une mémoire prodigieuse, une grande instruction, une rare amabilité, une conversation aimable et intéressante, une bonhomie (un peu factice à la vérité, mais agréable à ceux qui voulaient bien en être dupes), voilà les agréments de Koutouzov. Une grande violence, la grossièreté d’un paysan lorsqu’il s’emportait ou lorsqu’il n’avait pas à craindre la personne à qui il s’adressait ; une bassesse envers les individus qu’il croyait en faveur, portée au point le plus avilissant, une paresse insurmontable, une apathie qui s’étendait à tout ; un égoïsme rebutant, un libertinage aussi crapuleux que dégoûtant, peu de délicatesse sur les moyens de se procurer de l’argent, voilà les inconvénients de ce même homme. »
Cité par Rey, Pierre-Marie. L’effroyable tragédie. Une nouvelle histoire de la campagne de Russie. Paris, Flammarion, 2012, p. 134.
Scènes de la bataille de Borodino
Le 7 septembre, à l’approche de Moscou, les troupes françaises affrontent les forces russes dans une bataille particulièrement sanglante du fait qu’elle tourne à un duel d’artillerie. Les pertes sont importantes de part et d’autres, affaiblissant sérieusement le potentiel de l’envahisseur. Mais Napoléon n’en continuera pas moins sa marche sur Moscou, même si cette bataille, aussi coûteuse qu’elle fut, n’a pas encore été l’affrontement suprême que l’Empereur des Français cherche depuis juin. Plusieurs témoins ont raconté par la suite l’horreur du spectacle laissé par cette bataille.
Le général français Charles Griois (1772 – 1839) :
« Les balles, les boulets, les obus et la mitrailles pleuvaient sur nous de toutes parts et faisaient de larges trouées dans notre cavalerie qui, pendant plusieurs heures, resta là exposée et sans bouger. (…) La plaine était couverte d’hommes blessés qui se rendaient aux ambulances et de chevaux sans cavaliers qui galopaient en désordre. Je remarquai près de mois un régiment de cuirassiers wurtembourgeois, sur lequel les boulets semblaient frapper de préférence ; les casques et les cuirasses volaient en éclats dans tous les rangs. »
Friedrich von Schubert, officier des armées du tsar (1789 – 1865) :
« Qui ne l’a vu de ses propres yeux ne peut se faire aucune idée de l’ampleur de ce désordre. On ne pouvait plus parler de commandement. Chaque régiment, dès qu’il avait été à moitié rassemblé par un nouvel appel de clairon, repartait aussitôt à l’attaque. (…) Au milieu de la mêlée, il y avait les restes de nos divisions d’infanterie, que les officiers essayaient de réorganiser ; Paskievitch qui désespérément s’arrachait les cheveux en jurant ; et Barclay, dont le cheval venait d’être tué, qui, calmement, s’efforçait à pied de ramener l’ordre. »
Gaspard Ducque, sous-lieutenant français :
« Tout le terrain qui l’environnait et qu’ils traversèrent était littéralement couvert de cadavres d’hommes et de chevaux. (…) Le plus grand nombre de tués était des fantassins qui se trouvaient dessous les cavaliers et les chevaux tués, et dont la cavalerie avait passé par-dessus en chargeant. Jamais ces deux hommes n’avaient vu de choses aussi affreuses. Ce mélange d’hommes, d’armes et de chevaux, de cuirasses, de casques en fer et en cuivre de notre cavalerie formait un tableau difficile à peindre. (…) Cette effrayante scène de carnage est au-dessus de nos forces pour la dépeindre. L’horreur de cette épouvantable boucherie était encore augmentée par les gémissements des mourants qui gisaient parmi les morts. »
Un témoin russe, Iouri N. Bartenev, dans une lettre écrite six mois après la bataille :
« Partout des corps en morceaux, des mourants qui gémissaient. J’ai vu quelqu’un sans tête, un autre sans mains et sans jambes. J’ai vu un soldat qui, blessé légèrement, ne pouvait parler parce que sa bouche était remplie de la cervelle du soldat mort à côté de lui. Presque tous remuaient les lèvres ; savez-vous ce qu’ils demandaient, ce qu’ils voulaient ? Ils demandaient qu’on leur donnât la mort, pour ne plus éprouver leurs horribles souffrances. »
Dominique-Jean Larrey, chirurgien en chef de la Grande Armée (1766 – 1842) :
« Cette sanglante bataille a duré depuis 6 heures du matin jusqu’à 9 heures du soir. (…) Il serait difficile de peindre tout ce que présenta d’affreux cette épouvantable journée. (…) Les deux tiers des blessés passèrent par notre ambulance générale. (…) Je continuai sans désemparer, très avant dans la nuit, les opérations difficiles. Nos fonctions furent d’autant plus pénibles que le temps était très froid et devenait souvent nébuleux. Les vents de nord, de nord-est ou du nord-ouest, qui n’ont cessé de régner tout le mois, étaient très forts, en raison de l’approche de l’équinoxe. Ce n’était qu’avec beaucoup de peine qu’on pouvait, pendant la nuit, conserver sous mes yeux une torche de cire allumée ; d’ailleurs, je n’en avais absolument besoin que pour faire la ligature des artères. (…) Un grand nombre de blessures, faites par l’artillerie, ont exigé l’amputation d’un ou deux membres. J’en ai pratiqué, dans les premières vingt-quatre heures, environ 200. »
James Wylie, médecin personnel du tsar Alexandre (1768 – 1854) :
« Le champ de Borodino produisait, après la bataille, une impression épouvantable, surtout due à l’absence du service sanitaire. Tous les villages et les habitations à proximité de la route de Moscou étaient bondés de blessés et impotents russes et français. Or ces villages furent anéantis par les flammes, car des incendies éclataient constamment dans le secteur de campement et de mouvement de l’armée française. Les blessés qui avaient réussi à échapper au feu rampaient par milliers aux abords de la route, cherchant les moyens de prolonger leur misérable existence. »
Cités par Rey, Marie-Pierre. L’effroyable tragédie. Une nouvelle histoire de la campagne de Russie. Paris, Flammarion, 2012, pp. 160 – 163.
Tolstoï et Borodino
« Plusieurs historiens assurent que si les Français ont été battus à Borodino [le 7 septembre 1812], c’est parce que Napoléon souffrait ce jour-là d’un gros rhume. Sans ce rhume, ses combinaisons eussent été marquées au sceau du génie pendant la bataille, la Russie eût été perdue, et la face du monde changée ! Cette conclusion est d’une logique incontestable pour les écrivains qui soutiennent que la Russie s’est transformée par la seule volonté de Pierre le Grand ; que la république française s’est métamorphosée en Empire, et que les armées françaises sont entrées en Russie, également par la seule volonté de Napoléon. S’il avait dépendu de lui de livrer ou de ne pas livrer la bataille de Borodino, de prendre ou de ne pas prendre telle décision, il serait évident en ce cas que le rhume, qui aurait paralysé son action, eût été la cause du salut de la Russie, et que le valet de chambre qui oublia, le 28, de lui donner une chaussure imperméable, eût été notre sauveur ! Dans cet ordre d’idées, cette conclusion est aussi plausible que celle qu’en manière de plaisanterie Voltaire tire de la Saint-Barthélemy, due, dit-il, à un dérangement d’estomac de Charles IX. Mais, pour ceux qui n’admettent pas cette manière de raisonner, cette réflexion est tout bonnement absurde, et contraire en tous points à toute logique humaine. À la question de savoir quelle est la raison d’être des faits historiques, il nous paraît bien plus simple de répondre que la marche des événements de ce monde est arrêtée d’avance, et dépend de la coïncidence de toutes les volontés de ceux qui participent aux événements, et que celle des Napoléons n’y a qu’une influence extérieure et apparente.
Quelque étrange que paraisse à première vue de supposer que la Saint-Barthélemy, voulue et commandée par Charles IX, n’ait pas été le fait de sa volonté, et que le carnage de Borodino, qui a coûté 80 000 hommes, n’ait pas été réellement ordonné par Napoléon, bien qu’il eût pris toutes les dispositions à cet effet, la dignité humaine, en me démontrant que chacun de nous est homme au même degré que Napoléon, autorise cette solution, confirmée à plusieurs reprises par les recherches des historiens. Le jour de la bataille de Borodino, Napoléon n’a ni visé ni tué personne : tout fut fait par ses soldats, qui tuèrent leurs ennemis, non en conséquence de ses ordres, mais en obéissant à leur propre impulsion. Toute l’armée, Français, Allemands, Italiens, Polonais, affamés, déguenillés, fatigués par les marches qu’ils venaient de faire, sentait, en face de cette autre armée qui lui barrait le passage, que le vin était tiré et qu’il fallait le boire ! Si Napoléon leur avait défendu de se battre contre les Russes, ils l’auraient égorgé, et se seraient battus quand même, parce que c’était devenu inévitable !
À la lecture de la proclamation de Napoléon, qui leur promettait, comme compensation aux souffrances et à la mort, que la postérité dirait d’eux : « qu’eux aussi avaient pris part à la grande bataille de la Moskwa », ils avaient répondu par le cri de : « Vive l’Empereur ! » comme ils l’avaient déjà fait devant le portrait de l’enfant qui jouait au bilboquet avec la boule du monde, comme ils l’avaient acclamé à chaque non-sens qu’il avait dit. Ils n’avaient donc plus qu’une chose à faire, répéter : « Vive l’Empereur ! » et aller se battre pour gagner la nourriture et le repos qui, une fois vainqueurs, les attendaient à Moscou. Ils ne tuaient donc pas leurs semblables en vertu des ordres de leur maître ; Napoléon lui-même n’était pour rien dans la direction de la bataille, puisque aucune de ses dispositions n’a été exécutée et qu’il ignorait ce qui se passait. Ainsi donc la question de savoir d’une manière précise si Napoléon avait ou non un rhume à ce moment-là, n’a pas plus d’importance dans l’histoire que le rhume du dernier soldat du train.
Les historiens attribuent encore à ce rhume légendaire la faiblesse de ses dispositions, qui, selon nous, étaient au contraire mieux prises que celles qui lui avaient fait gagner d’autres batailles ; elles paraissent inférieures aujourd’hui, parce que la bataille de Borodino fut la première que perdit Napoléon. Les combinaisons les plus profondes et les plus ingénieuses semblent toujours mauvaises, et donnent prise aux critiques savantes des tacticiens, lorsqu’elles n’ont pas amené la victoire ; et vice versa. Les dispositions de Weirother, à la bataille d’Austerlitz, étaient le modèle de la perfection en ce genre, et cependant on les a désapprouvées, à cause même de cette perfection et de leur minutie.
Napoléon à Borodino avait joué son rôle de représentant du pouvoir aussi bien et même mieux que dans ses autres batailles. Il s’en était tenu aux mesures les plus sages. Aucune confusion, aucune contradiction ne peut lui être imputée ; il n’a pas perdu la tête, il n’a pas fui du champ de bataille, et son tact et sa grande expérience contribuèrent au contraire à lui faire remplir, avec calme et dignité, le personnage de chef suprême, qui semblait lui être attribué dans cette sanglante tragédie. »
Léon Tolstoï, Guerre et paix (roman), trad. du russe par « une Russe », T. III, ch. 10,
http://www.ebooksgratuits.com/, janvier 2006 (1863-69)
La ville de Moscou à la veille de l’incendie de septembre 1812
Les troupes françaises sont aux portes de la ville et un officier français se souvient de la vue qu’offrait Moscou juste avant le drame.
« Il était de ces globes, qui, posés sur le sommet d’une colonne ou d’un obélisque, avaient la forme d’un aérostat suspendu dans les airs. Nous fûmes transportés d’étonnement à la vue d’un si beau coup d’œil, devenu plus séduisant encore par le souvenir des tristes objets dont nous avions été témoins ; (…) et par un mouvement spontané, nous criâmes tous : Moscou, Moscou ! » A ce nom tant désiré, on courut en foule sur la colline, et chacun, en faisant des remarques de son côté, découvrait à tout moment des merveilles nouvelles. L’un admirait un magnifique château placé sur notre gauche, et dont l’architecture élégante nous rappelait celle des orientaux ; un autre portait son attention sur un palais, sur un temple ; mais tous étaient frappés du superbe tableau que représentait cette grande ville. (…) Les murs différemment colorés, les coupoles dorées ou couvertes de plomb et en ardoises, répandaient la plus piquante variété, tandis que les terrasses des palais, les obélisques des portes de la ville, et surtout les clochers, construits en forme de minarets, offraient à nos yeux et en réalité, une de ces cités fameuses d’Asie, qui jusqu’alors nous paraissaient n’avoir existé que dans la riche admiration des poètes arabes. »
Eugène Labaume, cité par Rey, Marie-Pierre. L’effroyable tragédie. Une nouvelle histoire de la campagne de Russie. Paris, Flammarion, 2012, p. 19.
—-
La Grande Armée quitte Moscou, octobre 1812
Après avoir séjourné dans la ville ou ses faubourgs, les troupes françaises s’apprêtent à quitter la capitale historique de la Russie. Plusieurs témoins confirment que, malgré plusieurs semaines de stationnement, les régiments sont en mauvais état, sauf la Garde qui a pu installer son campement en ville. Et ce mauvais état est particulièrement préoccupant lorsque l’on sait les épreuves qui attendent ce qui reste de la Grande Armée sur le chemin du retour vers le Niémen.
Le témoignage de Gaspard Ducque, sous-lieutenant français :
« Hommes et chevaux étaient harassés de fatigue. Les nuits étaient déjà froides ; le givre couvrait la terre. La misère n’avait plus de bornes, les chevaux crevaient comme des mouches et garnissaient l’entour du régiment avec une espèce de symétrie comme un rempart. Quel coup d’œil dégoûtant ! Tous les chevaux étaient dépecés car nous n’avions pas d’autre nourriture. On n’avait même pas de sel, cet assaisonnement si nécessaire. Enfin la brumeuse arrière-saison avec les frimas périodiques de la Russie était arrivée ; avec elles nos misères augmentaient encore s’il était possible. »
Médecin dans un régiment wurtembergeois, Heinrich von Roos a également laissé un portrait des soldats à la veille du départ :
« Notre vie au camp était pitoyable. Le froid, souvent très vif la nuit, nous obligeait à nous procurer beaucoup de bois. Les provisions du village et des environs furent vite épuisées. On se mit à démolir les écuries et les granges. On mettait les poutres dans le feu par une de leurs extrémités, et on les repoussait peu à peu jusqu’à ce qu’elles fussent complètement brûlées. Quand il ne resta plus, ni écuries, ni granges, on s’attaqua aux maisons. Il ne resta bientôt plus du village, que quelques chambres pour les officiers supérieurs et les malades.
Nous n’avions de paille que juste ce qu’il fallait pour la nourriture des chevaux. On s’en servait pour se coucher la nuit, et on la donnait ensuite à manger aux chevaux. Souvent, les nuits étaient si froides qu’on se cachait sous la paille pour dormir ; et le lendemain matin, cette paille était agglutinée par la gelée blanche de telle façon qu’il fallait la casser pour s’en dégager. Les chevaux étaient efflanqués et les selles étaient blanches de givre. (…) On faisait cuire le blé, l’orge, le sarrasin, qu’on pouvait se procurer. On les faisait bouillir jusqu’à ce que le grain fût gonflé, éclaté et ramolli. On le séparait alors de l’enveloppe. Puis, on en faisait de la soupe et de la bouillie. Une partie des grains était réservée pour faire du pain, après avoir été préalablement moulue. Ce travail était pénible à nos bras maigres et affaiblis. »
Cités par Rey, Marie-Pierre. L’effroyable tragédie. Une nouvelle histoire de la campagne de Russie. Paris, Flammarion, 2012, p. 214.
—-
Le retour des Russes dans Moscou
A la fin octobre 1812, les troupes russes réinvestissent la ville de Moscou et constatent les dégâts causés par l’incendie et par l’occupation française. Le général Alexandre Beckendorff s’en souvient dans ses mémoires.
« Le 10 octobre 1812 [c’est-à-dire le 23], nous entrâmes dans cette antique capitale encore toute fumante, à peine pouvions-nous nous frayer un chemin à travers les cadavres d’hommes et de bestiaux ; les décombres et des cendres obstruaient toutes les rues, les églises pillées et toutes noircies de fumée seules servaient tristement de guide pour s’orienter dans cette immense dévastation. Des Français égarés erraient dans Moscou et devenaient les victimes d’une foule de paysans qui de tous côtés affluaient dans cette malheureuse enceinte.
Mon premier soin fut de courir au Kremlin, dans cette Métropole de l’Empire ; un peuple immense y cherchait à y pénétrer ; il fallut les efforts réitérés du régiment des cosaques de la garde pour le faire reculer et pour défendre les ouvertures faites autour du Kremlin par l’écroulement des murs.
J’entrai seul avec un officier dans cette cathédrale que je n’avais vue que lors du couronnement de l’Empereur, brillante de richesse et remplie des Grands de l’Empire ; je fus saisi d’horreur en revoyant ce temple révéré que les flammes même avaient épargné, bouleversé par l’impiété d’une soldatesque effrénée, et me persuadai que l’état dans lequel il se trouvait devait être caché aux yeux du peuple. Les reliques des saints étaient mutilées, leurs tombeaux remplis d’ordures ; les ornements de ces tombeaux étaient arrachés. Les images qui décoraient l’église étaient salies, déchirées ; tout ce qui avait pu provoquer ou tromper l’avidité du soldat était enlevé, l’autel était renversé, des tonneaux de vin avaient inondé ces parquets sacrés et des cadavres d’hommes et de chevaux infectaient ces voûtes destinées à l’encens. Je me hâtai de mettre mon cachet sur la porte et d’en défendre l’entrée par une garde considérable.
Tout le reste du Kremlin était devenu la proie des flammes ou avait été ébranlé par l’explosion de mines ; l’Arsenal, l’église d’Ivan Velikoy, des tours et des murs ne formaient que des amas de pierres.
Le grand établissement des enfants trouvés attira mon attention ; quelques centaines d’enfants que l’entrée de l’ennemi avait surpris mourraient de faim ; une quantité de femmes et de blessés russes qui n’avaient pu fuit y avaient trouvé un asile et quelques milliers de malades français y avaient été abandonnés. Tous demandaient du pain, et la dévastation des environs de Moscou ne me permettait pas de pourvoir de suite à un besoin si pressant. Les corridors, les cours de cet énorme édifice étaient remplis de morts, de victimes de la misère, des maladies et de la frayeur.
D’autres grands édifices étaient encombrés de blessés russes, échappés à l’incendie et subsistant à peine, sans secours, sans nourriture, entourés de cadavres et attendant la fin de leurs souffrances. »
Cité par Rey, Marie-Pierre. L’effroyable tragédie. Une nouvelle histoire de la campagne de Russie. Paris, Flammarion, 2012, pp. 223 – 224.
—-
Le retour de la Grande Armée de Russie
Dès son départ de Moscou, les vestiges de la Grande Armée ne cessent d’affronter des difficultés croissantes : la faim, le harcèlement des Russes, des affrontements et, de plus en plus, le froid. De nombreux témoins, dans chaque camp, ont laissé un témoignage sur les conditions de cette retraite dramatique.
Un médecin de la Grande Armée, Heinrich von Roos :
« Cela tourna mal pour les malheureux blessés. Ils tombèrent entre les mains de cochers grossiers, de valets insolents, de cantiniers brutaux, de femmes enrichies et arrogantes, de frères d’armes sans pitié, et de toute la séquelle des soldats du train. Tous ces gens n’eurent qu’une seule idée : se débarrasser de leurs blessés. Partout où l’on campait pour la nuit ou bien en chemin, quand ces malheureux avaient besoin de descendre de voiture ou de refaire leurs pansements, on les abandonnait. Dès le jour suivant, j’en vis quelques-uns gémir sur la route et implorer du secours. Plus tard, on n’en vit plus, mais on racontait les histoires les plus épouvantables sur le sort qu’ils avaient subi, et sur la brutalité de ceux qui avaient mission de les emmener. »
Un Russe P.P. Konovnitsyne, écrit à sa femme à sa femme, le 9 novembre 1812 :
« Mon amie, jour et nuit, nous pourchassons l’ennemi, presque chaque jour nous lui prenons des canons et des drapeaux et faisons des prisonniers. C’est un abîme. L’ennemi meurt de faim, il ne mange pas que ses chevaux ; on en a vu qui faisaient griller de la chair humaine. Mon on ne peut décrire de telles extrémités. On peut jurer que leur armée a totalement disparu. Ainsi, mon amie, nous sommes vainqueurs et l’ennemi périt. Dans trois jours, nous traverserons Smolensk, et dans deux semaines, nous serons sans doute à Minsk, où j’emporterai tes clavicordes. Nous subissons l’hiver, nous passons par de durs moments, le froid et la mort sont là, nous sommes fatigués mais grâce à Dieu, nous sommes victorieux. Bonaparte ne s’est jamais trouvé dans une telle infortune, lui-même se nourrit tant bien que mal de ce que les Cosaques ne lui ont pas ravi. Peut-être tombera-t-il entre nos mains, peut-être les nôtres le repèreront-ils. »
Après une brève étape à Smolensk, les troupes reprennent la route et le calvaire continue. La température descend, les horreurs se multiplient de part et d’autres, en particulier envers les prisonniers que chaque camp parvient à capturer lors des escarmouches ou des affrontements plus sérieux.
Le général français Jean-Jacques-Germain Pelet (1777 – 1858) note dans ses carnets :
« Cette marche présentait une affreuse confusion, un horrible désordre ; à peine, de loin en loin, quelques groupes armés réunis autour des aigles et marchant avec une apparence d’ordre ; des files de voitures à chaque instant coupées, interrompues, s’arrêtant et se dépassant mutuellement ; au milieu de tout cela, une cohue de non-combattants, de blessés, d’éclopés, de cadavres ambulants sans plus de distinction de corps, d’arme, n’ayant conservé que ce qui pouvait les garantir du froid, débarrassés de tout ce qui les gênait, couvert de la manière la plus bizarre. Les régiments, les armes, les rangs, les sexes, tout était confondu ; plus d’obéissance, d’égards, de considération ; l’officier général marchait à côté du soldat ; les domestiques couverts de chapeaux galonnés ou d’habits brodés, les soldats entourés de lambeaux de belles fourrures. »
Dans ce dramatique désordre, la Garde de l’Empereur semble être la seule troupe encore compacte, comme en témoigne Denis Davydoff :
« La Vieille Garde, au milieu de laquelle se trouvait Napoléon lui-même, s’approcha… Nous enfourchâmes nos montures et nous nous plaçâmes près de la grand’route. Apercevant nos bandes bruyantes, l’ennemi arma ses fusils et continua fièrement sa marche, sans presser le pas. Tous nos efforts pour détacher un seul soldat de ses colonnes serrées restèrent vains : les hommes, comme taillés en granit, méprisaient toutes nos tentatives et restaient intacts. Je n’oublierai jamais la démarche libre, aisée, et l’allure menaçante de ces guerriers éprouvés par tous les aspects de la mort. Avec leurs hauts bonnets à poil, leurs uniformes bleus aux sangles blanches, leurs plumets et leurs épaulettes rouges, ils ressemblaient à des pavots dressés dans un champ de neige… Nos Cosaques avaient l’habitude de galoper autour de l’ennemi, lui arrachant des bagages et des canons qui traînaient, et encerclant les compagnies éparpillées ou détachées. Mais ces colonnes-là restèrent inébranlables. En vain, les colonels, les officiers, les sous-officiers ou les simples Cosaques fonçaient sur elles : les colonnes avançaient, l’une après l’autre, nous chassant à coups de feu et se moquant de nos raids inutiles… La Garde avec Napoléon passa parmi nos Cosaques comme un navire armé de cent canons passe parmi les barques de pêcheurs. »
Cités par Rey, Marie-Pierre. L’effroyable tragédie. Une nouvelle histoire de la campagne de Russie. Paris, Flammarion, 2012, pp. 234, 248, 254, 257-258.
La Berezina
A l’approche du fleuve et d’un gué, Napoléon semble si affaibli qu’un officier supérieur russe en donne le signalement en vue de sa probable capture. Mais l’Empereur des Français trompe les Russes et parvient à franchir, dans des conditions épouvantables, le fleuve pour ensuite sortir le plus rapidement possible des terres du tsar Alexandre. On reprocha beaucoup à Koutouzov de n’avoir pas pressé les Français et capturé Napoléon. Le général russe s’est justifié en invoquant le fait qu’il ne voulait pas que la destruction totale de la Grande Armée ne profitât trop aux Anglais.
« Ordre du jour du commandant en chef de l’armée du Danube, l’amiral P.V. Tchitchagov, à toutes les unités :
L’armée de Napoléon est en fuite. Le responsable des malheurs de l’Europe est avec elle. Nous le poursuivons. Il plaira peut-être à Dieu de calmer son courroux en nous le livrant. C’est la raison pour laquelle je désire faire connaître à tous le signalement de cet individu :
Il est de petite taille, trapu ; son cou est court et gras, sa tête forte, ses cheveux sont noirs. Il faut, par mesure de précaution, s’emparer de tout homme de petite taille et me les amener. Je ne parle pas de la récompense pour cette capture ; la générosité connue de notre monarque en est la garante. »
La traversée de la Berezina est connue. Voici deux témoignages parmi de nombreux autres.
Celui d’Alexandre de Chéron d’abord, qui a passé le fleuve le 28 novembre.
« Après 2 ou 3 heures d’attente, je commence à concevoir l’espérance d’arriver au pont. C’était une languette de glace assez forte pour porter et sur laquelle il ne pouvait passer qu’un seul cheval : à droite était la rivière couverte d’énormes glaçons, à gauche un marais rempli de chevaux et d’hommes qui ne pouvaient se retirer. Figurez-vous deux écrevisses dans un plat et vous aurez l’idée du spectacle que cela offrait ; mon tour arriva enfin, il en était temps, les obus tombaient de toutes parts, l’ennemi s’approchait, la confusion ne faisait qu’augmenter. Les hommes, les chevaux, les équipages, tout était pêle-mêle ; chacun avait tiré son sabre et frappait à droite et à gauche pour s’ouvrir un passage. Malheur à celui qui tombait dans la foule : il était écrasé impitoyablement. On n’avait d’égard pour personne. Deux généraux étaient à la tête des ponts pour maintenir l’ordre mais n’étaient plus écoutés. On a vu des femmes, des enfants écrasés par la foule ; cependant les deux personnes qui étaient devant moi tombent avec leurs chevaux dans un endroit difficile et y restent. J’étais indécis, quelques-uns de ceux qui s’étaient jetés à la nage avec leurs chevaux étaient passés à l’autre rive, je comptais beaucoup sur le mien, peu ne s’en fallut que je suivisse leur exemple ; mais mon cheval fait un faux pas et tombe sur les autres. Je n’ai d’autre parti à prendre que celui de tâcher de gagner le pont ; j’excite mon cheval qui met tant d’adresse à poser son pied sur le corps des autres chevaux que je parviens au pont sans incident et le traverse aussitôt. Mon domestique suivit mon exemple. »
Dominique-Jean Larrey, (1766 – 1842) témoigne également :
« L’épouvante était dans tous les esprits ; on se pressait, on se heurtait de toutes parts, on se jetait les uns sur les autres ; le plus fort abattait le plus faible, qui était foulé aux pieds de la multitude ; les voitures, les chariots d’artillerie, ceux des équipages, étaient renversés et brisés ; les chevaux et les conducteurs écrasés sous les débris de ces chariots ; enfin on n’entendait de tous côtés que des cris lamentables. Pour comble de malheur, les ponts mal assurés se rompent une seconde fois. Dès ce moment, toute espérance de salut paraît être détruite ; le plus grand nombre ne prend plus conseil que dans son désespoir ; on s’élance sur un banc de glace, imaginant pouvoir passer la rivière à la faveur des glaçons qui semblent la couvrir, mais on est arrêté près de l’autre rive, où ce banc était interrompu par la force même du courant. Quelques-uns parviennent à franchir cet espace à la nage ; d’autres ont le malheur de se noyer ou de se trouver embarrasser au milieu des glaçons ; ils y périssent plus vite qu’ils sont déjà engourdis par le froid et exténués par les privations. »
Cités par Rey, Marie-Pierre. L’effroyable tragédie. Une nouvelle histoire de la campagne de Russie. Paris, Flammarion, 2012, pp. 257-258, 269 et 275.
Deux versions de la Bérézina
« Lorsque j’y arrivai [à la tête du pont], le plus grand désordre y régnait déjà. Les hommes qui n’avaient pas voulu profiter de la nuit ou d’une partie de la matinée venaient, depuis qu’ils entendaient le canon, se jeter en foule sur les bords de la Bérézina, afin de traverser les ponts. (…)
Pendant ce désastre, des grenadiers de la Garde parcouraient les bivacs. Ils étaient accompagnés d’un officier; ils demandaient du bois sec pour chauffer l’Empereur. Chacun s’empressait de donner ce qu’il avait de meilleur; même des hommes mourants levaient encore la tête pour dire: «Prenez pour l’Empereur!»
Il pouvait être dix heures; le second pont, désigné pour la cavalerie et l’artillerie, venait de s’abîmer sous le poids de l’artillerie, au moment où il y avait beaucoup d’hommes dessus, dont une grande partie périt. Alors le désordre redoubla car, tous se jetant sur le premier pont, il n’y avait plus possibilité de se frayer un passage. Hommes, chevaux, voitures, cantiniers avec leurs femmes et leurs enfants, tout était confondu et écrasé, et, malgré les cris du maréchal Lefebvre placé à l’entrée du pont pour maintenir l’ordre autant que possible, il lui fut impossible de rester. Il fut emporté par le torrent et obligé, avec tous ceux qui l’accompagnaient, pour éviter d’être écrasé ou étouffé, de traverser le pont.
J’avais déjà réuni cinq hommes du régiment, dont trois avaient perdu leurs armes dans la bagarre. Je leur avais fait faire du feu. J’avais toujours les yeux fixés sur le pont; j’en vis sortir un homme enveloppé d’un manteau blanc : poussé par ceux qui le suivaient, il alla tomber sur un cheval abattu, sur la gauche du pont. Il se releva avec beaucoup de peine, fit encore quelques pas, tomba de nouveau, se releva de même, pour venir ensuite retomber près de notre feu. Il resta un instant dans cette position; pensant qu’il était mort, nous allions le mettre à l’écart et prendre son manteau, mais il leva la tête en me regardant. Alors il se mit sur les genoux, il me reconnut. C’était l’armurier du régiment; il se mit à se lamenter en me disant: «Ah ! mon sergent ! quel malheur ! J’ai tout perdu, chevaux, voitures, lingots, fourrures ! Il me restait encore un mulet que j’avais amené d’Espagne. Je viens d’être obligé de l’abandonner. Il était encore chargé de mes lingots et de mes fourrures! J’ai passé le pont sans toucher les planches, car j’ai été porté, mais j’ai manqué de mourir !» Je lui dis qu’il était encore très heureux et qu’il devait remercier la Providence s’il arrivait en France, pauvre, mais avec la vie.
Le nombre d’hommes qui arrivaient autour de notre feu nous força de l’abandonner et d’en recommencer un autre, quelques pas en arrière. Le désordre allait toujours croissant, mais ce fut bien pis, un instant après, lorsque le maréchal Victor fut attaqué par les Russes et que les boulets et les obus commençaient à tomber dans la foule. Pour comble de malheur, la neige recommença avec force, accompagnée d’un vent froid. Le désordre continua toute la journée et toute la nuit et, pendant ce temps, la Bérézina charriait, avec les glaçons, les cadavres d’hommes et de chevaux, et des voitures chargées de blessés qui obstruaient le pont et roulaient en bas. Le désordre devint plus grand encore lorsque, entre huit et neuf heures du soir, le maréchal Victor commença sa retraite. Ce fut sur un mont de cadavres qu’il put, avec sa troupe, traverser le pont. Une arrière-garde faisant partie du 9e corps était encore restée de l’autre côté et ne devait quitter qu’au dernier moment. La nuit du 28 au 29 offrait encore à tous ces malheureux, sur la rive opposée, la possibilité de gagner l’autre bord; mais, engourdis par le froid, ils restèrent à se chauffer avec les voitures que l’on avait abandonnées et brûlées exprès pour les en faire partir.
Je m’étais retiré en arrière avec dix-sept hommes du régiment et un sergent nommé Rossière. Un soldat du régiment le conduisait. Il était devenu, pour ainsi dire, aveugle, et il avait la fièvre. Par pitié, je lui prêtai ma peau d’ours pour se couvrir, mais il tomba beaucoup de neige pendant la nuit, elle se fondait sur la peau d’ours par suite de la chaleur du grand feu et, par la même raison, se séchait. Le matin, lorsque je fus pour la reprendre, elle était devenue tellement dure, qu’il me fut impossible de m’en servir: je dus l’abandonner. Mais, voulant qu’elle fût encore utile, j’en couvris un homme mourant.
Nous avions passé une mauvaise nuit. Beaucoup d’hommes de la Garde impériale avaient succombé: il pouvait être sept heures du matin. C’était le 29 novembre. J’allai encore auprès du pont, afin de voir si je rencontrerais des hommes du régiment. Ces malheureux, qui n’avaient pas voulu profiter de la nuit pour se sauver, venaient, depuis qu’il faisait jour, mais trop tard, se jeter en masse sur le pont. Déjà l’on préparait tout ce qu’il fallait pour le brûler. J’en vis plusieurs qui se jetèrent dans la Bérézina, espérant la passer à la nage sur les glaçons, mais aucun ne put aborder. On les voyait dans l’eau jusqu’aux épaules, et là, saisis par le froid, la figure rouge, ils périssaient misérablement. J’aperçus, sur le pont, un cantinier portant un enfant sur sa tête. Sa femme était devant lui, jetant des cris de désespoir. Je ne pus en voir davantage; c’était au-dessus de mes forces. Au moment où je me retirais, une voiture dans laquelle était un officier blessé, tomba en bas du pont avec le cheval qui la conduisait, ainsi que plusieurs hommes qui accompagnaient. Enfin, je me retirai. On mit le feu au pont; c’est alors, dit-on, que des scènes impossibles à peindre se sont passées. Les détails que je viens de raconter ne sont que l’esquisse de l’horrible tableau. »
In Mémoires du Sergent Bourgogne (1812-1813), Ed. Cottin et Hénault, 1910, ch. VIII sur www.gutenberg.org
« Nous partîmes de Smolensk avec l’Empereur le 14 novembre [1812]. Les Russes nous serraient de près le 22 ; il apprit que les cosaques venaient de s’emparer de la tête du pont de Borisow et se vit forcé d’exécuter le passage de la Bérézina. Nous passâmes devant le grand pont que les Russes avaient brûlé à moitié ; ils étaient de l’autre côté à nous attendre dans les bois et dans la neige. Sans échanger un seul coup de fusil, nous étions déjà dans la misère. A une heure de l’après-midi, 26 novembre, le pont de droite fut achevé et l’Empereur fit immédiatement passer sous ses yeux le corps du duc de Reggio et et le maréchal Ney avec ses cuirassiers. L’artillerie de la garde passa avec les deux corps et traversa un marais heureusement gelé. Afin de pouvoir gagner un village, ils repoussèrent les Russes à gauche et donnèrent le temps à l’armée de passer le 27. L’Empereur passa la Bérézina à une heure de l’après-midi, et alla établir son quartier général dans le petit hameau. Le passage de la rivière continua dans la nuit du 27 au 28. L’Empereur fit appeler le maréchal Davoust et je fus nommé pour garder la tête du pont et ne laisser passer que l’artillerie et les munitions, le maréchal à droite et moi à gauche. Lorsque tout le matériel fut passé, le maréchal me dit : « Allons mon brave, tout est passé. Allons rejoindre l’Empereur. » Nous traversâmes le pont et le marais gelé ; il pouvait porter notre matériel, sans quoi tout était perdu. Durant notre pénible service, le maréchal Ney avait taillé les Russes qui remontaient pour nous couper la route ; nos troupes les avaient surpris en plein bois et cette bataille leur coûta cher ; nos braves cuirassiers les ramenaient couverts de sang ; c’était pitié à voir. Nous arrivons sur un beau plateau, l’Empereur passait les prisonniers en revue ; la neige tombait si large que tout le monde en était couvert, on ne se voyait pas.
Mais derrière nous, il se passait une scène effrayante ; à notre départ du pont, les Russes dirigèrent sur la foule [Cette foule se composait de traînards qui avaient refusé de passer le jour précédent, et qui bivaquaient sur la rive. Il fallut le canon russe pour les émouvoir. (NdE)] qui entourait les ponts, les feux de plusieurs batteries. De notre position on voyait ces malheureux se précipiter vers les ponts, les voitures se renverser et tous s’engloutir dans les glaces. Non, personne ne peut se faire une idée d’un pareil tableau. Les ponts furent brûlés le lendemain à huit heures et demie. »
In cahiers du capitaine Coignet (1799-1815), Paris, Hachette, 1883, septième cahier, p. 332-4 sur http ://gallica.bnf.fr/
La Grande Armée sort de Russie
Parvenue au terme de son périple meurtrier et abandonnée par Napoléon qui est retourné à Paris et confiée à Murat, la Grande Armée, ou plutôt ce qu’il en reste, veut se précipiter dans Vilnius, le 8 décembre 1812, à la recherche de nourriture et de chaleur. Les soldats sont complètement livrés à eux-mêmes et se retrouvent, pour les survivants, face à une population qui s’enferme, ne voulant pas revivre les horreurs subies lors du premier passage des Français. Christian-Wilhelm von Faber du Faur (1780 – 1857) témoigne.
« Ce jour-là, le gros de l’armée, fort d’environ 40 000 hommes, opérant sa retraite dans le désordre le plus complet, suivi de près par l’arrière-garde, et pressé par les colonnes russes, atteignit Vilna et s’y précipita en désespéré. Des milliers périrent sous les portes de la ville, victimes de cette presse affreuse ou d’un froid horrible. Ici, comme à la Berezina, on foule aux pieds les morts et les vivants, et ce torrent d’homme que le froid et la faim ont rendu furieux, se répand dans les rues de la ville consternée. Les habitants effrayés ferment leurs maisons et en refusent l’entrée. C’est un spectacle déchirant de voir ces malheureux, couverts de lambeaux, errer en furieux dans les rues par un froid de -28°, suppliant, menaçant, cherchant en vain à entrer dans les demeures. (…) Les hôpitaux et les casernes ne peuvent plus recevoir personne ; ils offrent depuis longtemps le tableau de la misère la plus affligeante ; sur le plancher glacé de leurs salles sans feu et dans tous les corridors, on rencontre des malades, des mourants et des morts, entassés par rangées épaisses. »
Le 21 décembre, Xavier de Maistre (1763 – 1852) écrit à son frère Joseph :
« Je ne puis te donner une idée de la route que j’ai faite. Les cadavres des Français obstruent le chemin, qui, depuis Moscou jusqu’à la frontière (environ 800 verstes) a l’air d’un champ de bataille continu. Lorsqu’on approche des villages, pour la plupart brûlés, le spectacle devient plus effrayant. Là les corps sont entassés, et, dans plusieurs endroits où les malheureux s’étaient rassemblés dans les maisons, ils y ont brûlé sans avoir la force d’en sortir. J’ai vu des maisons où plus de 50 cadavres étaient rassemblés, et parmi eux, trois ou quatre hommes encore vivants, dépouillés jusqu’à la chemise, par quinze degrés de froid. L’un d’eux me dit : « Monsieur, tirez-moi de là ou tuez-moi ; je m’appelle Normand de Flageac, je suis officier comme vous. » Il n’était pas en mon pouvoir de le secourir. On lui fit donner des habits, mais il n’y avait aucun moyen de le sauver ; il fallut le laisser dans cet horrible lieu (…). De tous côtés et dans tous les chemins on rencontre de ces malheureux qui se traînent encore, mourant de faim et de froid ; leur grand nombre fait qu’on ne peut pas toujours les recueillir à temps, et ils meurent pour la plupart en se rendant aux dépôts. Je n’en voyais pas un, sans songer à cet homme infernal qui les a conduits à cet excès de malheur. »
Cités par Rey, Marie-Pierre. L’effroyable tragédie. Une nouvelle histoire de la campagne de Russie. Paris, Flammarion, 2012, pp. 290 et 295.