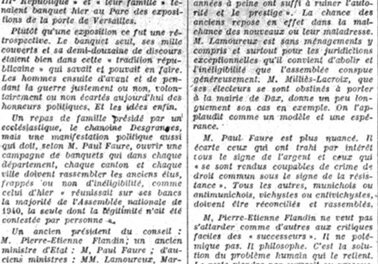Un entretien entre de Gaulle et Staline.
« Là-dessus, vint au jour le véritable enjeu du débat. Comme nous nous y attendions, il s’agissait de la Pologne. Voulant savoir ce que, décidément, les Russes projetaient de faire à Varsovie quand leurs troupes y seraient entrées, je posai nettement la question à Staline, au cours d’une conférence que nous tînmes au Kremlin, le 6 décembre [1944]. Bidault, Garreau et Dejean étaient à mes côtés ; Molotov, Bogomolov et l’excellent interprète Podzerov se tenaient auprès de Staline.
Je rappelai que, de tous temps, la France avait voulu et soutenu l’indépendance polonaise. Après la première guerre mondiale, nous avions fortement contribué à la faire renaître. Sans doute la politique suivie ensuite par Varsovie, celle de Beck en particulier, nous avait-elle mécontentés et, finalement, mis en danger, tandis qu’elle poussait l’Union Soviétique à rester éloignée de nous. Cependant, nous tenions pour nécessaire que reparaisse une Pologne maîtresse de ses destinées, pourvu qu’elle soit amicale envers la France et envers la Russie. Ce que nous pouvions avoir d’influence sur les Polonais, — je précisai : « sur tous les Polonais », — nous étions résolus à l’exercer dans ce sens. J’ajoutai que la solution du problème des frontières, telle que Staline nous l’avait lui-même exposée, à savoir : « La ligne Curzon » à l’est et « l’Oder-Neisse » à l’ouest, nous paraissait acceptable. Mais je répétai qu’à nos yeux il fallait que la Pologne fût un État réellement indépendant. C’est donc au peuple polonais qu’il appartenait de choisir son futur gouvernement. Il ne pourrait le faire qu’après la libération et par des élections libres. Pour le moment, le gouvernement français était en relations avec le gouvernement polonais de Londres, lequel n’avait jamais cessé de combattre les Allemands. S’il devait arriver qu’un jour la France fût amenée à changer cela, elle ne le ferait que d’accord avec ses trois alliés.
Prenant la parole à son tour, le maréchal Staline s’échauffa. A l’entendre, grondant, mordant, éloquent, on sentait que l’affaire polonaise était l’objet principal de sa passion et le centre de sa politique. Il déclara que la Russie avait pris « un grand tournant » vis-à-vis de cette nation qui était son ennemie depuis des siècles et en laquelle, désormais, elle voulait voir une amie. Mais il y avait des conditions. « La Pologne, dit-il, a toujours servi de couloir aux Allemands pour attaquer la Russie. Ce couloir, il faut qu’il soit fermé, et fermé par la Pologne elle-même. » Pour cela, le fait de placer sa frontière sur l’Oder et sur la Neisse pourrait être décisif, dès lors que l’État polonais serait fort et « démocratique ». Car, proclamait le maréchal, « il n’y a pas d’État fort qui ne soit démocratique. »
Staline aborda, alors, la question du gouvernement à instaurer à Varsovie. Il le fit avec brutalité, tenant des propos pleins de haine et de mépris à l’égard des « gens de Londres », louant hautement le « Comité de Lublin », formé sous l’égide des Soviets, et affirmant qu’en Pologne celui-ci était seul attendu et désiré. Il donnait à ce choix, qu’à l’en croire aurait fait le peuple polonais, des raisons qui ne démontraient que son propre parti pris. « Dans la bataille qui libère leur pays, déclara-t-il, les Polonais ne voient pas à quoi servent le gouvernement réactionnaire de Londres et l’armée d’Anders. Au contraire, ils constatent la présence et l’action du « Comité de la libération nationale » et des troupes du général Berling. Ils savent, d’ailleurs, que ce sont les agents du gouvernement de Londres qui furent causes de l’échec de l’insurrection de Varsovie, parce qu’ils la déclenchèrent avec la pire légèreté, sans consulter le commandement soviétique et au moment où les troupes russes n’étaient pas en mesure d’intervenir. En outre, le Comité polonais de la libération nationale a commencé d’accomplir sur le territoire libéré une réforme agraire qui lui vaut l’adhésion enthousiaste de la population. Les terres appartenant aux réactionnaires émigrés sont distribuées aux paysans. C’est de là que la Pologne de demain tirera sa force, comme la France de la Révolution tira la sienne de la vente des biens nationaux. »
Staline, alors, m’interpella : « Vous avez dit que la France a de l’influence sur le peuple polonais. C’est vrai ! Mais pourquoi n’en usez-vous pas pour lui recommander la solution nécessaire ? Pourquoi prenez-vous la même position stérile que l’Amérique et l’Angleterre ont adoptée jusqu’à présent ? Nous attendons de vous, je dois le dire, que vous agissiez avec réalisme et dans le même sens que nous. » Il ajouta, en sourdine : « D’autant plus que Londres et Washington n’ont pas dit leur dernier mot. » — « Je prends note, dis-je, de votre position. J’en aperçois les vastes conséquences. Mais je dois vous répéter que le futur gouvernement de la Pologne est l’affaire du peuple polonais et que celui-ci, suivant nous, doit pouvoir s’exprimer par le suffrage universel. » Je m’attendais à quelque vive réaction du maréchal. Mais, au contraire, il sourit et murmura doucement : « Bah ! nous nous entendrons tout de même. »
Voulant achever l’exploration, je demandai à Staline quel sort il envisageait pour les États balkaniques. Il répondit que la Bulgarie, ayant accepté les conditions d’armistice des alliés, garderait son indépendance, mais « qu’elle recevrait le châtiment mérité » et qu’elle devrait, elle aussi, devenir « démocratique. » Il en serait de même pour la Roumanie. La Hongrie avait été sur le point de se rendre aux alliés. Mais les Allemands, l’ayant appris, — « je ne sais comment », dit Staline, — avaient arrêté le régent Horthy. « S’il se forme en Hongrie, ajouta le maréchal, un gouvernement démocratique, nous l’aiderons à se tourner contre l’Allemagne. » Point de problème de cette sorte pour la Yougoslavie, « puisqu’elle était rassemblée et dressée contre le fascisme. » Staline parla avec fureur de Mikhaïlovitch, dont il semblait croire que les Anglais le tenaient caché au Caire. Quant à la Grèce, « les Russes n’y ont pas pénétré, laissant la place aux troupes et aux navires britanniques. Pour savoir ce qui se passe en Grèce, c’est donc aux Britanniques qu’il y a lieu de s’adresser. »
De cette séance, il ressortait que les Soviétiques étaient résolus à traiter suivant leur gré et à leur façon les États et les territoires occupés par leurs forces ou qui le seraient. On devait donc s’attendre, de leur part, à une terrible oppression politique en Europe centrale et balkanique. Il apparaissait qu’à cet égard Moscou ne croyait guère à une opposition déterminée de Washington et de Londres. Enfin, on discernait que Staline allait tâcher de nous vendre le pacte contre notre approbation publique de son opération polonaise. «
in Charles de Gaulle, Mémoires de Guerre, ch. « Le rang », p. 65-7, 1960
numérisé sur http://archive.org/stream/mmoiresdeguerr03gaul/mmoiresdeguerr03gaul_djvu.txt,