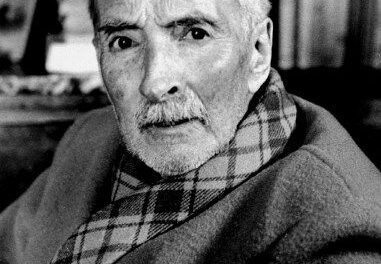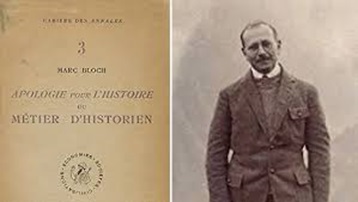“Définir une intrigue, pour un historien, c’est d’abord configurer son sujet. Il ne le trouve jamais tout fait, il le construit, il le façonne par un acte inaugural et constitutif qu’on peut désigner comme une mise en intrigue (emplotment dans la littérature américaine).
La mise en intrigue commence par le découpage de l’objet, l’identification d’un début et d’une fin. Le choix des limites chronologiques n’est pas le bornage d’un champ que l’on voudrait labourer, mais la définition de l’évolution qu’on veut expliquer, et donc de la question à laquelle on va répondre. Le découpage de l’intrigue décide déjà du sens de l’histoire. Un récit de la guerre de 1914 qui commence en 1871 et finit en 1933 n’est pas l’histoire de la même guerre que s’il avait commencé en 1914 pour finir aux traités de 1919…
La mise en intrigue porte aussi sur les personnages et les scènes. Elle est choix des acteurs et des épisodes. Toute histoire comporte, implicite, une liste de personnages et une suite de décors. Pour rester dans la guerre de 1914, on ne construira pas la même intrigue si l’on prend en compte l’arrière, les femmes, les vieux, les enfants, ou si l’on se limite aux soldats…
La mise en intrigue décide aussi du niveau auquel l”historien se place : il peut voir son intrigue de plus ou moins près. Il lui faut en quelque sorte choisir la distance focale et le pouvoir de définition de ses lentilles. En effet, toute histoire peut toujours être racontée avec plus ou moins de détails…
La construction de l’intrigue est l’acte fondateur par lequel l’historien découpe un objet particulier dans la trame événementielle infinie de l’histoire. Mais ce choix implique bien davantage : il constitue des faits comme tels…
La mise en intrigue configure donc l’oeuvre historique, et elle décide même de son organisation interne. Les éléments retenus sont intégrés en un scénario, à travers une série d’épisodes ou de séquences soigneusement agencées. L’agencement chronologique est le plus simple, mais il n’a rien de nécessaire.”
Antoine Prost, Douze leçons sur l’histoire, Paris, Seuil, 1996 P.245 à 247