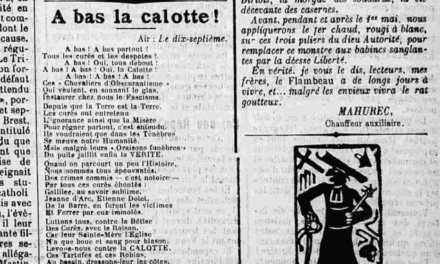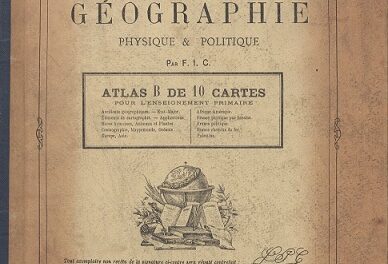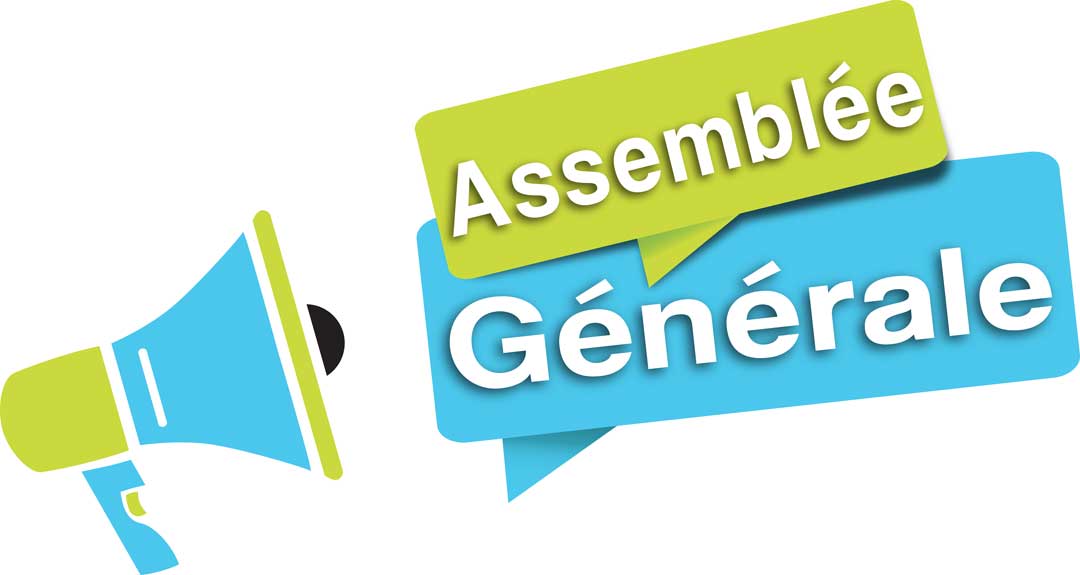Discours de M. COMBES, Président du Conseil
MESSIEURS,
Quelque éloigné que je sois par habitude et par goût de rechercher les occasions de me produire en public, je ne peux que m’applaudir aujourd’hui d’avoir cédé aux instances de mon excellent ami, M. Bienvenu Martin, et de vos autres représentants, et d’avoir accepté la présidence de cette fête locale. L’accueil si cordial qui m’était réservé, l’universelle et manifeste allégresse de la foule, la spontanéité des ovations vraiment enthousiastes dont je suis l’objet, toutes ces marques de la communauté de sentiments qui m’unit à vos populations si ardemment, si profondément républicaines, sont bien propres à échauffer l’âme la plus froide et à laisser dans l’imagination la moins impressionnable d’ineffaçables souvenirs. (Applaudissements.)
II déplaît à certaines gens que j’invoque ces manifestations populaires. C’est à leurs yeux, d’un très mauvais goût de l’aire étal des adhésions publiquement données par le parti républicain à la politique du Cabinet. La publicité n’est bonne, paraît-il, que pour les protestations dirigées contre cette politique. Celles-là, le Gouvernement est tenu de les subir et de les enregistrer. Mais il lui est interdit surtout de s’en autoriser pour persévérer dans une politique si malencontreusement encouragée. Qui sait si je ne donne pas moi-même, en la défendant, un détestable exemple de suffisance et d’indélicatesse ? Peut-être même n’ai-je pas le droit de faire observer que je suis obligé de me justifier par cela même qu’on m’accuse. Car on me répondrait que le moi est haïssable et doit être banni de mes discours. Messieurs, au risque de m’exposer à des critiques encore plus acerbes, je ne me départirai pas de la règle générale que je me suis tracée. Si je me fais quelquefois un devoir et toujours un plaisir de participer à des fêtes populaires, ce n’est pas, croyez-le bien, pour la vaine et puérile satisfaction d’y faire acclamer le Président du Conseil, c’est pour soumettre sa personne et ses actes à l’appréciation de ses juges naturels, les électeurs républicains, et ma règle absolue est de leur exposer en toute franchise ce que j’ai fait et ce que je me propose de faire. (Vifs applaudissements.)
Il y a du moi forcément dans cette façon d’opérer. Mais je me permets de penser que ce moi n’est haïssable que pour ceux qui font métier de haïr la politique dont il est l’organe, politique essentiellement agissante, qui ne vise pas plus à la finesse des aperçus et à l’élégance des formules qu’à la pompe des phrases, politique résolument réformatrice, qui puise sa raison d’être et ses motifs d’action dans les besoins reconnus et les aspirations constatées du parti républicain, politique de combat pour le présent et de paix pour l’avenir, qui se rattache à sa politique courageuse et prévoyante de nos chefs les plus honorés, Gambetta, Jules Ferry, Paul Bert, Waldeck-Rousseau, et se caractérise par la même lutte ardente, la même offensive vigoureuse contre le même ennemi, cette réaction cléricale au sein de laquelle se sont données rendez-vous les convictions hésitantes et les factions hostiles à la République.
J’ai nommé Waldeck-Rousseau. Ce grand républicain nous appartient après sa mort quoi que l’Eglise ait pu entreprendre sur son cadavre (Vifs applaudissements), quoi que la congrégation ait pu comploter contre sa mémoire, comme il nous appartenait de son vivant, nonobstant certaines divergences de vues, qui s’expliquent facilement par la trempe de son caractère et des détails encore ignorés ou mal connus des deux dernières années de sa vie.
Messieurs, tant que sera nécessaire notre politique d’action républicaine, nous serons condamnés à entendre les mêmes accusations injustes, à subir les mêmes attaques passionnées, et nous serons conduits, comme contre – partie, à présenter des réfutations de ces attaques et de ces accusations. Le pays jugera les uns et les autres. Que dis-je? Le pays a déjà jugé, et il a jugé contre les attaques en faveur des réfutations. (Applaudissements.)
Les Dernières élections
Je me fonde pour le déclarer sur les deux dernières consultations du suffrage universel. Oui, Messieurs, le pays est maintenant fixé sur le caractère véritable des élections municipales. Il sait qu’elles ont procuré au gouvernement un succès du meilleur aloi.
L’opposition, déconcertée par ce succès, s’est bien ingéniée tout d’abord à nier sa signification politique et son étendue, Mais ses dénégations de la première heure n’ont pu tenir contre l’évidence des faits.
Elles ont été promptement démenties par la nomination des municipalités, qui a mis en pleine lumière de la façon la plus saisissable la vraie composition des Conseils municipaux, avec cette particularité précieuse à relever, que nombre de Conseils, classés d’abord douteux par les Préfets, à qui le Gouvernement avait prescrit la plus scrupuleuse sincérité, se sont révélés d’eux-mêmes, par le choix des Maires, comme nettement acquis à la politique gouvernementale.
Puis, Messieurs, sont arrivées place Beauveau les adresses de sympathies et de dévouement en nombre tellement considérable que les plus anciens fonctionnaires du Ministère de l’Intérieur ne se souviennent pas d’avoir assisté, sous aucun autre Cabinet, je ne dis pas à une telle affluence, je dis à quelque chose d’approchant. (Vifs applaudissements.)
Messieurs, la déconvenue n’a pas été moins cruelle pour les adversaires du Gouvernement dans les élections départementales. Au lendemain de cet autre scrutin, qui trompait leurs prévisions effrontément optimistes, certains d’entre eux ont essayé de balbutier quelques réponses incohérentes, de se réfugier dans quelques réserves embarrassées.
D’autres ont pris prétexte de quelques erreurs de noms commises par des correspondants mal informés d’une agence pour jeter de la suspicion sur les statistiques du Ministère et révoquer en doute leur exactitude. Cette pitoyable échappatoire a été dédaignée même par une partie de leurs amis. Car, si les journaux progressistes, remontés de leur premier désappointement à grand renfort d’audace par une association soi-disant nationale républicaine et, plus exactement, nationaliste républicaine, ont persisté à soutenir que le Ministère avait essuyé un revers électoral, les organes d’une opposition plus accentuée et plus franche, sans être plus violente, ont avoué honnêtement, en face des résultats vérifiés, que le suffrage universel, en s’obstinant dans un engouement aveugle pour le Cabinet, décourageait l’opposition la plus intrépide. (Applaudissements.)
Et pourtant, Messieurs, jamais circonstances politiques n’avaient été plus propices à une levée de boucliers contre le Ministère. Le conflit du Gouvernement français avec la Papauté avait atteint son plus tout point d’acuité. Il venait d’aboutir à la rupture des relations diplomatiques. (Applaudissements répétés.)
L’opposition s’attendait cette fois, du moins paraissait s’attendre à une protestation générale du suffrage populaire. Elle comptait que la France, témoin attristé des méfaits d’un gouvernement sectaire, saisirait avec empressement l’occasion de lui signifier qu’elle en avait assez de sa politique irréligieuse et qu’elle allait châtier par son bulletin de vote les attentats journellement perpétrés contre le Dieu de ses pères.
Hélas ! Messieurs, le Dieu de nos pères, qui devait armer d’un papier vengeur la main de l’électeur, s’est montré d’une longanimité, d’une indifférence sans pareille. Nulle part ses éclairs n’ont illuminé le ciel politique. Nulle part sa foudre n’a pulvérisé les urnes criminelles. (Rires et applaudissements.)
Le scrutin s’est déroulé tout le long du jour dans une tranquillité parfaite. Catholiques et mécréants se sont coudoyés devant l’urne sans éprouver la moindre envie d’en venir aux mains.
Visiblement, ce jour-là, le ciel s’est désintéressé des choses de la terre, et peut-être, ce faisant, a-t-il voulu donner à ses croyants un exemple salutaire, dont nous souhaitons qu’ils se souviennent, quand les Chambres auront à instituer un nouveau mode d’existence pour les deux sociétés, civile et religieuse.
Le dépouillement des votes et la proclamation du scrutin se sont faits au milieu du même calme. Il en est sorti, à la confusion de ceux qui avaient spéculé sur une intervention céleste, une nouvelle approbation de la politique gouvernementale et un surcroît de force pour le Cabinet. Toutes les Croix de France en ont tressailli d’horreur. Tous les journaux de sacristie en ont poussé des cris de colère. Mais tous ont été d’accord pour reconnaître à cette importante consultation le caractère d’une épreuve éminemment douloureuse à l’âme des dévots et des dévotes.
Une Statistique édifiante
Au reste, Messieurs, jamais douleur ne fut plus justifiée. 1 554 conseillers généraux étaient soumis
au renouvellement. De ce nombre, 844 étaient ministériels, 673 antiministériels, 37 douteux. Après le renouvellement, le nombre des ministériels monta de 844 à 978 ; celui des antiministériels baissa de 673 à 535 ; celui des douteux fut de 41.
Il faut bien supposer que les journaux progressistes ont été moins prompts dans la soumission due aux dessins impénétrables de la Providence, ou peut-être, sont-ils restés quelque peu voltairiens, en dépit de leurs accointances intimes avec les défenseurs de l’autel. Car ils ont continué de passer les opérations du scrutin au crible de leur incrédulité rechignante, ils ont découvert que cinq ou six députés du Bloc ont succombé dans la journée du 31 juillet, par suite de circonstances locales.
Ils ont découvert en même temps que 41 conseillers généraux ministériels avaient été battus, et ils ont opposé triomphalement défaites partielles à la victoire d’ensemble et aux 171 gains des troupes gouvernementales ces partielles à la victoire d’ensemble et aux 171 gains des troupes gouvernementales. On se console comme on peut. Les journaux progressistes se sont consolés, en donnant une vigoureuse entorse aux règles de l’arithmétique. (Rires et applaudissements.)
Malheureusement pour eux, cette maigre consolation n’a pu les préserver d’un déboire final. Les Conseils généraux se sont réunis. Les effets de l’élection ont apparu à ce moment sous la forme la moins discutable. Chaque département a pu les contrôler, en comparant les bureaux nouvellement élus avec les bureaux antérieurs.
Avant le renouvellement, les bureaux des assemblées départementales se divisaient de la manière suivante :
– Bureaux ministériels : 61
– Bureaux antiministériels : 26
– Bureaux mixtes et douteux : 3
Après le renouvellement, la composition des bureaux a été modifiée comme suit :
– Ministériels : 62
– Antiministériels : 20
– Douteux : 3
En outre, les ministériels gardent la majorité connue avant, dans les Conseils généraux des Bouches-du-Rhône, des Alpes-Maritimes, du Gers, de la Corse et des Pyrénées-Orientales, qui ne se sont pas encore réunis. Ce qui porte à 67 le nombre des Conseils généraux ministériels. Ainsi, les ministériels ont déplacé à leur profit la majorité dans 6 Conseils généraux.
La plupart de ces Conseils ont voulu corroborer par une manifestation expresse de leurs sentiments la signification d’ailleurs non équivoque qui se dégageait de l’élection de leurs bureaux.
Cinquante ont fait parvenir au Ministère, sous forme d’adresses, l’assurance de leur sympathie et de leur concours.
Messieurs, au simple énoncé des chiffres que je viens de citer, l’esprit le moins logique conclura nécessairement que la politique ministérielle est sortie victorieuse de la dernière épreuve. (Vifs applaudissements.)
La conclusion s’imposera d’autant plus rigoureusement que les partis d’opposition avaient fait porter tous leurs efforts, concentré tous leurs appels aux électeurs sur le désaveu de cette politique. Aussi, n’est-ce plus que pour la forme et du bout des lèvres qu’ils imputent la victoire du Cabinet à la pression administrative et à l’intimidation. Comme si une telle pression était possible à un Gouvernement dépourvu des moyens de l’exercer ! Comme si l’intimidation pouvait se concevoir dans un régime de libertés publiques, qui soustrait le dernier des citoyens à l’autorité arbitraire du pouvoir !
La vérité, Messieurs, c’est que les élections des Conseils généraux ont jeté l’opposition dans le plus complet désarroi ; c’est qu’elles ont attesté avec éclat la parfaite identité d’aspirations et de vues qui existe entre le Ministère et le pays républicain. (Cris : Oui ! Oui ! Applaudissements.)
Certes, le Cabinet ne saurait être mal venu à s’en glorifier. Mais ce serait rapetisser misérablement le succès obtenu que de le restreindre aux proportions d’une satisfaction ministérielle, quelque légitime qu’elle puisse être. Le succès fait plus qu’honorer les hommes qui détiennent le pouvoir. Il consacre un système politique pratiqué depuis plus de deux ans avec un esprit de suite que personne ne contestera, attaqué dans le même laps de temps par tous les partis d’opposition avec un acharnement qu’on ne contestera pas davantage, et cette consécration est d’autant plus imposante qu’elle s’ajoute à une consécration de même nature, qui s’est produite dans des conditions identiques trois mois auparavant.
Messieurs, le système politique en question consiste dans la subordination de tous les corps, de toutes les institutions, quelles qu’elles soient, à la suprématie de l’Etat républicain et laïque.
Il a pour base, en thèse générale, le principe fondamental de la Révolution, la souveraineté nationale, pour formule dernière et pour conclusion, la sécularisation complète de la société.
La République de 1870 a débarrassé la France de la dernière forme de la Monarchie. Le Ministère actuel entend que la République de nos jours l’affranchisse absolument de toute dépendance, quelle qu’elle soit, à l’égard du pouvoir religieux.
Tous ses actes depuis son avènement au pouvoir ont été calculés vers ce but. C’est pour l’avoir poursuivi avec une opiniâtreté de tous les instants qu’il a ameuté contre lui les tenants de toutes les réactions; de la réaction royaliste, dont le représentant se morfond piteusement dans les intrigues impuissantes de l’exil; de la réaction bonapartiste, qui guette inutilement derrière quelque caserne l’occasion d’un coup de force ; de la réaction nationaliste, qui ne rougit pas de prostituer le patriotisme à la résurrection du pouvoir personnel ; de la réaction cléricale, la plus insidieuse et la plus redoutable de toutes, parce qu’elle est le trait d’union des trois autres et qu’elle déguise sous un masque républicain son projet d’asservissement intellectuel et moral. (Applaudissements. )
L’oeuvre de sécularisation du Ministère
Messieurs, quand nous avons pris le pouvoir, nous avons trouvé la France envahie et à demi conquise par les ordres religieux. Notre premier soin a été de refouler les envahisseurs au delà des frontières.
La loi des associations nous en fournissait les moyens à l’égard des congrégations non autorisées. Nous en avons fait l’application à tous les ordres enseignants, prédicants et commerçants, qui n’avaient pas d’existence légale.
Des décrets du premier Empire et une loi de la Restauration, aggravés par d’autres décrets subséquents, avaient livré la France à une invasion monacale plus ancienne, qui l’avait couverte d’un flot dévastateur de 914 congrégations. Sans désemparer, nous avons pris à partie celles de ces congrégations qui s’adonnaient à l’enseignement et qui, par un enseignement de doctrines contre-révolutionnaires, battaient en brèche l’édifice républicain.
Nous avons proposé et fait voter par les Chambres la suppression des congrégations enseignantes.
Conformément à ce vote, nous avons fermé aussitôt leurs établissements, partout où nos écoles communales disposaient de locaux assez vastes pour recevoir leurs élèves.
Nous ne perdons pas de vue qu’il nous appartient de fixer des délais pour la fermeture des autres établissements similaires, en tenant compte de la situation financière des communes. Nous nous emploierons de notre mieux à l’accomplissement de cette tache. Car il nous tarde plus qu’à qui que ce soit de pouvoir dire en toute vérité qu’en France l’enseignement congréganiste a vécu. (Bravos)
Messieurs, s’il se rencontrait par hasard dans cette réunion, comme il s’est rencontré fâcheusement ailleurs, des républicains assez mal avisés pour nous reprocher d’avoir fait jusqu’à ce jour de la lutte contre les congrégations l’objet principal de notre activité et le point culminant de notre politique, qu’ils veuillent bien méditer un petit tableau d’ensemble qui les éclairera tout à la fois sur l’étendue du péril couru par la République et sur la nécessité d’une action décisive pour le conjurer.
An moment de notre arrivée aux affaires, le 7 juin 1902, il existait, eu France, 914 congrégations autorisées, dont 5 congrégations d’hommes et 909 congrégations de femmes, et 457 congrégations en instance d’autorisation, dont 61 d’hommes et 396 de femmes, en tout 1 371 congrégations.
Oui, Messieurs, dans ce beau pays de France, où la liberté, paraît-il, n’est plus qu’un souvenir de temps lointains, sous cette République, qui n’a pas d’égale au monde pour l’intolérance, au dire de la société bien pensante, un siècle seulement après la Révolution française, qui avait aboli les ordres monastiques, 1371 congrégations religieuses d’hommes, de femmes, autant ou plus que l’ancien régime n’en avait connu, s’étaient librement et grassement constituées.
Les 5 congrégations d’hommes autorisées occupaient 1 450 établissements et les 909 congrégations de femmes étaient réparties dans 15 915 établissements.
Quant aux congrégations en instance d’autorisation, les 61 congrégations d’hommes avaient fondé 1 964 établissements et les 396 congrégations de femmes, 1 534 établissements.
Ainsi, Messieurs, les établissements congréganistes de tout genre s’élevaient au chiffre formidable de 20 823. (Exclamations.)
Ce chiffre se décomposait en 16 904 établissements enseignants et 3 919 établissements mixtes, c’est-à-dire enseignants et hospitaliers ou contemplatifs, ou bien purement hospitaliers ou purement
contemplatifs.
Pour des raisons connues de tout le monde et approuvées par le Parlement, le Ministère a du négliger pour un temps la dernière catégorie d’établissements et s’occuper d’abord des établissements
d’enseignements, les plus dangereux sans contredit pour l’avenir de la République.
Messieurs, vous l’avez vu à l’oeuvre. C’est à vous de dire s’il s’est montré à hauteur de sa tâche.
Sans se lasser une minute, pendant deux années consécutives, sans prendre garde aux injures, aux calomnies, ce qui devait lui être plus pénibles, aux défections, il a continué méthodiquement la mission dont il s’était chargé.
A l’heure actuelle, sur 16 904 établissements d’enseignement congréganiste, 13 904, près de 14 000, ont été fermés. Nous nous proposons d’utiliser les crédits inscrits au budget de 1905 pour prononcer 500 fermetures nouvelles sur 3 000 établissements qui restent à supprimés. (Vifs applaudissements.)
Les insolences de la Papauté Messieurs, c’est beaucoup, on en conviendra, pour un Ministère forcé de combattre à tout instant pour son existence propre, d’être parvenu à expulser de notre France les ordres religieux qui aspiraient à la subjuguer. Il nous reste un autre devoir à remplir pour répondre à l’attente du parti républicain, c’est de libérer la société française de la sujétion traditionnelle que font peser sur elle les prétentions ultramontaines. (vifs applaudissements)
Depuis un siècle, l’Etat français et l’Eglise catholique vivent sous un régime concordataire qui n’a jamais produit ses effets naturels et légaux. Ce régime a été présenté au monde comme un instrument de pacification sociale et religieuse. C’est là, du moins, le caractère conventionnel que ses partisans lui ont gratuitement attribué. En réalité, il n’a jamais été qu’un instrument de lutte et de domination.
Sous les gouvernements autoritaires, comme le premier Empire, l’Etat s’en est servi pour contraindre le clergé catholique à la soumission la plus humiliante, aux adulations les plus basses, même à un rôle répugnant de policier, en usant contre les ministres des cultes récalcitrants de moyens coercitifs violents. (Cris : Oui ! oui ! et applaudissements.)
Sous les gouvernements faibles et timorés, qui se piquaient de pratiquer l’alliance du trône et de l’autel, c’est l’Eglise qui s’est prévalue du Concordat pour assurer sa prépondérance, en supprimant de fait toutes les clauses des articles organiques qui gênaient son dogmatisme intolérant.
La République, n’ayant pour elle ni la crainte résultant des habitudes violentes du pouvoir personnel, ni les bénéfices corrélatifs d’une pieuse docilité, s’est débattue depuis plus de trente ans dans des difficultés inextricables pour régler, conformément au pacte concordataire, les rapports de l’autorité civile et de l’autorité religieuse. Toutes ses tentatives sont demeurées infructueuses. Ses ministres, même les mieux intentionnés, ont du céder finalement, après d’inutiles efforts, ou sentiment de leur impuissance.
On peut dire que, depuis plus de trente ans, le pouvoir ecclésiastique a exploité le Concordat au profit de ses intérêts avec une hardiesse croissante. II l’a audacieusement violé, il l’a violé sans discontinuité dans toutes celles de ses prescriptions qui proclament les droits du pouvoir civil.(Bravos.)
Et ce n’est pas 1à, .Messieurs, une affirmation sensationnelle, une thèse de circonstance réservée à dessein pour une réunion populaire. Je l’ai portée moi-même, il y a dix-huit mois, à la tribune du Sénat, en l’appuyant de nombreux exemples, tous plus convaincants les uns que les autres, et le Sénat en a reconnu le bien fondé, puisqu’il a ordonné l’affichage de mon discours.
Mais, Messieurs, sans même remonter à cette date, prenez les faits les plus récents. Qu’avez-vous vu hier ? Que voyez-vous aujourd’hui ?
Vous avez vu nos évêques, à très peu d’exceptions près, au mépris des prohibitions les plus certaines de notre législation concordataire, se concerter en vue de manifestations collectives, ou se livrer, tantôt isolément, tantôt simultanément, à des manifestations individuelles contre les actes les plus réguliers du gouvernement.
Vous les avez vus, vous les voyez quotidiennement, en guise de bravade contre l’application de la loi des associations aux ordres religieux, ouvrir avec fracas les chaires de nos églises aux membres des congrégations dissoutes, qui n’ont jamais eu le droit d’y monter.
Vous les avez vus, vous les voyez s’insurger avec arrogance contre les décisions des Chambres et l’autorité de la loi, prêcher l’insoumission à leurs fidèles dans des documents publics, en alléguant que la loi des hommes doit s’effacer devant la loi de Dieu, encourager, a l’occasion de l’exécution des mesures les plus légales, les mouvements les plus tumultueux, quand ils ne les provoquent pas eux-mêmes, et recevoir de Rome à ce propos des approbations explicites.
Rome, de son côté, sans nul souci de nos textes légaux les plus formels, donne pleins pouvoirs à son nonce et à ses tribunaux étrangers de correspondre directement avec nos évêques, de fausser la situation officielle de ceux qui lui déplaisent, en les mutilant dans leurs attributions essentielles, de leur intimer des ordres manifestement contraires aux lois organiques du Concordat.
Alors que le Concordat attribue au Gouvernement, de la façon la plus nette, la nomination des évêques, Rome refuse systématiquement l’investiture canonique aux prêtres promus à l’épiscopat par le Gouvernement, sous prétexte qu’elle doit être consultée préalablement à toute nomination. Elle s’arroge ainsi le droit d’écarter de l’épiscopat qui bon lui semble, en dehors de toute raison canonique de doctrine ou de moralité, sans même se croire obligée de fournir le moindre motif à l’appui de ces évictions arbitraires. C’est le bon plaisir remplaçant la légalité concordataire.
Malheur à ceux de nos prêtres qui sont signalés là-bas par les meneurs de notre réaction ou par les Jésuites dispersés dans nos villes, comme coupables d’une soumission respectueuse au Gouvernement et aux lois de leur pays !
Même les immixtions anticoncordataires dans nos affaires intérieures ne suffisent plus à la Papauté.
Qui de vous ne se souvient de son injurieuse protestation contre la visite rendue par le Président de la République au souverain de l’Italie? Qui n’a présente à l’esprit la circulaire insolente envoyée à ce propos par la Curie romaine aux puissances catholiques de l’Europe?
Ainsi, Messieurs, nous devons l’avouer humblement, nous n’avons pas été plus heureux que nos devanciers dans nos efforts obligatoires pour réfréner chez les représentants du pouvoir religieux le mépris outrecuidant du texte concordataire. (applaudissements)
Vainement, au début de notre Ministère, avons-nous annoncé que nous nous placions sincèrement sur le terrain du Concordat. Vainement, avons-nous déclaré que nous ferions l’essai loyal de ce régime, estimant qu’il serait prématuré et impolitique de l’abandonner avant de l’avoir soumis à une dernière et décisive expérience. Loin de s’arrêter, les violations du Concordat par le pouvoir ecclésiastique ont suivi leur cours habituel.
Je ne dis pas assez : elles se sont multipliées au delà de toute mesure, elles se sont en quelque sorte exaspérées, à la suite de l’application de la loi des associations aux ordres religieux. La Curie romaine et l’épiscopat français n’ont plus observé le moindre ménagement dans l’exposé public comme dans la mise en pratique de leurs prétentions.
Une heure est venue, où patienter encore et nous taire n’aurait pas été seulement une faiblesse insigne, mais une abdication avouée de nos droits, un manquement impardonnable à nos devoirs.
Force nous était, sous peine de trahison envers la République, d’élever une suprême protestation. (Vifs applaudissements.)
Nous avons mis en demeure le pouvoir ecclésiastique, violateur obstiné du pacte concordataire, de rentrer dans la vérité, dans le respect légal du texte, de nous faire savoir une fois pour toutes, par oui on par non, s’il entendait se soumettre aux obligations du Concordat, comme le Gouvernement s’y était lui-même constamment soumis.
La mise en demeure restant sans effet, nous avons signifié au Vatican la rupture des relations diplomatiques.
La Dénonciation du Concordat est à présent inévitable
Messieurs, aucun homme réfléchi n’a pu se méprendre sur la situation nouvelle qui est née, tant des réponses évasives de la Curie romaine que de la résolution prise par le Gouvernement. Le pouvoir religieux a déchiré ostensiblement le Concordat. En ce qui me concerne personnellement, il n’entre pas dans mes intentions de le rapiécer. Ce serait perdre son temps et duper l’opinion républicaine que de l’essayer.
(Bravos.)
En séparant délibérément la convention diplomatique des articles organiques qui avaient déterminé les Chambres françaises à l’accepter, le Pape de l’époque et, après lui, ses successeurs, lui ont ôté son efficacité, par cela même qu’ils ont annulé les règlements de police destinés à l’appliquer. Faut-il rappeler, au surplus, que l’avant-dernier Pape, Pie IX, l’a caractérisée expressément comme un don gracieux de la puissance pontificale, comme une simple concession motivée par la dureté des temps ? Tout aussi hardi et tout aussi franc, le Pape de nos jours, qui certes n’a pas adopté le vocable qu’il porte pour renier les doctrines de Pie IX, ne se prêterait pas à une convention nouvelle qui ne serait pas la justification explicite de l’attitude antérieure de la Papauté. Comme aucun Ministère français, fût-il composé des éléments républicains les plus modérés, ne pourrait entrer dans une négociation de cet ordre sans revendiquer hautement les droits méconnus de l’Etat, il est évident que la seule voie restée libre aux deux pouvoirs en conflit, c’est la voie ouverte aux époux mal assortis, le divorce et, de préférence, le divorce par consentement mutuel.(applaudissements et rires)
Je n’ajoute pas, remarquez-le, pour cause d’incompatibilité d’humeur. Car il ne saurait être question, dans l’espèce, d’accès d’irritation et de mauvaise humeur. Il s’agit d’une chose bien autrement sérieuse et grave; il s’agit d’une incompatibilité radicale de principes. (rires et applaudissements)
Ce que devra être le Régime nouveau
Messieurs, je crois sincèrement que le parti républicain, éclairé enfin pleinement par l’expérience des deux dernières années, acceptera sans répugnance la pensée du divorce, et je crois aussi, disons mieux, je suis sûr qu’il l’acceptera, non dans un sentiment d’hostilité contre les consciences chrétiennes, mais dans un sentiment de paix sociale et de liberté religieuse. C’est aussi sous l’empire du même sentiment que la Chambre abordera la question de la séparation des Eglises et de l’Etat, déjà étudiée avec beaucoup de soin par une des Commissions dont les travaux, heureusement empreints d’un sincère désir de conciliation, serviront de base à une discussion également conciliante et sincère.
Il importe que les républicains fassent preuve dans ce débat d’une largeur d’idées et d’une bienveillance envers les personnes qui désarment les défiances et rendent acceptable le passage de l’ordre de choses actuel à l’ordre de choses à venir.
Qu’il s’agisse des édifices affectés au culte ou des pensions à allouer aux titulaires actuels des services concordataires, il n’est pas de concession raisonnable, pas de sacrifice conforme à la justice que je ne sois disposé pour ma part à conseiller, afin que la séparation des Eglises et de l’Etat inaugure une ère nouvelle et durable de concorde sociale, en garantissant aux communions religieuses une liberté réelle sous la souveraineté incontestée de l’Etat. (applaudissements)
Messieurs, nous nous étions figuré, sur la foi des déclarations hautaines, que formulaient, au nom de l’Eglise, des organes réputés autorisés, que le pouvoir religieux, loin de répugner à une séparation, ne demanderait pas mieux que de recouvrer son indépendance sous une législation lui assurant le libre fonctionnement de son culte. Il paraît que nous nous trompions. Car on nous a prévenus que la doctrine catholique repousse tout système de liberté réciproque dans les rapports de l’Eglise et de l’Etat, et l’on a invoqué, à l’appui de cette thèse, l’encyclique fameuse de Pie IX, le Syllabus. C’est une singulière façon de restituer à l’idée concordataire la faveur qu’elle a perdue dans l’opinion que de la placer sous l’égide du Syllabus, cet effroyable répertoire des sentences les plus oppressives pour la conscience et la raison humaines.
Heureusement, messieurs, nous ne sommes plus au temps on l’on pouvait s’émouvoir des anathèmes perfectionnés que le Syllabus prodigue à ceux qui le méconnaissent, et nous ne ferons pas aux républicains, même les plus timides, l’injure de croire qu’ils puissent se déterminer par des arguments de ce genre. (applaudissements et rires)
Le Protectorat d’Orient
Nous pensons de même qu’aucun d’eux ne se laissera ébranler dans ses résolutions par la menace que des feuilles amies du Vatican nous ont faite de perdre, à la suite de la séparation des Eglises et de l’Etat, le protectorat des chrétiens dans les contrées orientales.
D’abord, les deux questions ne sont pas nécessairement liées ensemble, l’une concernant uniquement nos rapports avec la Papauté, l’autre nos relations diplomatiques avec d’autres puissances. Mais je veux, sans m’arrêter à cette considération, envisager directement l’éventualité dont on cherche à nous effrayer.
Si la croyance des siècles passés a attaché au protectorat une idée de pieux dévouement et de grandeur chrétienne si elle a servi notre influence à une époque de foi, il s’est trouvé alors aussi, qu’on ne l’oublie pas, d’autres motifs très positifs et très humains, qui ont contribué largement à faire décerner à l’ancienne France un privilège glorieux, j’en conviens, dans l’esprit de ce temps, mais parfois encore plus embarrassant que glorieux. (Approbations.)
Il fallait, pour l’exercer, une puissance militaire et navale de premier ordre. La France réunissait cette double condition. Notre pays a rempli honorablement les obligations découlant des capitulations et des traités, et il peut s’étonner à bon droit de la menace dont il est l’objet.
Mais, Messieurs, la Papauté s’abuse, si elle s’imagine nous amener par ce procédé comminatoire à quelque acte de résipiscence. Nous n’avons plus la même prétention au titre de fille aînée de l’Eglise, dont la monarchie se faisait un sujet d’orgueil pour la France, et nous avons la conviction absolue que notre considération et notre ascendant dépendent exclusivement aujourd’hui de notre puissance matérielle, ainsi que des principes d’honneur, de justice et de solidarité humaine, qui ont valu à la France moderne, héritière des grandes maximes sociales de la Révolution, une place à part dans le monde. (Applaudissements prolongés.)
Je me refuse donc à considérer le privilège dont il s’agit comme un motif susceptible de nous détourner de la séparation de l’Église et de l’Etat et, à plus forte raison, de nous faire passer sous les fourches caudines de la Papauté.
J’observe, en outre, que les autres puissances n’ont pas attendu que la séparation fût votée pour substituer vis a vis de leurs nationaux, comme le suggèrent la raison et la nature des choses, leur initiative propre à celle de notre diplomatie.
Le Programme du Cabinet
Messieurs, tout à l’heure, j’ai cru devoir résumer devant vous en quelques chiffres significatifs les résultats de notre lutte contre la congrégation, afin que vous puissiez vous rendre compte de son importance et de ses difficultés. Quand même une pareille lutte aurait absorbé entièrement notre action gouvernementale, nous estimons que nous aurions assez fait pour qu’on nous pardonnât, d’avoir négligé momentanément d’autres affaires, d’avoir ajourné temporairement d’antres solutions.
Qui donc oserait soutenir que c’est trop de deux ans de travaux continus pour l’oeuvre de sécularisation entreprise par le Cabinet ? (Applaudissements. )
Mais, quoi qu’en disent des adversaires trop visiblement désireux de s’emparer du pouvoir pour n’être pas suspects de partialité, notre oeuvre de sécularisation n’a pas été exclusive des réformes politiques et des améliorations sociales. En même temps que nous arrachions la société française à l’accaparement congréganiste, nous poursuivions l’exécution d’un programme bien défini, qui satisfait aux exigences les plus pressantes de la démocratie. (Applaudissements.)
Je l’ai si souvent exposé que je retomberais certainement dans des redites fatigantes, en l’exposant encore. Qu’il me suffise de rappeler que la réduction du service militaire y figure, à côté de l’impôt sur le revenu et des retraites ouvrières.
Les événements y ajoutent la séparation des Eglises et de l’Etat. ( Triple salve d’applaudissements. )
J’ai eu l’occasion d’indiquer à la tribune du Parlement suivant quel rang ces divers projets de première importance me semblaient pouvoir venir en discussion. Je n’y trouve rien à changer.
Il a été décidé par la Chambre que la session d’octobre s’ouvrirait au Palais-Bourbon par la discussion de l’impôt sur le revenu.
Il a été aussi implicitement convenu que la Chambre inscrirait en tête de son ordre du jour pour la session ordinaire de 1905 la proposition de loi relative aux retraites ouvrières.
Tous les partis, je l’espère, seront d’accord pour demander, et, en tout cas, je demanderai instamment moi-même que le débat sur la séparation des Eglises et de l’Etat commence immédiatement après. Dans le cours de la session extraordinaire de cette année, la réduction du service militaire, qui nécessite une nouvelle délibération du Sénat, devra être définitivement votée. (Applaudissements. )
Un crédit de quelques mois, fait au Cabinet, permettra de liquider un ordre du jour ainsi arrêté. C’est beaucoup demander, je le sais, à des ambitions impatientes que de réclamer un crédit de quelques mois.
Cependant j’aime à croire que, le premier moment de déplaisir passé, la solidité de leurs convictions républicaines reprendra le dessus et que, par l’ardeur généreuse qu’elles mettront à seconder l’action du Cabinet, elles abrégeront elles-mêmes le temps d’épreuve que les circonstances actuelles imposent à leur dévouement. Messieurs, fussions-nous déçus dans cette attente, nous comptons sur l’union persistante des groupes de gauche pour nous aider à surmonter les difficultés. Nous comptons sur cette union et nous avons le droit d’y compter, tant que les raisons qui l’ont fait naître n’auront pas disparu et tant que les groupes animés de l’esprit clérical s’uniront de leur côté pour entraver la marche du progrès républicain.
L’union des gauches s’est retrouvée résolue et compacte dans toutes les occasions critiques.
Elle se retrouvera telle au début de la session prochaine pour achever de concert avec le Gouvernement son oeuvre de défense et d’action républicaines.
Messieurs, un Cabinet peut avoir toute confiance dans la fidélité de ceux qui le soutiennent, quand ses regards tombent sur les hommes qui m’entourent, sur des collaborateurs aussi dévoués que mon ami Bienvenu-Martin, le Président si hautement considéré de la gauche radicale-socialiste (Vifs applaudissements) et ses collègues républicains de la représentation de l’Yonne, sénateurs et députés, que j’ai à coeur de louer publiquement par une parole de justice, qui sera en même temps une parole de reconnaissance pour leur attachement inébranlable à la politique du Gouvernement.
Messieurs, un de vos élus manque à cette fête, un des plus appréciés, des plus laborieux et des plus fidèles, notre ami Merlou. Mais il est de coeur avec nous. Il n’avait pas besoin de m’en donner l’assurance.
Néanmoins il a tenu à me l’apporter lui-même avant de partir pour la station où l’appelait le soin de sa santé.
Messieurs, je lève mon verre à la ville d’Auxerre, qui me reçoit avec un entrain si cordial et si chaleureux, et j’adresse à son Maire tous mes compliments. Je garderai de la visite que je fais un souvenir ému. Je bois aussi à la démocratie de l’Yonne, aux vaillants vignerons de ce département, qui s’est distingué de tout temps par l’indépendance du caractère et l’ardent amour de la liberté.