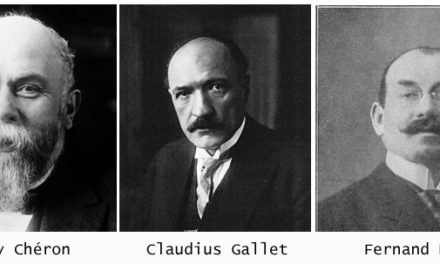DES GRANDES ÉPIDÉMIES (extraits)
Extrait n°1
Parmi les maladies, il en est qui sont aussi individuelles que les plaies et les fractures, et qui se remarquent dans tous les temps et dans tous les lieux ; il en est d’autres qui sont spéciales à certaines contrées, sans qu’il soit possible d’expliquer par quel concours de circonstances locales elles naissent dans un tel district, et pourquoi elles n’en sortent pas. Tel est le bouton d’Alep, qui attaque seulement les habitants de cette ville et les étrangers qui viennent y séjourner.
Enfin, une troisième classe de maladies a pour caractère d’envahir une immense étendue de pays ; et, ce qu’il y a de plus remarquable, c’est qu’elles n’ont pas une durée indéfinie ; je veux dire qu’elles ne sont pas aussi anciennes que les races humaines, que nos histoires en connaissent l’origine, que les unes sont déjà éteintes et ne sont pas arrivées jusqu’à nous, et que les autres, qui les remplacent, n’ont pas affligé nos aïeux et sont peut-être destinées à cesser à leur tour. Ce sont de grands et singuliers phénomènes. On voit parfois, lorsque les cités sont calmes et joyeuses, le sol s’ébranler tout à coup, et les édifices s’écrouler sur la tête des habitans ; de même il arrive qu’une influence mortelle sort soudainement de profondeurs inconnues et couche d’un souffle infatigable les populations humaines, comme les épis dans leurs sillons. Les causes sont ignorées, les effets terribles, le développement immense. Rien n’épouvante plus les hommes ; rien ne jette de si vives alarmes dans le cœur des nations ; rien n’excite dans le vulgaire de plus noirs soupçons. Il semble, quand la mortalité a pris ce courant rapide, que les ravages n’auront plus de terme, et que l’incendie, une fois allumé, ne s’éteindra désormais que faute d’alimens. Il n’en est pas ainsi ; les traits de l’invisible archer s’épuisent ; ces vastes épidémies restent toujours dans de certaines limites ; l’intensité n’en va jamais jusqu’à menacer d’une destruction universelle la race humaine. J’ai dit jamais, j’aurais dû dire dans l’intervalle des quatre ou cinq mille ans qui font toute notre histoire ; car qui peut répondre de ce que renferme l’avenir ? Des races d’animaux ont disparu du globe ; les découvertes de Cuvier sur les fossiles l’ont prouvé sans réplique. Sont-ce des épidémies plus puissantes qui, à des époques reculées, ont balayé notre planète, et qui, chassant les anciennes existences, ont fait place à de nouvelles ?
Les maladies universelles ont tout l’intérêt des grands évènemens ; le médecin en étudie les symptômes et les rapports avec d’autres maladies, et cherche en même temps à entrevoir la place qu’elles occupent dans l’enchaînement des choses du monde, et le lien par lequel les existences humaines et la planète qui les porte semblent tenir ensemble.
Dans le cadre des influences considérables qui ont agi sur les destins des sociétés, il faut faire entrer, quelque étrange que cela puisse paraître au premier coup d’œil, la pathologie, ou pour mieux dire, cette portion de la pathologie qui traite des vastes et universelles épidémies. Que sont vingt batailles, que sont vingt ans de la guerre la plus acharnée, à côté des ravages que causent ces immenses fléaux ? Le choléra a fait périr en peu d’années autant d’hommes que toutes les guerres de la révolution ; on compte que la peste noire du XIVe siècle enleva à l’Europe seule vingt-cinq millions d’individus ; la maladie qui dévasta le monde, sous le règne de Justinien, fut encore plus meurtrière. En outre, nulle guerre n’a l’universalité d’une épidémie. Que comparer, pour prendre un exemple bien connu de nous, au choléra qui, né dans l’Inde, a passé à l’est jusqu’en Chine, s’est porté à l’ouest jusqu’en Europe, l’a parcourue dans presque toutes ses parties, et est allé jusqu’en Amérique ?
La première grande maladie dont l’histoire fasse mention, est celle que l’on connaît sous le nom de peste d’Athènes, et dont Thucydide a donné une description célèbre. […]
Revue des Deux Mondes, tome 5, 1836, p.220-243
Extrait n°2
[…] Le malheur est superstitieux ; aussi les imaginations des hommes du moyen-âge s’ébranlèrent-elles à l’aspect des désastres que la peste noire leur apporta. Les flagellans, qui s’étaient montrés déjà dans le courant du siècle précédent, reparurent d’abord en Hongrie, et puis bientôt dans toute l’Allemagne. Ces bandes, peu nombreuses dans le commencement, finirent par s’augmenter, et l’on vit de toutes parts s’avancer, à travers les villes et les campagnes, de longues processions d’hommes qui chantaient des hymnes pleins de pénitence, et qui essayaient d’apaiser par leurs mortifications la colère du ciel. On les accueillait partout avec transport et souvent le même vertige enlevait soudainement à une ville une partie de ses habitans, qui commençaient le pèlerinage et ses rudes dévotions. Ce fut comme une monomanie de pénitence et de deuil qui saisit un grand nombre d’esprits en Europe ; effet combiné des vieilles superstitions et de l’épouvante nouvelle.
Mais à ces folles dévotions ne se bornèrent pas les effets de la peste sur l’esprit des peuples. Un vertige de sanglante cruauté accompagna le vertige de la superstition. Nous savons par expérience comment le vulgaire cherche à s’expliquer ces morts soudaines, mystérieuses, inévitables des épidémies. Comme le XIXe siècle, le XIVe crut aux empoisonnemens. On ferma les portes des villes, on mit des gardes aux fontaines et aux puits, et l’on accusa les juifs de l’effroyable mortalité. Alors, l’Europe tout entière offrit un des plus affreux spectacles qui se puissent concevoir. Tandis que la peste invisible dépeuplait les villes et les villages et rendait les cimetières trop étroits pour la foule des morts, des passions infernales déchaînées ajoutaient de nouvelles souffrances aux souffrances universelles, et toutes les fureurs de l’homme aux fureurs de la nature. Ce fut en Suisse que le massacre des juifs commença. On les accusa de correspondre avec les Maures d’Espagne et de s’entendre avec eux pour empoisonner les chrétiens. Mis à la torture, quelques-uns avouèrent, et l’on a encore les procès verbaux de ces prétendus jugemens. Condamnés, on les brûla ; mais la rage populaire n’attendit presque nulle part ces assassinats juridiques. Là on enferma les juifs dans leurs synagogues, et on y mit le feu. Ailleurs, plusieurs milliers de ces malheureux, hommes, femmes, enfans, sont entassés dans de vastes bûchers. À Mayence, ils essaient de résister ; vaincus, ils s’enferment dans leurs quartiers, et s’y brûlent. On veut les convertir, leur fanatisme s’en irrite, et l’on voit les mères jeter leurs enfans dans les flammes pour les arracher aux chrétiens, et s’y précipiter après eux. Ces massacres sont partout un moyen de payer les dettes contractées envers ces étrangers riches et industrieux ; puis l’on va fouiller dans leurs demeures incendiées, et on y recueille l’or et l’argent que le feu a épargnés. C’est toute l’Europe qui donne ce spectacle atroce ; les campagnes ne se trouvent pas plus sûres pour eux que les villes : les paysans traquent de toutes parts les fugitifs, la populace les massacre, les magistrats les livrent à la torture, les princes et les nobles à leurs hommes d’armes ; et les juifs, poursuivis sans pitié,ne trouvent de refuge que dans la lointaine Lithuanie, où le roi Casimir-le-Grand les reçoit sous sa protection. C’est pour cette raison qu’ils sont encore aujourd’hui en si grand nombre dans toute la Pologne. […]
Revue des Deux Mondes, tome 5, 1836, p. 239-240
Note : l’orthographe d’origine du texte imprimé a été respectée.