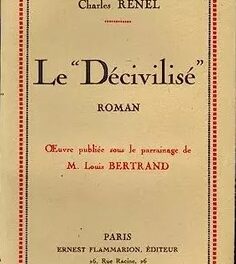UN EXEMPLE DE PARTAGE COLONIAL : L’AFRIQUE DEPECEE
Avant 1880, Les Européens disposaient pour l’essentiel d’implantations côtières. La France se réservait une partie du Maghreb, et en Afrique occidentale, le Sénégal. L’Angleterre possédait la colonie du Cap, la Côte de l’or, des compagnies commerciales anglaises travaillaient en Afrique occidentale et orientale. Toutefois, de 1870 à 1880, l’exploration de l’Afrique progresse : on découvre des richesses intéressantes, or et diamants d’Afrique du Sud, cuivre de Rhodésie. Les Européens voient miroiter, à tort souvent, l’image d’une Afrique noire riche et peuplée. Le point de départ des ambitions européennes se situe au Congo. Le roi des Belges, Léopold II, qui s’intéresse aux questions coloniales et gère une importante fortune personnelle, suscite en 1876 la fondation d’une Association internationale africaine à but essentiellement géographique : explorer le continent. Il trouve dans l’Anglais Stanley l’organisateur de l’exploration du bassin du Congo. Stanley se heurte aux ambitions françaises : Brazza s’engage dans l’arrière-pays du Gabon, sur un affluent du Congo (1875-1879); les Portugais font état de droits historiques sur l’embouchure du Congo. L’enjeu devient européen; les ambitions de Léopold se heurtent à celles d’autres pays colonisateurs. En 1884, Bismarck propose une conférence à Berlin, afin de régler les problèmes du commerce dans le bassin du Congo. Jusque-là intéressé par les seuls problèmes européens, Bismarck se rallie à l’idée de protéger les marchands allemands en Afrique. La conférence de Berlin (novembre 1884-février 1885), à laquelle participent les principaux Etats européens, rédige un « acte final ». Celui-ci, après avoir défini le bassin du Congo, établit l’obligation de respecter le libre-échange pour toute puissance colonisatrice, même en cas de guerre; il définit les conditions à remplir pour l’occupation effective des côtes et elles seules : implantation du « pavillon », autorité suffisante et notification diplomatique. L’acte, qui n’autorise aucun partage, le déclenche dans les faits. Dès lors, dans une course de vitesse, la France entreprend de constituer un vaste empire, de la Méditerranée à l’Afrique occidentale; l’Angleterre veut dominer l’Afrique orientale du Cap au Caire. La Belgique, l’Allemagne et l’Italie, moins bien lotie, se partagent le reste de l’Afrique. Des heurts nombreux opposent les grandes puissances, mais de multiples traités bilatéraux permettent de fixer les frontières. Les frontières issues de compromis entre les Européens sont artificielles et fondées sur le principe des compensations territoriales : elles divisent les ethnies africaines, les anciens royaumes. L’Afrique décolonisée en est restée tributaire.
_______________________________________________________
Extraits de l’Acte général de la conférence de Berlin du 26 février 1885.
» [Les chefs d’Etat réunis] voulant régler, dans un esprit de bonne entente mutuelle, les conditions les plus favorables au développement du commerce et de la civilisation dans certaines régions d’Afrique, (…) désireux d’autre part, de prévenir les malentendus et les contestations que pourraient soulever à l’avenir les prises de possession nouvelle sur les côtes de l’Afrique, et préoccupés, en même temps, des moyens d’accroître le bien-être moral et matériel des populations indigènes, ont résolu :
1. Le commerce de toutes les nations jouira d’une complète liberté (…) dans tous les territoires constituant le bassin du Congo et de ses affluents. (…)
5. Toute puissance qui exerce ou exercera des droits de souveraineté dans les territoires susvisés ne pourra y concéder ni monopole ni privilège d’aucune espèce en matière commerciale. (…)
6. Toutes les puissances exerçant des droits de souveraineté ou une influence dans les dits territoires s’engagent à veiller à la conservation des populations indigènes et à l’amélioration de leurs conditions morales et matérielles d’existence et à concourir à la suppression de l’esclavage et surtout de la traite des Noirs ; elles protégeront et favoriseront toutes les institutions et entreprises religieuses, scientifiques ou charitables créées et organisées à ces fins ou tentant à instruire les indigènes et à leur faire comprendre et apprécier les avantages de la civilisation. (…)
34. La puissance qui prendra possession d’un territoire sur les côtes du continent africain avertira les autres puissances signataire. (…)
Signé par : L’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, le Danemark, l’Espagne, les Etats-Unis, la France, le Royaume-Uni, l’Italie, les Pays-Bas, le Portugal, la Russie, la Suède, l’Empire ottoman. »
Idem
Chapitre premier, article 6 en entier
« Dispositions relatives à la protection des indigènes, des missionnaires et des voyageurs, ainsi qu’à la liberté religieuse.Article 6.
Toutes les Puissances exerçant des droits de souveraineté ou une influence dans lesdits territoires s’engagent à veiller à la conservation des populations indigènes et à l’amélioration de leurs conditions morales et matérielles d’existence et à concourir à la suppression de l’esclavage et surtout la traite des noirs ; elles protégeront et favoriseront, sans distinction de nationalités ni de cultes, toutes les institutions et entreprises religieuses, scientifiques ou charitables créées et organisées à ces fins ou tendant à instruire les indigènes et à leur faire comprendre et apprécier les avantages de la civilisation.
Les missionnaires chrétiens, les savants, les explorateurs, leurs escortes, avoir et collections, seront également l’objet d’une protection spéciale.
La liberté de conscience et la tolérance religieuse sont expressément garanties aux indigènes comme aux nationaux et aux étrangers. Le libre et public exercice de tous les cultes, le droit d’ériger des édifices religieux et d’organiser des missions appartenant à tous les cultes ne seront soumis à aucune restriction ni entrave. »
Tiré de: http://www.abidjandirect.net/document/ActegeneraldelaConferencedeBerlin.pdf
Afrique du Sud, le Grand Trek
Certains Boers veulent échapper à la domination anglaise du Cap. Ce sera le Grand Trek et la fondation des provinces d’Orange et du Transvaal.
« Des bruits ont circulé, qui avaient pour intention évidente d’éveiller dans l’esprit de nos compatriotes des préjugés contre ceux qui ont résolu d’émigrer loin d’une colonie où ils connaissent, depuis de longues années, des pertes et des vexations sans nombre ; or, nous voulons que nos frères continuent à nous estimer ; nous voulons qu’eux et le monde sachent bien que ce n’est pas sans raison amplement suffisante que nous tranchons le lien sacré qui unit un Chrétien à la terre où il est né. Aussi résumons-nous ici les raisons qui nous ont poussé à ce départ, et nos intentions quant aux tribus indigènes que nous rencontrerons au-delà des frontières.
1- Nous désespérons de sauver la colonie des maux qui la menacent du fait de la conduite turbulente et malhonnête de vagabonds, que l’on a autorisés à infester tout le pays ; et nous ne voyons aucun avenir pour nos enfants dans un pays aussi troublé.
2- Nous déplorons les énormes pertes qui nous ont été infligées par l’obligation d’affranchir nos esclaves, et les vexations que nous avons eu à subir à ce propos. [l’esclavage a été aboli par les Anglais en 1833] (…)
4- Nous déplorons la haine injustifiable que nous ont manifestée, sous le couvert de la religion, des personnes intéressées et malhonnêtes dont le témoignage est le seul qui soit pris en considération en Angleterre, à l’exclusion de tout ce qui peut témoigner en notre faveur ; et nous pensons que de tels préjugés ne peuvent avoir pour conséquence que la ruine totale du pays.
5- Nous sommes résolus, où que nous allions, à brandir les principes de la liberté ; mais, si nous nous engageons à veiller à ce que nul ne soit maintenu en esclavage, nous sommes également décidés à maintenir des règles propres à réprimer le crime et à préserver les relations entre maître et serviteur telles qu’elles doivent être. (…)
9- Nous quittons la colonie, certains que le gouvernement anglais n’a rien à exiger de nous et nous laissera, à l’avenir, nous gouverner nous-mêmes sans ingérence.
10- Nous quittons aujourd’hui cette riche terre qui nous a vus naître, où nous avons presque tout perdu, et où l’on nous a humiliés, pour pénétrer dans un territoire sauvage et dangereux ; mais c’est en nous appuyant sur un Etre omniscient, juste et miséricordieux. Que nous nous efforcerons de craindre et à Qui nous nous efforcerons d’obéir humblement. »
Tiré du Manifeste de Piet Retief, un des leaders du Grand Trek, en 1837.
Cité dans Paul Coquerel , « AFRIQUE DU SUD, l’histoire séparée », éd. Gallimard, Paris, 1992, pp. 134-135
Article « Négre »
« C’est en vain que quelques philanthropes ont essayé de prouver que l’espèce nègre est aussi intelligente que l’espèce blanche. Un fait incontestable et qui domine tous les autres, c’est qu’ils ont le cerveau plus rétréci, plus léger et moins volumineux que celui de l’espèce blanche. Mais cette supériorité intellectuelle qui selon nous ne peut être révoquée en doute, donne-t-elle aux blancs le droit de réduire en esclavage la race inférieure ? Non, mille fois non. Si les nègres se rapprochent de certaines espèces animales par leurs formes anatomiques, par leurs instincts grossiers, ils en diffèrent et se rapprochent des hommes blancs sous d’autres rapports dont nous devons tenir grand compte. Ils sont doués de la parole, et par la parole nous pouvons nouer avec eux des relations intellectuelles et morales, nous pouvons essayer de les élever jusqu’à nous, certains d’y réussir dans une certaine limite. Du reste, un fait plus sociologique que nous ne devons jamais oublier, c’est que leur race est susceptible de se mêler à la nôtre, signe sensible et frappant de notre commune nature. Leur infériorité intellectuelle, loin de nous conférer le droit d’abuser de leur faiblesse, nous impose le devoir de les aider et de les protéger. »
Pierre Larousse, Article « Nègre », Grand Dictionnaire Universel du 19e s. (1872)
Obock (avant Djibouti) en 1884
« 3 janvier [1884]. – Pour la seconde fois j’ai respiré les brûlants effluves de la mer Rouge, si redoutés et pourtant si doux aux malheureux qui ont souvenir des chaleurs humides du golfe Persique. Nous venons de laisser à bâbord la petite île de Périm, piton dénudé qui commande en souverain le détroit de Bab-el-Mandeb, et nous nous sommes dirigés vers la côte d’Afrique. Le commandant Nabona a l’ordre d’aller faire du charbon et des vivres frais à Obock [bourg sur la côte du territoire de Djibouti].
Bientôt les timoniers signalent le cap Ras-Bir. A l’horizon courent des montagnes qui s’étendent du nord-est au sud-ouest et s’infléchissent vers le sud, entre Obock et Tadjoura. Au bas de cette chaîne, prolongement volcanique des côtes de la mer Rouge, se présente un plateau madréporique soutenu par des falaises assez élevées. Ce plateau constitue le territoire d’Obock. Il fut acquis des chefs indigènes en 1862, par le commandant Fleuriot de Langle, et payé dix mille thalaris, soit à peu près cinquante mille francs. Sa superficie et de vingt-cinq lieues carrées.
En promenant ma lorgnette sur la côte, je distingue tout d’abord la tour de Soleillet, quelques arbres noueux, une dépression verdie par de chétifs palétuviers, le lit d’un torrent desséché, puis une maison appartenant à la Compagnie concessionnaire des dépôts de charbon, un hôpital en construction et, à quelques milles de là, un amoncellement de houille exposé au grand air.
(…) Le Tonkin s’avance prudemment dans la direction des bouées, auprès desquelles est mouillé le Brandon, stationnaire de la colonie – heureux stationnaire -, et jette l’ancre à plus d’un mille de terre. A part un minuscule vapeur de l’Etat, le Pingouin, un chaland chargé de charbon et deux ou trois barques indigènes qui ne jaugent pas quatre tonnes chacune, je ne vois navire qui vive dans cet étrange port de mer.
Cependant le Tonkin fait des signaux; le sémaphore de la tour Soleillet lui répond avec une sage lenteur, et, une heure plus tard, quelques indigènes, dont la peau noire paraît être le plus élégant vêtement, courent vers la plage, entrent dans l’eau jusqu’aux genoux et accostent le chaland de charbon. Après les noirs, arrivent, plus solennels, trois hommes blancs, tout de blanc habillés. Les Européens enlèvent leurs souliers, retroussent leurs pantalons et barbotent pendant vingt minutes avant d’atteindre de petites embarcations calant deux pieds, mais trop creuses cependant pour se rapprocher du rivage.
(…) En quittant le Tonkin, j’ai regardé le thermomètre de la cursive de tribord ; il marquait 30 degrés centigrades. Cette température hivernale donne une vague idée du plaisir que doivent ressentir les baigneurs lorsqu’ils viennent, au mois d’août, respirer l’air d’Obock-les-Bains.
Une cahute indigène, peut-être même un poste de douaniers, signale le débarcadère. Le long d’un chemin de fer Decauville réservé au transport de la poudre d’or et des dents d’éléphant, blanchit un sentier tracé dans le sable. C’est la grand-route de la factorerie. Nous laissons sur la gauche les palétuviers aperçus du bout de la lorgnette, et atteignons la falaise.
A ses pieds s’élèvent des tamaris arborescents, des mimosas noueux au feuillage fin et clairsemé. Ils abritent une trentaine de huttes couvertes d’étoffes de poil de chèvre ou formées de nattes en feuilles de palmier suspendues aux plus grosses branches. Autour de ces habitations primitives sont couchés des vaches très petites, fort maigres, et de superbes moutons blancs à tête noire, qui sembleraient parents des chèvres leurs voisines, s’ils n’avaient le poil ras et la queue développée. La population du village se précipite vers nous. J’avais médit du costume des indigènes. Les hommes entourent le bas des reins d’un pagne; quelques importants ajoutent à ce costume une sorte de toge de calicot blanc. Les femmes mûres, plus couvertes que leurs maris, s’enroulent dans des étoffes de laine, tout en laissant épaules et bras nus. La tête, protégée par une toison que les coquettes s’efforcent de natter, est décorée d’un paquet de cotonnade plié en forme de chaperon plus ou moins fantaisiste. Des bracelets d’argent, des colliers de verroterie complètent la toilette. Je n’insisterai pas sur le costume des enfants: il se réduit à une amulette attachée autour du cou.
Les Danakils sont noirs de peau, bien constitués, mais grêles de forme. Chasseurs adroits, pêcheurs habiles, coureurs rapides, ils joignent à ces qualités une cruauté et une fourberie dont ils se vantent tout les premiers. Frapper un ennemi par derrière est digne d’éloge; le massacrer, un titre de gloire. La mort d’un adversaire vulgaire donne le droit de porter une année durant la plume noire plantée dans la chevelure; une plume blanche, valable dix ans, est octroyée au vainqueur d’un lion ou d’un Européen. Il est flatteur pour l’Européen d’être traité avec autant de considération que le roi des animaux.
Ces moeurs sanguinaires sont si bien en harmonie avec le caractère de la race, qu’un homme ne saurait trouver femme s’il n’a prouvé sa valeur en tuant un de ses semblables. Les familles prévoyantes achètent même de vieux nègres affaiblis et les livrent à leurs enfants en bas âge; les chers bébés peuvent ainsi conquérir la plume noire et satisfaire, dès la plus tendre enfance, à la loi cruelle de la tribu.
Leur assimilation avec les lions rend les trois Européens d’Obock fort circonspects. L’année dernière ils n’osaient se hasarder sans armes entre leurs maisons, à peine distantes de quarante mètres. Un des plus vieux colons, M. Arnous, dont les Danakils prétendaient avoir à se plaindre, n’avait- il pas été frappé sur le seuil même de la factorerie? Aujourd’hui encore, Obock offre si peu de sécurité, que le gouverneur va coucher tous les soirs à bord du Pingouin, tandis que le corps de garde lève le pont-levis dès la tombée de la nuit et se barricade de son mieux.
Nous gravissons la falaise, formée de dépôts madréporiques, et atteignons la factorerie.
Deux corps de logis sont adossés aux murs d’enceinte: l’un réservé à l’habitation du gouverneur, l’autre au casernement vingt hommes commandés par un sergent.
Poussons plus avant. Près de la concession Menier, on me fait admirer l’emplacement d’un potager où je vois trois choux et une douzaine de laitues. Si l’on compte rafraîchir les six cents bouches du Tonkin affamées de salades avec les produits des jardins de la colonie !
Encore un espace rocheux et apparaît l’hôpital, vaste construction bâtie avec les matériaux arrachés à la falaise et recouverte d’une épaisse terrasse. A droite poussent des buissons plus bas et plus touffus que les tamaris venus sous l’oeil protecteur du gouverneur. L’extrémité de chacun d’eux est couronnée d’un vase fêlé, signe distinctif de toute habitation. Sous les rameaux de l’une de ces maisons, j’aperçois deux jeunes filles sommairement vêtues la plus jeune écrase du blé en promenant sur une pierre dure un cylindre de porphyre aminci à ses extrémités et poli sur toute sa surface ; l’autre s’occupe à regarder travailler son amie.
Comme nous les considérons, un Dankali, la lance à la main, les traits bouleversés, sort d’un épais buisson et se précipite vers nous ; à la vue de nos revolvers il s’arrête dans l’attitude d’un fauve prêt à bondir. Voilà comment on salue des amis à dix minutes du drapeau tricolore.
Obock, considéré au point de vue militaire, peut devenir une colonie précieuse. C’est un dépôt de charbon où nos navires trouveraient, à défaut d’Aden, à s’approvisionner de combustible. Il ne faudrait pas toutefois que l’Angleterre fût partie intéressée dans la guerre qui nous éloignerait de ses ports, car il lui suffirait de fermer à Périm le détroit de Babel-Mandeb, en supposant même que le canal de Suez fût libre, pour obliger la marine française à reprendre le chemin du cap de Bonne-Espérance. Mais on n’est pas toujours en guerre. En temps de paix, grâce à Obock, on espère s’affranchir des charbons anglais, des transports anglais; l’argument est topique… pour l’avenir. Aujourd’hui Obock coûte chaque année plus de quatre cent mille francs et reçoit, en fait de marchandises françaises, du charbon venu en droite ligne de Cardiff, apporté par des bateaux construits en Angleterre, chargés à Swansea et qui n’ont de français que le pavillon, l’équipage et un port d’attache où ils relâchent de temps à autre, afin de toucher la prime à la navigation. En observateur impartial, je dois ajouter qu’il existe pourtant une grande différence entre les charbons anglais d’Aden et les charbons, non moins anglais, d’Obock. A Aden la tonne coûte vingt francs de moins et arrive à bord des navires cinq fois plus vite qu’à Obock.
Les colonies, par bonheur, ne se nourrissent pas seulement de charbon l’agriculture, l’industrie nationale, le commerce vivent de nos conquêtes lointaines. Si nous causions d’agriculture? Elle ne saurait être bien prospère dans un pays pourvu de torrents sans eau, de rochers sans terre végétale, d’une atmosphère sans nuage, d’un soleil sans pitié ni merci.
Reste le commerce avec le Choa et l’Abyssinie, les caravanes, la poudre d’or, les dents d’éléphant, les blés, les orges! Je touche ici aux plus graves questions.
Malheureusement l’avenir commercial de notre colonie est aussi précaire que ses destinées agricoles. Une chaîne de montagnes d’un accès difficile sépare Obock des routes de caravanes conduisant en Abyssinie, barre le passage à l’Aouach, grande rivière qui seule eût permis d’effectuer des transports à bon marché, et ferme l’accès de cette partie du littoral au profit de Tadjoura, situé à plusieurs étapes au sud.
Nous sommes, assure-t-on, dans les meilleurs termes avec le roi du Choa, Ménélik, vassal de Sa Majesté le roi Jean d’Abyssinie. Ce prince chercherait même à nouer des relations amicales avec la France. »
DIEULAFOY, Jane. En mission chez les immortels, journal des fouilles de Suse 1884-1886, Paris, (1ère édition 1888) 1990. p.26-31
Sur Jane Dieulafoy, biographie sur http://perso.orange.fr/tybalt/LesGendelettres/biographies/DieulafoyJ.htm
Sur l’histoire de la colonie de Djibouti, voir http://www.chez.com/republiquedjibouti/histoire_dji.html
La colonisation du Dahomey
« Dernières terres de la Côte-des-Esclaves, ce sont les royaumes dahoméens que nous acquérons à la fin du XIXe siècle; (…). Au delà des lagunes, à plusieurs jours de marche de la côte, au fond de leur palais d’Abomey, vivaient, dans une atmosphère d’épouvante, les princes sanguinaires qui avaient réussi à subjuguer le vieux royaume de Ouidah et les provinces environnantes. Entourés de dignitaires au premier rang desquels se trouvait le bourreau, les rois dahoméens s’appuyaient sur une puissante armée dans laquelle entrait, pour un tiers au moins, un contingent d’amazones. Elle constituaient sans doute le noyau le plus solide de l’armée; on pouvait en évaluer le nombre à environ quatre mille, bien entraînées, portant une sorte d’uniforme, chemise bleue, écharpe et culotte rayées, bonnet blanc brodé d’un crocodile bleu; il y avait le gros de la troupe armé de vieilles pétoires, la cohorte des chasseresses d’éléphants, les artilleurs, enfin la phalange légère des archers au bracelet d’ivoire sur lequel on appuyait la flèche en visant; les amazones étaient recrutées parmi les vierges des meilleures familles du royaume et étaient astreintes au voeu de chasteté sanctionné par la mort; on les savait d’une férocité extrême et, avant que d’aller au combat, dans d’infernales pétarades, s’enivraient de bruit et de la fumée de poudre comme elles s’étaient copieusement enivrées de vin de palme. Les rois entouraient leur fonction d’un cérémonial compliqué, d’un appareil de bizarrerie, horrible et bouffon à la fois, où les sombres divinités du cru, les sorciers, les empoisonneurs et le trancheur de têtes, se partageaient les rôles.
C’est dans ces étranges terres que nous commençons à nous établir en 1875; (…).
[ L’auteur prétend ensuite que les Dahoméens ont attaqué en 1890 des possessions françaises sur la côte; le roi du Dahomey, Béhanzin, déclara pour sa part que son territoire était soumis aux exactions des troupes françaises et fit des concessions. ]
Ce ne pouvait être qu’une trêve; Béhanzin, sous le prétexte de châtier des peuplades rebelles, s’armait activement, achetait à une maison allemande près de cinq mille fusils à tir rapide, des canons, des munitions; il ouvrait le feu sur « la Topaze » [ navire ] à bord de laquelle se trouvait le gouverneur Ballot et, après une lettre d’une rare insolence, ce roitelet sanglant affirme ses exigences sur Cotonou et Porto-Novo [ villes de la côte ]. Il faut en finir et se préparer à une guerre sérieuse; (…).
[ La guerre a lieu en 1892 et le Dahomey est occupé ; Béhanzin se rend en 1894 après une guérilla.]
Notre position étant assurée sur la zone littorale, commence alors entre Anglais, Allemands et nous, une véritable course de clocher; les Anglais tendent à relier la Gold-Coast [ Côte de l’or ] à la (sic!) Nigéria, les Allemands à s’épancher vers le nord-est et nous-mêmes à achever et à consolider notre bloc africain en reliant le Dahomey septentrional aux vastes étendues soudanaises. (…)
Les grandes provinces de notre Afrique occidentale sont désormais esquissées; il faudra maintenant continuer en profondeur l’oeuvre de pacification. (…) »
Charles Hanin, Occident noir, Paris, 1946, extraits des pages 186-188. Charles Hanin fut administrateur dans les colonies françaises d’Afrique occidentale dans la première moitié du XXe siècle.
Annexion de Madagascar, arrivée de Gallieni
« Paris a adressé à Laroche un câblogramme lui commandant de remettre tous les pouvoirs à Gallieni, dès son arrivé. Celui-ci était parti en qualité de gouverneur militaire de l’Imérina et du Betsiléo, mais une fois à Tananarive, le général reçoit l’ordre de prendre aussi la charge du résident. Gallieni venu avec des consignes d’André Lebon, ministre des Colonies, va donc devoir assumer en outre les pouvoirs civils.
En effet, le 30 mai 1896, à Paris, en raison de l’insurrection des Menalambas, un projet de loi déclarant Madagascar et les îles qui en dépendent colonie française, avait été déposé à la Chambre des députés. Il devint exécutoire le 6 août et transmis par câblogramme à Laroche, en même temps que son rappel. Lebon s’est expliqué là-dessus sans son livre. La Pacification de Madagascar : « Tout fut donc disposé de la manière qu’au moment opportun un simple télégramme pût changer les facteurs déterminants du problème. »
Hippolyte Laroche est quelqu’un peu amer. Tout va vite, trop vite pour lui. Il est content d’être rappelé mais il ne peut quitter Madagascar sans édicter cette loi sur l’abolition de l’esclavage qui lui tient tant à cœur. Il décide donc sa promulgation sur-le-champ, le 27 septembre. En fait, l’abolition allait de soi, puisque Madagascar était devenu une colonie où s’exerçait donc pleinement le droit français. Néanmoins, ceci entraîna un différend entre Laroche et Gallieni.
Par le journal officiel de Madagascar, sous la signature de Laroche, Tananarive apprend donc, le 27 septembre 1896, en même temps, la loi d’annexion de l’île, l’abolition de l’esclavage et la déclaration de l’état de siège pour la capitale… Les Malgaches, faisant l’amalgame entre toutes ces nouvelles et l’arrivée du nouveau résident, surnomment déjà Gallieni, le général Maziaka, c’est-à-dire « le cruel ».
BARRIER Marie-France, Ranavalo, dernière reine de Madagascar. Paris : Gallimard, 1996. pp.225-226.
INSTRUCTIONS DE GALLIENI POUR LA PACIFICATION DE MADAGASCAR (2 mai 1898)
« Le meilleur moyen pour arriver à la pacification dans notre nouvelle et immense colonie de Madagascar, avec les ressources restreintes dont nous disposons, est d’employer l’action combinée de la force et de la politique. Il faut nous rappeler que, dans les luttes coloniales que nous impose trop souvent, malheureusement, l’insoumission des populations, nous ne devons détruire qu’à la dernière extrémité, et, dans ce cas encore, ne ruiner que pour mieux bâtir. Toujours, nous devons ménager le pays et ses habitants, puisque celui-là est destiné à recevoir nos entreprises de colonisation futures, et que ceux-ci seront nos principaux agents et collaborateurs pour mener à bien ces entreprises. Chaque fois que les incidents de guerre obligent l’un de nos officiers coloniaux à agir conte un village ou un centre habité, il ne doit pas perdre de vue que son premier soin, la soumission des habitants obtenue, sera de reconstruire le village, d’y créer immédiatement un marché et d’y établir une école. Il doit donc éviter avec le plus grand soin toute destruction inutile.
Action politique. L’action politique est de beaucoup la plus importante ; elle tire sa plus grande force de la connaissance du pays et de ses habitants ; c’est à ce but que doivent tendre les premiers efforts de tout commandement territorial. C’est l’étude des races qui occupent une région, qui détermine l’organisation politique à lui donner, les moyens à employer pour sa pacification. Un officier qui a réussi à dresser une carte ethnographique suffisamment exacte du territoire qu’il commande est bien près d’en avoir obtenu la pacification complète, suivie bientôt de l’organisation qui lui conviendra le mieux.
Toute agglomération d’individus, race, peuple, tribu ou famille, représente une somme d’intérêts communs ou opposés. S’il y a des moeurs et des coutumes à respecter, il y a aussi des haines et des rivalités qu’il faut savoir démêler et utiliser à notre profit, en les opposant les unes aux autres, en nous appuyant sur les unes pour mieux vaincre les secondes. (…)
En somme, toute action politique doit consister à discerner et mettre à profit les éléments locaux utilisables, à neutraliser et détruire les éléments locaux inutilisables.
L’élément essentiellement utilisable sera, avant tout, le peuple, la masse travailleuse de la population, qui peut, momentanément, se laisser tromper et entraîner, mais que ses intérêts rivent à notre fortune et qui sait bien vite le comprendre, pour peu qu’on lui indique et qu’on lui fasse sentir. (…)
Action économique. Au fur et à mesure que la pacification s’affirme, le pays se cultive, les marchés rouvrent, le commerce reprend. Le rôle du soldat passe au second plan, celui de l ‘administrateur commence. Il faut d’une part, étudier et satisfaire les besoins sociaux des populations soumises ; favoriser, d’autre part, l’extension de la colonisation qui va mettre en valeur les richesses naturelles du sol, ouvrir des débouchés au commerce européen.
Ce sont là, semble-t-il, les deux conditions essentielles su développement économique d’une colonie : elles ne sont nullement contradictoires. L’indigène, en général, n’a que fort peu de besoins. Il vit dans un état voisin de la misère, qu’il est humain de chercher à améliorer ; mais, le nouveau mode d’existence que nous lui ferons adopter, en créant chez lui des besoins qu’il n’avait pas, nécessitera de sa part des ressources qu’il n’a pas davantage et qu’il lui faudra trouver ailleurs.
Il faudra donc qu’il surmonte sa paresse et se mette résolument au travail, soit en faisant revivre des industries languissantes, celles de la banane et de la soie par exemple, soit en augmentant ses cultures et en adoptant pour elles des méthodes plus productives, soit en prêtant aux colons européens le concours de sa main-d’oeuvre.
Il rentre dans le rôle de nos commandants territoriaux de créer des écoles professionnelles, où l’indigène se perfectionnera dans son métier, par l’étude et l’application des moyens que la science et l’expérience nous ont acquis ; d’installer des fermes-modèles, où il viendra se rendre compte des procédés de culture féconds que nous employons et qu’il ignore ; d’encourager la reprise des industries nationales en facilitant l’établissement des premières fabriques qui s’organiseront et en les subventionnant au besoin ; de créer des marchés, francs de tout droits d’abord, et qui ne seront imposés que dans la suite, très progressivement, etcŠ
Il se produira, infailliblement, une augmentation de richesse dans le pays, avec, comme conséquence naturelle, un besoin de bien-être, que le commerce européen saura mettre à profit. Il trouvera, dans les produits nouveaux de l’activité que nous aurons ainsi créée, des articles d’exportation, qui lui manquent un peu aujourd’hui, et, en tout cas, des ressources locales qui lui font absolument défaut. »
in Journal officiel de Madagascar, mai 1898.
Conquête du Congo et sa justification
« La campagne antiesclavagiste fut une véritable guerre coloniale où, de 1891 à 1894, une poignée de chefs blancs, aidés de troupes indigènes peu nombreuses et d’auxiliaires dépourvus de valeur militaires, luttèrent sur trois théâtres différents contre des forces redoutables …… C’est au cours de cette campagne que se place l’épisode sublime du sergent De Bruyne, captif de Sefu et envoyé par celui-ci pour parlementer avec les Belges. …… Déçu dans son espoir de paix, Sefu fit périr dans d’affreux supplices le brave petit sergent, dont la conduite rivalise avec les plus beaux exemples qu’aient enregistrés les annales de l’humanité. …. Les officiers belges avaient participé à cette campagne comme à une nouvelle croisade. Obéissant au plus noble idéal, ils avaient, avec enthousiasme, bravé les plus grands périls et supporté toutes les privations, toutes les souffrances. Leur valeur, leur sens de la guerre et l’habilité de leurs conceptions stratégiques leur avaient permis, en dix-neuf mois, de briser la puissance formidable des Arabes, d’affranchir la partie orientale du Congo d’une domination odieuse et faire disparaître de la face du monde le honteux fléau de l’esclavage. »
Vicomte Charles Terlinden, « Histoire Militaire des Belges », 1931, pp. 318, 319 et 320, trouvé sur http://users.win.be/W0120966/moanda/annexe01.htm#BERLIN (3 juin 2009)
LE CONGO de Léopold II : la question de la cession à la Belgique
Bien avant que le scandale des mauvais traitements force la cession de sa propriété à l’Etat belge en 1908, Léopold II l’avait déjà envisagé.
« Je n’ai jamais cessé d’appeler l’attention de mes compatriotes sur la nécessité de porter leurs vues sur les contrées d’outre-mer.
L’histoire enseigne que les pays à territoire restreint ont in intérêt moral et matériel à rayonner au-delà de leurs étroites frontières… Plus que nulle autre, une nation manufacturière et commerçante comme la nôtre doit s’efforcer d’assurer les débouchés à tous ses travailleurs, à ceux de la pensée, du capital et des mains. Ces préoccupations patriotiques ont dominé ma vie. Ce sont elles qui ont déterminé la création de l’œuvre africaine.
Mes peines n’ont pas été stériles : un jeune et vaste Etat, dirigé de Bruxelles, a pris pacifiquement place au soleil grâce à l’appui bienveillant des puissances qui ont applaudi à ses débuts. Des Belges l’administrent, tandis que d’autres compatriotes, chaque jour plus nombreux, y font déjà fructifier leurs capitaux. L’immense réseau fluvial du Congo supérieur ouvre à nos efforts des voies de communication rapides et économiques qui permettent de pénétrer directement jusqu’au centre du continent africain. La construction du chemin de fer de la région des cataractes, désormais assurée grâce au vote récent de la législature, accroîtra notablement ces facilités d’accès. Dans ces conditions un grand avenir est réservé au Congo, dont l’immense valeur va prochainement éclater à tous les yeux.
Au lendemain de cet acte mémorable, j’ai cru de mon devoir de mettre la Belgique à même, lorsque la mort viendra me frapper, de profiter de mon œuvre, ainsi que du travail de ceux qui m’ont aidé à la fonder et à la diriger et que je remercie ici une fois de plus. (…)
Le début des entreprises comme celles qui m’ont tant préoccupé est difficile et onéreux. J’ai tenu à en supporter les charges. Un roi, pour rendre service à son pays, ne doit pas craindre de concevoir et de poursuivre la réalisation d’une œuvre même téméraire en apparence… Jusqu’au jour de ma mort, je continuerai dans la même pensée d’intérêt national qui m’a guidé jusqu’ici, à diriger et à soutenir notre œuvre africaine ; mais si, sans attendre ce terme, il convenait au pays de contracter des liens plus étroits avec nos possessions du Congo, je n’hésiterais pas à les mettre à sa disposition, je serais heureux, de mon vivant, de l’en voir en pleine jouissance. (…) Je ne crois pas me tromper en affirmant que la Belgique en retirera de sérieux avantages et verra s’ouvrir devant elle, sur un continent nouveau, d’heureuses et larges perspectives. »
Annales parlementaires, Chambre des Représentants, session extraordinaire de 1890, p.10 in LARAN Michel et WILLEQUET Jacques, L’époque contemporaine (1871-1965), Tome V, Paris : H. Dessain, 1969. pp. 184-186
LE CONGO BELGE : opinions sur la politique coloniale de Léopold II
Remarque : Depuis 1884, le Congo est une possession privée du roi des Belges, Leopold II.
1) CATTIER Félicien (1869-1946) : docteur en droit et en sciences administratives , il fut nommé professeur à l’Université libre de Bruxelles (1906). Suite à la campagne de diffamation orchestrée par l’Angleterre contre l’État indépendant du Congo (1904-1905), une commission d’enquête est envoyée au Congo. Le rapport de celle-ci (1905) met en évidence le travail forcé imposé aux indigènes. Son Étude sur la situation de l’État indépendant du Congo (1906) réagit au rapport de la commission d’enquête et met en évidence la nécessité d’annexer le Congo à la Belgique.
« L’État n’a pas soumis les indigènes au paiement d’un impôt en argent. Ils sont astreints à des prestations de travail. La grande majorité des contribuables, au lieu de fournir du travail, de la main-d’oeuvre, sont tenus à des prestations de certaines quantités de produits. L’impôt de travail se transforme, par des supputations diverses en un impôt d’un nombre déterminé de kilogrammes de caoutchouc ou de copal.
Dans quelques régions, le fisc, au lieu d’exiger du caoutchouc, contraint les noirs à lui remettre périodiquement des arachides, des vivres (…). Ailleurs, les indigènes sont appelés à exécuter certains travaux (…).
Si l’indigène est en défaut ou en retard de paiement, les agents de l’État et des sociétés concessionnaires auxquelles le Gouvernement a délégué le droit de percevoir l’impôt ont recours, d’après la Commission, aux moyens de coercition suivants :
– les chefs sont arrêtés, retenus prisonniers, châtiés jusqu’au moment où leurs sujets ont fourni les prestations exigées.
– des indigènes pris au hasard, le plus souvent des femmes et des enfants, sont retenus en otage dans les postes (…).
– des chefs de poste appliquent la chicote [ = fouet à lanières nouées] aux récolteurs qui n’ont pas fourni complètement leurs impositions. D’autres exercent des sévices sur les retardataires.
– des fonctionnaires civils ou militaires imposent à des villages des amendes très fortes. »
CATTIER, F., Étude sur la situation de l’État indépendant du Congo, Bruxelles-Paris, 1906, p. 108-109
2) WILLIAMS George Washington (1864-1891): théologien baptiste et juriste noir américain, il participa à la Guerre de Sécession au lendemain de laquelle il milita pour la cause des noirs américains persécutés par le groupuscule du Ku Klux Klan. Successivement pasteur et journaliste, il se lança ensuite dans la politique. Premier membre noir de l’assemblée législative de l’État de l’Ohio, il souleva la fureur en essayant d’obtenir l’abrogation d’une loi interdisant les mariages interraciaux. En 1882-1883, il publia un ouvrage intitulé : Histoire de la race noire en Amérique de 1619 à 1880. Les Noirs comme esclaves, comme soldats et comme citoyens, avec une considération préliminaire sur l’unité de la famille humaine, un résumé historique de l’Afrique et un rapport sur les gouvernements noirs de la Sierra Leone et du Libéria. Animateur de multiples conférences sur la cause noire, il fut ensuite amené à rencontrer notamment Léopold II, ce qui l’incita à aller découvrir l’oeuvre coloniale belge sur le terrain en juillet 1890. Sa célèbre Lettre ouverte (1890) d’une dizaine de pages fut largement distribuée en Europe et en Amérique, soulevant de vives protestations de la part de Léopold II et d’une partie de la classe politique belge. Ceux-ci prétextèrent la manipulation de G. Williams par des groupes de pression opposés au colonialisme de la Belgique. Il disparut prématurément suite à une tuberculose contractée à la fin de son périple africain en Egypte.
« Bon et grand ami, j’ai l’honneur de soumettre à la considération de Votre Majesté certaines réflexions à propos de l’État indépendant du Congo, fondées sur une étude minutieuse. (…)
Toute accusation que je suis sur le point de porter contre le gouvernement personnel de Votre majesté au Congo a fait l’objet d’une enquête minutieuse ; une liste de témoins compétents et crédibles, de documents, de lettres, de rapports et de données officiels a été préparée avec exactitude. (…)
À propos de la soumission des villages : Grâce à (…) quelques caisses de gin, des villages entiers ont été abandonnés par une signature à Votre Majesté. [Les terres achetées par de tels biais étaient] des territoires auxquels Votre Majesté ne peut davantage prétendre légalement que je n’ai le droit d’être commandant en chef de l’armée belge. (…)
À propos des bases militaires établies sur le fleuve : Ces postes de pirates et de boucaniers forcent les autochtones à les fournir en poissons, chèvres, volailles et légumes sous la menace de leurs mousquets ; et quand les indigènes refusent (…) , les officiers blancs arrivent avec une force expéditionnaire et brûlent leurs maisons. (…)
À propos de la manière dont est rendue la justice : Le gouvernement de Votre Majesté fait preuve d’une cruauté excessive envers ses prisonniers, les condamnant à être enchaînés comme des forçats pour les délits les plus mineurs. (…) Souvent, ces colliers à boeuf rongent le cou des prisonniers et provoquent des plaies infestées de mouches, ce qui aggrave la blessure suppurante. (…) Les tribunaux du gouvernement de Votre Majesté sont inefficaces, injustes partiaux et défaillants.
À propos de l’esclavagisme : (…) l’administration de Votre Majesté est engagée dans le commerce des esclaves, de gros et de détail. Elle achète, vend et vole les esclaves. L’administration de Votre Majesté donne trois livres par tête pour les esclaves aptes physiquement au service militaire. (…) La main-d’oeuvre dans les stations du gouvernement de Votre Majesté sur le fleuve supérieur est composée d’esclaves de tous âges et des deux sexes. »
WILLIAMS, G.W., An open letter to His Serene Majesty Leopold II, king of the Belgians and sovereign of the Independent state of Congo, juillet 1890.
3) de LICHTERVELDE Louis (1880-1959) : docteur en sciences politiques et sociales. Membre du Conseil général de l’Université catholique de Louvain, il publia quelques ouvrages sur les institutions et sur l’histoire monarchique de la Belgique (notamment Léopold II publié pour la première fois en 1926 et réédité ensuite à de nombreuses reprises). Il fut directeur de la Revue générale et devint chef de cabinet du premier ministre. Il fut préoccupé par la réforme de l’État et le problème linguistique, se déclarant favorable à une certaine décentralisation, mais opposé au fédéralisme.
« La politique coloniale de Léopold II a eu ses erreurs et ses fautes ; le reproche principal qu’on peut lui faire, c’est de ne pas avoir évolué suffisamment à mesure que l’État Indépendant croissait en force et en richesse ; elle a poursuivi des fins trop directement productives, mais est-ce une raison pour méconnaître les immenses bienfaits dont lui sont redevables les populations qu’elle a tirées de la sauvagerie primitive ? La traite [esclavagiste musulmane] surtout, la traite qui décimait le centre de l’Afrique, a été complètement vaincue, et le nom de l’État, comme le reconnaissait un missionnaire anglais, devint très tôt la terreur des esclavagistes. L’alcoolisme a été victorieusement tenu en échec. Les nègres n’ont, somme toute, pas payé trop cher leur libération. Le Roi, mieux que tout autre, comprenait, qu’après vingt-cinq ans, son oeuvre était à peine commencée et son génie ne répudiait pas la dure appellation de Boula-Matari – le briseur de roches – que son gouvernement avait héritée de Stanley. Lui aussi, comme l’explorateur, s’était attaché à une besogne préliminaire : créer le cadre politique et légal dans lequel s’ordonnerait le chaos, tracer les frontières, sauvegarder les voies d’accès, commencer l’outillage économique. Ceux qui le jugent d’après les lacunes qu’il a laissées subsister plutôt que sur ses réalisations oublient trop souvent deux choses : la colonisation est une oeuvre de longue haleine et la fondation d’un empire n’est pas un travail de demoiselles. Causant un jour avec un évêque missionnaire des abus reprochés à son administration, Léopold II disait : «Sans doute, Monseigneur, cela est fâcheux, très fâcheux, mais on ne peut accomplir une grande oeuvre sans faire la part du mal. Vous élevez une cathédrale ; durant la construction, il se produira forcément bien des incidents regrettables : il y aura des injustices, des accidents, des disputes, des rixes parfois violentes. On entendra proférer des injures et des blasphèmes, mais en fin de compte, le monument s’achève pour la gloire de Dieu et le salut des âmes ; il en va de même au Congo. »
Le Roi lui-même corrigea quelques graves imperfections signalées dans le régime judiciaire et administratif de la colonie et se montra sévère envers les individus reconnus coupables à l’égard des indigènes. »
DE LICHTERVELDE, L. (comte) , Léopold II, Louvain, Les Éditions Rex, s.d. [après 1932] (Collection Nationale), p. 256-257.
Témoignage du procureur de Boma, Stanislas Lefranc, recueilli par la Commission d’Enquête au Congo belge (1905).
« Tout d’abord, je dois dire qu’une source de fréquents abus est la jeunesse de beaucoup de chefs de poste. Investis de pouvoirs très étendus, ces jeunes gens, dans un grand nombre de cas, sont tentés d’en abuser. (…) Bien que les règlements énumèrent toute une série de peines, dont la chicotte [coups de cravache de cuir infligés à un homme ligoté nu sur le sol] , qui vient en dernière ligne, est la plus grave et devrait donc être la plus rare, il est de fait que ce châtiment corporel est la pénalité favorite des chefs de poste et qu’elle remplace, même dans les cas de légères peccadilles, les punitions plus douces prévues par le règlement disciplinaire.
Il y a plus : le maximum réglementaire des coups de chicotte est de cinquante, et encore ne peut-on administrer plus de vingt-cinq coups à un même délinquant en un seul jour. Or ce chiffre est souvent arbitrairement augmenté. On a vu jusqu’à infliger cent, cent cinquante, deux cents coups de chicotte, ce qui rend ce châtiment absolument meurtrier. (…)
Le moyen de coercition connu sous le nom de contrainte par corps et de système des otages donne également lieu à de répréhensibles excès.
On recommande comme spécialement efficace, la détention des femmes. (…) Les otages, en effet, sont traités en véritables prisonniers ; souvent on les met à la chaîne, et toute tentative d’évasion est infailliblement punie de mort ; car les gardiens des détenus reçoivent la consigne de tirer sur les fuyards.
Malheureusement, les fonctionnaires de l’Etat ne sont trop souvent que des instruments dans les mains des Compagnies. »
idem plus développé
Ceci est un témoignage de Stanislas Lefranc, 46 ans, Substitut faisant fonction de Procureur d’État à Boma (capitale):
« J’ai été substitut du Procureur d’État dans le district de l’Équateur, à la résidence de Coquilhatville, et également dans le district du Stanley Pool. Voici les observations que mon expérience me suggère au sujet du régime en vigueur dans ces districts. Tout d’abord, je dois dire qu’une source de fréquents abus est la jeunesse de beaucoup de chefs de poste. Des agents fraîchement débarqués en Afrique sont immédiatement chargés de ces fonctions qui réclament beaucoup d’expérience, de tact et de modération.
Investis de pouvoir très étendus, ces jeunes gens, dans un grand nombre de cas, sont tentés d’en abuser, et beaucoup d’entre eux se conduisent en véritables roitelets, instaurant dans leur rayon d’action un régime de bon plaisir. Il faut dire que leurs excès sont tout au moins tolérés par l’administration.
Presque aucun contrôle n’est exercé sur la manière arbitraire dont les chefs de poste appliquent en général les règlements de discipline. L’emprisonnement et la chicotte sont employés sans mesure contre les travailleurs et les soldats, et M. le Gouverneur Fuchs a pu dire justement dans une circulaire de 1898, que chaque inspection des postes a révélé… Bien que les règlements énumèrent tout une série de peines, dont la chicotte, qui vient en dernière ligne, est la plus grave et devrait donc être la plus rare, il est de fait que ce châtiment corporel est la pénalité favorite des chefs de poste et qu’elle remplace, même dans les cas de légères peccadilles, les punitions plus douces prévues par le règlement disciplinaire.
Il y a plus : le maximum réglementaire des coups de chicottes est de cinquante, et encore ne peut-on administrer plus de vingt-cinq coups à un même délinquant en un seul jour. Or ce chiffre est souvent arbitrairement augmenté* (*On a pu le constater plusieurs fois dans les dossiers et par l’audition de témoins appelés à déposer dans les procès à charge d’Européens). On a vu jusqu’à infliger cent, cent cinquante, deux cents coups de chicotte, ce qui rend ce châtiment absolument meurtrier.
Ces abus se commettent non seulement dans les régions administrées directement par l’Etat, mais encore, et avec une fréquence peut-être plus grande, dans le domaine des diverses sociétés concessionnaires, bien que les agents de ces sociétés ne possèdent nullement le droit d’infliger aux travailleurs des châtiments corporels. Le moyen de coercition connu sous le nom de contrainte par corps et de système des otages donne également lieu à de répréhensibles excès. On recommande comme spécialement efficace, la détention des femmes. J’ai vu, même dans les postes de l’État, des femmes prisonnières soumises aux travaux les plus durs.
Les otages, en effet, sont traités en véritable prisonniers; souvent on les met à la chaîne, et toute tentative d’évasion est infailliblement punie de mort; car les gardiens des détenus reçoivent la consigne de tirer sur les fuyards. (On sait que les factoreries des diverses sociétés disposent chacune d’une vingtaine de soldats-travailleurs armés d’Albinis). Dans certains cas, des gardiens ont été punis de chicotte pour avoir enfreint leur meurtrière consigne. Dans cet ordre d’idée, je dois relever la déplorable facilité avec laquelle on fait usage des armes à feu. On m’a dit qu’il était d’ usage que des blancs pénétrant dans un village paisible tirassent des coups de revolver pour « s’annoncer » de la sorte au chef.
Les indigènes ne peuvent se rendre de leur village dans un autre sans être munis d’un laisser-passer du chef de la factorerie. Pour le dire en passant, ceci est un corollaire du principe partout admis, qui fixe irrévocablement les nois sur la terre qui les a vus naître. On veut ainsi éviter que le village s’appauvrisse en hommes et ne puisse plus fournir le chiffre de prestations qui leur a été imposé. J’ai été plus d’une fois choqué par ce système qui rappelle fâcheusement le principe médiéval du « serf attaché à la glèbe [terre cultivée] » ; j’ai d’abord tenté d’intervenir, autorisant notamment des femmes à quitter leur village pour épouser des indigènes habitant d’autres villages; mais cette façon d’agir me mit en conflit à Coquilhaville, avec le commissaire du district de l’Équateur. C’était, je crois, vers août 1902. Nous en référâmes au gouvernement; et celui-ci nous donna à entendre qu’il valait mieux ne point toucher à ce système tacitement admis.
La force publique a été maintes fois employée à ramener chez eux les « fugitifs ». Lorsque les indigènes passent d’un district dans un autre, cette émigration donne régulièrement lieu à des « palabres » entre les autorités des deux circonscriptions administratives. Il arrivait aussi que les noirs se réfugiaient sur la rive française et refusaient de rentrer sur le territoire de l’État. Il est indéniable que dans les régions productrices du caoutchouc, l’objectif unique des Sociétés est la récolte de ce produit. Un mot du directeur B., de la S.C.A, exprime ce fait d’une manière frappante : « Tout ce que je demande- disait-il dans une lettre qui figure au dossier Caudron- c’est qu’on fait (sic) du caoutchouc, le plus possible, et le plus vite possible ».
Malheureusement, les fonctionnaires de l’État ne sont trop souvent que des instruments dans les mains des Compagnies; l’influence et les forces de l’État servent alors presque uniquement au but commercial poursuivi par l’ABIR ou la S.C.A. Les commissaires de district que j’ai connu étaient généralement « au mieux » avec les directeurs de Sociétés. M.M. Sarrazyn, Du Breucq et de Bauw, à en croire la rumeur publique, touchaient même de fortes primes des sociétés concessionnaires. On m’a rapporté que le commissaire Du Breucq ne faisait point mystère de l’appui financier que lui prêtait l’ABIR. M. De Bauw, qui avait entretenu de mauvais rapports avec l’avant-dernier directeur de cette puissante société, changea d’attitude lorsque M. Longtain arriva en Afrique. Depuis lors, il suivit l’exemple de ces prédécesseurs, mettant à chaque instant les soldats du poste de Basankusu à la disposition de la Société, ordonnant des expéditions militaires contre les villages qui ne donnaient point satisfaction à l’ABIR au point de vue de la récolte du caoutchouc.
L’État et la compagnie marchaient absolument la main dans la main; l’acquittement de l’agent Lejeune poursuivi pour sévices envers les indigènes, fut généralement interprété comme un gage d’impunité. L’influence de M. Longtain était considérée comme toute-puissante, et c’était une croyance répandue dans la concession que, lui étant directeur, les agents placés sous ses ordres auraient toujours pleine liberté d’action. Sur quelle base juridique repose le droit qu’ont les Sociétés de percevoir les impôts? C’est difficile à dire, toujours est-il que ce droit n’est pas contesté. En tout cas, ni les agents de sociétés ni les chefs de poste de l’État, ne croient bornée par aucune limite leur faculté de prélever des prestations de toute nature. Il paient des prix souvent dérisoires pour les vivres qu’ils exigent.
Bien plus, j’ai vu un chef de poste emprisonner des pêcheurs qui ne lui avaient pas apporté suffisamment de poisson; et ce personnage parut fort étonné lorsque je lui fis observer qu’il avait outrepassé ses droits. Les impositions, qu’on appellerait plus justement du nom de « tributs » sont souvent disproportionnées, véritablement écrasantes pour les indigènes. Ceux-ci seraient d’autant plus en droit de se plaindre qu’en échange des prestations fournies par eux à l’État et aux Compagnies, on a fait relativement peu de chose pour leur bien-être. L’insouciance des Compagnies à cet égard est totale. Je ne pense même pas que ces dernières aient pris des mesures pour faire disparaître les coutumes anthropophagiques.
L’Etat devrait à mon sens se préoccuper d’avantage de la situation sanitaire et de l’habitation des indigènes, car il est incontestable que les épidémies, et notamment la maladie du sommeil, dont les effets dévastateurs ont été terribles, n’aient été grandement favorisées par les déplorables conditions hygiéniques dans lesquelles vivent les noirs. Le rôle de la magistrature, -à laquelle incombent la recherche et la répression des abus, est souvent rendue difficile par la tolérance de l’administration à l’égard de certains de ces abus, quand la marche de la justice n’est pas entravée par le mauvais vouloir des fonctionnaires. Ainsi, en face des expéditions militaires dites « punitives », entreprises par ces forces de l’État et commandées par ses officiers, le Parquet est impuissant. Il peut tout au plus contrôler les opérations de ce genre que dirigent les Compagnies.
Souvent c’est le hasard seul qui fait éclater le scandale, comme dans l’affaire Matthÿs, amené au jour par les dénonciations de Moray. Les substituts savent qu’en s’occupant de semblables affaires ils s’exposent à des échecs qui diminuent leur prestige. Personnellement, j’en ai fait l’expérience lors de l’instruction que je dirigeai à charge des agents M. Ansiaux et K. (aff. de Nsele, avril 1902). L’affaire fut chargée sans suite. De même, lorsque des indigènes viennent se plaindre au juge de punitions arbitraires, ils n’y gagnent souvent que d’être « chicottés » une fois de plus. Le prétexte généralement choisi est que les plaignants, en allant exposer leurs doléances au magistrat ont indûment quitté le travail. Les substituts dépendaient naguère encore des commissaires de district, au moins matériellement, puisqu’ils étaient ravitaillés par l’intermédiaire de ceux-ci.
J’ajouterai quelques mots sur les enfants que l’on envoie dans les missions ou les colonies scolaires. Le recrutement en est fait par les commissaires de district, et le système est en vigueur depuis environ deux ans. Il est évidemment excessif que ces jeunes gens puissent être maintenus sous la tutelle de l’État jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans. L’institution est surtout profitable à l’État : c’est surtout une pépinière de travailleurs et de soldats.
J’exprimerai, en terminant, un vœu au sujet du mariage entre indigènes. Puisque les mariages selon les principes de notre Code Civil a été introduit au Congo, il faudrait qu’il eût une sanction dans la punition de l’adultère. Le juge qui a entretenu les époux de l’inviolabilité du contrat matrimonial et qui se trouve ensuite sans force pour le faire respecter, est placé dans une situation ridicule vis à vis du conjoint adultère et impuni, et du conjoint qui invoque en vain la protection de la loi. »