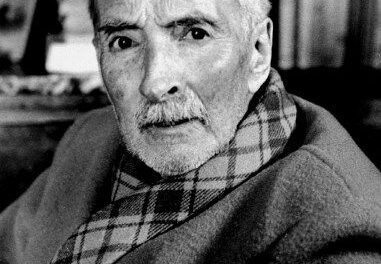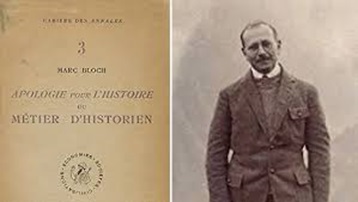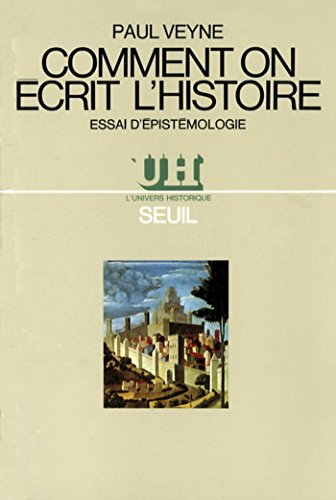
Les trois espèces de concepts
Ce sont donc d’étranges outils que les concepts historiques ; ils permettent de comprendre parce qu’ils sont riches d’un sens qui déborde toute définition possible ; pour la même raison, ils sont une incitation perpétuelle au contresens. Tout se passe comme s’ils portaient en eux toute la richesse concrète des événements qui leur sont subsumés, comme si l’idée de nationalisme englobait tout ce que l’on sait de tous les nationalismes. Il est bien ainsi. Les concepts du vécu sublunaire, en particulier ceux dont on se sert en histoire, sont très différents de ceux des sciences, que se soient les sciences déductives comme la physique ou l’économie pure, ou les sciences en voie d’élaboration comme la biologie. Il y a donc concepts et concepts et il ne faut pas tout confondre (comme fait la sociologie générale, qui traite certains concepts issus du sens commun, ceux de rôle ou de contrôle social, aussi gravement que si c’étaient des termes scientifiques). Pour reprendre une classification qui est en passe de devenir consacrée, il y a d’abord les concepts des sciences déductives : force, champ magnétique, élasticité de la demande, énergie cinétique ; ce sont autant d’abstractions parfaitement définies par une théorie qui permet de les construire et elles n’apparaissent qu’au terme de longues explications théoriques. D’autres concepts, dans les sciences naturelles, donnent lieu à une analyse empirique : nous savons tous intuitivement ce qu’est un animal ou un poisson, mais le biologiste cherchera des critères qui permettent de distinguer animaux et végétaux et il dira si la baleine est un poisson ; à la fin, les poissons du biologiste ne seront plus ceux du sens commun. Les concepts historiques, eux, appartiennent exclusivement au sens commun (une ville, une révolution), ou, s’ils sont d’origine savante (despotisme éclairé), ils n’en valent pas mieux pour cela. Ce sont des concepts paradoxaux : nous savons intuitivement que ceci est une révolution et que cela n’est qu’une émeute, mais nous ne saurions dire ce que sont émeute et révolution ; nous en parlerons sans vraiment les connaître. En donner une définition ? Ce serait arbitraire ou impossible. Révolution, changement brusque et violent dans la politique et le gouvernement de l’État, dit Littré, mais cette définition n’analyse pas le concept ni ne l’épuise ; en fait, notre connaissance du concept du révolution consiste à savoir que l’on donne couramment ce nom à un ensemble riche et confus de faits que l’on trouve dans des livres qui concernent les années 1642 et 1789 : « révolution » a pour nous la physionomie de tout ce que nous avons lu, vu et entendu sur les différentes révolutions dont la connaissance est venue jusqu’à nous et c’est ce trésor de connaissances qui commande notre emploi du mot. Aussi le concept n’a-t-il pas de limites précises : nous en savons beaucoup plus long sur la révolution que toute définition possible, mais nous ne savons pas ce que nous savons et cela nous fait parfois de désagréables surprises quand le mot se révèle sonner faux ou anachroniquement dans certains emplois. Nous en savons pourtant assez pour dire, sinon ce qu’est une révolution, du moins si tel événement en est une ou pas : « non, Sire, ce n’est pas une émeute… ». Comme dit Hume, « nous n’adjoignons pas d’idées distinctes et complètes à tous les termes dont nous nous servons et, quand nous parlons de gouvernement, d’Église, de négociations, de conquête, nous développons rarement en notre esprit toutes les idées simples qui composent ces idées complexes. Il faut néanmoins remarquer que, ce nonobstant, nous évitons de dire des absurdités sur tous ces sujets et que nous sentons les contradictions que ces idées peuvent présenter, aussi bien que si nous les comprenions parfaitement : par exemple si, au lieu de dire qu’à la guerre le vaincu n’a plus qu’à recourir à l’armistice, on nous disait qu’il n’a qu’à recourir à des conquêtes, l’absurdité de ces mots nous frapperait l’esprit ». Un concept historique permet, par exemple, de désigner un événement comme étant une révolution ; il ne s’ensuit pas qu’en employant ce concept on sache « ce qu’est » une révolution. Ces concepts ne sont pas des concepts dignes de ce nom, des complexes d’éléments nécessairement liés ; ce sont plutôt des représentations composites qui donnent l’illusion de l’intellection, mais qui ne sont en réalité que des espèces d’images génériques. La « révolution », la « ville », est faite de toutes les villes et de toutes les révolutions déjà connues et attend de nos expériences futures un enrichissement auquel elle demeure définitivement ouverte. Aussi peut-on voir tel historien, spécialiste du XVIIe siècle anglais, se plaindre que ses confrères « aient parlé de classes sociales sans faire de réserves pour ce siècle ; parlant de classes montantes ou en déclin, ils ont eu à l’esprit, de toute évidence, des conflits d’une nature toute différente » ; de même, l’expression de classe moyenne présente « beaucoup trop d’associations trompeuses quand on l’applique à l’état social du temps des Stuart » ; « parfois (mais plus rarement, à cause précisément du caractère vague de ce langage) on est allé jusqu’à confondre un groupement hiérarchique avec une classe sociale et on a poursuivi le raisonnement comme si de tels groupements pouvaient croître, décliner, se heurter entre eux, prendre conscience d’eux-mêmes, posséder une politique à eux ».
Paul Veyne, Comment on écrit l’histoire. Essai d’épistémologie, © Le Seuil, coll. « Points-Histoire», 1978, 1996, p. 89-91.