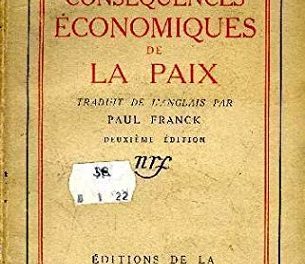Dans cet extrait, Stefan Zweig relate son retour à Vienne dans les tout premiers jours du mois d’Août 14, soit à peine une semaine après que son pays, l’Autriche-Hongrie, eût déclaré la guerre à la Serbie. Il revient d’une agréable villégiature au bord de la mer du Nord en Belgique et découvre « toute la ville en délire ».
Pour l’auteur, la guerre 14-18 signe la fin d’un monde, l’échec d’une civilisation européenne dont il est profondément nostalgique. Le fait que le chapitre consacré aux « premiers jours de la guerre de 1914 » soit situé au milieu du livre n’est sans doute pas anodin, car pour Zweig, il y a bien un avant et un après été 14. Ce texte est écrit par un intellectuel qui se définit comme « citoyen du monde » et qui avoue volontiers : « l’héroïsme ne convient pas à ma nature ».
Ces réserves étant faites, l’analyse de Stefan Zweig nous semble pertinente sur deux points :
- l’idée partagée chez tous les peuples belligérants de livrer une guerre de » légitime défense » contre un ennemi « fauteur de guerre ».
- la profonde méconnaissance par les masses des réalités de la guerre à l’ère industrielle.
« Le lendemain matin en Autriche ! Dans chaque station étaient collées les affiches qui avaient annoncé la mobilisation générale. Les trains se remplissaient de recrues qui allaient prendre leur service, des drapeaux flottaient. À Vienne, la musique résonnait et je trouvais toute la ville en délire. La première crainte qu’inspirait la guerre que personne n’avait voulue, ni les peuples, ni le gouvernement, cette guerre qui avait glissé contre leur propre intention des mains maladroites des diplomates qui en jouaient et bluffaient, s’était retournée en un subit enthousiasme. Des cortèges se formaient dans les rues, partout s’élevaient soudain des drapeaux, s’agitaient des rubans, montaient des musiques; les jeunes recrues s’avançaient en triomphe, visages rayonnants, parce qu’on poussait des cris d’allégresse sur leur passage à eux, les petites gens de la vie quotidienne que personne, d’habitude, ne remarquait ni ne fêtait. […]
La génération actuelle, qui n’a vu éclater que la Seconde Guerre mondiale, se demande peut-être : Pourquoi n’avons-nous pas vécu cela? Pourquoi les masses ne s’enflammèrent-elles pas en 1939 du même enthousiasme qu’en 1914 ? Pourquoi n’obéirent-elles à l’appel qu’avec fermeté et résolution, silencieuses et fatalistes ? Les mêmes intérêts n’étaient-ils pas en jeu, n’y allait-il pas en fait de biens encore plus sacrés, plus élevés, dans notre guerre actuelle, qui était une guerre pour les idées et non pas seulement pour les frontières et les colonies ?
La réponse est simple : c’est que notre monde de 1939 ne disposait plus d’autant de foi naïve et enfantine que celui de 1914. Alors, le peuple se fiait encore sans réserve à ses autorités ; personne en Autriche n’aurait osé risquer cette pensée que l’empereur François-Joseph, le père de la patrie universellement vénéré, aurait dans sa quatre-vingt-quatrième année appelé son peuple au combat sans y être absolument contraint, qu’il aurait exigé le sanglant sacrifice sans que des adversaires méchants, perfides, criminels eussent menacé la paix de l’empire. Les Allemands, de leur côté, avaient lu les télégrammes de leur empereur au tsar, dans lesquels il luttait pour la paix; un prodigieux respect de « ceux d’en haut », des ministres, des diplomates et de leur clairvoyance, de leur honnêteté, animait encore les gens simples. Si l’on en était venu à la guerre, cela n’avait pu être que contre la volonté de leurs propres hommes d’Etat ; eux-mêmes ne pouvaient être en faute, personne dans tout le pays n’encourait la moindre responsabilité. C’était donc de l’autre côté de la frontière, dans l’autre pays, que devaient nécessairement se trouver les criminels, les fauteurs de guerre; si l’on prenait les armes, c’était en état de légitime défense contre un ennemi astucieux et fourbe, qui sans le moindre motif « attaquait » la pacifique Autriche, la pacifique Allemagne. » […]
Et puis, en 1914, après un demi-siècle de paix, que savaient de la guerre les grandes masses ? Elles ne la connaissaient pas. Il ne leur était guère arrivé d’y penser. Elle restait une légende et c’était justement cet éloignement qui l’avait faite héroique et romantique. On la voyait toujours dans la perspective des livres de lecture scolaires et des tableaux des musées : d’éblouissantes attaques de cavaliers en uniforme resplendissants ; la balle mortelle, généreusement, frappait toujours en plein coeur ; toute la campage était une foudroyante marche à la victoire : «Nous serons de retour à la maison pour Noël », criaient à leur mère, en riant, les recrues de 1914. Qui, au village ou à la ville, se souvenait encore de la « véritable » guerre ? Tout au plus quelques vieillards qui, en 1866, avaient combattu contre les Prussiens, nos alliés d’aujourd’hui : et que cette guerre avait été rapide et lointaine, qu’il s’y était versé peu de sang! Une campagne de trois semaines, et sans beaucoup de victimes finalement, avant qu’on reprenne haleine ! Une rapide excursion en pays romantique, une aventure sauvage et virile -c’est de ces couleurs que la guerre se peignait en 1914 dans l’imagination de l’homme du peuple, et les jeunes gens avaient même sérieusement peur de manquer, dans leur vie, une expérience aussi merveilleuse et excitante; c’est pourquoi ils se pressaient en tumulte autour des drapeaux, c’est pourquoi ils chantaient et poussaient des cris de joie dans trains qui les menaient à l’abattoir. […]
Stefan Zweig, Le monde d’hier – Souvenirs d’un européen, extrait du chap.9, « Les premiers jours de la guerre de 1914 ».