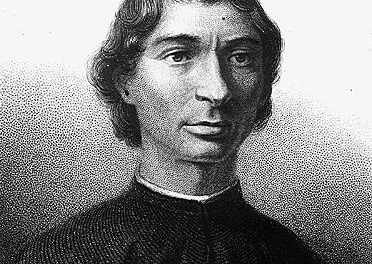Expression d’époque
Montaigne, observateur des pratiques religieuses (158
Les protestants de Bâle
» M. de Montaigne jugea qu’ils étaient mal d’accord de leur religion pour les réponses qu’il en reçut : les uns se disant zwingliens, les autres calvinistes, et les autres martinistes (1) ; et il fut averti que plusieurs couvaient encore la religion romaine dans leur cœur. La forme de donner le sacrement, c’est en la bouche communément ; toutefois tend la main qui veut, et n’osent les ministres remuer cette corde de ces différences de religions. Leurs églises ont au-dedans la forme que j’ai dite ailleurs. Le dehors est plein d’images et les tombeaux anciens entiers, où il y a prières pour les âmes des trépassés ; les orgues, les cloches et les croix es clochers, et toutes sortes d’images aux verrières y sont en leur entier, et les bancs et sièges du chœur. Ils mettent les fonts baptismaux à l’ancien lieu du grand autel et font bâtir à la tête de la nef un autre autel pour leur cène. Celui de Bâle est d’un très beau plan. L’église des Chartreux, qui est un très beau bâtiment, est conservée et entretenue curieusement ; les ornements mêmes y sont, et les meubles, ce qu’ils allèguent pour témoigner leur fidélité, étant obligés à cela par la foi qu’ils donnèrent lors de leur accord. L’évêque du lieu, qui est fort leur ennemi, est logé hors la ville en son diocèse, et maintient la plupart du reste en la campagne en la religion ancienne, et jouit de bien 50.000 livres de revenu de la ville, et se continue l’élection de l’évêque. «
La coexistence des religions catholique et protestante à Lindau
» Il y a exercice de deux religions. Nous fûmes voir l’église catholique, bâtie l’an 866 où toutes choses sont en leur entier ; et vîmes aussi l’église de quoi les ministres se servent. Toutes les villes impériales ont liberté de deux religions, catholique ou luthérienne, selon la volonté des habitants. Ils s’appliquent plus ou moins à celle qu’ils favorisent. A Lindau, il n’y a que deux ou trois catholiques, à ce que le prêtre dit à M. de Montaigne. Les prêtres ne laissent pas d’avoir leur revenu libre et de faire leur office, comme aussi des nonnains qu’il y a. Ledit sieur de Montaigne parla aussi au ministre, de qui il n’apprit pas grand-chose, sauf la haine ordinaire contre Zwingle et Calvin. On tient qu’à la vérité il est peu de villes qui n’aient quelque chose de particulier en leur créance ; et sous l’autorité de Martin, qu’ils reçoivent pour chef, ils dressent plusieurs disputes sur l’interprétation du sens des écrits de Martin. «
Une messe catholique et un office luthérien à Kempten
» Cette ville est luthérienne, et ce qu’il y a d’étrange, c’est que, comme à Isny, là aussi l’église catholique y est servie très solennellement : car le lendemain, qui fut jeudi matin, un jour ouvrier, la messe se disait en l’abbaye hors la ville, comme elle se dit à Notre-Dame de Paris le jour de Pâques, avec musique et orgues où il n’y avait que les religieux. Le peuple, au-dehors des villes impériales, n’a pas eu cette liberté de changer de religion. Ceux-là vont, les fêtes, à ce service. C’est une très belle abbaye. L’abbé la tient en titre de principauté ; elle lui vaut bien cinquante mille florins de rente. Il est de la maison de Stein. Tous les religieux sont, de nécessité, gentilshommes. (…)
Le même jeudi matin, M. de Montaigne alla à l’église des luthériens, pareille aux autres de leur secte et huguenotes, sauf qu’à l’endroit de l’autel, qui est la tête de la nef, il y a quelques bancs de bois qui ont des accoudoirs au-dessous, afin que ceux qui reçoivent leur cène, se puissent mettre à genoux, comme ils font. Il y rencontra deux ministres vieux, dont l’un prêchait en allemand à une assistance non guère grande. Quand il eut achevé, on chanta un psaume en allemand, d’un chant un peu éloigné du nôtre. A chaque verset il y avait des orgues qui y ont été mises fraîchement (2), très belles, qui répondaient en musique ; autant de fois que le prêcheur nommait Jésus-Christ, et lui et le peuple tiraient le bonnet. «
Office luthérien du dimanche à Augsbourg
» M. de Montaigne, le lendemain qui était dimanche matin, fut voir plusieurs églises, et aux catholiques, qui sont en grand nombre, trouva partout le service fort bien fait. Il y en a six luthériennes et seize ministres ; les deux des six sont usurpées des églises catholiques, les quatre sont bâties par eux. Il en vit une ce matin, qui semble une grande salle de collège : ni images, ni orgues, ni croix. La muraille chargée de force écrits en allemand des passages de la Bible ; deux chaires, l’une pour le ministre, et lors il y en avait un qui prêchait, et au-dessous une autre où est celui qui achemine le chant des psaumes. A chaque verset ils attendent que celui-là donne le ton au suivant ; ils chantent pêle-mêle, qui veut, et couvert qui veut. Après cela, un ministre qui était dans la presse (3), s’en alla à l’autel, où il lut force oraisons dans un livre, et à certaines oraisons, le peuple se levait et joignait les mains, et au nom de Jésus-Christ faisait des grandes révérences. «
Office du samedi à la synagogue de Vérone
» Il avait déjà vu une autre fois leur synagogue, un jour de samedi, le matin, et leurs prières, où ils chantent désordonnément, comme en l’église calvinienne, certaines leçons de la Bible en hébreu accommodées au temps. Ils ont des cadences de son pareilles, mais un désaccord extrême, pour la confusion de tant de voix de toute sorte d’âges : car les enfants, jusques au plus petit âge sont de la partie, et tous indifféremment entendent l’hébreu. Ils n’apportent non plus d’attention en leurs prières que nous ne faisons aux nôtres, devisant parmi cela d’autres affaires, et n’apportant pas beaucoup de révérence à leurs mystères. Ils lavent les mains à l’entrée, et en ce lieu-là ce leur est exécration de tirer le bonnet ; mais baissent la tête et le genou là où leur dévotion l’ordonne. Ils portent sur les épaules ou sur leur tête certains linges, où il y a des franges attachées : le tout serait trop long à déduire. L’après-dîner, tour à tour leurs docteurs leur font la leçon sur le passage de la Bible de ce jour-là, le faisant en italien. Après la leçon, quelque autre docteur assistant choisit quelqu’un des auditeurs, et parfois deux ou trois de suite, pour argumenter contre celui qui vient de lire, sur ce qu’il a dit. Celui que nous ouïmes lui sembla avoir beaucoup d’éloquence et beaucoup d’esprit en son argumentation. «
Michel de MONTAIGNE, Journal de voyage en Italie, édition présenté, établie et annotée par Pierre Michel, Paris, Le Livre de Poche, 1974, p. 59 – 60 ; 89 – 90 ; 98 – 99 ; 107 – 108 ; p. 260 – 261.
Notes :
1. Luthériens, à cause du prénom de Luther : Martin.
2. Récemment.
3. La foule.
Montaigne est reçu en audience par le pape Grégoire XIII (1580)
Le 29 décembre, M. D’Albain (1), qui était lors ambassadeur, gentilhomme studieux et fort ami de longue main de M. de Montaigne, fut d’avis qu’il baisât les pieds du pape. M. d’Estissac et lui se mirent dans le coche dudit ambassadeur. Quand il fut en son audience, il les fit appeler par le camérier du pape. Ils trouvèrent le pape, et avec lui l’ambassadeur tout seul, qui est la façon ; il a près de lui une clochette qu’il sonne, quand il veut que quelqu’un vienne à lui. L’ambassadeur assis à main gauche découvert ; car le pape ne tire jamais le bonnet à qui que ce soit, ni nul ambassadeur n’est près de lui la tête couverte. M. d’Estissac entra le premier, et après lui M. de Montaigne, et puis M. de Mattecoulon, et M. du Hautoy. Après un ou deux pas dans la chambre, au coin de laquelle le pape est assis, ceux qui entrent, qui qu’ils soient, mettent un genou à terre, et attendent que le pape leur donne la bénédiction, ce qu’il fait ; après cela ils se relèvent et s’acheminent jusqu’à environ la mi-chambre. Il est vrai que la plupart ne vont pas à lui de droit fil, tranchant le travers de la chambre, ains (2) gauchissant un peu le long du mur, pour donner, après le tour, tout droit vers lui. Etant à mi-chemin, ils se remettent encore un coup sur un genou, et reçoivent la seconde bénédiction. Cela fait, ils vont vers lui jusques à un tapis velu, étendu à ses pieds, sept ou huit pieds plus avant. Au bord de ce tapis, ils se mettent à deux genoux. Là, l’ambassadeur qui les présentait se mit sur un genou à terre, et retroussa la robe du pape sur son pied droit, où il y a une pantoufle rouge, à tout une croix blanche au-dessus. Ceux qui sont à genoux se tiennent en cette assiette jusqu’à son pied, et se penchent à terre, pour le baiser. M. de Montaigne disait qu’il avait haussé un peu le bout de son pied. Ils se firent place l’un à l’autre, pour baiser, se tirant à quartier, toujours en ce point. L’ambassadeur, cela fait, recouvrit le pied du pape, et, se relevant sur son siège, lui dit ce qu’il lui sembla pour la recommandation de M. d’Estissac et de M. de Montaigne. Le pape, d’un visage courtois, admonesta M. d’Estissac à l’étude et à la vertu, et M. de Montaigne de continuer à la dévotion qu’il avait toujours portée à l’Église et service du roi très chrétien et qu’il les servirait volontiers où il pourrait : ce sont services de phrases italiennes. Eux ne lui dirent mot ; ains ayant là reçu une autre bénédiction, avant de se relever, qui est signe du congé, reprirent le même chemin. Cela se fait selon l’opinion d’un chacun : toutefois le plus commun est de se sier en arrière à reculons, ou au moins de se retirer de côté, de manière qu’on regarde toujours le pape au visage. A mi-chemin, comme en allant, ils se remirent sur un genou, et eurent une autre bénédiction, et à la porte, encore sur un genou, la dernière bénédiction.
Le langage du pape est italien, sentant son ramage bolonais, qui est le pire idiome d’Italie ; et puis de la nature il a la parole malaisée. Au demeurant, c’est un très beau vieillard, d’une taille moyenne et droite, le visage plein de majesté, une longue barbe blanche, âgé lors de plus de quatre-vingts ans, le plus sain pour cet âge et vigoureux qu’il est possible de désirer, sans goutte, sans colique, sans mal d’estomac, et sans aucune sujétion ; d’une nature douce, peu se passionnant des affaires du monde, grand bâtisseur ; en cela il laissera à Rome et ailleurs un singulier honneur à sa mémoire ; grand aumônier, je dis hors de toute mesure. (…) Outre cela il a bâti des collèges pour les Grecs, pour les Anglais, Ecossais, Français, pour les Allemands, et pour les Polacs, qu’il a dotés de plus de dix mille écus chacun de rente à perpétuité, outre la dépense infinie des bâtiments. Il l’a fait pour appeler à l’Église les enfants de ces nations-là, corrompus des mauvaises opinions contre l’Église ; et là les enfants sont logés, nourris, habillés, instruits et accommodés de toutes choses, sans qu’il y aille un quatrin du leur, à quoi que ce soit. les charges publiques pénibles, il les rejette volontiers sur les épaules d’autrui, fuyant à se donner peine. Il prête tant d’audiences qu’on veut. Ses réponses sont courtes et résolues, et perd-on temps de lui combattre sa réponse par nouveaux arguments. En ce qu’il juge juste, il se croit ; et pour son fils même, qu’il aime furieusement, il ne s’ébranle contre cette sienne justice. Il avance ses parents (…) et, à la vérité, a une vie et des mœurs auxquelles il n’y a rien de fort extraordinaire ni en l’une ni en l’autre part. «
Michel de MONTAIGNE, Journal de voyage, éd. Fausta Garavini, Paris, Gallimard, « Folio », 1983, p. 193 – 195.
Notes :
1. Louis Chastegnier (1535 – 1595), seigneur d’Albain et de La Roche-Posay, ambassadeur de France à Rome de 1575 à 1581.
2. Ains = au contraire.
Réflexions de Montaigne sur les prières
» Je propose des fantaisies informes et irrésolues, comme font ceux qui publient des questions douteuses à débattre aux écoles ; non pour établir la vérité, mais pour la chercher. Et les soumets au jugement de ceux à qui il touche de régler non seulement mes actions et mes écrits, mais encore mes pensées. Egalement m’en sera acceptable et utile la condamnation comme l’approbation, tenant pour exécrable s’il se trouve chose dite par moi ignorament ou par inadvertament contre les saintes prescriptions de l’Eglise catholique, apostolique et Romaine, en laquelle je meurs et en laquelle je suis né. Et pourtant, me remettant toujours à l’autorité de leur censure, qui peut tout sur moi, je me mêle ainsi témerairement à toute sorte de propos, comme ici. (…)
Ce n’est pas sans grande raison, ce me semble, que l’Eglise défend l’usage promiscue, téméraire et indiscret des saintes et divines chansons que le Saint Esprit a dicté en David. Il ne faut mêler Dieu en nos actions qu’avec révérence et attention pleine d’honneur et de respect. Cette voix est trop divine pour n’avoir d’autre usage que d’exercer les poumons et plaire à nos oreilles ; c’est de la conscience qu’elle doit être produite, et non pas de la langue. Ce n’est pas raison qu’on permette qu’un garçon de boutique, parmi ces vains et frivoles pensemens, s’en entretienne et en joue.
Ni n’est certes raison de voir tracasser par une sale et par une cuisine le Saint livre des sacrez mystères de notre créance. C’étoient autrefois mystères ; ce sont à présent déduits et ébats. Ce n’est pas en passant et tumultuairement qu’il faut manier une étude si sérieuse et vénérable. Ce doit être une action destinée et rassise, à laquelle on doit toujours ajouter cette préface de notre office : « Sursum corda », et y apporter le corps même disposé en contenance qui témoigne une particulière attention et révérence.
Ce n’est pas l’étude de tout le monde, c’est l’étude des personnes qui y sont vouées, que Dieu y appelle. Les méchants, les ignorants s’y empirent. Ce n’est pas une histoire à compter, c’est une histoire à révérer, craindre, adorer. Plaisantes gens qui pensent l’avoir rendue maniable au peuple, pour l’avoir mise en langage populaire ! Ne tient-il qu’aux mots qu’ils n’entendent tout ce qu’ils trouvent par écrit ? Dirai-je plus ? Pour l’en approcher de ce peu, ils l’en reculent. L’ignorance pure et remise toute en autrui était bien plus salutaire et plus savante que n’est cette science verbale et vaine, nourrice de présomption et de témérité.
Je crois aussi que la liberté à chacun de dissiper une parole si religieuse et importante à tant de sortes d’idiomes a beaucoup plus de danger que d’utilité. Les Juifs, les Mahométans, et quasi tous autres, ont épousé et révèrent le langage auquel originellement leurs mystères avaient été conçus, et en est défendue l’altération et changement ; non sans apparence. (…)
Je propose les fantaisies humaines et miennes, simplement comme humaines fantaisies, et séparément considérées, non comme arrêtées et réglées par l’ordonnance céleste, incapables de doute et d’altercation ; matière d’opinion, non matière de foi ; ce que je discours selon moi, non ce que je crois selon Dieu, comme les enfants proposent leurs essais ; instruisables, non instruisants ; d’une manière laïque, non cléricale, mais très religieuse toujours.
Et ne dirait-on pas aussi sans apparence, que l’ordonnance de ne s’en remettre que bien reservément d’écrire de la Religion à tous autres qu’à ceux qui en font expresse profession, n’aurait pas faute de quelque image d’utilité et de justice ; et, à moi avec, à l’aventure, de m’en taire ?
On m’a dit que ceux mêmes qui ne sont pas des nôtres, défendent pourtant entre eux l’usage du nom de Dieu, en leurs propos communs. Ils ne veulent pas qu’on s’en serve par une manière d’interjection ou d’exclamation, ni pour témoignage, ni pour comparaison : en quoi je trouve qu’ils ont raison. Et, en quelque manière que ce soit que nous appelons Dieu à notre commerce et société, il faut que ce soit sérieusement et religieusement. «
Michel de MONTAIGNE, Essais, I, LVI, « Des prières », Paris, Gallimard, « Pléiade », p.302-309.
Sur Clio-Texte, vous trouverez aussi des textes de Montaigne sur les « sauvages » .