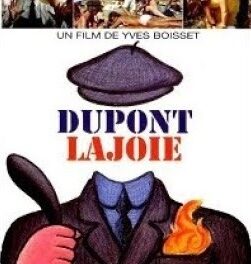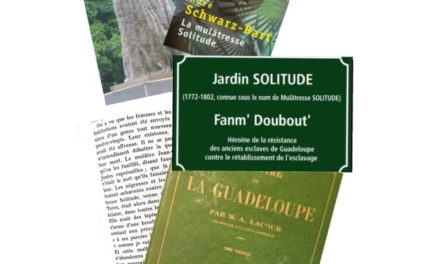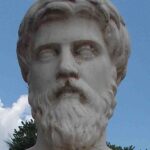Pierre Martyr d’Anguiera (en italien Pietro Martire d’Anghiera) (1457–1526) est né en février 1457 à Arona dans le Piémont. En 1477, il arrive à Rome et devient secrétaire du gouverneur de Rome, Francesco Negro.
Dix ans plus tard, Pierre Martyr D’Anguiera quitte l’Italie pour l’Espagne après avoir rencontré le comte de Tendilla. C’est à ce titre que, désormais installé à la Cour du roi de Castille, il participe au siège de Grenade, puis reçoit pour mission d’assurer l’éducation de jeunes nobles et des pages de la Reine Isabelle la Catholique dont il est un proche. Parmi les pages de la Reine, se trouvent les deux fils de Christophe Colomb, Diego et Hernando, qui acquièrent ce statut privilégié au retour de leur père en 1493.
C’est dans ce contexte que dès 1493, Pierre Martyr s’intéresse à l’histoire de la découverte de nouvelles terres par Colomb qu’il rencontre à plusieurs reprises (à ce moment, on ne parle pas de nouveau continent et encore moins de l’Amérique). Ayant réuni une abondante documentation, entendu les témoignages des nombreux protagonistes et rédigé lui-même de nombreux rapports consacrés aux nouvelles terres découvertes qu’il estime être un tournant de l’histoire, il est le premier auteur à écrire sur ces dernières dès 1494.
En 1511, Pierre Martyr commence la publication, en latin, de son ouvrage central De Orbe Novo. Elle se poursuit en 1516 et 1521, Pierre Martyr rédigeant au fur et à mesure des découvertes. Imprimé à Séville, De Orbe Novo est consacré à la découverte de l’Amérique, sa conquête et sa colonisation. Très rapidement, les écrits d’Anghiera deviennent très populaires, en premier lieu au saint des élites. Avec les écrits de Bartholomé de las Casas, et d’Hernando Colomb, Pierre Martyr d’Anghiera fait donc figure de source incontournable pour appréhender la découverte de l’Amérique et sa colonisation, Christophe Colomb n’ayant laissé que peu d’écrits.
Les extraits choisis reviennent ici sur le premier voyage de Christophe Colomb, sa première rencontre avec les populations des îles découvertes et son retour en Espagne. Après un départ depuis le port de Palos de la Frontera (Andalousie) le vendredi 3 août, Colomb et son équipage (entre 90 et 120 hommes, selon les sources) font une halte de trois semaines aux îles Canaries. L’objectif est de renouveler les provisions et de remplacer le gouvernail de la Pinta. Le 6 septembre 1492, le second départ a lieu. Après plusieurs semaines de voyage tendues, dans la nuit du 11 au 12 octobre, la terre est enfin en vue …
Extrait n° 1 : le voyage et la découverte de terres nouvelles
[…] Ecoutez maintenant ce qu’on raconte des îles de la mer Occidentale récemment découvertes et des auteurs de ces découvertes. Aussi bien vous m’exprimiez dans vos lettres le désir de le savoir. Je veux, pour ne faire de tort à personne, commencer par les origines.
Un certain Christophe Colomb, un Génois, proposa aux rois catholiques, Ferdinand et Isabelle, de trouver, en partant de l’extrémité de nos terres occidentales, les îles qui avoisinent l’Inde. Il demandait des vaisseaux et ce qui est nécessaire à la navigation, et promettait non seulement de propager le christianisme, mais aussi de rapporter fidèlement, et au-delà de toute prévision, beaucoup de perles, d’aromates et d’or. Il réussit à les persuader, et, sur ses instances, on lui destina, aux frais du trésor royal, trois 3 vaisseaux ; le premier était un vaisseau de charge, ponté, les deux autres des navires marchands non pontés, du genre de ceux que les Espagnols appellent caravelles.
Quand tout fut disposé, Colomb partit des rivages d’Espagne vers les calendes de septembre de l’an 1492. Il avait un équipage d’environ 220 hommes.
Les îles Fortunées, ainsi qu’on les nomme, les mêmes que les Espagnols dénomment les Canaries, ; ont été depuis longtemps découvertes au milieu de l’Océan. […]
Colomb y aborda pour renouveler ses provisions d’eau et reposer ses équipages avant de commencer la partie difficile de son entreprise. […]
En quittant ces îles et en poussant droit à l’ouest, mais avec une légère déviation au sud-ouest, Colomb navigua trente-trois jours de suite sans voir autre chose que la mer et le ciel. Ses compagnons commencèrent à murmurer en secret, puis ils ne cachèrent plus leur mécontentement, et songèrent à se débarrasser de leur chef. Ils voulaient même le jeter à la mer. Ils se prétendaient trahis par ce Génois qui les conduisait à un endroit d’où jamais ils ne pourraient revenir. Au trentième jour ils réclamaient à grands cris et pleins de fureur pour qu’on les ramenât en arrière et pour qu’on n’avançât pas plus loin. Quant à Colomb, mêlant les promesses aux espérances, il s’efforçait de gagner du temps, calmait les colères, descendait aux prières, et finissait par leur rappeler qu’ils seraient accusés de trahison par les rois d’Espagne, s’ils se livraient contre lui à quelque voie de fait et refusaient d’obéir.
Cette terre tant désirée ils la découvrirent enfin, à leur grande joie. Dans ce premier voyage, Colomb ne reconnut que six îles, mais deux de ces îles étaient de première grandeur. Il nomma l’une Hispaniola et l’autre Joanna. Il n’était pourtant pas bien sûr que Joanna fût une île. En longeant le littoral de ces îles, les Espagnols entendirent des rossignols qui chantaient, au mois de novembre, dans l’épaisseur des bois. Ils trouvèrent de grands fleuves d’eau douce, et des ports naturels où pouvaient s’abriter de grandes flottes. Colomb longea la côte de Joanna en droite ligne dans la direction du nord-ouest pendant près de huit cent mille pas, ou cent quatre-vingt lieues. Aussi pensa-t-il que c’était un continent, puisqu’on n’apercevait dans l’île, aussi loin que pouvait s’étendre le regard, ni bornes, ni signe quelconque de bornes. Il résolut donc de revenir sur ses pas. Aussi bien le gonflement des eaux le força à retourner en arrière. Les côtes de Joanna décrivaient dans la direction du nord de vastes sinuosités, et se redressaient devant lui. Comme on était en hiver, les vents du nord devenaient dangereux pour ses navires. Il prit donc la direction de l’ouest, et gouverna vers l’île qu’il croyait être l’île d’Ophir. Pourtant, si on examine avec soin les traités cosmographiques, on remarquera qu’il s’agit non d’Ophir mais des Antilles et autres archipels voisins. Colomb donna à cette île le nom d’Hispaniola. […]
Extraits pp. 6 à 9
Hispaniola = Haïti / Joanna = Cuba
Extrait n°2 : la première rencontre
[…] C’est là que, descendus à terre, les Espagnols découvrirent pour la première fois des insulaires. Voyant venir à eux ces inconnus, les insulaires se réunirent et tous ensemble s’enfuirent au plus profond des forêts, comme de timides lièvres pourchassés par des lévriers.
Les Espagnols poursuivirent les fuyards mais ne réussirent à prendre qu’une femme. Ils la ramenèrent sur leurs navires, lui donnèrent en abondance des vivres et du vin, la revêtirent d’habillements, car les deux sexes vivent absolument nus, à l’état de nature, et lui rendirent la liberté. Cette femme, qui connaissait l’endroit où s’étaient cachés les fugitifs, retourna vers eux, leur montra ses ornements, et vanta la libéralité des Espagnols. Tous alors accourent au rivage, convaincus que les nouveaux débarqués sont des envoyés célestes. Ils se mettent à la nage, et portent aux navires de l’or, dont ils avaient une petite quantité. Ils échangeaient volontiers cet or contre un morceau de poterie ou de verre. Si un Espagnol leur montrait une aiguille, une sonnette, un fragment de miroir, ou quelque chose de semblable, ils lui donnaient en échange tout l’or qu’il demandait, et tout celui qu’ils portaient sur eux.
Lorsque des rapports plus familiers se furent établis, et que les Espagnols purent étudier les usages locaux, ils comprirent par signes et par conjectures que ces insulaires étaient gouvernés par des rois. Descendus de leurs navires, ils furent reçus avec de grands honneurs par ces rois et par tous les autres naturels. Ils s’ingéniaient à leur rendre hommage et à leur témoigner du respect. Lorsque le soleil se coucha, les Espagnols, à l’heure de l’angelus, se mirent à genoux suivant l’usage chrétien. Ils furent aussitôt imités par les insulaires. Ils donnaient à la croix tous les signes d’adoration dont ils voyaient les chrétiens se servir. […]
Extrait page 10
Note : c’est à cette occasion que Colomb rencontre pour la première fois les Taïnos.
[…] Les Espagnols ont entendu dire que non loin de ces îles s’étendaient d’autres archipels, habités par des peuplades féroces qui se nourrissent de chair humaine. C’est pour cela que les naturels d’Hispaniola s’enfuirent si précipitamment à notre arrivée. Ils nous l’ont avoué plus tard, ils nous avaient pris pour des Cannibales : tel est le nom qu’ils donnent à ces barbares. Ils les nomment encore Caraïbes. Les îles de ces impies sont situées au midi, à peu près à mi-chemin des autres îles. Quant aux insulaires d’Hispaniola, qui sont d’un naturel doux, ils se plaignent avec raison d’être exposés aux fréquentes attaques des Cannibales, qui débarquent chez eux pour faire du butin, et les poursuivent dans les forêts comme des chasseurs en quête de bêtes fauves. Les Cannibales les prennent tout enfants, et les châtrent, comme nous faisons chez nous des poulets ou des porcs que nous voulons engraisser et attendrir pour nos repas ; quand ils ont grandi et se sont engraissés, ils les mangent. Lorsqu’ils tombent plus âgés entre leurs mains, les Cannibales les tuent et les coupent en morceaux. Ils mangent aussitôt les intestins et l’extrémité des membres. […]
Extrait page 12
Cet extrait évoque la découverte d’un autre peuple, les Karib ou Kaniba, ennemis des Taïnos. Leurs pratiques culturelles, choquantes pour les Européens, donnèrent naissance au terme de « cannibale ».
Extrait n° 3 : le retour en Espagne
[…] Ferdinand et Isabelle qui ne cessaient de penser, même pendant leur sommeil, à propager la foi chrétienne, espérant que ces nations si nombreuses et si douces seraient facilement converties à notre religion, éprouvèrent à ces nouvelles une vive émotion. Colomb à son retour fut reçu par eux avec de grands honneurs, comme il le méritait pour ce qu’il avait exécuté. Ils le firent s’asseoir en leur présence, ce qui pour les rois d’Espagne est la preuve la plus grande d’amitié, de reconnaissance, et le signe suprême de gratitude. Ils ordonnent que dorénavant Colomb soit appelé préfet de la mer, ou, en langue espagnole, Amiral. Barthélemy Colomb son frère, lui aussi très expert en l’art de la navigation, est par eux honoré du titre de préfet de l’île Hispaniola, ce qu’en langue vulgaire on appelle Adelantado. Aussi bien, pour me faire mieux comprendre, je n’emploierai désormais que ces termes usuels d’amiral et d’adelantado, ainsi que tous les termes dont on se sert aujourd’hui pour la navigation : mais revenons à notre récit. […]
Extrait page 16-17
Source : Pierre Martyr Anghiera De orbe novo : les huit décades traduites du latin, avec notes et commentaires, par Paul Gaffarel, doyen honoraire de l’Université d’Aix-Marseille, Paris, Ernest Leroux, 1907, 755 pages.