En guise d’introduction des textes…
Albin Michel a réédité en 2021, pour son centenaire, l’ouvrage Batouala, de René Maran, qui obtint le prix Goncourt 1921 mais finit, en raison de sa critique des « dysfonctionnements » d’un système colonial qu’il ne remettait pas en cause sur le fond, par subir de violentes attaques des milieux littéraires. Ceux-ci lui imputèrent rapidement des incompétences qu’on ne pouvait éclairer que par le fonctionnement « intermittent » du cerveau des noirs1.
Institutrice puis diplômée d’études supérieures en Sorbonne, Paulette Nardal est fort peu connue aujourd’hui dans l’hexagone. Elle fut avec sa sœur Jeanne à l’origine d’un salon littéraire noir parisien avant de se distinguer dans deux revues dont on parle encore aujourd’hui, elle compte sans conteste possible comme l’une des précurseures du mouvement littéraire de la négritude, en amont de Césaire et Senghor2. Paulette Nardal participa en 1928 à La Dépêche africaine, dont on a souvent souligné la valeur culturelle (le journal souffrit probablement de son sulfureux directeur3 finalement condamné pour escroquerie en 19364 et dont la personnalité tranchait nettement avec l’équipe de rédaction). Paulette Nardal participe ensuite avec Maran à La Revue du monde noir, qui ne paraît qu’en 1931-1932. C’est donc quatre ans après l’échec économique de cette revue qu’elle signe un article dans JSP, à côté d’un autre signé de Maran.
Tous ceux qui se sont intéressés sérieusement et sans a priori à Maran sont au fait d’une affirmation récurrente dans des conversations contemporaines d’historiens ou de littéraires : sa participation à l’hebdomadaire Je suis partout, journal dont on connaît le parcours collaborationniste en 1940-1944. Le fait fut rappelé par un historien, lors des questions qui suivaient la première des tables rondes du colloque du Musée de l’homme du 15 décembre 2021. La question avait déjà été abordée par Elsa Geneste qui affirmait en 2013 que Maran n’avait rien publié dans JSP durant la Collaboration5. Il semble effectivement que non. On ne peut en outre tenir grief à Maran (si tant est que ce soit le rôle du discours historique) d’être demeuré une référence pour la rédaction de JSP qui le cite ou le chronique à plusieurs reprises en 1941, 1942 ou 1944. Il est d’ailleurs beaucoup plus important de constater qu’un journal où se réunit la fine fleur du collaborationnisme français cite à trois reprises un auteur noir. Maran a donc bien écrit dans les pages coloniales de JSP, peut être jusqu’en 1936, à une époque où l’ancrage antisémite, l’inclination pour les régimes autoritaires et la fascination pour le nazisme étaient des faits patents. Comment le comprendre ? Benjamin Crémieux, qui fut plus tard résistant et déporté, fut aussi jusqu’en 1934 critique théâtral dans Je suis partout. Or le fait est que la tentation fasciste y est largement une réalité en 1932. Comment l’expliquer ? De Maran, on a pu écrire qu’il cherchait à prouver que l’homme noir pouvait faire aussi bien que l’homme blanc. C’est ce que Xavier Luce avance6 à propos de lettres de Maran à Maurice Barrès en amont de Batouala (1921). Maran ne fut pas seul dans ce cas et d’autres personnalités noires de la Troisième République, s’inscrivirent régulièrement dans une démarche visant à prouver à l’homme blanc l’égale valeur de l’homme noir, obsession qui nous renvoie en miroir la volonté d’en finir avec ce qui fut au quotidien leur expérience de la race. Il faut par ailleurs noter que certains articles de Maran ne sont pas en phase avec Je suis partout. Ainsi en est-il d’un article de 1936 dans lequel il refuse l’idée de céder des colonies à l’Allemagne nazie. Ce point de vue est alors partagé par le Guyanais Monnerville, jeune député radical. Il est également exprimé en 1939 par le député sénégalais Galandou Diouf et par son collègue guadeloupéen Gratien Candace dans un meeting de la jeune Ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme (alors LICA). Paulette Nardal est d’ailleurs quelques temps la secrétaire de Diouf en 1939.
Les deux articles présentés ici sont a priori d’une extraordinaire banalité pour l’époque. Ce qui ne l’est pas, vu du XXIe siècle, est leur présence dans Je suis partout. Il est vrai qu’on trouve des pages coloniales dans la plupart des journaux de cette époque. Comme c’est très souvent le cas pour les vieilles colonies (Martinique, Guadeloupe, Guyane, la Réunion), des auteurs qui en sont originaires s’en font les promoteurs. En exposant la valeur des colonies, peut-être démontrent-ils leur propre valeur. Plutôt que d’en faire aujourd’hui des collaborateurs passés du système colonial (qu’on appelle rarement colonialisme à cette époque), il apparaît plus judicieux de les regarder comme des acteurs autonomes qui ont eux aussi tenu à promouvoir l’empire, regardant les injustices coloniales, non comme le péché originel qu’on dénonce aujourd’hui mais comme des dysfonctionnements dans la mise en œuvre d’un projet qu’ils ne balayaient pas d’emblée. À titre plus individuel, c’était aussi une façon de faire leur place dans un monde qui ne leur laissait guère de possibilités individuelles.
Que nous disent ces textes ? Pour Maran, il s’agit de constater une fois encore, qu’on ne connaît pas les colonies. Son texte s’inscrit dans l’ensemble d’une certaine littérature journalistique coloniale dont les auteurs expliquent aux Français de la métropole les merveilles de la plus grande France et les richesses qu’elles brûlent de lui apporter à pleines carènes. Cet article a également valeur de présentation de ce qu’est alors l’orpaillage en Guyane. Cette contribution de Maran n’a finalement pas grande originalité si l’on excepte une allusion fort neutre au fait qu’on a indemnisé les propriétaires d’esclaves en 1848.
L’article de Paulette Nardal, est illustré par JSP de deux photos dont l’une à laquelle est attribuée la légende très banale « Type indigène », une référence qui ignore la singularité de l’homme représenté. A priori, celui-ci pourrait être de maints endroits d’Afrique de l’Ouest mais la rédaction s’est sans doute dit qu’il valait bien un Martiniquais. Elle n’a pas davantage relevé que le terme « indigène » n’a pas cours dans l’ordre juridique des Antilles, même s’il est alors utilisé par les fonctionnaires fraîchement arrivés et non encore informés des choses à ne pas dire et du statut de citoyen hérité de 1848, quelles qu’en soient les réalités concrètes. Le texte de Paulette Nardal, qui s’inspire surtout de sa propre terre de Martinique, ne se contente pas de quelques réflexions pittoresques et exotistes. Elle souligne ainsi l’importance des cataclysmes sismiques, volcaniques et atmosphériques dans les deux sociétés insulaires et ne fait pas de chaque jour un paradis indolent et doudouiste. On relève qu’elle évoque une civilisation africaine au singulier mais elle parle bien de civilisation et explique finement le syncrétisme religieux entre Afrique et Antilles. Elle montre l’importance dans le carnaval de la mémoire de l’esclavage, tout en s’entourant des formes nécessaires pour éviter l’accusation d’ingratitude qui guette tout individu exotique se montrant quelque peu critique. Ce faisant, elle ne cherche pas comme d’autres (on songe à Gratien Candace encore en 1948) à euphémiser l’esclavage français par rapport à d’autres. Son récit sur le carnaval martiniquais et sur le jour des Morts peut exercer suffisamment de fascination pour qu’elle y glisse sans problème une strophe de la Foire aux morts de Gilbert Gratiant, poète martiniquais, sang mêlé et communiste.
Est-il possible que la motivation pour écrire des articles ait été alimentaire ? Est-il possible que l’on y ait vu un simple moyen de faire connaître les mondes coloniaux sans que Paulette Nardal ou René Maran ne fussent très au point sur l’évolution du journal ? Est-il possible que Paulette Nardal se soit jouée de la rédaction de Je suis partout en glissant autant de références qui cadrent difficilement avec les orientations du journal en 1936 ? Est-il possible que Paulette Nardal et René Maran aient souhaité jouer le rôle de contrepoints dans une telle publication ?
La Guyane française et l’exploitation aurifère
« La statistique, affirme non sans humour certain dicton anglais, est l’une des formes les plus perverses du mensonge ». Voilà qui déplaira sans doute aux économistes ayant accoutumé de faire de cette science le meilleur ou le pire usage. À vrai dire, le tort de ceux-ci est de la faire intervenir pour démontrer l’excellence du système qu’ils ont fondé, alors qu’elle n’est que le résultat d’actes ou d’effets répartis sur un laps de temps donné et dans des conditions nettement spécifiées. Il est facile de deviner ce qui s’ensuit. La moindre erreur commise dans l’appréciation de ces dernières, qui peuvent être aussi bien d’ordre moral, que matériel, exclut toute conclusion précise et profitable.
C’est à cette erreur de cause à effet – M. Ch. Porod, ingénieur, qui séjourne actuellement en Guyane française, quelque part dans le Haut-Oyapock, le prouve irréfutablement dans une étude qu’il nous a envoyée il y a quelques mois et dont s’inspire le présent article – que la France doit de méconnaître ses possessions d’outre-mer en général et la Guyane en particulier.
Pour ce qui touche à la Guyane, bon nombre de reportages superficiels nous ont appris à l’ignorer. Les chasseurs d’informations sensationnelles n’ont pas dépassé ses bagnards. Ils n’ont pas daigné pénétrer sa forêt vierge. C’est elle qui renferme pourtant, si l’on peut du moins s’exprimer ainsi, le to be or not to be de la colonie, sa raison d’être, en un mot : son or.
Cet or dont tant d’États font officiellement fi7, mais dont on ne cesse de pousser l’exploitation à outrance, on sait, depuis le dix-septième siècle, qu’il existe en Guyane.
En 1720, Claude Orvilliers envoie aux frais de la colonie, une expédition à la recherche du fameux « El Dorado ». Les membres de cette expédition meurent les uns après les autres à la tâche. L’El Dorado, ses palais d’or, ses statues d’or n’étaient que rêves. Par contre, les autochtones, les Indiens connaissaient maints gisements du précieux métal…
En 1762, Patris trouve des paillettes d’or dans les criques – c’est le nom qu’on donne en Guyane aux ruisseaux – des monts Tumuc-Humac.
En 1803, d’après Coudreau, le colonel Ogier de Gombaud, alors qu’il voyageait à l’intérieur, rencontra un indigène portant au cou un morceau d’or pesant quatre livres.
En 1830, le naturaliste Schomburg trouve de l’or dans la sierra Paracaïma. Le métis brésilien Paolino, en 1853, redécouvre de l’or dans le Haut-Approuage, aux endroits où venaient jadis les Nolaques chercher les paillettes et les pépites dont ils avaient besoin.
Sa découverte marque le début d’une exploitation qui donne rapidement des résultats de plus en plus importants, comme en font foi les chiffres fournis par le fonctionnaire chargé des statistiques à l’Agence économique des colonies autonomes.
Toujours est-il que les quantités d’or officiellement exportées de Guyane, de 1853 à fin mars 1933, atteignent 147.198 kilos, d’une valeur de 2.207.843.000 fr.8 On peut donc admettre, restant de la sorte dans la limite des choses possibles, que 49.000 kilos ont été exportés clandestinement pendant la même période. Il est, par conséquent, certain que la Guyane, en quatre vingts années a fourni deux cents tonnes d’or, s’élevant à la valeur de trois milliards.
C’est là un record, dont cette colonie, qui ne comprend que 35.000 habitants, peut s’enorgueillir à juste titre. Ce record est d’ailleurs d’autant plus remarquable, qu’on a usé, pour l’atteindre, des moyens les plus primitifs, qui sont : la battée, le sluice et le longtem9(sic).
Devant les résultats acquis, trente ans après la découverte de Paolino, nombreux étaient ceux qui prédisaient l’épuisement à brève échéance de l’or alluvionnaire. Tous fondaient leurs prédictions sur le sort dont avaient pâti les gisements similaires de l’étranger. Ils n’oubliaient que ceci : c’est que la Guyane française est vraiment exceptionnelle.
Il n’est pas jusqu’au législateur lui-même qui ne s’y soit laissé prendre, en appliquant à la Guyane une législation minière calquée sur celle dont l’application donne encore de nos jours des résultats si féconds dans la plupart des possessions coloniales étrangères.
Les décrets successifs pris en 1858, 1881, 1906 et 1917 ont bien tenté de réglementer l’industrie10 aurifère en ce pays, qu’on appela à un moment la France équinoxiale11. Leur promulgation n’a heureusement touché que peu de gens.
Quant à l’élément producteur d’or – il faut entendre par là les orpailleurs réguliers ou irréguliers – il a pu continuer à exploiter comme devant, le plus tranquillement du monde, au plus profond de l’immense forêt guyanaise, toutes les terres domaniales, même celles concédées en bonne et due forme à des entreprises légalement constituées.
Le bricoleur devint plus libre que jamais lorsqu’on supprima, en 1908, la production à tout certificat d’origine. La chose n’a pas besoin de longues explications. L’obligation d’avoir à justifier de la provenance de la récolte présentée, aux fins de paiements de droits de douane, suffisait à empêcher nombre d’orpailleurs de se livrer à l’exploitation clandestine.
Sociétés et exploitations procédant industriellement à l’extraction de l’or furent de ce fait acculées du jour au lendemain aux pires difficultés de main d’œuvre. Leur disparition ou leur insuccès – n’a, en général, pas d’autre cause. D’autres entreprises les ont naturellement remplacées, qui ont eu un même destin. Il est vrai qu’on était alors en pleine guerre. Le matériel de rechange n’arrivait pas. Les fonds de roulement n’avaient rien à envier au matériel de rechange. Le personnel s’usait moralement à ce régime et le matériel se détériorait prématurément. Ainsi jusqu’à la fin de 1919.
Il fallait pourtant en produire coûte que coûte, vu la hausse continuelle du prix de l’or. On en produisait bien mais Dieu seul sait comment ! Un morceau de fer venait-il à manquer à droite, on démontait aussitôt son voisin de gauche. On transformait échelles et entretoises en rivets et en boulons. Les arbres des machines tournaient sur des coussinets en bois. Tout était à l’avenant. Le personnel européen – il ne comprenait la plupart du temps qu’un seul homme – s’efforçait d’assurer tant bien que mal, dans ces conditions, le fonctionnement de trois cents tonnes de machinerie désagrégeant à grand ahan, avec un bruit d’enfer, des montagnes de terre et de sable.
On dormait comme on pouvait. Il ne fallait pas être malade. Venait la fin du mois. Le directeur-mécanicien, chef de comptoir, bon à tout faire de l’entreprise, recevait alors de Paris, du siège de la Compagnie dont il était l’employé, des semonces catastrophiques parce qu’on avait jugé insuffisant son envoi d’or du mois précédent. Mais pas un mot des pièces de rechange. Ou celles-ci n’arrivaient qu’avec des retards inexplicables. Ou encore elles ne répondaient que de loin à la commande qu’elles prétendaient justifier. Il n’est donc pas étonnant que les deux dernières entreprises d’exploitation industrielle de l’or guyanais – deux compagnies de dragage datant l’une de 1912, l’autre de 1913 – aient fini par abandonner vers 1923 ou 1924 une lutte que tout concourait à rendre impossible.
La première a récolté 1.200 kilos d’or, la seconde 600. Soit une moyenne de cent kilos par an pour la première et de cinquante seulement pour la seconde. Il convient de souligner qu’on a obtenu les résultats ci-dessus malgré les mauvaises conditions de rendement consécutives à la guerre et à l’après-guerre – ne serait-ce que pour éclairer la religion de certains détracteurs de la drague à godets.
On doit, pour être complet, signaler que sept autres compagnies ont vécu d’une existence précaire de 1906 à 1911, et que la doyenne de toutes les sociétés aurifères est incontestablement la « Compagnie de l’Approuague », constituée en 1857, au capital de 20 millions, soit cinq ou six fois plus au cours actuel12.
Elle se composait de fonctionnaires – ou propriétaires – de la colonie, que le gouvernement avait nantis d’un privilège d’exploitation portant sur 20.000 hectares du bassin du Haut-Approuague, à seule fin de les dédommager de pertes qu’ils avaient subies du fait de l’abolition de l’esclavage.
Cette compagnie ne put récolter en trois ans que 180 kilos d’or, auxquels il faut adjoindre 60 kilos achetés aux indigènes – résultat on ne peut plus désastreux par rapport au capital investi. L’activité de la « Compagnie du Haut-Approuage » diminua par la suite peu à peu. Et elle finit par disparaître, laissant inachevée, l’œuvre qu’elle s’était, un moment flattée de mener à bien.
René Maran.
Joie et douleur au pays du soleil
Scènes de la vie martiniquaise
Carnaval antillais. Fête des Morts. Deux scènes caractéristiques de ces îles où, après les plus terribles cataclysmes13, le sourire fait place à la tristesse dans l’ardeur de la tâche retrouvée et de la vie renaissante.
Le carnaval de Saint-Pierre, la ville disparue, était aussi célèbre dans l’archipel caraïbe que l’est celui de Nice en Europe. De nos jours, le carnaval dure encore deux mois. Il ne commence pas avec l’année nouvelle, car le début de janvier ramène, pour les Antillais, le souvenir du tremblement de terre qui fit de nombreuses victimes à la fin du siècle dernier14.
Tous les dimanches, dès quatre heures de l’après-midi, les rues de la ville encore éblouie de soleil, sont envahies par une foule joyeuse de masques aux accoutrements bizarres. Aucune comparaison avec les pompeux défilés de mi-carême à Paris sous le ciel triste de février. Ici, la dominante est le burlesque. Ces masques, gens du peuple ou bourgeois en rupture de classe, se sont habillés à peu de frais. Ils ont réquisitionné pour ce faire les plus invraisemblables « rossignols »15 et leurs drôleries suffisent à faire rire les innombrables spectateurs massés sur les balcons et les trottoirs. Ces masques s’agglutinent parfois en véritables défilés de foule mouvante et gesticulante qui parcourent les rues principales, entraînées par les cadences endiablées d’un orchestre de musiciens locaux aux déguisements désopilants. Car tout le monde danse en marchant, rit et crie16. Impossible de résister à ce courant de joie simple et enfantine qui emporte tout un peuple17.
L’Antillais ne manque pas d’humour. Il sait à merveille se caricaturer et caricaturer les autres races. C’est souvent sur l’aspect le plus extérieur de la civilisation occidentale, c’est à dire le vêtement, qu’il exerce son sens de l’humour. Tel jeune homme s’exhibe en impeccable tenue de soirée : huit reflets, habits de bonne coupe, plastron de chemise aux mille plis, cravate blanche et… pieds nus.
Les masques antillais vont même jusqu’à reconstituer – toujours dans la note comique – certaines scènes de l’esclavage (un intermezzo de danses et de chants entre deux reprises du travail dans les champs de cannes à sucre, sous l’œil féroce du « commandeur », à cheval, et armé d’une cravache).
Ceux qui figurent les esclaves ont accentué leur couleur naturelle en s’enduisant la peau, et même leur pagne succinct, de « mélasse », empruntée à quelques distillerie des environs18. C’est la partie la plus pittoresque du défilé. Elle est toujours attendue avec un frémissement de plaisir par les enfants ravis de voir jouer les « nèg gros sirop 19».
Car ils jouent vraiment, ces hommes et ces femmes, tout au plaisir de recréer, pour des spectateurs amusés, ce qui fut un passé tragique. Détachement ? Insouciance ? Ce n’est après tout que du passé.
Mais voici venir un groupe étrange. Autour d’une espèce de monstre, vêtu de paille, le chef recouvert d’une tête de buffle, une nuée de gamins avance en sautillant et en simulant la peur. En effet, le « Diable » marmonne une chanson monotone. Où il est question de manger les petits enfants. Et les enfants lui répondent comme dans une litanie les fidèles en récitant. Or, quand on regarde avec attention cette tête de buffle, on s’aperçoit qu’avec ses miroirs encastrés sous les cornes, elle reproduit assez fidèlement les masques de sorciers africains que l’on peut voir dans les différents musées d’art nègre, en particulier au Trocadéro et à Tervueren (Belgique). Survivance frappante du passé africain de la race antillaise. Seulement, la civilisation chrétienne a transformé le sorcier nègre en diable.
Le mercredi des Cendres, une coutume également curieuse est scrupuleusement observée par les masques, qui revêtent tous la robe noire, tandis que sous le mouchoir de tête blanc les visages se montrent couverts de poudre blanche. Plaintes et lamentations célèbrent la mort du carnaval, tandis que les yeux désespérés, à la cornée subitement jaunie, roulent dans les faces grises de poudre. Ici, le christianisme rejoint curieusement le paganisme. Il existe, dans des mêmes musées, des masques africains dont le visage est blanchi à la chaux, et l’on sait que les femmes africaines, dans certaines régions, se couvrent le visage de poudre blanche pour participer à des fêtes rituelles.
Mais tout n’est pas burlesque ou primitif dans le Carnaval antillais. Il arrive que de jeunes bourgeoises de couleur qui se sont toujours habillées à l’européenne revêtent pour l’occasion l’éclatant costume local que portaient leurs grands-mères. Les fêtes données dans la métropole en commémoration du Tricentenaire du rattachement des Antilles à la France20 ont popularisé ce costume : foulards, mouches assassines, madras, colliers « choux », robes somptueuses à ramages (8 m. de tour) ramassées sur les hanches en énormes paniers, avec, en dessous la chute vaporeuse des jupons à multiples volants. Elles se promènent en auto, offrant à l’admiration des badauds leur beauté brune ou ambrée qui n’est jamais plus évidente que ces jours-là.
Deux novembre
Le culte des morts, trait caractéristique de la civilisation africaine, est demeuré très vif chez les Antillais. Tel est aussi le sentiment de la famille.
C’est pourquoi le Jour des Morts, et même celui de la Toussaint, sont pour les Antillais des jours de tristesse profonde. Nul accord de piano ne viendra troubler le pieux recueillement des familles. Ce jour-là, tous les établissements de plaisir se font un devoir de fermer…
Et le soir, toute la ville se rend aux deux cimetières de la capitale : le grand cimetière dit cimetière des riches, et l’autre, le plus pittoresque, qu’on appelle le Trabeau. Car c’est après le dîner, à la nuit tombée et à la lueur changeante des bougies, que l’Antillais aime à honorer ses morts.
Aux portes de la ville se trouve le grand cimetière qu’ornent de très beaux monuments funéraires. La douleur s’y fait distinguée et secrète.
Mais au Trabeau, quel contraste et quelle féerie !
C’est à un kilomètre de la ville, passé la rivière Madame, dans le quartier de l’Hermitage.
Parmi la foule qui se presse dans les allées étroites qui serpentent entre les tombes s’insinue on ne sait quel air de fête païenne.
Sur chaque tombe, tumulus à peine bombé, resplendit la flamme claire de multiples petites bougies piquées dans la terre. La mer a donné à ces humbles tertres une parure exquise : les conques de « lambis »21 qu’on dispose en bordure et dont l’intérieur d’un rose nacré luit doucement Entre les bougies retombent des grappes de bougainvillier mauve, de stéphanotis et de roses.
Le relent de la cire fondante qui se mêle au parfum violent des leurs tropicales met dans l’air une espèce d’ivresse…
Tassées sur des bancs minuscules, de vieilles femmes, aux figures rigides sous le mouchoir blanc ou le foulard calendré, égrènent de lourds rosaires.
Dans les allées circule la jeunesse, visages sombres ou moins sombres éclairés d’en bas, yeux splendides où brille la joie de vivre tandis que les lèvres murmurent des Avé…
Un poète martiniquais, Gilbert Gratiant22, a appelé ce spectacle « la Foire aux Morts ». Voici deux strophes du poème qui lui a été inspiré par cet aspect local du culte des morts :
C’est la Foire ! Voici les échoppes ! Celui-ci vous vend des coquilles
De lambis couleur de rose. Celle-là vante ses bougies.
Gros-Loulou offre du sable blanc en plaisantant avec les filles.
A l’étalage du chagrin, combien de paupières rougies !
Aux portes du champ muré, pains doux, pistaches, cacahuètes.
Ravitaillement de la douleur, s’offrent en des trays23 de bois blancs, après la dernière pirouette !
Même chair, autre douleur, – avec moins de faux semblants !
Paulette Nardal.
Notes
1 « Le cerveau des nègres est encore un mécanisme au fonctionnement intermittent », phrase publiée dans Le Temps, 18 février 1922 cité dans Nous qui ne cultivons pas le préjugé de race. Histoire(s) d’un siècle de doute sur le racisme en France, Paris, Le Félin, 2021, p. 123 sq.
2 Eric Jennings racontait, dans un livre récent, la rencontre avec les surréalistes séjournant en Martinique après avoir fui Vichy : Eric Jennings, Les bateaux de l’espoir. Vichy, les réfugiés et la filière martiniquaise, CNRS, 2020. Voir recension de la VF par Carole Douki sur En attendant Nadeau.
3 Sur Maurice Satineau : Dominique Chathuant, HAL : Brève note sur Maurice Satineau député de la Guadeloupe (1936-1940/42) et sa relation au Commissariat général aux questions juives (CGQJ) de 1940 à 1944, 2019 ; id., « D’une République à l’autre : ascension et survie politique de Maurice Satineau (1891-1945)», Bulletin de la Société d’histoire de la Guadeloupe, n°178, septembre-décembre 2017, p. 9-85.
4 Sa fraude spectaculaire en 1936 sur 3000 voix dans quatre communes de Guadeloupe est éclipsée par la polémique sur les 13 voix suspectes attribuées au préfet Jean Chiappe à Ajaccio, cf. « D’une République à l’autre…», op. cit., p. 25-26.
5 Elsa Geneste, « René Maran et la Résistance: enquête sur une prétendue collaboration », Présence Africaine, 2013, no 187/188, p. 139‑152, voir sur Jstor. Une référence apparaît sur le site de Radio France dans la biographie accompagnant la réception d’Alain Mabanckou au Collège de France. Un texte de Maran y est daté du 27 juin 1936 mais de façon erronée. Il est convenablement daté à la note 48 de Sandrine Sanos – « Fascist Fantasies of Perversion and Abjection: Race, Gender, and Sexuality in the Interwar Far-Right », Journal of the Western Society for French History, vol. 37, Texas A & M University, Corpus Christi, 2009 http://hdl.handle.net/2027/spo.0642292.0037.017 – René Maran, « Pourquoi ne vend-on plus d’automobiles françaises dans nos colonies?, » JSP, 25 avril 1936. De façon surprenante le profil de René Maran n’est pas mentionné dans cet article de Sandrine Sanos.
6 Xavier Luce, « René Maran à Maurice Barrès : d’un « écrivain français » à l’autre », Continents manuscrits, 17 | 2021, mis en ligne le 15 octobre 2021, url : http://journals.openedition.org/coma/7775
7Allusion possible au fait qu’on avait renoncé à l’étalon-or (Gold Standard) qui faisait de l’encaisse métallique la seule garantie monétaire des banques centrales pour admettre, en la regardant sans doute comme provisoire, l’idée de l’étalon change-or (Gold Exchange Standard) qui ajoutait à l’encaisse métallique un certain nombre de devises réputées solides. Assise sur son tas d’or depuis 1928, la France était alors touchée depuis seulement quelques mois par la crise mondiale.
8 Précision assez inutile à cette époque compte tenu des secousses qui affectaient alors très durement les monnaies nationales.
9 Longtom : instrument appelé aussi « batakash » en créole. Variété sommaire de sluice, très courte, formée d’une seule rigole et introduite en 1851 par Dupuy et ses quatre-neuvards (forty-niners) arrivés de Californie. Source : Vincent Huygues-Belrose, « Longtom », Jack Corzani (dir.), Dictionnaire encyclopédique Antilles-Guyane, vol. 5, Fort-de-France, Désormeaux, 1992, p. 1607.
10 Acception un peu datée du terme « industrie ». Il s’agit en réalité d’une activité primaire d’extraction de matière première.
11 Expression qu’on retrouve plus tard sous la plume de beaucoup d’autres dont Gaston Monnerville.
12 L’auteur entend probablement qu’il faudrait cinq ou six fois plus de francs pour retrouver ce que valaient vingt millions en francs de 1857, c’est à dire en francs-Napoléon de 1803-1914.
13 Elle peut songer à l’irruption de la montagne Pelée qui engloutit Saint-Pierre en 1902 et au cyclone de 1928 en Guadeloupe.
14 Allusion au tremblement de terre guadeloupéen de 1897 (sept morts). Celui de 1843 avait occasionné au moins 3000 décès. Le séisme martiniquais de 1839 en avait provoqué au moins 300.
15 Ici, vieilles frusques.
16 Pour les profanes : courir le vidé est toujours d’actualité.
17 On notera cette utilisation du mot « peuple ».
18 Il s’agit des « Neg Gwo Siwo » enduits d’un mélange gluant de sirop-batterie (mélasse consistant en un concentré de jus de canne cuit) et de suie. Le sirop-batterie peut alors aussi être servi en tartine aux enfants avant l’école et constituer l’apport énergétique de la journée scolaire.
19 Orthographe étymologique alors en usage alors que le créole était considéré comme un patois et non comme l’expression dialectale insulaire d’une langue créole caribéenne.
20 La Guadeloupe ayant été investie par des Français en 1635 et la Martinique en 1636, une croisière du Tricentenaire débarque du Colombie en Guadeloupe (décembre 1935) puis en Martinique (janvier 1936). Elle est animée par Albert Sarraut et les parlementaires des deux colonies.
21 On dirait volontiers aujourd’hui « les conques à lambis ».
22 Ancien khâgneux d’Henri IV, élève d’Alain, agrégé d’anglais alors engagé au PCF.
23 Note incluse dans le poème de Gratiant et reprise dans l’article : « Tray, vaste plateau de bois dont on se sert pour porter sur la tête fruits et légumes (mot créole, d’origine anglaise). »
Source : Je suis partout, 27 juin 1936, p. 5, BNF-Rétronews.



![Image illustrant l'article L'Action_française___organe_du_[...]Action_française_bpt6k7666940_1 de Clio Texte](https://clio-texte.clionautes.org/wp-content/uploads/cliotexte/2020/07/laction-francaise---organe-du--action-francaise-bpt6k7666940-1-440x264.jpeg)
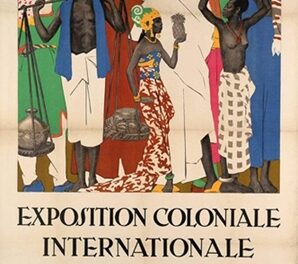

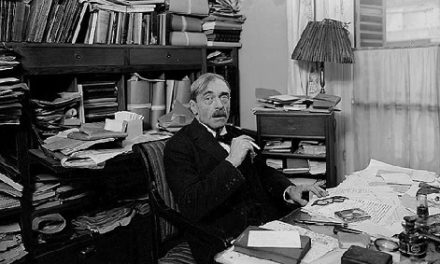








Merci à vous. J’ai mis cela en ligne en servant la règle du dire tout ce qui est vrai. On ne perdra pas de vue qu’il faut se garder de toute pensée téléologique puisque notre regard sur Je suis partout est conditionné par le fait que nous connaissons la suite. Je n’ai en tout cas pas cherché à nuire en posant une question embarrassante : celle de la participation au journal. J’ai en tout cas parfois été surpris de constater l’usage de ces faits historiques à l’extrême-droite. Il y a quelques années, une personnalité d’extrême-droite avait brandi sur son blog un gros plan de Candace avec la mention de son groupe : la Gauche radicale. Le but était évidemment – et je suis sûr que l’homme politique blogueur était persuadé d’avoir raison – de prouver que la gauche avait enfanté Vichy. L’homme ignorait bien sûr (Wieviorka, 2001) que le partage des eaux est postérieur au vote du 10 juillet qui ne nous dit pas grand’chose et ne fait pas des Quatre-vingts des résistants. Il ignorait aussi que l’Assemblée nationale n’était pas en 1940 la Chambre des députés. Celle du Front populaire était de surcroît amputée des communistes avant de se diluer dans l’Assemblée nationale convoquée à Vichy. Enfin, et surtout, il ignorait que la Gauche radicale n’était pas une gauche radicale mais un groupe de centre-droit réunissant des indépendants, de vieille sensibilité radicale mais plus conservateurs (on disait de modérés en évitant le mot droite alors uniquement revendiqué par l’extrême-droite) que les valoisiens. Au fond, je crois que ce blogueur cherchait confusément à prouver une culpabilité noire derrière l’individu Candace, ce qui est la définition même du racisme.
Remarquable article, qui ouvre des horizons. Peut-être faudrait-il approfondir la question des rapports plus complexes qu’on ne pourrait le supposer entre personnes issues de diverses minorités et l’extrême-droite? Après tout un certain chroniqueur-candidat nous y invite…