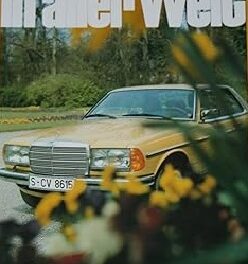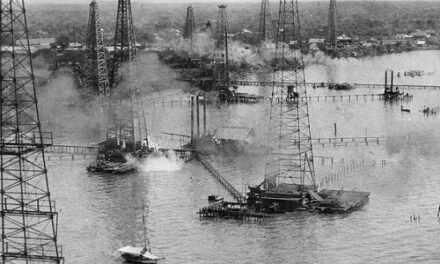L’ALENA, triomphe du libre-échange
« Le Gouvernement du Canada, le Gouvernement des États-Unis d’Amérique et le Gouvernement des États-Unis du Mexique (…) ont convenu de ce qui suit :
Article 101 : Établissement de la zone de libre-échange
Les Parties au présent accord (…) établissent par les présentes une zone de libre-échange.
Article 102 : Objectifs
1. Les objectifs du présent accord, définis de façon plus précise dans ses principes et ses règles, notamment le traitement national, le traitement de la nation la plus favorisée et la transparence, consistent :
a) à éliminer les obstacles au commerce des produits et des services entre les territoires des Parties et à faciliter le mouvement transfrontières de ces produits et services ;
b) à favoriser la concurrence loyale dans la zone de libre-échange ;
c) à augmenter substantiellement les possibilités d’investissement sur les territoires des Parties ;
d) à assurer de façon efficace et suffisante la protection et le respect des droits de propriété intellectuelle sur le territoire de chacune des Parties ;
e) à établir des procédures efficaces pour la mise en oeuvre et l’application du présent accord, pour son administration conjointe et pour le règlement des différends ; et
f) à créer le cadre d’une coopération trilatérale, régionale et multilatérale plus poussée afin d’accroître et d’élargir les avantages découlant du présent accord. (…) »
Accord de libre-échange américain, 17 décembre 1992. Rapporté in http://www.nafta-sec-alena.org/fr/view.aspx?conID=590&mtpiID=ALL [consulté le 30 mars 2012].
Opposition au libre-échange
« Le libre-échange est la religion de notre temps. Elle a son paradis – l’économie monde – et ses fondements analytiques et philosophiques. On fait appel aux mathématiques supérieures pour énoncer ses théorèmes, mais, en dernière analyse, le libre-échange est moins une stratégie économique qu’une doctrine morale. Malgré sa prétention à être exempt de jugement de valeurs, il repose sur elles. Il suppose que le bonheur suprême consiste à acheter, que la mobilité et le changement sont synonymes de progrès. Le transport du capital, des matériaux, des marchandises et des personnes a priorité sur l’autonomie, la souveraineté et la culture des communautés locales. Au lieu de favoriser et d’entretenir les relations sociales qui rendent une communauté vivante, la théologie du libre-échange invoque une définition étroite de l’efficacité comme guide de notre conduite.
Les postulats du libre-échange
Après trois décennies de lavage de cerveau, les principes et les prétendus bienfaits du libre-échange nous paraissent aller de soit ; la concurrence stimule l’innovation, augmente la productivité et abaisse les prix ; la division du travail permet la spécialisation, qui elle aussi augmente la productivité et abaisse les prix ; plus la taille des unités de production est importante, plus grands sont la division du travail et la spécialisation, et donc leurs avantages.
Le culte du grand imprègne tout le discours politique. Le département du Trésor préconise la création de cinq à dix banques américaines géantes. « Si nous voulons être compétitifs sur le marché mondialisé des services financiers, nous devons modifier nos conceptions sur la taille des institutions américaines », déclare-t-il. Le vice-président de la Citicorp met en garde contre « l’idée réconfortante que 14’000 banques sont un grand bien pour notre pays ». Le magazine libéral Harper’s abonde dans ce sens : « Les exploitations agricoles, comme les entreprises de presque tous les autres secteurs, ont grossi. Elles l’ont fait pour tirer parti des économies d’échelle engendrées par les méthodes modernes de production ». Lester Thurow, le conseiller démocrate du président américain, stigmatise les lois antitrust et les accuse de participer d’ « une vieille conception démocrate démodée ». Il prétend que même IBM, dont le chiffre d’affaire est de 50 milliards de dollars, n’est pas assez important pour le marché mondial. « Les grosses sociétés écrasent parfois les petites, concède Thurow, mais mieux vaut que les petites entreprises américaines soient écrasées par de grosses entreprises nationales que par des firmes étrangères ». Le magazine In These Times, qui se qualifia d’hebdomadaire socialiste indépendant, conclut : « Les entreprises sidérurgiques japonaises ont pu prendre l’avantage sur leurs concurrentes américaines en construisant des aciéries de plus grande taille ».
L’engouement pour les grosses structures amène logiquement le postulat suivant : le besoin de marchés mondiaux. Tout obstacle à l’expansion des marchés réduit la possibilité de se spécialiser et nuit donc à la compétitivité en élevant les coûts.
Le dernier pilier du libre-échange est le principe de l’avantage comparatif, qui se présente sous deux formes : absolue et relative. La notion d’avantage comparatif absolu est plus facile à comprendre : compte tenu de leurs ressources naturelles et de leurs climats différents, le Guatemala devrait cultiver des bananes et le Minnesota, élever des brochets. En se spécialisant ainsi dans ce qu’elle peut produire le mieux, chaque région jouit d’un avantage comparatif dans ce domaine. L’avantage comparatif relatif est un concept moins intuitif mais en définitive plus fécond. Au XIXe siècle, David Ricardo, l’économiste britannique architecte de l’économie du libre-échange, l’explique (…). Ainsi, même si une région est capable de tout fabriquer plus efficacement qu’une autre, elle a intérêt à se spécialiser dans les articles qu’elle produit avec la plus grande efficacité, en termes relatifs, et à les échanger contre les autres. Chaque région, et en définitive chaque nation, devrait se spécialiser dans ce qu’elle fait le mieux.
Qu’impliquent ces principes du libre-échange ? Que les régions et les nations abandonnent leur indépendance. Qu’elles renoncent à leur capacité de produire de nombreux articles pour concentrer leurs efforts sur la production de quelques-uns. Qu’elles importent ce dont elles ont besoin et exportent ce qu’elles produisent. Plus c’est gros, mieux c’est. L’humanité est mue par l’intérêt matériel de chacun. La compétition est préférable à la coopération, la dépendance, à l’indépendance. Telles sont les bases du libre-échange. En somme, nous troquons la souveraineté sur nos affaires contre la promesse de davantage d’emplois, de biens et de services, et d’un niveau de vie supérieur. Aux yeux des zélateurs du libre-échange, essayer d’entraver l’évolution économique revient à vouloir empêcher l’évolution naturelle. Suggérer que nous choisissions une autre voie de développement est considéré, au mieux, comme un tentative d’inverser le cours de l’histoire, au pis, comme un acte contre nature, voire un péché. (…)
De même que l’Homo sapiens est considéré comme la réussite la plus achevée de la nature, de même la société multinationale ou supranationale est devenue notre animal économique le plus évolué. L’économie planétaire exige des institutions planétaires. L’Etat-nation lui-même commence à disparaître, tant comme objet de notre affection et entité géographique à laquelle nous nous identifions que comme acteur important des affaires mondiales. (…)
En Europe, le Marché commun, qui comprenait six pays dans les années 50 et dix dans les années 70, en compte seize aujourd’hui, et les barrières entre ces nations sont rapidement démantelées. Il y a de moins en moins de firmes italiennes, françaises ou allemandes, mais seulement des superfirmes européennes. Les gouvernements des Etats-Unis, du Canada et du Mexique ont constitué L’ALENA pour intégrer économiquement les pays d’Amérique du Nord.
(…)
La mondialisation modifie nos attaches et distend nos relations de voisinage. « Dans le nouvel ordre planétaire, aucune fidélité ne lie aux travailleurs, aux produits, à l’entreprise, à l’usine, à la communauté et même à la nation », proclame le New York Times. Martin S. Davis, président de Gulf and Western, déclare : « Selon les nouvelles règles, on peut se libérer de toutes ces chaînes. Nous ne pouvons être attachés affectivement à un facteur de production particulier ».
Désormais, nous sommes tous des facteurs de production. Jeter aux orties les liens de fidélité n’est pas chose facile, mais c’est le prix que nous croyons devoir payer pour jouir des avantages du village planétaire. Chaque communauté doit atteindre le coût de production le plus bas possible, même si cela oblige à rompre ce qui reste du contrat social et des traditions séculaires. La version revue et corrigée du rêve américain est décrite clairement par Stanley J. Mihelick, vice-président chargé de la production chez Goodyear : « Tant que nous n’aurons pas abaissé les salaires réels à un niveau très proche de ceux du Brésil et de la Corée, nous ne pourrons faire profiter les salariés des gains de productivité en restant compétitifs ».
Les augmentations de salaires, la protection de l’environnement, le système national d’assurance-maladie, les actions en dommages et intérêts, bref, tout ce qui alourdit le coût de production et rend l’entreprise moins compétitive constitue une menace pour notre économie. Nous devons renoncer à vivre bien pour la soutenir. Nous sommes engagés dans une lutte mondiale pour la survie, et le libre-échange est devenu une nécessité. »
David Morris, « Libre-échange, le grand destructeur », in E. Goldsmith, J. Mander, Le progrès de la mondialisation, Fayard, Paris, 2001, pp. 217-222.