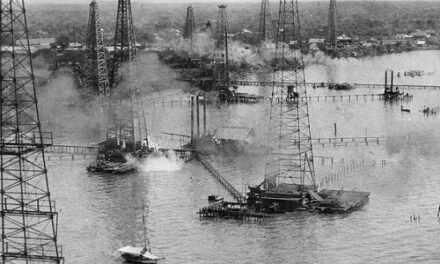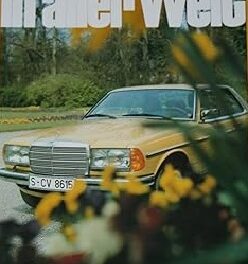« Depuis que Nicolas Oresme a inventé la science économique, les gouvernements cherchent à se référer, dans la conduite des affaires économiques de l’Etat, à une doctrine, une école, un savoir-faire. La doctrine économique peut se cataloguer – en simplifiant – en trois courants de pensée :
– l’école keynésienne qui situe le raisonnement au niveau du gouvernement et qui se préoccupe de l’équilibre général, du plein-emploi;
– l’école des descendants d’Adam Smith (fort nombreux et très divers) qui expliquent l’économie en partant de la gestion et de la croissance de l’entreprise;
– les disciples de Karl Marx dont l’analyse est liée au remplacement du capitalisme.
On pourrait ajouter le courant très intellectuel des disciples de Schumpeter qui veulent expliquer chaque événement économique en dehors des faits, sur la base d’un raisonnement rigoureux.
Il s’agit bien là de doctrines. Quant aux pratiques – que l’on appelle les politiques économiques – on a distingué essentiellement, pour les économies non communistes, les pratiques relevant du keynésianisme et celles dites du monétarisme.
Aucune méthode il est vrai n’a évité la crise ! Qu’ont donc fait les gouvernements ? Pour les monétaristes, que l’on identifie parfois à M. Friedman de l’école dite de Chicago, la politique économique a une base monétaire à court terme. En agissant sur la masse monétaire, on peut influencer la demande. C’est une application raffinée de la théorie quantitative de la monnaie d’Irving Fisher. Cette école monétariste, qui a exercé et exerce encore une grande influence pratique, connaît actuellement plusieurs variantes. On a dit du monétarisme qu’il était la politique économique du frein, parce qu’en période de difficulté, le gouvernement agit sur la masse monétaire pour freiner les dépenses, bloquer les salaires, etc.
Les keynésiens sont les adeptes d’une politique économique se référant aux théories de John Maynard Keynes (1883-1946). Pour Keynes, la demande est à la base de la production et de l’emploi. L’intervention de l’Etat par une politique budgétaire (déficitaire s’il le faut) et monétaire (sans tenir compte de la stabilité de la monnaie) doit assurer le plein-emploi. Les dépenses d’investissements doivent absorber les excédents de main-d’oeuvre inemployée. Cette théorie – appliquée pour la première fois par le président Roosevelt – était véritablement révolutionnaire à l’époque où elle fut énoncée.
Le monétarisme et le keynésianisme ont été les deux modèles de gouvernement de ces dernières décennies. En Angleterre, après l’échec de la politique de l’accélérateur qui voulait relancer les investissements tout en évitant la hausse des prix et des salaires (…) et qui fit perdre les élections aux travaillistes, Mme Thatcher adopte la politique du frein.
En France, le gouvernement de M. Mitterrand, après s’être inspiré de Keynes, se replie vers une politique monétariste nuancée. Ce fut d’ailleurs le même scénario sous le gouvernement précédent ! En Belgique comme aux Etats-Unis, on a dû renoncer au déficit budgétaire de type keynésien, trop lourd de conséquences dans les circonstances du moment (…) mais dans les deux pays, c’était trop tard. Carter, président keynésien, devint monétariste en 1978. Reagan, extra-monétariste, parvint à de meilleurs résultats, mais au prix d’un lourd déficit budgétaire de type keynésien ! La Suède, championne de l’accélérateur, dut également recourir à une politique plus rigoureuse et presser sur le frein monétariste. Ces exemples montrent qu’il est difficile de soutenir que la gauche est keynésienne et la droite monétariste…
On constate donc que face à la crise actuelle, aucune de ces politiques économiques n’est opérante. Est-ce parce que les conditions sociales et politiques ont empêché les gouvernements d’appliquer rigoureusement et assez longtemps leur politique, qu’elle soit celle du frein ou celle de l’accélérateur? C’est ce que cherchent à démontrer actuellement certains économistes. En fait, c’est l’ampleur de la forme actuelle de la crise et de ses composantes qui font que ces politiques économiques traditionnelles ne fonctionnent plus. La politique monétariste de la Dame de fer a pour conséquence d’augmenter le chômage, lequel coûte très cher et freine la modernisation des entreprises. Le coup de frein aurait exigé ce que Michel Albert appelle le consensus.
Quand à la politique de l’accélérateur, elle exige qu’il y ait croissance économique. Le scénario développé par Keynes est d’autre part entravé par la nouvelle interdépendance des économies nationales et par le déficit extérieur.
Ainsi, pour limiter les dégâts provoqués par la crise actuelle, on ne peut que doser les deux médecines, au gré des circonstances. C’est ce qu’ont fait avec un relatif succès l’Allemagne et l’Autriche. Enfin, les exigences électorales jouent un rôle !
Face à la crise actuelle, les gouvernements sont donc démunis. Il faut attendre une nouvelle relance générale par la demande (…) et peut-être un nouveau Keynes !
Roger Schindelholz, Le Démocrate, 1992

La fin de l’année 1992 aura marqué symboliquement l’achèvement d’une longue décennie qui fut dominée par l’écroulement des Etats dirigistes et le triomphe de l’ultralibéralisme. Rien ne remettra en cause dans les années prochaines le remplacement d’une planification dégradée en contrôle bureaucratique de l’économie par le marché…
Le marché est le seul moyen de se débarrasser de tous les types de nomenklatura, mais il n’est rien de plus. Sans lui, rien n’est possible, mais il n’apporte pas lui-même de solutions et les pays qui s’en remettent à lui seul ont les plus fortes chances de s’écrouler dans le chaos ou dans les conséquences d’une inégalité insupportable. »
Alain Touraine,« La fête ultralibérale est finie », article du Nouveau Quotidien du 9.2.1993.
Les nouveaux maîtres de la planète :
Bien qu’ils ne soient pas des élus, bien qu’ils soient anonymes et souvent étrangers, les grands investisseurs mondiaux en bons du trésor américain disposent désormais, fort probablement, d’un pouvoir sans précédent – peut-être même d’un droit de veto – sur la politique américaine écrivait dans le Wall Street Journal (9 .11.1992 édition européenne) le porte-parole des milieux d’affaires américains, quelque jours après la victoire de Bill Clinton en novembre 1992.
En septembre dernier, le très libéral quotidien britannique des finances Financial Times (30.11.1994) renchérissait. Parce que ce sont eux qui traitent les milliards et les milliards de dollars de capitaux qui transitent d’un pays à l’autre chaque jour, les marchés financiers sont devenus à la fois le gendarme, le juge et le jury de l’économie mondiale, ce qui ne laisse pas d’être inquiétant, étant donné leur propension à voir les événements et les politiques à travers les verres déformants de la peur et de la cupidité.
Après les turbulences du Système monétaire européen de septembre 1992, son éclatement l’été suivant et la crise mexicaine de décembre, la chute du dollar et de la lire, les dévaluations de la peseta et de l’escudo et les attaques contre le franc français donnent raison à ceux qui pensent que les marchés financiers sont devenus les véritables maîtres de la planète. Les turbulences monétaires trouvent certes des explications dans le niveau gigantesque de la dette extérieure américaine, les déficits des balances de paiements de nombreux pays, l’instabilité politique, mais la globalisation des marchés des changes amplifie comme jamais les mouvements des cours des devises. Ces turbulences démontrent surtout que la partie la plus importante et de loin la plus rentable des activités financières se déroule sur le marché des changes affirme François Chesnais dans La mondialisation du capital (Paris, Syros, 1994).
La raison ? La libéralisation et la globalisation du marché à quoi s’ajoute les nouveaux réseaux informatiques et les progrès des télécommunications qui permettent aux investisseurs de vagabonder où bon leur semble. Au cours des années 80, le volume des transactions sur devises a été multiplié par dix. C’est le compartiment des marchés financiers qui a subi la plus forte croissance. Selon une enquête de la Banque des règlements internationaux, le volume des transactions a atteint 1000 milliards de dollars en 1992. Seuls 3 % de ces opérations sont liées aux échanges de marchandises. ce qui fait dire à Henri Bourguinat que le marché des changes est devenu l’économie internationale de spéculation (in « Renégocier Bretton Woods ? La spéculation internationale comme trouble-fête », 1994) ; la spéculation étant définie comme une opération dont l’objectif n’est que le profit qu’elle peut engendrer. Il ne faut jamais faire de raisonnement économique. C’est le meilleur moyen de perdre son pognon. Ce qui m’intéresse, c’est de dégager un résultat positif chaque soir , expliquait hier dans Le Monde (11.3.1995) un responsable d’une salle de marché.
Face aux milliards de dollars qui se promènent chaque jour sur les réseaux informatiques de la planète, les réserves en devises des banques centrales se révèlent insuffisantes. Leurs interventions ratées, vendredi dernier, pour enrayer la baisse du dollar le prouvent. Plus grave, leurs actions font le jeu des spéculateurs. Ainsi, la hausse de trois centimes pour un dollar jeudi, suite aux déclarations de plusieurs ministres et de la Bundesbank, a rempli les poches des investisseurs (hedge funds, banques, assurances, caisses de pension, etc.) qui ont misé mercredi sur la monnaie américaine lorsqu’elle était au plus bas.
Pour Alain Minc, cela ne peut plus continuer ainsi. Les résultats peuvent être dévastateurs pour le libéralisme. Les marchés financiers représenteront-ils pour lui ce que le stalinisme a incarné pour l’idée socialiste ? Une logique poussée jusqu’à l’extrême limite, une perversion absolue, une caricature rédhibitoire dont le libéralisme fera, un jour, les frais. Pour tenter d’enrayer la toute puissance du marché des changes, l’Américain James Tobin, Prix Nobel d’économie 1981, a réitéré l’an dernier la proposition qu’il avait déjà faite en 1978 de prélever une taxe internationale. Une taxe de 0,5 % , affirme-t-il, serait un facteur extrêmement dissuasif pour ceux qui envisageraient un aller-retour rapide entre deux monnaies. L’intention est de freiner les mouvements de capitaux spéculatifs. Les recettes potentielles seraient considérables : plus de 1500 milliards de dollars par an.
La force des marchés financiers davantage que les Parlements nationaux ou les manifestations de citoyens en colère est désormais capable de déjouer la politique économique d’un pays si celle-ci ne lui convient pas. Les conséquences sociales de leurs actions leur importent peu. Les assassinats sur la grand-route me semblent des actes de charité comparés à certaines combinaisons financières écrivait déjà Honoré de Balzac au XIXe siècle. »
Jean-Philippe Buchs, dans La liberté, 12.3.1995.