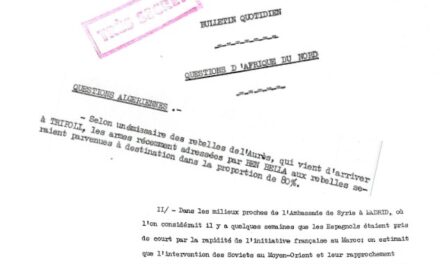Au lendemain des attaques terroristes du 11 septembre 2001 (le 11-Septembre), l’expression « Wretched of the Earth » était encore usitée dans le débat américain par des gens comme Noam Chomsky, figure de la gauche américaine anti-libérale. Fanon reste une icône pour la culture intellectuelle liée aux mouvements anticolonialistes. On notera d’ailleurs que le colonialisme n’est pas un terme très en vogue avant d’être dénoncé par cet anticolonialisme.
Franz Fanon, Les Damnés de la Terre (1961)
Ce monde rétréci ne peut être remis en question que par la violence absolue
La décolonisation, qui se propose de changer l’ordre du monde, est, on le voit, un programme de désordre absolu. Mais elle ne peut être le résultat d’une opération magique, d’une secousse naturelle ou d’une entente à l’amiable […] La décolonisation est la rencontre de deux forces congénitalement antagonistes […] Leur première confrontation s’est déroulée sous le signe de la violence et leur cohabitation – plus précisément l’exploitation du colonisé par le colon – s’est poursuivie à grand renfort de baïonnettes et de canons. Le colon et le colonisé sont de vieilles connaissances. Et, de fait, le colon a raison quand il dit : « les » connaître. C’est le colon qui a fait et qui continue à faire le colonisé […]
On ne désorganise pas une société […] si l’on n’est pas dès le début […] à briser tous les obstacles qu’on rencontrera sur sa route. Le colonisé qui décide de réaliser ce programme, de s’en faire le moteur, est préparé de tout temps à la violence. Dès sa naissance, il est clair pour lui que ce monde rétréci, semé d’interdictions, ne peut être remis en question que par la violence absolue.
Le monde colonial est un monde compartimenté. Sans doute est-il superflu, sur le plan de la description, de rappeler l’existence de villes indigènes et de villes européennes, d’écoles pour indigènes et d’écoles pour Européens, comme il est superflu de rappeler l’apartheid en Afrique du Sud […]
Franz Fanon, Les damnés de la terre, Maspéro, 1961, Folio-Actuels, 1991, p. 66-68.
Domination capitaliste et domination coloniale : la violence dans les maisons et dans les cerveaux du colonisé
Le monde colonisé est un monde coupé en deux. La ligne de partage, la frontière en est indiquée par les casernes et les postes de police. Aux colonies, l’interlocuteur valable et institutionnel du colonisé, le porte-parole du colon et du régime d’oppression est le gendarme ou le soldat. Dans les sociétés de type capitaliste, l’enseignement, religieux ou laïque, la formation de réflexes moraux transmissibles de père en fils, l’honnêteté exemplaire d’ouvriers décorés après cinquante années de bons et loyaux services, l’amour encouragé de l’harmonie et de la sagesse, ces formes esthétiques du respect de l’ordre établi, créent autour de l’exploité une atmosphère de soumission et d’inhibition qui allège considérablement la tâche des forces de l’ordre. Dans les pays capitalistes, entre l’exploité et le pouvoir s’interposent une multitude de professeurs de morale, de conseillers, de « désorientateurs ». Dans les régions coloniales, par contre, le gendarme et le soldat, par leur présence immédiate, leurs interventions directes et fréquentes, maintiennent le contact avec le colonisé et lui conseillent, à coups de crosse ou de napalm, de ne pas bouger. On le voit, l’intermédiaire du pouvoir utilise un langage de pure violence. L’intermédiaire n’allège pas l’oppression, ne voile pas la domination. Il les expose, les manifeste avec la bonne conscience des forces de l’ordre. L’intermédiaire porte la violence dans les maisons et dans les cerveaux du colonisé.
Franz Fanon, Les damnés de la terre, Maspéro, 1961, Folio-Actuels, 1991, p. 68-69.
Une ségrégation raciale et spatiale : il n’y a pas un colonisé qui ne rêve au moins une fois par jour de s’installer à la place du colon
La zone habitée par les colonisés n’est pas complémentaire de la zone habitée par les colons. Ces deux s’opposent, mais non au service d’une unité supérieure […], elles obéissent au principe d’exclusion réciproque : il n’y a pas de conciliation possible, l’un des termes est de trop. La ville du colon est une ville en dur, toute de pierre et de fer. C’est une ville illuminée asphaltée, où les poubelles regorgent toujours de restes inconnus, jamais vus, même pas rêvés. Les pieds du colon ne sont jamais aperçus, sauf peut-être dans la mer, mais on n’est jamais assez proche d’eux. Des pieds protégés par des chaussures solides alors que les rues de leur ville sont nettes, lisses, sans trous, cailloux. La ville du colon est une ville repue, paresseuse, son ventre est plein de bonnes choses à l’état permanent. La ville du colon est une ville de blancs, d’étrangers.
La ville du colonisé, ou du moins la ville indigène, 1e village nègre, la médina, la réserve est un lieu mal famé, peuplé d’hommes mal famés. On y naît n’importe où, n’importe comment. On y meurt n’importe où, de n’importe quoi. C’est un monde sans intervalles, les hommes y sont les uns sur les autres, les cases les unes sur les autres. La ville du colonisé est une ville affamée, affamée de pain, de viande, de chaussures, de charbon, de lumière. La ville du colonisé est une ville accroupie, une ville à genoux, une ville vautrée. C’est une ville de nègres, une ville de bicots. Le regard que le colonisé jette sur la ville du colon est un regard de luxure, un regard d’envie. Rêves de possession. Tous les modes de possession : s’asseoir à la table du colon, coucher dans le lit du colon, avec sa femme si possible. Le colonisé est un envieux. Le colon ne l’ignore pas qui, surprenant son regard à 1a dérive constate amèrement mais toujours sur le qui-vive : « Ils veulent prendre notre place ». C’est vrai, il n’y a pas un colonisé qui ne rêve au moins une fois par jour de s’installer à la place du colon.
Ce monde compartimenté, ce monde coupé en deux est habité par des espèces différentes. L’originalité du contexte colonial, c’est que les réalités économiques, les inégalités, l’énorme différence des modes de vie, ne parviennent jamais à masquer les réalités humaines.
Franz Fanon, Les damnés de la terre, Maspéro, 1961, Folio-Actuels, 1991, p. 69.
On est riche parce que blanc, on est blanc parce que riche
Quand on aperçoit dans son immédiateté le contexte colonial, il est patent que ce qui morcelle le monde c’est d’abord le fait d’appartenir ou non à telle espèce, à telle race. Aux colonies, l’infrastructure économique est également une superstructure. La cause est conséquence : on est riche parce que blanc, on est blanc parce que riche. C’est pourquoi les analyses marxistesPour le marxisme, le système politique n’est qu’une superstructure, un habillage de l’infrastructure constituée par le mode de production, le système économique. doivent être toujours légèrement distendues chaque fois qu’on aborde le problème colonial. II n’y a pas jusqu’au concept de société pré-capitaliste, bien étudié par Marx, qui ne demanderait ici à être repensé. Le serf est d’une essence autre que le chevalier, mais une référence au droit divin est nécessaire pour légitimer cette différence statutaire. Aux colonies, l’étranger venu d’ailleurs s’est imposé à l’aide de ses canons et de ses machines. En dépit de la domestication réussie, malgré l’appropriation le colon reste toujours un étranger. Ce ne sont ni les usines, ni les propriétés, ni le compte en banque qui caractérisent d’abord la « classe dirigeante ». L’espèce dirigeante est d’abord celle qui vient d’ailleurs, celle qui ne ressemble pas aux autochtones, « les autres ».
Franz Fanon, Les damnés de la terre, Maspéro, 1961, Folio-Actuels, 1991, p. 70.
Faire sauter le monde colonial
La violence qui a présidé à l’arrangement du monde colonial, qui a rythmé inlassablement la destruction des formes sociales indigènes, démoli sans restrictions les systèmes de références de l’économie, les modes d’apparence, d’habillement, sera revendiquée et assumée par le colonisé au moment où […] la masse colonisée s’engouffrera dans les villes interdites. Faire sauter le monde colonial est désormais une image d’action très claire, très compréhensible et pouvant être reprise par chacun des individus constituant le peuple colonisé. Disloquer le monde colonial ne signifie pas qu’après l’abolition des frontières on aménagera de part et d’autres des voies de passage entre les deux zones. Détruire le monde colonial c’est ni plus ni moins abolir une zone, l’enfouir au plus profond du sol ou l’expulser du territoire.
Franz Fanon, Les damnés de la terre, Maspéro, 1961, Folio-Actuels, 1991, p. 70.
Dans la culture de l’indigène, l’absence de valeurs
La mise en question du monde colonial par le colonisé n’est pas une confrontation rationnelle des points de vue […] Le monde colonial est un monde manichéiste. Il ne suffit pas au colon de limiter physiquement, c’est-à-dire à l’aide de sa police et de sa gendarmerie, l’espace du colonisé. Comme pour illustrer le caractère totalitaire de l’exploitation coloniale, le colon fait du colonisé une sorte de quintessence du mal. La société du colonisé n’est pas seulement décrite comme une société sans valeurs. Il ne suffit pas au colon d’affirmer que les valeurs ont déserté, ou mieux n’ont jamais habité, le monde colonisé. L’indigène est déclaré imperméable à l’éthique, absence de valeurs, mais aussi négation de valeurs. Il est, osons l’avouer, l’ennemi des valeurs. En ce sens, il est le mal absolu. Élément corrosif détruisant tout ce qui l’approche, élément déformant défigurant tout ce qui a trait à l’esthétique ou à morale, dépositaire de forces maléfiques, instrument inconscient et irrécupérable de forces aveugles […] Les valeurs, en effet, sont irréversiblement empoisonnées et infectées dès lors qu’on les met en contact avec peuple colonisé. Les coutumes du colonisé, ses traditions, ses mythes, surtout ses mythes, sont la marque même de cette indigence, de cette dépravation constitutionnelle. C’est pourquoi il faut mettre sur même plan le D.D.T. qui détruit les parasites, vecteurs de maladie, et la religion chrétienne qui combat dans l’œuf les hérésies, les instincts, le mal. Le recul de la fièvre jaune et les progrès de l’évangélisation font partie du même bilan. Mais les communiqués triomphants des missions renseignent en réalité sur l’importance des ferments d’aliénation introduits sein du peuple colonisé. Je parle de la religion chrétienne, et personne n’a le droit de s’en étonner. L’Église aux colonies est une Église de Blancs, une église d’étrangers. Elle n’appelle pas l’homme colonisé dans la voie de Dieu mais bien dans la voie du Blanc, dans la voie du maître, dans la voie de l’oppresseur. Et comme on le sait, dans cette histoire il y a beaucoup d’appelés et peu d’élus.
Franz Fanon, Les damnés de la terre, Maspéro, 1961, Folio-Actuels, 1991, p. 71.
Le langage du colon, quand il parle du colonisé, est un langage zoologique
Parfois ce manichéisme va jusqu’au bout de sa logique et déshumanise le colonisé. A proprement parler il l’animalise. Et, de fait, le langage du colon, quand il parle du colonisé, est un langage zoologique. On fait allusion aux mouvements de reptation du jaune, aux émanations de la ville indigène, aux hordes, à la puanteur, au pullulement, au grouillement, aux gesticulations. Le colon, quand il veut bien décrire et trouver le mot juste, se réfère constamment au bestiaire. L’Européen bute rarement sur les termes imagés. Mais le colonisé, qui saisit le projet du colon, le procès précis qu’on lui intente, sait immédiatement à quoi l’on pense. Cette démographie galopante, ces masses hystériques, ces visages d’où toute humanité a fui, ces corps obèses qui ne ressemblent à rien, cette cohorte sans tête ni queue, ces enfants qui ont l’air de n’appartenir à personne, cette paresse étalée sous le soleil, ce rythme végétal, tout cela fait partie du vocabulaire colonial. Le général de Gaulle parle des « multitudes jaunes » et M. Mauriac des masses noires, brunes et jaunes qui bientôt vont déferler. Le colonisé sait tout cela et rit un bon coup à chaque fois qu’il se découvre animal dans les paroles de l »autre. Car il sait qu’il n’est pas un animal. Et précisément dans le même temps qu’il découvre son humanité, il commence à fourbir ses armes pour la faire triompher.
Dès que le colonisé commence à peser sur ses amarres, à inquiéter le colon, on lui délègue de bonnes âmes qui, dans les « Congrès de culture », lui exposent la spécificité, les richesses des valeurs occidentales. Mais chaque fois qu’il est question de valeurs occidentales, il se produit, chez le colonisé, une sorte de raidissement, de tétanie musculaire.
Franz Fanon, Les damnés de la terre, Maspéro, 1961, Folio-Actuels, 1991, p. 73.
Quittons cette Europe qui n’en finit pas de parler de l’homme tout en le massacrant partout où elle le rencontre
Allons, camarades, il vaut mieux décider dès maintenant de changer de bord. La grande nuit dans laquelle nous fûmes plongés, il nous faut la secouer et en sortir. Le jour nouveau qui déjà se lève doit nous trouver fermes, avisés et résolus.
II nous faut quitter nos rêves, abandonner nos vieilles croyances et nos amitiés d’avant la vie. Ne perdons pas de temps en stériles litanies ou en mimétismes nauséabonds. Quittons cette Europe qui n’en finit pas de parler de l’homme tout en le massacrant partout où elle le rencontre, à tous les coins de ses propres rues, à tous les coins du monde.
Voici des siècles que l’Europe a stoppé la progression des autres hommes et les a asservis à ses desseins et à sa gloire; des siècles qu’au nom d’une prétendue « aventure spirituelle » elle étouffe la quasi-totalité de l’humanité […] Alors, frères, comment ne pas comprendre que nous avons mieux à faire que de suivre cette Europe-là. Cette Europe qui jamais ne cessa de parler de l’homme, jamais de proclamer qu’elle n’était inquiète que de l’homme, nous savons aujourd’hui de quelles souffrances l’humanité a payé chacune des victoires de son esprit […]
Quand je cherche l’homme dans la technique et dans le style européens, je vois une succession de négations de l’homme, une avalanche de meurtres.
Franz Fanon, Les damnés de la terre, Maspéro, 1961, Folio-Actuels, 1991, p. 371-373.
Sartre préface Fanon : «notre inhumanité»
Il n’y a pas si longtemps, la terre comptait deux milliards d’habitants, soit cinq cents millions d’hommes et un milliard cinq cents millions d’indigènes. Les premiers disposaient du Verbe, les autres l’empruntaient. Entre ceux-là et ceux-ci, des roitelets vendus, des féodaux, une fausse bourgeoisie forgée de toutes pièces servaient d’intermédiaires. Aux colonies la vérité se montrait nue; les « métropoles » la préféreraient vêtue; il fallait que l’indigène les aimât. Comme des mères, en quelque sorte. L’élite européenne entreprit de fabriquer un indigénat d’élite; on sélectionnait des adolescents, on leur marquait sur le front, au fer rouge, les principes de la culture occidentale, on leur fourrait dans la bouche des bâillons sonores, grands mots pâteux qui collaient aux dents après un bref séjour en métropole, on les renvoyait chez eux, truqués. Ces mensonges vivants n’avaient plus rien à dire à leurs frères; ils résonnaient; de Paris, de Londres, d’Amsterdam nous lancions des mots « Parthénon ! Fraternité! » et, quelque part en Afrique, en Asie, des lèvres s’ouvraient : « … thé-non!… nité! » C’était l’âge d’or.
Il prit fin : les bouches s’ouvrirent seules; les voix, jaunes et noires parlaient encore de notre humanisme mais c’était pour nous reprocher notre inhumanité. Nous écoutions sans déplaisir ces courtois exposés d’amertume. D’abord ce fut un émerveillement fier : comment? Ils causent tout seuls? Voyez pourtant ce que nous avons fait d’eux! Nous ne doutions pas qu’ils acceptassent notre idéal puisqu’ils nous accusaient de n’y être pas fidèles; pour le coup, l’Europe crut à sa mission : elle avait hellénisé les Asiatiques, créé cette espèce nouvelle, les nègres gréco-latins. Nous ajoutions, tout à fait entre nous, pratiques : et puis laissons-les gueuler, ça les soulage; chien qui aboie ne mord pas.
Une autre génération vint, qui déplaça la question. Ses écrivains, ses poètes, avec une incroyable patience essayèrent de nous expliquer que nos valeurs collaient mal avec la vérité de leur vie, qu’ils ne pouvaient ni tout à fait les rejeter ni les assimiler. En gros, cela voulait dire : vous faites de nous des monstres, votre humanisme nous prétend universels et vos pratiques racistes nous particularisent. Nous les écoutions, très décontractés : les administrateurs coloniaux ne sont pas payés pour lire Hegel, aussi bien le lisent-ils peu, mais ils n’ont pas besoin de ce philosophe pour savoir que les consciences malheureuses s’empêtrent dans leurs contradictions. Efficacité nulle. Donc perpétuons leur malheur, il n’en sortira que du vent. S’il y avait, nous disaient les experts, l’ombre d’une revendication dans leurs gémissements, ce serait celle de l’intégration. Pas question de l’accorder, bien entendu : on eût ruiné le système qui repose, comme vous savez, sur la surexploitation. Mais il suffirait de tenir devant leurs yeux cette carotte : ils galoperaient. Quant à se révolter, nous étions bien tranquilles : quel indigène conscient s’en irait massacrer les beaux fils de l’Europe à seule fin de devenir Européen comme eux? Bref, nous encouragions ces mélancolies et ne trouvâmes pas mauvais, une fois, de décerner le prix Goncourt à un, nègre : c’était avant 39Il s’agit du Guyanais René Maran, administrateur colonial en Oubangui-Chari, pour Batouala, Véritable roman nègre, Albin Michel, 1921..