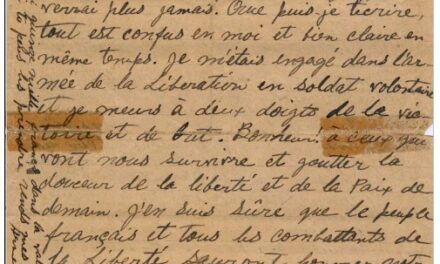Marc Bloch (1886-1944) fut incontestablement un des plus grands historiens du XXe siècle. Grand médiéviste, il est le fondateur en 1929 avec son collègue et ami Lucien Febvre des Annales d´histoire économique et sociale. Les Annales furent une révolution historiographique majeure, traçant une frontière entre un avant et un après dans la manière de « faire de l’histoire ». Il est aussi l’auteur d’un chef d’oeuvre d´histoire immédiate : L’étrange défaite. Rédigé pendant l’été 1940, juste après la débâcle, L’étrange défaite demeure de nos jours une des analyses les plus pertinentes des causes de l’effondrement de juin 1940.
Le texte ci-dessous est le début de la partie II intitulée La déposition d’un vaincu. Marc Bloch pose la question qui taraude beaucoup de ses contemporains au même moment : À qui la faute de cette étrange défaite? Lui qui a vu de près le désastre militaire du printemps 40 en tant que capitaine de réserve mobilisé à sa demande, il répond : à « l’incapacité du commandement », à « nos généraux ». Le jugement est sévère et sans doute trop schématique, il le reconnaît lui-même, mais l´heure n’est pas à la nuance. Il nous semble cependant que l’intérêt du texte se situe sur un autre plan.
Ce qu’exprime ici Marc Bloch, c’est une éthique du commandement : « un chef est responsable de tout ce qui se fait sous ses ordres », » il lui appartient de prendre à son compte, dans le mal comme dans le bien, les résultats ». Ethique qui fit défaut aux généraux rassemblés derrière le Maréchal Pétain et qui tentèrent de faire endosser la défaite aux hommes politiques de la Troisième République.
Enfin, comme toujours chez Marc Bloch, l’historien reprend le dessus et on lira avec intérêt sa réflexion sur le rapport que les peuples entretiennent avec leurs généraux vaincus.
II/ La déposition d’un vaincu
Nous venons de subir une incroyable défaite. À qui la faute ? Au régime parlementaire, à la troupe, aux Anglais, à la cinquième colonne, répondent nos généraux. À tout le monde, en somme, sauf à eux. Que le père Joffre était donc plus sage! « Je ne sais pas, disait-il, si c’est moi qui ai gagné la bataille de la Marne. Mais il y a une chose que je sais bien : si elle avait été perdue, elle l’aurait été par moi ». Sans doute entendait-il surtout rappeler, par là, qu’un chef est responsable de tout ce qui se fait sous ses ordres. Peu importe qu’il n’ait pas eu lui-même l’initiative de chaque décision, qu’il n’ait pas connu chaque action. Parce qu’il est le chef et a accepté de l’être, il lui appartient de prendre à son compte, dans le mal comme dans le bien, les résultats. La grande vérité que cet homme simple exprimait si simplement prend cependant aujourd’hui un sens encore plus plein. Au retour de la campagne, il n’était guère, dans mon entourage, d’officier qui en doutât; quoi que l’on pense des causes profondes du désastre, la cause directe qui demandera elle-même à être expliquée fut l’incapacité du commandement.
Je crains bien que ce propos, par sa brutalité, ne choque, chez beaucoup, des préjugés puissamment enracinés. Notre presse, presque tout entière, et tout ce qu’il y a, dans notre littérature, de foncièrement académique, ont répandu dans notre opinion le culte du convenu. Un général est, par nature, un grand général et lorsqu’il a mené son armée à la débâcle, il arrive qu’on le récompense par un cordon de la Légion d’honneur. Ainsi s’imagine-t-on, sans doute, entretenir par un voile pudiquement jeté sur les pires erreurs, la confiance de la nation ; alors qu’en réalité on ne fait que semer, parmi les exécutants, un dangereux agacement. Mais il y a plus, et en somme, plus respectable.
Une singulière loi historique semble régler les rapports des États avec leurs chefs militaires. Victorieux, ceux-ci sont presque toujours tenus à l’écart du pouvoir ; vaincus, ils le reçoivent des mains du pays qu’ils n’ont pas su faire triompher. Mac-Mahon, malgré Sedan, Hindenburg, après l’effondrement de 1918, ont présidé aux destinées des régimes issus de leurs défaites ; et ce n’est pas le Pétain de Verdun, non plus que le Weygand de Rethondes, que la France a mis ou laissé mettre à sa tête. Je n’ignore certes point que dans ces réussites tout n’est pas spontané. Elles n’en répondent pas moins à une sorte de psychose de l’affectivité collective. Aux yeux des peuples vaincus, ces uniformes, semés d’étoiles et de médailles, symbolisent, avec les sacrifices consentis sur le champ de bataille, les gloires du passé et peut-être de l’avenir. Je ne crois pas qu’une opinion qui heurte la vérité mérite jamais qu’on évite de la contredire. Je pense, avec Pascal, que le zèle est étrange « qui s’irritent contre ceux qui accusent des fautes publiques, et non pas contre ceux qui les commettent »… « Jamais les saints ne se sont tus», a-t-il encore écrit ailleurs. Ce n’est pas une devise pour la censure. Elle n’en mérite pas moins d’être méditée par quiconque, sans prétendre, hélas! à la sainteté, s’efforce simplement vers la modeste moralité de l’honnête homme. Mais, du moment que le sentiment est sincère, on ne saurait le battre en brèche sans un peu de chagrin.
Je viens de parler du « commandement ». À peine, cependant, le mot est-il sorti de ma plume qu’en moi l’historien se scandalise de l’avoir écrit. Car l’A.B.C. de notre métier est de fuir ces grands noms abstraits pour chercher à rétablir, derrière eux, les seules réalités concrètes, qui sont les hommes. Les erreurs du commandement furent, fondamentalement, celles d’un groupe humain. […]
Marc Bloch, L’étrange défaite, début de la partie 2