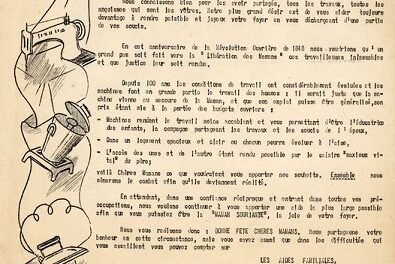Lucie Delarue-Mardrus (1874-1945)
Lucie Delarue est issue d’une famille bourgeoise qui s’installe à Paris en 1880. Après avoir refusé une demande en mariage de Philippe Pétain en 1900, elle épouse l’orientaliste Joseph-Charles Mardrus et en divorce 15 ans plus tard. Elle multiplie les activités artistiques et devient poétesse, romancière, sculptrice… Entre-autres.
En 1908, Lucie Delarue-Mardrus publie un roman intitulé Marie, fille-mère. Ce roman tragique, oublié de nos jours, raconte et dénonce sans ambiguïté, dans un style incisif et précis, le sort d’une jeune fille violée à l’âge de 17 ans et des injustices sociales qu’elle subit par la suite.
Ce texte, qui adopte un point de vue féminin à la fois factuel et dénonciateur, peut servir à remettre en perspective les mouvements et les publications actuels consacrés aux violences faites aux femmes.
« Debout, dans sa fraîcheur pareille à celle des Anglo-saxonnes, elle considérait avec complaisance cet être gentil qui semblait innocent comme elle. Car elle ne soupçonnait pas ce qu’il peut y avoir dans l’âme d’un homme qui regarde une femme. Elle ignorait que le désir est un chasseur sans pitié. […] Elle ne savait pas qu’il y a de la lutte dans l’amour et de l’assassinat dans la possession, qu’il y a d’un côté l’attaque et de l’autre la défense, et que l’homme, plus cruel que toute autre bête, est agité dans sa jeunesse par la sourde envie de terrasser la femme comme un adversaire plus faible ».
(Extrait, pp. 19- 20)
« Marie s’égaie encore, puis elle s’étonne et veut se redresser. Un bras impérieux la recouche. Le cœur de Marie bat avec tant de violence qu’elle peut à peine crier. Une révélation foudroyante lui apprend tout du drame de l’amour. Elle comprend que l’homme est un animal comme les autres, et que son gentil amoureux va la couvrir comme elle a vu les taureaux couvrir les vaches dans les prés de son enfance. Une terreur immense l’a saisi toute entière […]
Elle veut se débattre. Une épaule lourde et vêtue lui écrase la figure. Marie, étouffée, malmenée, annihilée par l’épouvante, jette tout à coup un cri plus martyrisé, plus indigné, plus terrifié que les autres. Des pleurs jaillissent de ses yeux, tout son corps se tend, s’arc-boute pour protester.
Le garçon est muet, implacable, haletant. Marie, maintenant, pousse des sanglots de rage impuissante. Et, soudain, se mêle à sa clameur bâillonnée celle plus courte, plus saccadée, de son agresseur. Marie se tait presque pour l’écouter. Une nouvelle stupeur la terrasse. Va-t-elle devenir folle de tout cela ?
Brusquement, l’étreinte a cessé. Le garçon s’est tu. L’étau desserré désemprisonne Marie, renversée dans le désordre des jupons saccagés. Le couchant est enfin mort au bout du pré. La nuit règne seule sur les foins, avec toutes ses étoiles multipliées. Le garçon s’est relevé dans l’ombre.
Marie, d’un geste vaincu, rabaissa sa robe sur son corps blessé. Une douleur profonde continuait à mortifier son être intime.
(Extrait : pp. 34-35)
Elle appela faiblement, d’une voix coupée de spasmes. Personne ne lui répondit. Le garçon avait fui.
Comme un meurtrier qui se sauve de sa victime, il s’en était allé sans rien dire, sans rien vouloir connaître des suites de son forfait. »
(Extrait p. 37)