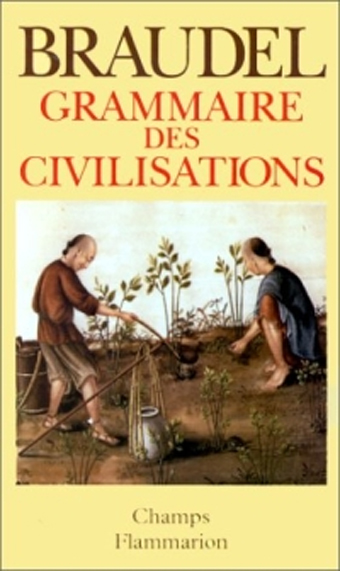
Extrait de F. Braudel, Grammaire des civilisations , Paris, 1963, réédition : Paris, 1987, pp. 420-428.
« Le mérite de l’Occident est d’avoir cherché avec véhémence une riposte sociale, humaine, assez efficace et valable, aux duretés multiples de l’industrialisation. Il a fabriqué un humanisme social, dirions-nous, si nous n’avions abusé déjà de ce mot commode.
Cette élaboration s’est faite au cours du triste, dramatique et génial XIXe siècle – triste, si l’on songe à la laideur de sa vie quotidienne; dramatique, si l’on considère sa séquence de troubles et de guerres ; génial, si l’on veut récapituler ses progrès scientifiques et techniques, et même, à un moindre degré, sociaux.
En tout cas, le point d’aboutissement est clair: aujourd’hui, bien au-delà du XXe siècle, une législation sociale tranquille, perfectible, essaie d’assurer un sort meilleur à des masses d’hommes de plus en plus considérables et de désamorcer la revendication révolutionnaire.
Cette multiple et imparfaite conquête ne s’est pas accomplie avec facilité, comme l’opération nécessaire qu’exige une morale ou une science impartiale. Elle se présente au contraire comme un combat très dur, où trois phases au moins se distinguent, en Occident (nous reviendrons sur l’évolution russe et soviétique, qui reste à part) :
a) La phase révolutionnaire et idéologique, celle des réformateurs sociaux, des prophètes (pour reprendre un mot de leurs nombreux ennemis). Elle va de 1815 à 1871, de la chute de Napoléon Ier à la Commune. La vraie coupure est peut-être 1848, l’année des révolutions en chaîne.
b) La phase des luttes ouvrières organisées (syndicats et partis ouvriers). Commencée dès avant le drame parisien du printemps 1871, elle se situe, pour l’essentiel, entre cette date et 1914.
c) La phase politique ou mieux étatique. l’État prend en main la réalisation des programmes sociaux, au-delà de 1919, ou mieux de 1929, et plus encore, la prospérité matérielle aidant, de 1945-1950 à nos jours.
Ce schéma suggère que la revendication sociale face à l’industrialisation a changé souvent de ton et de sens, selon les oscillations mêmes de la vie matérielle en gros, véhémente lors des époques de reflux économiques (1817-1851; 1873-1896; 1929-1939); apaisée au contraire par les montées économiques (1851-1873; et de 1945 à nos jours). Un historien, à propos de l’Allemagne, dit de ce va-et-vient de la revendication sociale :
« En 1830, en Allemagne, le mot de prolétariat n’est pas encore connu, en 1955, il ne l’est plus qu’à peine. »
De ces trois phases, la première, qui se situe seulement sur le plan des idées sociales, est la plus importante peut-être, parce qu’elle marque le tournant d’une civilisation entière.
De 1815 à 1848 et 1871, ce vaste mouvement d’idées, d’analyses aiguës, de prophéties, c’est, vu en gros, le déplacement de l’intérêt idéologique du politique vers le social.
L’État n’est plus la cible des revendications, mais la société, qu’il s’agit de comprendre, de guérir, d’améliorer.
Programme nouveau, langage nouveau. Avec les mots industriel, société industrielle, prolétariat, masse, socialisme, socialiste, capitaliste, capitalisme, communiste, communisme, se met en place une formulation nouvelle de l’idéologie révolutionnaire.
C’est le comte de Saint-Simon qui a fabriqué le substantif et l’adjectif industriel (à partir du vieux mot d’industrie) et sans doute la formule: société industrielle, dont s’emparent Auguste Comte, Herbert Spencer et bien d’autres. Pour A. Comte, il s’agit là de la société qui a remplacé la société militaire, jusqu’alors maîtresse de la scène. Celle-ci était belliqueuse, celle-là sera forcément pacifique, ce qu’Herbert Spencer, pour sa part, n’ose affirmer, et il a raison. Le mot de prolétariat entre en 1828 dans le Dictionnaire de l’Académie. Masse, au singulier et surtout au pluriel, devient le mot clef, « le symptôme terminologique de cette évolution dont le plein éclatera sous le règne de Louis-Philippe » . « J’ai l’instinct des masses, voilà ma seule supériorité politique » , déclare Lamartine, en 1828. Et Louis-Napoléon Bonaparte, dans son Extinction du paupérisme (1844): « Aujourd’hui, le règne des castes est fini, on ne peut gouverner qu’avec les masses. »
Ces masses, ce sont surtout les masses urbaines ouvrières, pauvres, exploitées. D’où l’idée que le temps présent est dominé par l’opposition des classes, ce que Marx appelle « la lutte des classes » . La lutte des classes est un phénomène ancien, présent dans toutes les sociétés matériellement évoluées du passé. Mais il n’est pas niable que le XIXe siècle va l’amplifier, qu’il se produit alors une violente prise de conscience.
Socialiste et socialisme commencent leur carrière avec les années 30. Communisme aussi, avec le sens assez vague d’égalité économique et sociale. Auguste Blanqui, « général des masses révolutionnaires » , peut ainsi écrire que « le communisme est la sauvegarde de l’individu « . Capitalisme apparaît chez Louis Blanc (Organisation du travail 1848-1850), chez Proudhon (1857), dans le Larousse de 1867, mais sa grande vogue attendra le début du XXe siècle. Capitaliste est plus vivant. En 1843, Lamartine s’écrie :
« Qui reconnaîtrait la Révolution dans nos mains?… Au lieu du travail et de l’industrie libre, la France vendue aux capitalistes!… » A signaler parmi les mots qui réussissent mal : bourgeosisme et collectisme.
Pourtant les souvenirs de 89 n’ont pas perdu leur pouvoir. Les jacobins, la Terreur, le Salut Public, autant de mots et de souvenirs qui continuent à hanter les esprits, comme des exemples ou des épouvantails. Pour la plupart des réformateurs, « la Révolution » reste le mot magique, la force créatrice. Lors de la Commune, en 1871, Raoul Rigault, déclare : « Nous ne faisons pas de la légalité, nous faisons la Révolution. »
Du comte de Saint-Simon à Marx, la mise en place des « philosophies massives », comme dit Maxime Leroy (entendez les idéologies inspirées par les problèmes de masses) est achevée pour l’essentiel en 1848.
En février de cette année-là, paraît le Manifeste communiste, de Karl Marx et Engels, qui reste, aujourd’hui encore, la bible de l’avenir communiste.
Nous pourrions, en suivant dans son détail la longue liste des réformateurs de ce premier XIXe siècle, dresser le tableau qui les situe dans le temps et l’espace. Il met assez bien en lumière le rôle primordial des trois grandes régions aux prises avec l’industrialisation : l’Angleterre, la France, l’Allemagne…
Il montre aussi la primauté de l’élaboration française (et celle-ci en soi est un problème sur lequel nous reviendrons dans un instant). Enfin, il souligne la priorité du comte de Saint-Simon. Cet homme singulier, un peu fou, génial aussi, a été à l’origine de toutes les idéologies sociales, socialistes et non socialistes, et par surcroît de la sociologie française (Georges Gurvitch). Son influence a été nette sur l’autre géant, qui d’ailleurs le surpasse de loin, Karl Marx: celui-ci, tout jeune, aura déjà lu les oeuvres de Saint-Simon à Trêves et puisé dans cette lecture beaucoup de ses idées et de ses arguments.
Si l’on excepte l’ancêtre, Saint-Simon, les réformateurs sociaux se groupent en trois classes d’âges: ceux qui sont nés durant les trois dernières décennies du XVIIIe siècle (Owen 1771, Fourier 1772, Cabet 1788, Comte 1798); ceux qui sont nés avec les dix premières années du siècle (Proudhon, Considérant, Louis Blanc); la génération plus homogène de Marx (1818), Engels (1820) et Lassalle (1825). Le groupe allemand ferme la marche. On a dit que la mort de Lassalle (1864), tué en duel, avait fait disparaître le seul partenaire de taille en face de Marx et assuré le succès de ce dernier. Mieux vaudrait attribuer ce succès à la puissance du Capital (1867).
Il ne saurait être question d’examiner ces « philosophies massives » , une à une. Toutes se présentent comme des analyses de la « société en devenir » ; cette belle formule est de Saint-Simon. Elles sont autant de médications, de thérapeutiques. Pour Saint-Simon et ses disciples (Enfantin, Chevalier, qui feront fortune dans les affaires au temps du Second Empire), l’effort doit porter sur l’organisation de la production. La Révolution française, qu’ils n aiment pas, est morte, à leur avis, de ne pas avoir organisé son économie. Fourier, qui lui aussi déteste la Révolution, pense qu’il faut surtout organiser la consommation.
Barbès et Blanqui, Louis Blanc et Proudhon restent fidèles aux principes de 89, les deux premiers comme des hommes de main et d’action, les deux autres « pour (en) compléter et parfaire » les principes. V. Considérant, pour sa part, les rejette, bien que moins violemment que son maître Fourier.
En dehors de Marx dont nous parlerons par la suite, le plus original de ces penseurs est Proudhon, épris de liberté jusqu’à l’anarchie, face à l’État comme face au christianisme, à la recherche d’une dialectique sociale qui saisirait scientifiquement la société vivante, nouant sous nos yeux ses contradictions. Ce sont ces contradictions mêmes qu’il faut résoudre pour saisir les mécanismes sociaux qu’elles impliquent. C’est là une spéculation scientifique, éloignée des passions d’ordre religieux, voire de l’action. Elle s’oppose à l’esprit des fondateurs de phalanstères (Owen, Cabet, Fourier), à l’esprit des révolutionnaires et de Marx, quant à eux ouvriers décidés d’un monde meilleur qu’ils annoncent, en attendant de le fabriquer de leurs mains.
La primauté de la pensée française en ces domaines, évidente en ce premier XIXe siècle, constitue un problème.
Sans doute est-elle le pays de la Révolution, de la grande Révolution. Sans doute est-elle fidèle aux rendez-vous révolutionnaires des années 1830 et 1848, et en 1871, seule et vaincue par l’étranger, elle aura nourri cette haute flamme révolutionnaire qu’a été la Commune parisienne.
Mais, ces originalités dûment mises en place, la France socialisante est, bien sûr, une conséquence entre quelques autres de sa propre industrialisation. Comme ailleurs la pensée réformiste ou révolutionnaire y est l’oeuvre des intellectuels, privilégiés sociaux dans leur très grande majorité. Et comme ailleurs, ces idées ne prendront force et vie que lorsqu’elles gagneront les milieux ouvriers et leur action. Mais plus qu’ailleurs les réactions intellectuelles y ont été précoces et violentes, alors que l’industrialisation est, au contraire, plus tardive qu’en Angleterre (le take off français se situerait vers 1830-1860).
Sans doute, mais la théorie du take off simplifie trop les vrais processus. Elle indique l’heure H où la grande poussée industrielle partirait d’un seul jet. Or, y a-t-il une heure H si nettement marquée? Le croire c’est négliger toute la période d’incubation préalable. En France, de 1815 à 1851, un taux annuel de croissance industrielle assez élevé (2,5 %) a été décelé par de récentes études. Cet élan aura suffi à amplifier une montée urbaine dès le XVIIIe siècle, à altérer l’ancienne société et à donner au pays déjà secoué par la Révolution et ses guerres, cet aspect de chantier de démolition qui a frappé les contemporains.
La poussée des villes entraînait, à elle seule, la brusque détérioration de leur paysage humain et matériel. Tous les observateurs s’en inquiètent de Balzac à Victor Hugo. Misère, mendicité, brigandage, délinquance, enfants errants, épidémies, criminalité, tout est aggravé par l’entassement rapide de travailleurs dans l’indicible promiscuité de murs étroits. Car les provinciaux ne cessent d’arriver. En 1847, Michelet note encore que le paysan « admire tout à la ville, il désire tout, il y restera s’il le peut… La campagne une fois quittée, on n’y retourne guère » . Pourtant, à Orléans, en 1830, année trouble, il faut secourir 12 500 indigents sur 40000 habitants, soit 1 sur 3. A Lille, la proportion est de 1 sur 2,21, cette même année.
Il semble bien que la société urbaine ait été, alors, particulièrement bouleversée par une industrie qui la touche, l’attire, sans être capable de la soulever, ni même de la faire vivre. Peut-être cette misère citadine n’était-elle pas pire au demeurant que celle des campagnes d’alors. Mais dans les villes, aux yeux de tous, s’étale le spectacle alarmant d’une population de travailleurs victimes de l’industrie qui, lorsqu’elle leur fournit du travail, se soucie peu de leurs conditions de vie.
Ainsi les premiers « idéologues » ont eu sous les yeux une société pareille à celle des pays sous-développés d’aujourd’hui, dès que les premiers essais d’industrialisation s’implantent et réussissent dans les villes.
Au contraire, à partir de 1851, puis avec la montée économique et l’essor du Second Empire (1852-1870), la situation ouvrière s’améliorera.
De l’organisation ouvrière à la Sécurité Sociale.
Il ne saurait être question de traiter à fond cette multiple, cette immense question.
Est-ce possible d’ailleurs? Il s’agirait de faire marcher de pair les idées socialistes (famille d’idées en mouvement, se contredisant les unes les autres, s’ajoutant aussi les unes aux autres) et l’activité, la revendication ouvrières qu’il faudrait replacer dans le cadre réel du travail et de la vie quotidienne. Comment les idées socialistes sont-elles prises en charge par ce corps vigoureux et tumultueux de la masse ouvrière?
Il est difficile de répondre à cette question, d’autant que souvent, et l’exemple anglais le prouve, le monde ouvrier se sera organisé pour lui-même, de façon réaliste, prudente, étroite, loin des idéologies et de la politique active et violente.
Puis, si la première heure a été celle des théoriciens sociaux, la seconde celle des groupements syndicaux, la troisième celle des partis politiques ouvriers, la dernière a été assurément celle des Etats, soit qu’ils disent non aux revendications (ou qu’ils leur cèdent de mauvais gré, au nom de la sagesse, ce qui revient à peu près au même), soit qu’ils suivent ou même précèdent les revendications, les désamorçant à l’avance.
Dans cette course, voilà donc au moins quatre troupes qu’il faudrait suivre: théoriciens de tous horizons, syndicalistes de tout poil, politiques issus du monde ouvrier, représentants de l’État, tous fort différents les uns des autres.
Une évolution se dessine cependant à travers l’Europe, avec à peu près les mêmes phases, au moins dans les trois pays essentiels, Angleterre, Allemagne, France, et dans les pays proches, Pays-Bas, Belgique, pays scandinaves, Suisse. Hors de ces Etats privilégiés, les retards, visibles, ne sont pas tous comblés aujourd’hui.
C’est la marche des pays progressistes qui nous importe ici. Marquons-en quelques étapes:
Avant 1871:
En Angleterre, les syndicats, Trade Unions, se sont constitués en grand nombre à partir de 1858-1867 et, dès leur fondation, ils s’emploient à lutter pour l’abolition de la loi « Maître et Serviteur » . Le premier congrès des Trade Unions est de 1866. Ces syndicats groupent seulement les ouvriers qualifiés.
En France, rien encore de positif, sauf, en 1864, cette loi sur les coalitions qui permet les grèves non abusives; en 1865, l’ouverture à Paris d’un bureau de la Section française de l’Internationale (la première, créée à Londres, en 1864), d’un autre bureau, à Lyon, en 1868. Le Second Empire a été à la fois « progressif et compressif » , il a amélioré la condition ouvrière, mais a surveillé de près les libertés de ce même monde ouvrier.
En Allemagne, même situation lente à se dessiner. Lassalle a fondé, en 1862, à Londres, l’Allgemeiner Deutscher Arbeiter Verein. Sept ans plus tard, le congrès d’Eisenbach voit la fondation du Parti ouvrier social-démocrate, d’inspiration marxiste.
Avant 1914:
Les progrès accomplis à cette date sont immenses.
En Angleterre, la fondation par Hyndmann, en 1881, de la Fédération démocratique a marqué les débuts de la propagande « socialiste » dans les milieux ouvriers, réfractaires jusque-là à la politique. En même temps que commence la politisation, le mouvement syndicaliste touche, à partir de 1884, les ouvriers les plus pauvres, les non-quailifiés. Ce n’est pourtant que dix ans plus tard que se produira la grande grève historique des dockers de Londres. En 1893, se constitue l’Independant Labour Party ; cinq ans plus tard la Fédération générale des Syndicats, Trade Unions. Les succès électoraux du Labour Party sont suivis de la formation quasi révolutionnaire du gouvernement « radical » de 1907. Une série de lois sociales sont alors votées. Une nouvelle Angleterre se dessine.
En France même processus: en 1877, Jules Guesde fonde le premier journal socialiste, l’Egalité, et deux ans plus tard le Parti ouvrier français (P.O.F.). Les syndicats sont reconnus par la loi de 1884, les Bourses du travail créées à partir de 1887. L’année 1890 voit la première célébration du Ier mai, fête du Travail; l’année 1893 voit la première élection de Jean Jaurès, député de Carmaux. En 1895 était créée la C.G.T. En 1901, création de deux partis socialistes, celui de Jules Guesde (Parti socialiste de France) et celui de Jaurès (Parti socialiste français); en 1904, fondation de L’Humanité ; en 1906, fusion des deux partis et formation du Parti socialiste unifié.
En Allemagne, les socialistes sont pourchassés par Bismarck (lois d’exception de 1878). A partir de 1883, un socialisme d’État multiplie les mesures sociales. Après la retraite de Bismarck, les syndicats se reconstituent, groupent bientôt plus d’un million d’adhérents. Leur succès politique est grand (3 millions de voix aux élections de 1907; 4’245’000, en 1912).
Dans ces conditions, sans s’exagérer la puissance de la Seconde Internationale à partir de 1901, on a le droit d’affirmer que l’Occident, en 1914, autant qu’au bord de la guerre, se trouve au bord du socialisme. Celui-ci est sur le point de se saisir du pouvoir, de fabriquer une Europe aussi moderne, et plus peut-être qu’elle ne l’est actuellement. En quelques jours, en quelques heures, la guerre aura ruiné ces espoirs.
C’est une faute immense pour le socialisme européen de cette époque que de n’avoir pas su bloquer le conflit. C’est ce que sentent bien les historiens les plus favorables au socialisme et qui voudraient savoir qui porte au juste la responsabilité de ce retournement de la politique ouvrière. Le 27 juillet 1914, à Bruxelles, se rencontrent Jouhaux et Dumoulin d’une part, secrétaires de la C.G.T. française, et K. Legien, de l’autre, secrétaire de la Centrale syndicale d’Allemagne. Se sont-ils rencontrés par hasard, dans un café, ou sans autre but que d’échanger leur désespoir ? Nous ne le savons pas et nous ne savons pas non plus le sens qu’il faut attribuer aux dernières démarches de Jean Jaurès, le jour même où il va être assassiné (31 juillet 1914).
L’Europe d’aujourd’hui, dans ce qu’elle a de socialiste, s’est bâtie lentement, incomplètement, par le jeu des votes politiques, des lois, par l’établissement en France (1945-1946) et en Angleterre, un peu plus tard, de la Sécurité sociale. Déjà le Marché commun, en posant le principe de l’égalité des Etats devant les charges sociales, en a décidé dans un plus ou moins bref délai l’extension à l’Europe des six. »












