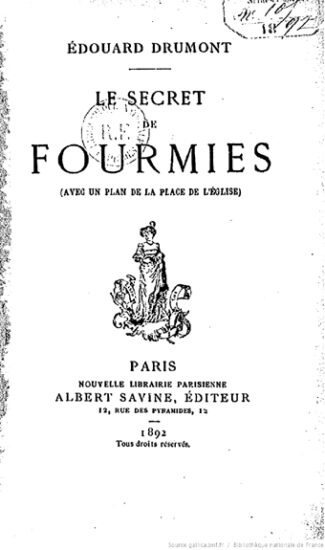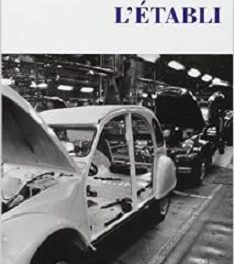Extrait d’un discours de Paul Lafargue, prononcé à Fourmies le 18 Avril 1891.
» Puis Lafargue appelle à la mobilisation pour le premier mai : » le nombre des manifestants du 1er mai 1890 a surpris les organisateurs eux-mêmes. Cette année, la manifestation sera bien autrement importante. Et dans beaucoup d’endroits, les ouvriers s’imposeront ensuite d’eux-mêmes le travail de 8 heures, en dépit des patrons. Il ne faut, dit-il, songer à retourner en arrière en brisant les machines ! Autrefois, les ouvriers industriels n’avaient qu’un maître, qui pouvait être humain, aujourd’hui les manufactures sont aux mains d’actionnaires auxquels il faut donner de forts dividendes au prix des sueurs ouvrières, il faut que les ouvriers deviennent leurs propres maîtres pour avoir le profit de leur travail. Le travail industriel tel qu’il est imposé détruit notre race. Il faut enrayer le rachitisme constaté tant de fois dans nos centres manufacturiers. Il est temps de réagir contre le Machinisme qui accapare tout, au point que bientôt il n’y aura plus qu’une profession possible, celle de mécanicien!… Honneur, dit-il, aux citoyennes qui sont venues. La femme a plus d’énergie et de volonté que l’homme, c’est par la femme que nous arriverons au communisme. »
Reproduit par le Courrier de Fourmies du 19 avril 1891, cité par A. Pierrard et J.L. Chappat, La fusillade de Fourmies, éditions Miroirs, 1991.
La réponse patronale
» Le même jour, La Croix du Nord, publiée à Lille, dans un article signé » Pauvre Jacques » et intitulé » Réflexions d’un pauvre homme à l’occasion du 1er mai « , tente de ridiculiser la revendication des Huit heures :
« … Nous aurons donc 8 heures de sommeil et 8 heures de travail. Mais nous aurons aussi 8 heures de loisir. Le loisir, c’est l’oisiveté ; et l’oisiveté c’est la mère de tous les vices. Qu’est-ce que nous pourrons en faire, de ces 8 heures ? Et moi, personnellement, qu’est-ce que j’en ferai ? Parbleu ! J’irai au cabaret. Au lieu d’y aller une heure ou deux par semaine comme je le faisais, j’irai tout le temps que j’aurai de libre. Au lieu de prendre deux ou trois chopes comme je le faisais, j’en prendrai quinze ou vingt. Si bien que je dépenserai davantage à mon plaisir le jour où je travaillerai le moins. «
(Article repris intégralement le lendemain 20 avril 1891 par Le Bien Public fourmisien.)
Extrait de A. Pierrard et J.L. Chappat, La fusillade de Fourmies, éditions Miroirs, 1991.
Les origines de la grève des mines d’Anzin en 1884
« Généralement dans les familles de mineurs, ce n’est pas seulement le chef de famille qui est occupé aux travaux de la mine, ce sont aussi les enfants… ce sont les vieux parents jusqu’à ce qu’ils soient devenus invalides ou aient acquis leur droit à la retraite payée par la compagnie… De même que les vieux serviteurs attachés de père en fils à un domaine, les mineurs qui de père en fils vivent sur la mine, en arrivent à croire qu’ils ont sur la mine un droit qu’on pourrait appeler le droit au travail…
Mais, depuis dix ans, la production des fosses ne s’est pas augmentée, et la Compagnie entrevoit qu’elle devra plutôt baisser prochainement… Elle a cru, dans le cas présent, devoir affirmer son droit au renvoi des ouvriers qu’elle ne peut pas occuper utilement. Elle n’a pas cru pouvoir accepter les propositions des mineurs de réduire le nombre d’heures de travail par semaine. »
Historique de la Grève par l’ingénieur en chef, 19 mai 1884, cité dans « Le Pays Noir », CRDP de Lille 1979.
Une étude vendéenne
« Bien loin des problèmes d’appréciation des salaires, venaient toutes les revendications concernant la durée du travail, soit 11% de 1874 à 1938, dont 8% pour la réduction du temps de travail.
La durée du travail ne devint réellement un sujet de préoccupation qu’avec les campagnes syndicales (C.G.T.)sur la question des huit heures obtenues dans les mines et secteurs assimilés, dès la loi du 29 juin 1905. Les cheminots réclamèrent ces huit heures dès 1919, suivis par les ouvriers minotiers et ceux du bâtiment. Dans le terrassement, la journée tournait autour de onze heures, neuf à dix dans la maçonnerie. Déjà la loi du 30 mars 1900 préconisait les dix heures, et les ouvriers vendéens demandèrent l’application des lois d’avril 1919 et de juin 1919. C’est pourquoi la réduction de la durée du travail en général et sans perte de salaires (…)furent causes de plus en plus fréquentes de conflits, davantage après 1919 qu’avant 1914.
Les mineurs durent défendre leur acquis en refusant des règlements et des consignes particulières de descente, qui portaient atteinte à la législation (…). Les mineurs réclamaient les huit heures pour tous, plus une heure décomptée en cas de remontée occasionnelle par les échelles. Sur 11% de leurs revendications de 1919 à 1938, citons encore la grève générale du 16 juin au 11 juillet 1919, protestation contre le vote des députés [vendéens] sur la question des huit heures, et celle de novembre 1921, quand les mineurs repoussèrent la proposition du directeur tendant à réinstaurer la journée de dix heures(…).
Les monteurs, les tourneurs, les ajusteurs de Luçon réclamèrent également la stricte application de la journée de huit heures, alors qu’on leur en imposait dix en 1928. Même revendication des dockers charbonniers que l’on contraignit quelquefois à douze heures de travail consécutives quand un steamer attendait sur les quais. »
extrait de F. REGOURD, « La Vendée Ouvrière », Le Cercle d’Or 1981.