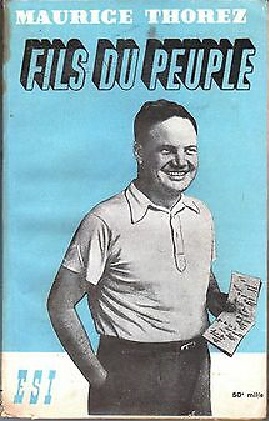« Fils du peuple », l’autobiographie du secrétaire général du PCF Maurice Thorez, diffusé à partir d’octobre 1937, fut un incontestable succès éditorial.
Publié par « les Éditions sociales internationales », contrôlées par le PCF, l’ouvrage bénéficia d’une large publicité dans les organes de presse et revues du Parti mais aussi, fait plus novateur, par le biais d’un petit film de propagande.
Pourtant, « Fils du peuple » n’est pas une autobiographie au sens propre du terme, puisqu’on sait depuis les années 70 que les Mémoires de Maurice Thorez sont en réalité l’oeuvre de deux « nègres », Jean Fréville et surtout André Wirezbolowiez. Aussi peut-on légitimement se poser la question de ce qui dans cette biographie relève de la réalité ou de la fiction. Mais cette question importe peut-être moins finalement que celle de la mise en récit de la vie du secrétaire général du PCF, qui au moment où l’ouvrage est publié, n’a que 37 ans…
L’extrait ci-dessous reproduit les toutes premières pages du chapitre 1 du livre. La première phrase donne à la fois la clé et le ton du récit : « FILS et petit-fils de mineurs, aussi loin que remontent mes souvenirs, je retrouve la rude vie du travailleur : beaucoup de peines et peu de joies. » En se rattachant à une lignée de mineurs et de militant syndicaliste par son grand-père ; en rappelant que son premier souvenir marquant, c’est la catastrophe de Courrières en 1906, le récit renvoie de manière subliminale à la geste ouvrière décrite par Zola dans « Germinal ». Avec de telles origines, Maurice Thorez n’est donc pas seulement un authentique « fils du peuple » ; il est surtout predestiné à être le chef légitime de la classe ouvrière dont le PCF prétend être l’unique représentant.
« Fils du peuple » édité en 1937 a connu avant et après la guerre de multiples rééditions et c’est devenu, en quelque sorte, un classique que tout bon militant et militante communiste se devait d’avoir lu. Ce livre est donc un jalon important dans la création d’un culte de la personnalité du chef du PCF, qui sans atteindre les proportions du culte de Staline qui se développe au même moment, en est directement inspiré.
FILS et petit-fils de mineurs, aussi loin que remontent mes souvenirs, je retrouve la rude vie du travailleur : beaucoup de peines et peu de joies. Le coron triste, l’entrée du carreau, le cheminement des mineurs accablés par l’ effort à plusieurs centaines de mètres sous terre, et parfois l’ accordéon, la course des «coulonneux » et les flonflons de la ducasse. Sur ce fond monotone et terne surgit, plus intense, plus poignant, le défilé des bâches noires ou vertes marquées de taches foncées, s’allonge la perspective des cercueils de bois blanc, alignés dans les hangars. Je vois des hommes, des femmes, des enfants courir en tout sens, se heurter, se bousculer, revenir, tournoyer sur place. Des gendarmes gardent des portes contre lesquelles se brise une foule hurlante… Puis mes souvenirs s’enchaînent, se précisent, s’éclaircissent. Les scènes et les couleurs deviennent plus distinctes et plus nettes. Je vais avoir six ans, étant né presque avec le siècle, le 28 avril 1900…
Un jour comme les autres, je jouais avec d’autres gosses du coron lorsque notre attention fut attirée par un grondement sourd, un piétinement lointain, le fracas des sabots sur les pavés. Les gens se précipitaient dans une même direction : je fis comme eux. C’était amusant de galoper, de dépasser les vieux qui soufflaient, les femmes qui portaient leur dernier-né sur le bras. On criait :
-C’est à Courrières ! À la fosse de Méricourt ! Il y a des centaines de victimes !
Ainsi le 10 mars 1906, je galopai dans la brume glacée et je parcourus, aussi vite que me le permettaient mes petites jambes, les sept kilomètres qui séparent Noyelles-Godault des corons de Méricourt, sur la route de Lens. Des villages environnants, mineurs quittant leur travail, femmes et enfants se bousculant, s’interpellant, brassés, mélangés, emportés, ressemblaient à quelque armée en déroute sur qui s allongeait l’ombre de la mort.
À Méricourt, je ne vis d´abord rien. Le flot humain venait s écraser contre une haute grille de fer coupant un long mur de briques. Derrière la grille s’agitaient des hommes noirs, affairés, la tête encapuchonnée, enfoncée dans des appareils étranges. Au loin, dans le brouillard, se profilait le chevalet du puits, aux molettes immobiles. Sur ce paysage lugubre flottait une odeur de suie mouillée, de brûlé, de fumée. Bientôt des lamentations, des imprécations s’élevèrent, des femmes hurlaient, échevelées, il y eut des remous. On parlait d’enfoncer la grille. Des gendarmes à cheval surgirent et poussèrent leurs bêtes contre la foule.
Mais celle-ci, toujours plus dense, ne cédait pas un pouce de terrain. Des cris aigus fusaient de tous côtés.
—Dites -nous la vérité !… Dites-nous ce qu’il y a !… Laissez-nous voir!… Laissez-nous entrer!… —-Mon mari est au fond…
—Mes enfants sont au fond…
—Tous les miens sont au fond…
Je me souviens qu’ensuite, avec d’autres gosses, nous sommes revenus au village, accablés et harassés, et que nous sommes restés longtemps sans jouer et sans nous disputer…
Les jours suivants, je suis retourné à Méricourt. Il y avait beaucoup de gendarmes, tout le monde était vêtu de noir. Sur le seuil des maisons, le long du coron, les gens pleuraient, des enfants se serraient autour de leurs mères. Dans les villages des environs, à Sallaumines, à Billy-Montigny, c’était le même spectacle. Partout, on transformait des hangars en chapelles ardentes. Les gens parlaient avec reconnaissance des équipes de sauveteurs venus de Westphalie. Puis ce furent, sous la neige, les convois désolés, les obsèques des malheureuses victimes.
La terrible catastrophe avait remué tout le pays. Depuis longtemps, le peuple noir des mineurs se plaignait des salaires de famine, du travail trop pénible, des conditions de sécurité insuffisantes. La colère grondait contre les compagnies. Pour grossir les dividendes, treize cents ouvriers avaient connu une affreuse agonie au fond de la mine. À peine enterrés, la compagnie vorace réclamait qu’ils fussent remplacés, elle exigeait le sacrifice de nouvelles victimes. Le désespoir et la révolte coururent de coron en coron, soulevèrent dans un même refus les survivants : la grève éclata.
Une véritable armée d’occupation s’abattit sur le bassin minier.
Dans les villages, dans les courées, des groupes se formaient. De longs cortèges se déroulaient sur les chemins. Ce n’était plus la débandade affolée du 10mars ; des hommes aux regards sombres criaient leur indignation ou parlaient à voix basse de ceux qui dormaient leur dernier sommeil au cimetière.Une de ces manifestations, drapeau rouge en tête, se heurta aux gendarmes, sur la route d’Hénin-Liétard.Ce jour-là, ma mère, se rendant à la ville, m’avait emmené avec ma sœuret mon frère. Nous cheminions dans le cortège. Soudain, en tête, il y eut un arrêt brusque, des cris, des coups de sifflets, des remous violents dans la foule et, brusquement, une galopade éperdue. Les gendarmes chargeaient. Je fus séparé de ma mère, emporté, piétiné, tandis que passaient au-dessus de moi les ombres gigantesques des chevaux.
Je me relevai et gagnai l’encoignure d’une porte ; un colosse brandissant son sabre jeta sa monture contre un groupe de manifestants. Quelques grévistes s’accrochaient aux rênes des chevaux, d’autres se réfugiaient dans les courées, tandis qu’au loin les soldats, baïonnette au canon, dressaient leur ligne bleue et rouge, comme sur l’image que possédait mon grand-père et qui représentait le massacre de Fourmies…
Toute la journée, les gendarmes patrouillèrent dans notre village, jetant des regards insolents par les fenêtres. Ma mère avait tiré les rideaux. Et nous restions chez nous, dans l’obscurité, à écouter le cliquetis des sabres… Des manifestants avaient été arrêtés, d’autres blessés. La grève dura près de deux mois, exactement cinquante-deux jours. Deux mois de misère terrible et de privations, deux mois de souffrances et de colère. C’était là le sort des mineurs: le travail exténuant, les blessures, les éboulements, le grisou. Et quand, excédés de misère, ils criaient leur malheur, la force armée surgissait pour les mettre à la raison !
Durant la grève, Clément Baudry, mon grand-père, se dépensa sans compter. Vieux militant ouvrier, il avait adhéré dès la première heure au syndicat fondé par Basly. J’aimais l’entendre. Il me racontait l’histoire de sa vie et de ses luttes. Sa vie ! Elle s’était écoulée presque tout-entière dans la nuit de la fosse, mais elle était plus claire, plus ensoleillée que bien des existences passées à la lumière du jour. Elle était illuminée par sa passion pour le syndicat, pour la classe ouvrière. Récits toujours nouveaux de grèves, de batailles et d’efforts, résistance opiniâtre aux maîtres des mines et des usines, aux gendarmes, aux soldats, souvenirs enthousiastes où claquaient comme des drapeaux les noms de Basly et de Jules Guesde, vous m’avez fait mûrir plus vite que les années!
Le grand-père tempêtait contre les «faux frères », contre le «jeune »syndicat de la C.G.T. opposé au «vieux » syndicat de Basly et de Lamendin. Les deux syndicats se livraient une âpre bataille et, dans ces pays du Nord, où les traditions des anciens compagnonnages et de leurs rivalités demeuraient vivaces, on en venait parfois aux coups. Je ne comprenais pas le fond du débat qui dressait ainsi les mineurs les uns contre les autres, mais j’étais fasciné par cette vie ardente et si bien remplie, par cet héroïsme dépensé chaque jour au service de l’idéal ouvrier. Le grand-père et ses camarades, inlassables, parcouraient les puits et les corons, recrutant sans cesse ; ils luttaient pour chaque homme,ils essayaient deconquérir à leurs idées, un à un, lesmineurs qu’ils voulaient arracher à l’indifférence, à la soumission, à l’ignorance. Ils se heurtaient à l’apathie des uns, à la crainte des autres, à la haine et aux menaces patronales, aux divisions ouvrières, —l’influence des «broutchoutards » était grande à Courrières et à Lens. Clément Baudry, mon grand-père, mort à la tâche en 1931, à soixante et onze ans, avec votre carte de syndiqué à jour, vous qui avez occupé une telle place dans ma vie, qui avez guidé mes premiers pas et m’avez appris à lutter, je vous salue ici comme l’incarnation du militant modeste, courageux, irréprochable —et fidèle !Maurice Thorez, Fils du peuple, ESI, octobre 1937, chap.1