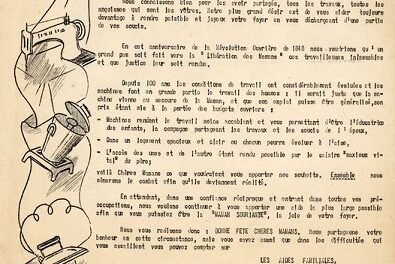Un autre regard sur le genre de la nation ?
En France aujourd’hui, on écrit et on théorise beaucoup sur la République, la citoyenneté, l’égalité et l’universel ; mais, dans la production la plus récente, on parle peu de la nation. Du moins dans les écrits concernant les femmes…Les colloques sur « Femmes, nations et Europe » et sur « Féminismes et identités nationales » représentent dans ce panorama rapide des exceptions notables.
[…]Notre vision n’était pas seulement de voir l’histoire de la France autrement, mais aussi de proposer de nouvelles approches aux questions classiques et de juxtaposer des problématiques semblables dans des espaces-temps différents. Une de nos préoccupations majeures est donc d’examiner la manière dont les hommes et les femmes, citoyens ou non d’un pays, se positionnent par rapport à l’État et à la nation, c’est-à-dire comprennent les obligations et les droits des deux sexes. Pour les femmes, se pose la question classique de l’accès au suffrage, mais aussi, dans des moments exceptionnels ou non, celle de porter les armes ou de refuser l’injonction nationale de la maternité. Pour les hommes qui en général ont gagné la pleine citoyenneté au cours du XIXe siècle ou au début du XXe les exclusions jouent sur d’autres critères que le genre, notamment la race (comme par exemple les Noirs aux États-Unis) ou la situation économique (suffrage censitaire). Pour les deux sexes, la possibilité de chercher à acquérir la nationalité et la citoyenneté d’un pays, ou encore de contourner ou remettre en question l’État par l’internationalisme, le pacifisme ou l’anarchisme, apparaît au prime abord identique pour les deux sexes ; mais, en fait, on relève dans chaque cas de figure des différences.
[…]L’intersection du « genre » et de la « nation » sont spécifiques. Nous voulons signifier par cette affirmation, que la construction et l’entretien de l’État et du sentiment national sont « genrés », c’est-à-dire qu’il est attribué aux hommes et aux femmes des rôles, des fonctions et des pouvoirs spécifiques. Nous concevons la nation comme un objet tout autant construit que l’est l’État, mais dans le quotidien, au cours du temps, même si, pour les individus, le sentiment d’appartenance nationale parait inné. Les hommes sont censés servir l’État dans les domaines militaire, politique et économique ; c’est le territoire du rationnel. Les femmes, en revanche, sont censées créer la nation dans les domaines de l’éducation, du domestique et du culturel et c’est l’espace de l’affectif. Dans des circonstances extraordinaires guerres ou crises graves cet ordre des choses peut être bousculé. C’est le cas par exemple, au moins en Europe, de la guerre de 1914-1918 avec ce que Françoise Thébaud a appelé « la nationalisation des femmes », c’est-à-dire la mobilisation par l’État du corps des femmes.
Cette réflexion sur le genre de la nation aide à éclaircir comment et pourquoi l’État a tendance à représenter la nation par une symbolique sexuée, comme la Marianne française ou la Germania allemande. En France, Maurice Agulhon a initié le champ de recherche sur la représentation féminisée de la République. Traduits, ses travaux ont eu des échos dans d’autres historiographies nationales. Mais le paradoxe entre l’exclusion des femmes françaises de la citoyenneté pendant un siècle et leur importance dans les représentations symboliques reste ouvert, comme le souligne Maurice Agulhon lui-même. Depuis un siècle, l’historiographie, suivant en cela les hommes politiques, a entretenu la confusion entre les deux notions en mettant sur le même plan un régime politique (La République) et une communauté (la nation). Sans doute, faire une histoire comparée du rapport entre le symbolique et les pratiques politiques dans les autres États-nations, éclaircirait-il cette énigme.
Léora AUSLANDER et Michelle ZANCARINI-FOURNEL : « Le genre de la nation et le genre de l’État », in CLIO – Le genre de la nation, N° 12-2000
L’histoire des femmes, telle que Georges Duby l’écrit et la conçoit, est d’abord celle de la domination masculine. Attaché au modèle anthropologique de l’échange matrimonial développé par Claude Levi-Strauss, il décrit avec vigueur un Mâle Moyen Age (1988) âpre et brutal, réglé par l’ordre patriarcal. L’amour courtois ? Ce n’est pour lui qu’une fiction littéraire, où des simulacres de désir se déploient autour de l’épouse du seigneur. La femme n’est qu’un leurre dans cette parade du pouvoir qui divertit les jeunes chevaliers soumis aux rigueurs de l’ordre lignager, de même qu’elle n’est, dans le discours des clercs, “jamais qu’un reflet d’une image de Dieu”. Et Duby d’ajouter : “Un reflet, on le sait bien, n’agit pas de lui-même. L’homme seul est en position d’agir”Dames du XIIè siècle, vol 3, p.81 Sans doute Georges Duby s’était-il convaincu, à la fin de sa vie, que les textes littéraires qu’il lisait et relisait sans cesse ne permettaient pas de faire autre chose qu’une histoire des discours et des représentations. Manipulée et muette, la femme se dérobait sans cesse à sa quête. Et c’est sur ce constat, faussement désenchanté, qu’il prend congé des ses Dames du XIIè siècle : “je n’ai entrevu que des ombres, flottantes, insaisissables. Aucune de leurs paroles ne m’est directement parvenue.”Ibid, p. 217
Il semble bien qu’il ait exagéré le silence et l’instrumentalisation des femmes (“fortes, bien plus fortes que je n’imaginais”). C’est du moins ce que tente de montrer, avec de solides arguments, une tendance de l’historiographie féministe américaine. Tout en saluant le rôle crucial que tint Georges Duby dans la conquête d’une respectabilité scientifique pour la gender history, elle remet en cause une historiographie qui ne s’attache, précisément, qu’un reflet des femmes dans le discours des hommes. Ainsi la recherche dans les cartulaires révèle-t-elle une société féodale moins patriarcale et moins misogyne que Georges Duby ne l’avait imaginé, où les femmes ont une capacité d’agir que l’historien leur refusait. Le voici, en somme, “pris à revers sur le terrain même où il avait fait ses premières armes”. Son point de vue s’expliquerait en partie par ses choix documentaires et sa volonté de privilégier un petit nombre de sources narratives.
Patrick Boucheron : « Georges Duby », in Les Historiens , ouvrage coordonné par V. Sales, Paris, Colin, 2003, p. 241-2