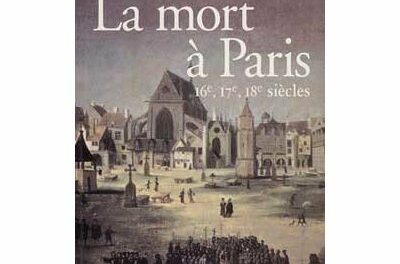La bataille de Rethel
D’après « La Chronique de Champagne » – H. Fleury – 1838
Le récit qu’on va lire de la bataille de Rethel, perdue par les Espagnols que commandait Turenne, est extrait des Mémoires de l’évêque de la Ravalière.
Le Roy venait de terminer les affaires qui l’avaient obligé d’aller en Guienne. Dès qu’il eut pacifié cette province, il donna les ordres pour chasser les ennemis des lieux qu’ils avaient fortifiés en Champagne, et empêcher le maréchal de Turenne de mettre le pays à contribution, avec l’armée qu’il commandait.
Les troupes et les munitions nécessaires pour un siège s’avançaient vers Reims et Châlons. Le maréchal Du Plessis, à la tête d’une partie de l’armée qu’il avait commandée toute la campagne, se logea près de Vitry-en-Perthois et feignit d’en vouloir à Bar. Il manda au sieur de Villequier, l’un des lieutenants généraux de cette armée de prendre la route vers Châlons, et aux troupes commandées par le sieur de la Ferté Senneterre, aussi lieutenant général, de s’approcher de Saint-Dizier. Ils restèrent dans ces postes jusqu’à ce que l’artillerie et les munitions de guerre et de bouche fussent en l’état qu’il désirait.
Le maréchal de Turenne s’avança pour les observer. Il vint se poster auprès Montfaucon, et il jeta deux ponts sur la Meuse auprès de Dun. On jugea qu’on tenterait inutilement de l’engager à combattre, qu’il repasserait la Meuse à l’approche de notre armée : que la prise de Rethel était plus importante pour la sûreté de nos frontières, qu’il serait plus glorieux d’attendre à le défaire, lorsque les troupes allemandes et celles que le comte de Ligniville avait dans les montagnes de la Lorraine l’auraient joint.
Le maréchal Du Plessis résolut donc de marcher. Il manda aux sieurs de Villequier et d’Hoquincourt, lieutenants généraux, d’aller investir Rethel avec leurs brigades, et de presser tellement leur marche, que ceux de la place ne pussent avant leur arrivée rompre le pont de Tugny qui facilitait beaucoup l’entreprise, et donnait lieu d’empêcher que la cavalerie de Rethel ne brûlât les villages et les fourrages de delà la rivière.
Une partie de la garnison travaillait à le ruiner lorsque d’Hoquincourt arriva, il le passa et se logea aux endroits qui empêchaient la cavalerie ennemie de sortir. Villequier resta en deça et il ne joignit d’Hoquincourt que le lendemain. Le maréchal Du Plessis marchait à grandes journées avec la cavalerie française, celle du lieutenant général Roze, la plupart de l’infanterie de l’armée, deux pièces de canon qu’il amenait de Saint-Dizier, et les troupes de la vieille cavalerie allemande, commandées par Fleckenstein, maréchal de camp qui tenait l’arrière-garde.
En cet ordre, il parut, le vendredi 9 décembre, sur les hauteurs à la vue de Rethel, et il distribua son armée dans les villages voisins. Il reconnut la place, et après avoir pris la résolution d’attaquer le grand faubourg de la rivière, qu’il était important de gagner, pour éviter les travaux d’une circonvallation qu’il aurait fallu faire de ce côté-là, il jeta dans le village d’Assy un détachement de mille mousquetaires, sous les ordres du sieur d’Aimeras, capitaine au régiment des gardes.
On avait dessein de jeter un pont sur le bras de la rivière qui enferme le faubourg. La largeur rendait la chose impraticable, et l’on se détermina à forcer la partie du faubourg qui n’est couverte que d’un petit ruisseau et où l’église des Minimes est située. On l’emporta avec beaucoup de vigueur, tout ce qui fit résistance fut passé au fil de l’épée. Le sieur Manicamp, lieutenant général et le sieur de Valon, maréchal de camp qui commandait sous lui à l’attaque, y passèrent la nuit. La porte du faubourg était défendue par un ouvrage de terre qu’ils abandonnèrent. Il s’agissait de battre cette porte, on fit avancer le canon, et l’on se prépara à l’attaquer le lendemain. Le logement que nous avions dans les Minimes nous rendit maîtres d’une redoute de pierre à l’entrée de ce faubourg. Une enseigne et dix-huit soldats qui la gardaient y furent faits prisonniers.
La nuit du samedi au dimanche, on fit passer le ruisseau sur un petit bateau à vingt-cinq soldats du régiment de Rambures, commandés par le sieur Dufresne. Ils entrèrent dans le faubourg sans résistance, et paraissant tout à coup, la confusion se mit parmi les Espagnols, ils lâchèrent pied, abandonnèrent le faubourg, et furent poursuivis si vivement, qu’ils ne purent achever de rompre le pont dormant qui est sur la rivière pour entrer dans la ville.
Le sieur de Manicamp fit faire aussitôt un retranchement à la tête du pont, et insista sur ce qu’il avait proposé auparavant, qu’on pourrait forcer la place de ce côté-là. Le maréchal Du Plessis n’avait été d’un avis contraire que parce que la rapidité de la rivière en cet endroit ne permettait point d’y jeter un pont. Mais depuis qu’on se fût rendu maître du faubourg, la difficulté était surmontée, et il ne restait qu’à rétablir celui de la ville.
Dès que la nuit l’eût permis, on mit en batterie une pièce de canon qui brisa la porte et qui fit une brèche dans la tour qui la défendait. On continua, à tirer tout le lundi 12 du même mois, et la brèche étant suffisante, on raccommoda le pont à l’entrée de la nuit. Pendant que l’on battait la porte, les assiégés la remplissaient par derrière de terre et de fumier jusqu’à la voûte, et ils la comblèrent en dedans presque à l’épaisseur de l’arcade intérieure de la ville.
On eût perdu trop de temps et de monde à percer cet ouvrage : l’assaut étoit moins meurtrier et moins difficile, et la brèche que le canon avait augmentée, parut une voie plus prompte. Le régiment de la Marine passa avec une intrépidité extraordinaire sur des bouts d’ais restés du pont et des planches qu’on jeta dessus. L’ennemi faisait un feu continuel des flancs de la porte qu’on n’avait pu ruiner en aussi peu de temps. On s’établit à l’instant sur le terrain qui est entre la ville et la muraille, et l’on se logea sur la porte par la brèche.
Pendant que nos soldats y montaient, on arrêta le feu des ennemis en commandant des fantassins (vingt ou trente tiraient sans cesse du bord de la rivière aux créneaux de la porte). Chaque créneau était attaqué en même temps par un pareil nombre, ce qui empêcha les Espagnols de se montrer pour tirer un seul coup.
Le premier des nôtres qui entra dans la ville fut un nommé Randoulet, originaire de Rethel et charpentier de sa profession, qui s’était signalé au passage du pont et lorsqu’on monta à la brèche. Il s’avança témérairement dans la grande rue, presque seul, et il y fut fait prisonnier de guerre.
Le maréchal de Du Plessis-Praslin, après la prise de la ville, lui fit donner 80 pistoles de récompense. Il perdit dans la suite la gloire qu’il avait acquise dans cette action. Dans le mois de mai de l’année 1653, il se mit à la tête d’un parti du prince de Condé contre sa propre patrie, volant indifféremment ses concitoyens comme les autres qu’il rencontrait, et le 18 du même mois, il fut tué près de Boult-sur-Suippes par ceux de Rethel, comme il retournait à Château-Porcien.
Dès que nos troupes se furent logées sur le rempart, elles s’étendirent et firent des prisonniers. Les assiégés avancèrent sur nous avec des grenades. Ils écartèrent ceux des nôtres qui étaient descendus pour dégager la porte des terres qui en fermaient l’entrée. Cet avantage dura peu, une partie des Espagnols se retira en confusion dans le château, l’autre défendit la brèche.
Le lendemain mardi 13, Delponty, gouverneur, fut sommé de se rendre. Il manquait de fourrages et de provisions, et il courait risque de voir emporter la ville à une deuxième attaque, sans le pouvoir empêcher. Il offrit des ôtages sur les neuf heures du matin et demanda à traiter pour la reddition de la place. La première proposition fut, qu’on lui permît de faire avertir le maréchal de Turenne de l’état de la ville, et que si dans dix jours il ne recevait point de secours, il se rendrait. Cet article fut rejeté, l’on n’écouta point non plus les autres, et les otages furent renvoyés. Quelques heures se passèrent pendant lesquelles on donnait les ordres pour réduire la ville.
Le gouverneur envoya une deuxième fois faire de nouvelles propositions qui furent accordées et signées. Il s’engageait, quand même le secours viendrait à la garnison espagnole, de sortir le lendemain mercredi 14, à la pointe du jour. A peine la capitulation fut-elle réglée, qu’on apprit que les ennemis approchaient. Le maréchal de Praslin dépêcha aussitôt dans tous les quartiers, avec ordre de le venir joindre, afin de former un corps et de bien recevoir le maréchal de Turenne. L’armée fut en bataille toute la nuit, et l’on ne douta point qu’on en vînt aux mains.
L’avantage que l’on venait d’avoir sur les Espagnols, et les desseins que l’on formait sur Château-Porcien étaient importants à la vérité. Mais il restait quelque chose de plus essentiel ; il s’agissait d’empêcher les ennemis de prendre des quartiers en France, où ils eussent fait subsister le corps de leur cavalerie à nos dépens : maîtres de l’augmenter quand ils voudraient, et en état d’agir et de s’avancer dans le royaume à l’ouverture de la campagne.
Il fallait, ou leur faire tête durant tout l’hiver, ce qui aurait infailliblement ruiné notre armée, ou les combattre au commencement du printemps. On voyait assez qu’il était plus à propos de hasarder la bataille avant que la saison devînt plus rigoureuse, puisqu’en attendant, nos troupes affaiblies seraient difficilement remplacées, au lieu que l’armée de M. de Turenne pouvait aisément se rafraîchir et augmenter par les corps que les Espagnols y envoyaient de tous côtés.
On avait encore un autre parti à prendre : c’était d’entrer dans les quartiers d’hiver. Mais outre que c’était autant ou pire que de perdre un combat, M. de Turenne par cette retraite devenait également redoutable pour la campagne prochaine. Ces raisons, qui furent agitées par les généraux, firent prendre la résolution d’aller droit à lui et de l’obliger à combattre ou de repasser la Meuse, d’autant plus que l’année en se mettant en marche souffrirait moins qu’en demeurant en bataille, comme elle avoit fait la nuit précédente.
Le maréchal de Turenne nous aida lui-même à exécuter ce dessein. Son but était de nous surprendre pendant le siège, lorsque notre armée s’était séparée par la rivière, et de s’emparer de notre pont. Il donna ses ordres aux troupes qu’il faisait marcher à grandes journées et au milieu des plaines. Le canon et son infanterie étaient déjà à Tugny, à deux grandes lieues au-delà du corps de la cavalerie. Dès qu’il eut appris par nos déserteurs que depuis deux jours nous étions maîtres du faubourg, et que Delponty avait signé sa capitulation, il se retira avec précipitation et marchant toute la nuit, il se couvrit de la rivière d’Aisne et campa dans la vallée de Bourg.
- de Praslin, bien informé de ce mouvement, fit presser le gouverneur de Rethel d’exécuter sa capitulation dès la pointe du jour, et en même temps que la garnison sortait, il partit avec l’armée pour joindre M. de Turenne avant qu’il fût trop éloigné. Il était nuit lorsque l’armée arriva à Juniville, Bignicourt, Ville-sur-Retourne et le Mesnil- en-Nelles. Les partis détachés par les sieurs d’Hoquincourt et Roze, qui étaient aux quartiers plus avancés, rapportèrent que les ennemis étaient encore dans la vallée de Bourg.
- de Praslin, qui ne voulait pas échapper cette occasion de combattre, fit avancer toute l’armée dès que la lune fut levée, et le lendemain, entre neuf ou dix heures du matin, elle se trouva près du village de Semide. Les Croates ne faisoient que d’en sortir sur l’avis qu’ils avaient eu de notre marche. Ils envoyèrent aussitôt au quartier général d’où l’on fit trois décharges de six coups de canon chacune, pour assembler les troupes.
L’armée du Roy allait droit aux quartiers de celle des ennemis pour se placer dans leur centre et les empêcher de se joindre. On les vit paraître sur des hauteurs encore éloignées de nous, marchant pour s’assembler et se mettant en bataille. M. de Praslin fit de son côté la même chose, de sorte que les deux armées marchèrent plus d’une lieue sur deux lignes parallèles assez proches l’une de l’autre.
Le maréchal de Praslin, qui voulait couper chemin aux ennemis, eut le dessein de gagner avec son aile droite la hauteur sur laquelle était la gauche des ennemis, pour de là la prendre en flanc. Mais comme la chose fut trouvée trop hasardeuse, et que les premiers escadrons n’eussent pu être soutenus, il s’arrêta et mit ses troupes en ordre de bataille.
L’aile droite de l’armée du Roy avait à sa première ligne quinze escadrons de cavalerie, et à leur tête les sieurs de Villequier et de Manicamp, avec le comte Du Plessis, maréchal de camp. Ils étaient soutenus à la deuxième ligne par les troupes allemandes, commandées par le maréchal de camp Fleckenstein. A la première ligne de l’aile gauche étaient les sieurs d’Hoquincourt et de Roze, lieutenants généraux, les sieurs de Navailles, Saint-Genier et de Courval, maréchaux de camp, avec dix escadrons de cavalerie française et quatre autres d’Allemands du corps du sieur Roze, lieutenant général. A chacune des ailes, étaient joints cinq cents mousquetaires, séparés en pelotons avec des officiers qui les commandaient.
La première ligne d’infanterie était composée de six bataillons, et la deuxième de cinq. Au milieu et entre ces deux lignes d’infanterie, on avait placé deux escadrons de gens d’armes du prince Thomas, des compagnies franches du maréchal Du Plessy et du marquis de Praslin et d’Igby. Le corps de réserve derrière cette deuxième ligne était formé par les escadrons de la Ferté-Maupas et Noirmoutier, et des deux bataillons des marquis de Montausier et de Courval.
Dès que cet ordre fut établi, M. de Praslin, qui craignait que M. de Turenne ne lui échappât, alla reconnaître le vallon qui séparait les deux armées. Il le trouva assez facile, hormis à l’endroit par où l’infanterie devait passer, et par conséquent plus avantageux pour nous parce qu’il était moins accessible à la cavalerie dont les ennemis avaient plus grand nombre que nous. Quantité de nos cavaliers étaient demeurés avec tous les bagages de l’armée de Rethel. On avait laissé derrière divers corps de cavalerie et d’infanterie, soit pour le siège de Château-Porcien, où l’on avait envoyé le sieur de Bougy, maréchal de camp, soit pour des escortes de vivres et des munitions de guerre. D’autres venaient de Reims à Rethel, mais ils ne pouvaient joindre l’armée qui s’était avancée et qu’ils croyaient occupée au siège.
On fut surpris que M. de Turenne eut quitté une hauteur qui lui était avantageuse, d’autant plus qu’il devait juger que nous allions à lui, et que M. de Praslin était allé reconnaître comment il pouvait l’attaquer. En même temps, il envoya avertir M. d’Hoquincourt que la situation de son aile gauche lui permettant de s’étendre plus que la droite des ennemis, il l’attaqua en flanc. Les ennemis ne soutinrent point de ce côté-là l’effort des nôtres, tout plia devant nos troupes. Cinq escadrons qui étaient dans un fond venaient nous prendre en flanc, M. d’Hoquincourt alla à eux, les chargea et les mit en fuite. Il gagna ensuite une hauteur sur la droite où les ennemis se ralliaient.
Un gros des ennemis allait tomber sur les escadrons de Roze, lieutenant général. Le sieur de Cossé, qui commandait la deuxième ligne et qui n’était point nécessaire à M. d’Hoquincourt qu’il devait également soutenir en cas de besoin, chargea ce gros, le rompit et le mit en fuite.
Le choc fut beaucoup plus rude et le combat plus opiniâtre à l’aile droite. La première ligne des ennemis joignit la nôtre et demeura quelque temps sans tirer, heurtant la tête des chevaux les unes contre les autres. On avait défendu aux nôtres de faire la première décharge, ils essuyèrent le feu des ennemis qui nous tuèrent un grand nombre d’officiers et de cavaliers. Le comte Du Plessis resta mort. Cette perte enflamma le courage du soldat qui poussa et rompit les ennemis.
Les escadrons les plus proches de notre infanterie, auprès desquels était M. de Praslin, soutinrent les plus grands efforts du combat, ils firent reculer d’abord la première ligne des ennemis. Mais la deuxième venant les appuyer, les nôtres plièrent et furent contraints de céder au nombre. On les rallia presque aussitôt. Les ennemis qui avaient eu l’avantage en cet endroit, n’osèrent entreprendre de les pousser plus avant.
Fleckenstein, avec les huit escadrons qui avaient ordre de soutenir ce qui venait de la deuxième ligne des ennemis, arriva si à propos, que chargeant ceux d’entre eux qui faisaient bonne contenance en cet endroit, il les contraignit à perdre leur terrain. Deux de leurs escadrons vinrent à eux et les rallièrent. Ils vinrent ensemble fondre sur notre infanterie qui se trouva pour la deuxième fois seule et sans être appuyée de cavalerie. Le corps de réserve qui avait déjà chargé était éloigné, elle parut cependant avec une résolution si ferme, que l’on ne craignit point que les ennemis la renversassent. Elle fit plusieurs mouvements à mesure qu’ils se présentaient pour l’enfoncer, attendant à tirer qu’ils fussent pour ainsi dire au bout du fusil.
Le maréchal Du Plessis-Praslin donnait ses ordres pour rallier derrière cette infanterie les escadrons qui étaient encore dans quelque désordre, après avoir chargé plusieurs fois. Le sieur de Villequier, qui avait rompu les ennemis à son aile droite, vint heureusement avec ce qu’il avait pu ramasser. Le sieur de Manicamp, tout blessé qu’il fut, nous renforça, et en cet état, l’on attaqua le corps de deux escadrons de cavalerie ennemie et de deux bataillons d’infanterie qui nous disputaient la victoire. Cette action fut vive, mais décisive.
A la tête des deux bataillons étaient quelques pièces de canon chargées à cartouches qui éclaircirent nos rangs. Le nombre en fut diminué, mais la valeur n’en souffrit point. La cavalerie, voyant que cet effort ne nous ébranlait point, prit la fuite. L’infanterie fit sa décharge, elle nous tua neuf officiers dans le seul bataillon de Montausier. On en fit ensuite un grand carnage, le reste demeura entre nos mains, et de cette sorte, nous achevâmes de demeurer maîtres du champ de bataille.
La cavalerie poursuivait les ennemis, M. de Praslin fit avancer toute l’infanterie pour la soutenir. On rallia tout ce qui s’était débandé contre les fuyards, et jusqu’à la nuit, on fit des prisonniers. De ce nombre fut un corps d’infanterie de plus de huit cents hommes, que le sieur de Cossé rencontra en même temps que le régiment de Ruvigny commençait à les attaquer.
On ne pouvait espérer de remporter une victoire plus complète. Tout le canon des ennemis consistant en huit pièces, toutes leurs munitions de guerre et une grande quantité de chariots chargés de leurs bagages restèrent entre nos mains. Ils perdirent dans cette mémorable journée toutes leurs timbales, vingt-quatre enseignes d’infanterie, parce que la plupart des régiments allemands n’en portent qu’une, et quatre-vingt-quatre étendards.
De quatre officiers généraux qui commandaient leur armée, don Estevan di Gamarra, commandant les troupes espagnoles et qui avait toute la direction de l’armée pour le roi d’Espagne, fut fait prisonnier, de même que le sieur Fauge, l’un des généraux de l’armée du duc Charles de Lorraine. Le comte de Ligniville fut blessé. Le maréchal de Turenne, qui craignait quelque fâcheux événement pour lui, se sauva du côté de Bar avec quarante chevaux avant la déroute entière de son armée.
Tous les colonels, tant de cavalerie que d’infanterie des ennemis qui étaient à cette bataille, ont été tués ou faits prisonniers, à la réserve des comtes de Bossut et Réens qui se sont sauvés. L’infanterie des ennemis était au nombre de trois mille cinq cents hommes, il n’en resta pas un seul qui ne fut tué ou pris. Deux mille trois cents des prisonniers que l’on fit sur eux entrèrent dans les corps d’Allemands, d’Irlandais et de Polonais de l’armée du Roy, outre deux mille deux cents autres tant cavaliers que fantassins que l’on gardait.
Le champ de bataille et le chemin par où ils se sauvoient étoient couverts de plus de deux mille morts, parmi lesquels était le prince palatin. Les partis de cavalerie que l’on avait détachés après les fuyards en tuèrent un grand nombre, les paysans ne leur faisaient point quartier. On avoit rompu les ponts de la rivière d’Aisne par où ils pouvaient se retirer, ainsi il n’en échappait presque aucun. On eut peine à retenir nos soldats qui voulaient ne point épargner les Français qu’ils trouvaient prisonniers avec les ennemis, les armes à la main contre leur patrie.
Cette victoire entraîna la réduction de Château-Porcien. Le sieur de Bougy somma la place qui se rendit à discrétion. La garnison de trois cents hommes qui y était prit parti dans nos troupes. Celles que les ennemis avaient mises aux châteaux des environs au-delà de la rivière d’Aisne, firent de même.
Ces garnisons assuraient leur communication jusqu’à Stenay. Ils en avaient à Olizy, Quatre-Champs, Quincourt, Busancy, Gaban, Charbonne, Beaumont, et en douze autres endroits desquels on les délogea. Les paysans que le sieur de Bougy avait commandés pour reprendre la plupart de ces châteaux, s’y portèrent avec autant d’ordre et de valeur que des troupes réglées. Ils s’avancèrent jusqu’au-dessous de Stenay, et taillèrent en pièces la garnison de Guincourt au nombre de cent cinquante hommes qui se sauvaient sans avoir fait de capitulation. Ceux de Busancy firent quelque résistance, après quoi ils se rendirent et entrèrent dans les troupes du Roy.
Entre les personnes de considération que nous perdîmes dans cette bataille, on comptait quatre maréchaux de camp tués sur la place, au nombre desquels était le comte Du Plessis, le général major Roze, frère du lieutenant général, le colonel Bens et le vicomte de l’Hôpital.
Les sieurs de Rabutin, d’Andrecy et de Miremont, gentilshommes du pays de Reims, s’y distinguèrent par leur valeur, aussi bien que les sieurs Chertemps de Bergerie, lieutenant de Picardie, Colbert, enseigne dans le même régiment, qui commandaient chacun un des pelotons de mousquetaires dont nous avons parlé. Ils étaient originaires de Reims, de même que le sieur Petit de Hartebize, cornette de cavalerie, qui eut part à cette action glorieuse.
Le sieur d’Apremont commandait dans Rethel lorsqu’il fut pris. On le soupçonna d’intelligence avec les ennemis. Sa terre de Balan fut conservée pendant qu’ils mettaient tout au pillage. Il se retira à Reims, où deux cents cavaliers l’escortèrent, suivant l’un des articles de sa capitulation. Il y eut mille reproches à essuyer.
Au fil des mots et de l’histoire